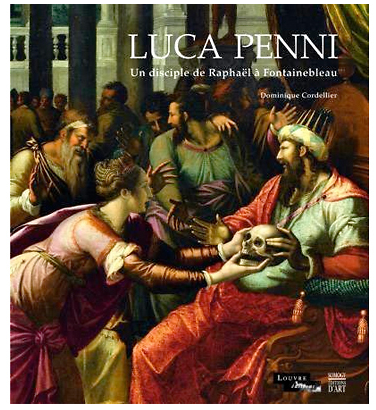Ils sont quatre, couvertures usées et coins émoussés. Quatre carnets. Les reliques d’une jeunesse, celle, très vécue, d’Antoine Jean Gros… En 1848, Delacroix paya ses dettes envers le chantre de la geste napoléonienne, le premier «moderne» de l’art français, et l’accoucheur du romantisme. Les comptes étaient bons. Côté carnets, en revanche, les chiffres pleurent. A la mort de Gros, qui se suicide en 1835, on inventoria 24 de ces musées portatifs où s’était entassé notamment le trésor des années italiennes… C’était son butin, parallèle à celui qu’il avait contribué à constituer au gré des victoires du jeune Aigle en péninsule. Les fanatiques de Gros, j’en suis, n’ont pas renoncé à l’espoir de voir resurgir les carnets manquants. Les quatre qu’abrite le Louvre viennent d’être publiés par Laura Angelucci, accompagnés des feuilles que le musée a acquises depuis la vente après décès du peintre. L’ensemble, qu’une exposition célèbre, impressionne, surprend, émeut. Car il n’est pas, au sein des davidiens affranchis, d’artiste plus « sensible » et moins maître de ses humeurs noires. A 22 ans, après avoir frôlé le Prix de Rome, Gros quitte le Paris de la Terreur et de la conscription. David a le bras long : ce Jacobin opportuniste est une mère pour ses élèves. Nous sommes en janvier 1793, la décapitation sordide de Louis XVI n’a que 10 jours lorsque Gros file vers l’Italie. Les Français n’y sont pas bien reçus partout. Le républicain Gros croyait fuir les dangers de la politique et les appels de la guerre, ils le poursuivent jusqu’à la divine rencontre de Gênes : le 27 novembre 1796, Joséphine, qui s’était rapprochée de son victorieux général, est présentée à ce Français encore incertain de son génie et de sa route. Coup de foudre : « Je vous emmène à Milan, je vous emmène partout », lui promet la future impératrice. Elle tiendra parole.

Séduit à son tour, Bonaparte lui commande son portrait au pont d’Arcole, sublime contrefaçon de l’histoire, et l’enrôle dans la Commission des arts, qui collecte les chefs-d’œuvre dont les traités de guerre dépouillent l’Italie. Gros prend à cœur sa mission, peint moins, mais bourre ses carnets de copies de toutes sortes. L’antique requiert le davidien, mais ses choix disent un besoin de rupture, qu’il partage avec son ami Girodet. Gros, déjà porté aux excès, Eros et pathos, a le don de les dénicher au cœur des sarcophages et de la statuaire où d’autres ne retiennent que leçons froides et freins à l’expression. Ses carnets, où les femmes ne sont pas de marbre non plus, brûlent ailleurs du feu des Anglais excentriques, Füssli en premier lieu, auxquels la gravure lui donne accès. Le futur peintre de la crépusculaire, de la suggestive Sapho de 1801, perce déjà et Laura Angelucci, grâce à son superbe travail d’identification des sources, confirme les penchants d’un l’artiste qui balance entre fièvre et angoisse, ardeur et dépression. La trahison politique, la déchirure familiale, le désir érotique insatisfait, le deuil impossible, la mort rampante, l’attrait pour Dante, Shakespeare et Young, autant de signes. La chance de sa peinture de propagande, qu’on pense à Jaffa et Eylau, sera d’y importer bientôt ce venin noir, plaisir et douleur. La politique en est aussi faite. Rien ne s’oppose, selon moi, à ce que le dessin sublime d’Alexandre domptant Bucéphale, don récent de la Société des amis du Louvre, ne métaphorise Bonaparte faisant plier l’Italie. Mais c’est aussi Gros lui-même, graine de suicidé, enfourchant ses démons, qu’on y devine. A sa mère, en novembre 1798, il dit son amertume de n’avoir pu suivre son héros en Egypte, trouver du neuf là-bas : « Les autres auraient peint l’ancien Alexandre, moi le nouveau, les mamelouks, les chevaux arabes… ». Stéphane Guégan
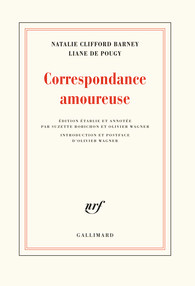
Laura Angelucci, Inventaire général des dessins. Ecole française. Antoine Jean Gros (1771-1835), Louvre éditions / Mare et Martin, 89€. L’exposition du Louvre se prolonge jusqu’au 30 septembre. J’ai évalué le Salon de 1801, véritable « orgie noire » où furent présentés Bonaparte au pont d’Arcole et Sapho, dans le catalogue de la mémorable exposition de Jean Clair, Mélancolie, non référencé par Laura Angelucci, laquelle se montre un peu trop retenue dans ses analyses. Sapho, Lesbos, restons-y mais changeons de siècle en parcourant plus vite qu’il ne faudrait la Correspondance amoureuse de Natalie Clifford Barney et Liane de Pougy (Gallimard, 24€). Olivier Wagner, son éditeur avec Suzette Robichon, éclaire le destin de ces lettres fusionnelles et nous dit tout de ce couple qui faisait des désirs interdits une obligation à satisfaire par tous les moyens, les plus singuliers étant préférables aux trop réguliers : la milliardaire et la courtisane, en suffragettes des boudoirs et des écritoires impudiques, inventèrent une autre forme de féminisme que le refus du sexe par désaliénation vertueuse. Liane, prénom de fiction bien assorti, fit même des ravages parmi les hommes que Natalie ne souffrait pas, sauf à les singer en page androgyne. Leur saphisme 1900 baigne dans une atmosphère plus proche de Chéret et Whistler que de mon cher Lautrec, la révérence à Oscar Wilde mise à part. Car ces insatiables gourmandes en chambre sont des lectrices et presque des écrivaines. Dans l’effroi de l’absence ou de la distance, elles s’accablent de tendresses et de formules à double entente. Et la littérature qu’elles chérissent et citent démultiplie un peu plus leur impatience à se retrouver. Tout y passe, Musset, Gautier, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Péladan, Rodenbach, D’Annunzio… Les mots les grisent car ils sont promesses d’action. La Seraphîta de Balzac, où se concentre le mépris des tièdes, sert de viatique et de moteur à leurs audaces. Après la flambée des années 1899-1900, il y aura les reprises de feu, la cruauté aidant, puis la séparation et, pour Liane, le retour au Christ. « Dans ce monde-là, disait-elle, c’est l’adoration ou la haine ». SG