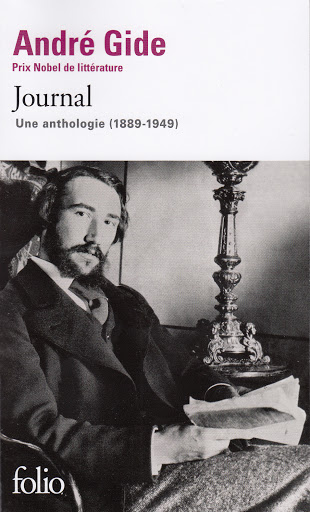Le 15 mai 1855, Théophile Gautier écrivait à Ernesta Grisi, la mère de ses filles et la confidente de ses humeurs : « Demain mercredi la chose ouvre et j’irai faire mon article. » La chose ? Tout simplement l’exposition des Beaux-Arts, qui remplaçait et amplifiait le Salon annuel au cœur d’une « chose » plus grande encore, l’Exposition universelle. Si la désinvolture de Gautier n’annonce guère le sérieux de son compte rendu, elle devrait inciter les historiens à mieux dégager l’ironie et le « double meaning » des soixante-trois feuilletons que le critique donnerait au Moniteur universel. L’ex-Jeune France choisit donc de rejoindre définitivement le quotidien de l’Empire à cette occasion. En mettant fin à vingt ans de collaboration avec La Presse, il ne faisait pas que des heureux. Et Émile de Girardin, se sentant trahi, lui adressa aussitôt des mots amers tout en suggérant que son ancien poulain avait marchandé son transfert et obtenu la place d’Inspecteur des Beaux-Arts que Louis-Philippe et la République de 48 avaient oublié de lui offrir. Coup bas, mais gratuit. C’était la nécessité et l’assurance d’être mieux payé, et non quelque conversion au bonapartisme, qui avaient poussé Gautier à sauter le pas. Mais il lui en coûtait de se soumettre plus directement à la censure impériale. Pour conserver le peu d’indépendance que permettait le décret du 17 février 1852, il faudrait ruser de plus en plus. L’ancien gilet rouge passe déjà pour le valet de l’Empire. Jugement excessif, et qui s’est perpétué jusqu’à une date récente dans les manuels scolaires et la littérature de vulgarisation. C’est ignorer la polyphonie du journalisme de Gautier et la marge de manœuvre du Moniteur. Un éditeur à l’époque, et l’un des plus grands, Michel Lévy a immédiatement saisi la valeur du « livre » qui s’écrivait chaque semaine ; dès juillet, il décida de publier les articles de Gautier sur l’exposition de 1855 et de les rassembler sous le titre, si juste, des Beaux-Arts en Europe. Les deux volumes de 300 pages chacun paraîtraient dès décembre pour profiter de l’effervescence provoquée par l’Exposition universelle. Il s’agissait bien d’une date mémorable, comme l’écrit Marie-Hélène Girard, à la suite d’Henri Jouin. Sans doute n’en mesurons-nous plus la raison ni la portée comme il siérait. Marie-Hélène Girard, qui signe la première édition critique du texte de Gautier, invite à le relire dans la lumière précise de l’événement qu’il tentait d’embrasser. Le résultat impressionne : riche d’une annotation confondante et de perspectives neuves, cet ouvrage comptant près de 900 pages comprend même un cahier d’images.

Il s’ouvre sur une ample introduction qui situe les enjeux du moment et redresse les idées fausses colportées par l’histoire de l’art des années 1980, trop manichéenne pour comprendre le second Empire et son impact sur la vie des arts. Alors que toute l’Europe a les yeux rivés sur la mer Noire, Napoléon III multiplie les signes du redressement national qu’il a promis aux Français dès décembre 1848. On ne saurait dissocier l’Exposition universelle de cette politique conquérante qui, justifiée d’abord, finirait par perdre le régime. Patriotisme fiévreux, en raison de la guerre de Crimée, et foi dans le progrès technique, c’est bien la note des discours officiels en 1855. Dans l’immense palais de l’Industrie, édifié le long des Champs-Élysées, vingt mille exposants chantent les vertus du progrès et de la prospérité comme un seul homme. Et l’ensemble est soufflant, moderne. Côté art, cinq mille œuvres de toutes provenances sont en compétition. Napoléon III adresse au reste du monde un message de puissance comme il les aime. Il sait, par ailleurs, que la suprématie artistique de la France est un atout à ne pas négliger pour faire de son exposition un moment inoubliable, supérieur à ce qu’avait été le précédent londonien de 1851. C’est une grande idée, comme Gautier le reconnaîtra en toute sincérité, que d’avoir rendu possible la première rencontre des artistes européens. L’empereur et son entourage croient aux vertus de la compétition ouverte et, si l’on ose dire, aux retombées du libre échange. Si la Russie s’absente en raison de la guerre de Crimée, le reste de l’Europe envoie une représentation proportionnée à sa situation artistique. Mis en part quelques défections importantes, pour raison politique (Scheffer, David d’Angers, etc.) ou stratégique (Delaroche, Préault, etc.), l’ensemble a plus que belle allure. Les cinq mille œuvres rassemblées, malgré un certain entassement, fixent une géographie assez juste de la création contemporaine. La sélection française ne se réduit pas au triomphe de l’éclectisme officiel que Patricia Mainardi a vu en elle. En fait d’éclectisme, Gautier préconise moins la tiédeur du juste-milieu que le bonheur de la diversité : la France, écrit-il, « possède dans son art tous les climats et tous les tempéraments ». De même, comme y insiste Marie-Hélène Girard, son jugement n’est-il en rien inféodé à quelques directives d’en haut. Le rédacteur du Moniteur ne se prive pas d’émettre des réserves à propos d’artistes ou d’œuvres que le régime faisait travailler ou couvrait de récompenses. Bien malin, du reste, celui qui définirait le « style officiel » du second Empire. Marie-Hélène Girard s’intéresse plus aux divisions qui régnaient parmi les hauts commis de l’Etat…
Elle montre aussi le profit qu’en tire Gautier pour faire prévaloir au mieux son indépendance critique. À l’évidence, l’exposition lui permet de dresser un bilan du romantisme dont il avait été l’un des militants dès la fin des années 1820. Elle lui permet de redire sa méfiance à l’égard du réalisme, dont il condamne toutefois moins la prétendue objectivité que les limites d’une rhétorique de l’excès qui ne dirait pas son nom. Préférant ranger Gautier parmi les indécrottables contempteurs de Courbet, l’histoire de l’art n’a pas saisi ce subtil distinguo et ce que signifie le « maniérisme du laid » dont il affuble certains tableaux, pas tous, du « maître d’Ornans ». Courbet n’aurait-il jamais cédé à l’exagération et au poncif rustique par provocation de faux paysan ? Gautier fut l’un des premiers avec Baudelaire à le sentir et à l’exprimer avec drôlerie. De plus, Courbet reste frileux à l’égard de la représentation de la vie urbaine ; il n’est pas, pas encore, pleinement moderne. C’est sur ce point crucial que je me séparerais des analyses de Marie-Hélène Girard. La première valeur du texte de Gautier, en 1855, est plus positive que négative. Elle ne tient pas à ce qu’il regrette, le romantisme de 1830, ou rejette, le réalisme de 1850. Gautier voit plus loin. Et Napoléon III, par le concours des nations qu’il a voulu, aura contribué à cette ouverture de champ. What next ? Telle est la question que se pose Gautier depuis le Salon de 1852. D’autres autour de lui, Baudelaire, les frères Goncourt, s’interrogent pareillement. L’histoire de l’art étant une grande paresseuse, elle n’a jamais perçu en quoi Gautier prépare en 1855 les deux articles que Baudelaire allait donner au Figaro huit ans plus tard. Ce « peintre de la vie moderne », Gautier le cherche et le trouve, fût-ce incomplètement, à maints détours de l’Exposition universelle. Ne cherchons pas plus loin la vraie raison qui le poussa à donner tant d’importance aux peintres anglais. L’heure, certes, était au rapprochement avec l’extraordinaire reine Victoria ; mais, s’agissant de Gautier, la politique n’explique jamais tout. La préséance est une chose, le nombre des articles qu’il consacra à la section britannique dépasse largement les courbettes protocolaires. Le coup de foudre fut indéniable, total, rafraîchissant, comme on dit outre-Manche. Chez les jeunes Anglais, peu d’historicisme à l’allemande, mais des sujets modernes, la vie de tous les jours, ou la vraie littérature traitée de façon « actuelle ». N’attribue-t-il pas la palme du « singulier » aux trois tableaux de John Everett Millais et le prix du « bizarre » à son Ophélie, si troublante en sa sensuelle agonie ? Après sept ans d’opprobre, les préraphaélites décrochaient la timbale à Paris.
On pourrait, d’un autre côté, multiplier les citations à l’appui de cette quête de nouveauté, de modernité, qui donne au texte de 1855 son centre de gravité le plus intéressant et le plus riche d’avenir : « Les caractères distinctifs de l’Angleterre sont une originalité franche, une forte saveur locale ; […] c’est un art particulier, raffiné jusqu’à la manière, bizarre jusqu’à la chinoiserie, mais toujours aristocratique et gentleman, d’une élégance mondaine et d’une grâce fashionable […]. L’antiquité n’a rien à y voir. Un tableau anglais est moderne comme un roman de Balzac. » Même adéquation aux temps présents si l’on considère, avec Gautier, la question des formats : « L’école anglaise […] ne compte qu’un petit nombre de tableaux d’histoire ; elle aborde rarement les grandes toiles, et la raison en est simple : avec un rare sens pratique, les peintres d’outre-Manche ont compris que l’art devait se proportionner aux milieux qu’il traverse : la vie moderne tend à se concentrer dans les villes [on lit « villas » dans la présente édition !], où l’espace devient de jour en jour plus précieux par suite de l’agglomération et l’alvéole accordée à chaque abeille humaine dans l’immense ruche de la civilisation, réduite aux dernières exiguïtés, ne peut guère admettre que le tableau de chevalet ou la statuette. – En Angleterre, il n’y a pas, comme en France, une direction des beaux-arts commandant de vastes travaux pour les palais, les musées, les églises, les édifices publics, et perpétuant ainsi les grandes traditions […]. » La très ancienne méfiance de Gautier à l’égard des « tartines officielles » et d’une politique des arts trop distributive s’exprime ici avec un sens merveilleux du contournement. Bref, il n’y pas en Angleterre d’équivalent, ou si peu, à ces tableaux payés au mètre et « que nul particulier ne saurait acheter ». Leur peinture d’histoire est affaire de style, d’invention et non de sujet ni de taille. Heureux pays, pense Gautier, sans réserve aucune. Heureux homme, tout autant, qui jouit enfin de la vue des tableaux, de leur coloris si peu orthodoxe, et que la gravure est impuissante à rendre. Le déficit criant de l’estampe est bien noté, qui avait privé les amateurs de ces « associations de couleurs impossibles, des gammes de notes fausses, des illuminations de reflets fantasques […]. » Il y a quelque chose de rimbaldien dans le cri de joie que lui arrachent les tableaux de Mulready ou de Francis Grant. À lire son commentaire du Rendez-vous d’Ascot, équipage de Sa Majesté pour la chasse au cerf, on pense au profit que Manet et James Tissot allaient faire du texte de Gautier, qu’ils lurent évidemment : « Il est si difficile de concilier les exigences de la fashion avec celles de la peinture. »
Les peintres français n’ont pas tous apprécié que Gautier se soit autant « attardé » sur le génie de l’école anglaise. Le journal de Delacroix, le 17 juin, enregistre les réserves du peintre à l’endroit d’un critique dont il n’avait pourtant pas à se plaindre. N’empêche, le vieux lion, dont la main et l’inspiration ont bien baissé, déplore que Gautier ne fasse « pas véritablement œuvre de critique ». Voilà une manière bien narcissique de reconnaître qu’il appartient au passé et Gautier au présent. La correspondance de Delacroix peut se lire autrement, non ? Quel aveu, par exemple, que cette autre lettre, adressée au « critique » après avoir lu le premier des articles qu’il lui consacrait enfin : « Mon cher Gautier, […] J’ai rencontré hier soir une femme que je n’avais pas vue depuis dix ans et qui m’a assuré qu’en entendant lire une partie de votre article, elle avait cru que j’étais mort, pensant qu’on ne louait ainsi que les gens morts et enterrés. » Tout est dit, n’est-ce pas ? Parlant de l’espèce de rétrospective que le second Empire avait accordée en 1855, Gautier fut à la fois dithyrambique et restrictif : la Liberté sur les barricades ne formait-elle pas « un morceau unique dans l’œuvre du peintre, qui, cette fois seulement, aborda le costume moderne » ? Ingres, auquel une salle entière était attribuée, fait aussi l’objet d’un commentaire plein de sous-entendus et de connotations funéraires. Je ne dirais donc pas, avec Marie-Hélène Girard, que l’ingrisme représente pour Gautier le dernier mot de l’art « moderne » en 1855. Il y a une évidente emphase dans sa façon de porter en triomphe le vieil Ingres. Noble vie et noble peinture : Gautier sait d’expérience que le peintre du Bain turc ne ressemble guère à son panégyrique. Et il aime moins en lui le supposé continuateur de Raphaël que l’homme qui a perverti l’idéalisme du XVIe siècle sans retour possible. Ce que Gautier préfère à tout, d’ailleurs, c’est sentir « la grande dame moderne » au contact du Portrait de la comtesse d’Haussonville… Le reste des Beaux-Arts en Europe est à l’avenant. On pourrait s’attarder sur ce qu’il dit de Gérôme, de Couture (le passage sur l’Orgie parisienne de ce dernier a dû terriblement intéresser son élève Manet), du Vive l’empereur de Muller (« Être de son temps, […], voilà certes une entreprise hardie ! »), de Vernet (« M. Horace Vernet aura cette gloire d’avoir été de son époque, lorsque tant d’artistes d’un mérite supérieur, peut-être, se renfermaient dans la sphère de l’idéal et n’en descendaient pas. »), du tout jeune Doré, alors réaliste peintre de bataille (le musée de Versailles ferait bien de retrouver sa Bataille de l’Alma), etc. L’appel du et au moderne éclate partout avec l’insistance des slogans d’avenir. Stéphane Guégan
Théophile Gautier, Œuvres complètes. Critique d’art. Tome IV. Les Beaux-Arts en Europe – 1855, texte établi et annoté par Marie-Hélène Girard, Paris, Honoré Champion, 185 €. J’ai consacré à la diversité de la peinture française du second Empire bien des pages de Peinture. Musée d’Orsay, Flammarion, 2011.

Signalons chez le même éditeur la parution d’un autre volume des Œuvres complètes de Gautier, le tome IV de la critique théâtrale (1 096 p., 190 €), qui bénéficie de l’érudition infaillible et de l’esprit caustique de Patrick Berthier. Les années couvertes (1843-août 1844) sont riches en événements et reprises notables, Les Burgraves d’Hugo (je ne dirais pas que Gautier n’en propose qu’une « réécriture admirative », son article est plus grinçant), Lucrèce de Ponsard, Judith de Delphine de Girardin avec Rachel dans le rôle titre, etc. Mais l’intérêt de la publication intégrale et annotée du feuilleton dramatique de Gautier, outre sa verve sublime, c’est de nous confronter à une matière vierge encore du tri que l’histoire va y opérer. Notre regard, notre culture est tellement tributaire des œuvres effacées et des noms oubliés qu’il est hygiénique de replonger, de temps à autre, dans le grand journalisme du XIXe siècle. Gautier nous donne envie de relire les mélos de son ami Bouchardy et surtout les drames légers de Léon Gozlan, l’une des grandes victimes de l’amnésie historienne. Au moment où la scène parisienne se montrait si réticente à monter Balzac sans le défigurer (Pamela Giraud en 1843), l’un de ses meilleurs disciples triomphait à la Comédie Française. La complicité étroite qui liait Gautier à l’auteur de Vautrin se vérifie à la lecture du deuxième volume de la Correspondance de Balzac (édition de Roger Pierrot et Hervé Yon, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 62,50 €), lettres envoyées et reçues. C’est la vraie vie, mêlée, confuse, tendue, du romantisme qui s’y peint sans afféterie. C’est donc plein de ces « détails libres » que la direction de La Presse signalait à l’écrivain comme gênant certains des lecteurs… Or à cette époque Gautier dirigeait le feuilleton du journal de Girardin. On imagine les difficultés qui en découlèrent régulièrement. Leur amitié en sortit renforcée et elle se prolongerait jusqu’à la mort précoce de Balzac. Les années 1836-1841, cruciales dans la cristallisation du projet de la Comédie humaine, marquent une accélération infernale du rythme de travail (violent « coup de sang » après l’écriture des premiers feuillets du génial Illusions perdues, pour lequel Gautier écrit La Tulipe, que le livre attribue à Rubempré). La correspondance croise aussi les peintres et les sculpteurs qui se disputent le privilège de fixer les traits du forçat de lettres modernes. Lui s’amusait à mêler le nom de ses proches à ses fictions. En août 1839, il dédia à Gautier Les Secrets de la princesse de Cadignan, merveilleuse histoire d’une passion ultime, où Marcel Proust voyait l’un des bijoux du Paris interlope que Balzac avait radiographié avant lui.
Je ne voudrais pas quitter ce cher Théophile sans avoir annoncé que mon Gautier (Gallimard, 2011) vient de se voir décerner le Prix François-Victor Noury par l’Académie française. Voilà une couronne sans épines, qui n’aurait pas déplu à Théophile. Je remercie vivement les Immortels du quai Conti de lui avoir fait une place parmi eux, il en rêvait depuis longtemps. Le Prix François-Victor Noury vise « à encourager le développement de la culture, de la science et de l’art français dans leurs manifestations les plus diverses ». Gautier, acteur et témoin d’un des âges d’or de notre pays, incarna un temps cette multiplicité heureuse.