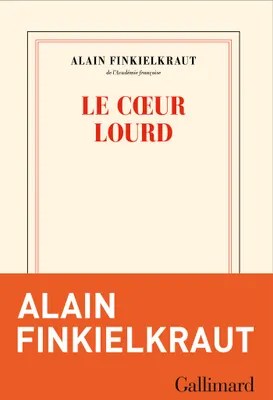
Ils appartiennent tous deux à la classe 69, et virent donc la lumière en 1949, sous Vincent Auriol, l’année du procès Kravchenko, du transfert des cendres de Victor Schœlcher au Panthéon, de la rétrospective Matisse du musée d’art moderne (époque Chaillot et Jean Cassou), du Silence de la mer de Jean-Pierre Melville et du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Le festival de Cannes connaît lui sa troisième édition alors, et le plan Marshall n’en finit pas d’étendre sur l’Europe de l’après-guerre sa domination réparatrice. Millésime intéressant que 49, à songer aux parcours d’Alain Finkielkraut et Franz-Olivier Giesbert. Dans le sillage de ses livres d’entretien, que Robert Kopp a eu la bonne idée de réunir (Bouquins, 2024), le premier s’est confié à Vincent Trémolet de Villers. Quand on a le cœur lourd ou le cœur gros, disaient les anciens et les curés d’antan, la parole est libératrice. A cette maïeutique, le lecteur trouve son compte si l’état du monde et, soyons clair, le destin de la France sont de ses soucis. Quitte à parler, autant ne pas se payer de mots, autant aller au but, formule ad hoc, puisque Finkielkraut est amateur du ballon rond. Il y eut Notre jeunesse de Péguy, un des livres qui ne le quittent jamais longtemps, il y eut Jeunesse de Pierre Nora, voilà la sienne, regardée d’aujourd’hui. Le retour en arrière conditionne l’état des lieux, le personnel le général. Différent de l’intimisme du diariste, le recul de l’inventaire donne au livre sa juste mesure, tendre et émue ici, nostalgique là, jamais passéiste. Le jeu préféré des journalistes, on le sait, est d’accuser Finkie du contraire. Chacun son sport. Le « monde d’hier » et sa barbarie inaperçue le couperaient du présent et de ses vertueux combats. Il est vrai que les raisons de se réjouir sont indéniables, du déclin des humanités à la défiguration de la langue, de la situation des arts à la faillite du champ politique, de la décomposition sociale aux poussées communautaristes, du paysage souillé au patrimoine désacralisé. Juif polonais, né en plein Paris populaire, dans une famille meurtrie par la Shoah et éloignée de la religion (en dehors de certaines fêtes), mais fidèle à ses origines (doublement enracinée, dirait Simone Weil), Finkielkraut, naturalisé français à un an, n’est pas un vrai penseur de « l’appartenance » pour rien. Cette notion controversée, il l’a dit et redit, ne doit pas être confondue avec le droit du sol, elle se définit plutôt par l’attachement sentimental et culturel au territoire où l’on décide de vivre, et à la société dont on se fait devoir de respecter les valeurs. Français, on le devient, en somme. L’exil volontaire de Levinas, de Cioran et de Kundera, fiers de rejoindre la patrie de la littérature et d’épouser sa langue, a trouvé sa véritable résonance lorsque Finkielkraut a vu « la France se dépouiller rageusement d’elle-même ». Faut-il consentir à voir se défaire ce qui prit deux mille ans à se construire au rythme effréné d’un processus d’autodestruction devenu incontrôlable ? Faut-il accepter que l’orthodoxie de la bienpensance, en plus de l’exercer, revendique publiquement les bienfaits de la censure ?

Chaque samedi matin, à l’écoute de Répliques, on se demande comment cette émission vieille de quarante ans résiste au « rappel à l’ordre », pour citer un livre de 2002, qui n’avait pas trouvé mieux que de détourner Jean Cocteau à des fins inquisitoires. La France des années 1920 a souffert du régime de violence hérité des tranchées, celle des années 2020 subit une forme de haine à plusieurs fronts, alimentée par l’impérialisme d’un autre âge, le renouveau du pogromisme et le retour du manichéisme. Le Cœur lourd tient courageusement tête à cette hydre d’un genre nouveau, qui fait d’un mal un bien, et préfère le déni à l’évidence. Que Franz-Olivier Giesbert ait aussi « le courage de ses opinions », comme on disait au XXe siècle, la chose est notoire. Tout Américain qu’il soit par son lieu de naissance et son GI de père – un des rescapés de l’enfer d’Omaha Beach, respect ! – il a du viking la flamberge facile et l’humour dévastateur. Au ton aigre-doux de son livre se devinent l’orphelin d’une « certaine idée de la France », la disparition d’une classe politique qu’il a connue mieux que personne et la perte plus douloureuse d’une culture encore capable de concilier les Français, de toutes origines, de haut en bas, autour de son amour des mots et du désir qu’ils inspiraient de les protéger. Joe Dassin pouvait faire rimer « été indien » et « Marie Laurencin » – transformée en Marie-Laurence par l’Internet de la déculturation – la rumeur publique ne l’envoyait pas au piloris pour élitisme et mépris de classe. Innocents, nous nous régalions de Sardou, de Nino Ferrer et de ce génie d’Aznavourian (c’est ainsi que ma grand-mère l’appelait) sans imaginer ce que leur coûtait le perfectionnisme des maisons de disques. FOG lui les a vus à l’œuvre, penchés sur la feuille blanche, épris de cet absolu qu’ils avaient la délicatesse de ne pas afficher. Ce Voyage dans la France d’avant se laisse porter par les chansons, la cuisine régionale, le souvenir des villes que la grande distribution n’avait pas encore vidées de la boulangerie, des cafés et du vendeur de journaux. Le désert culturel, que les hommes à calculettes n’associent qu’au nombre des musées et des salles de théâtre par habitant, commence là, la déliaison sociale et politique aussi. Une fois lancée, ce fléau grossira de plus en plus vite au sortir des Trente glorieuses, condamnant à plus ou moins brève échéance le monde des campagnes et le tissu industriel à son sort actuel. « Le pessimisme, cause de découragement pour les uns, est un principe d’action pour les autres », écrivait le Jacques Bainville d’Heur et malheur des Français en 1924. L’historien proche de l’AF, qui savait son peuple « composé », a nourri, semble-t-il, les idées que Giesbert défend en matière d’immigration et d’intégration. Avant de le crucifier au nom de la lutte contre « la réacosphère » ou, pire, « la faschosphère », on lira les pages informées qu’il consacre à Zidane, père et fils, comme à tous ces « enfants de la diversité » qui ont choisi d’être français sans renier leurs origines, ni céder aux sirènes et pièges de la racisation. Le droit n’est pas une politique, ici comme ailleurs, écrivait Guillaume Larrivé en 2024. La fatalité de l’échec, non plus, clame un FOG, échaudé par l’histoire de France, mais rétif aux capitulards. Stéphane Guégan
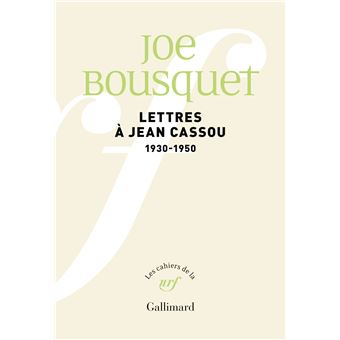
*Alain Finkielkraut, de l’Académie française, Le Cœur lourd. Conversation avec Vincent Trémolet de Villers, Gallimard, 18,50€ / Frantz-Olivier Giesbert, Voyage dans la France d’avant, 23€ / Le surréalisme, auquel Joe Bousquet avait adhéré à sa façon, puis l’Occupation, où Jean Cassou s’exposa aux pires dangers, aurait pu mettre fin à la relation que les deux hommes, pour des raisons éditoriales et une admiration réciproque, nouèrent au printemps 1930. Quoique classe 17 l’un et l’autre, seul le premier a connu le feu et, le corps déchiré à maintes reprises, s’est couvert de gloire. Cassou, qui a bénéficié de plusieurs reports d’incorporation, fera une carrière littéraire plus rapide que le « poète alité » de Carcassonne. En 1929, alors que l’administration des arts l’appelle déjà, il égratigne L’Amour de la poésie (N.R.F.) de Paul Eluard et lui reproche avec tact son afféterie et même sa coquetterie. L’intéressé n’apprécia qu’à moitié cette recension à double entente. Mais Bousquet refusa de brûler Cassou sur l’autel insatiable de ses « amis » surréalistes. D’où cette centaine de lettres, la plupart inédites, qui ruissellent de leur amitié intense, des échos multiples de la République des lettres et des rumeurs de l’époque, de la guerre d’Espagne (Cassou, membre du cabinet de Jean Zay en 36, se désespère de la non-intervention) aux réseaux de la résistance. Relisons cette lettre de Bousquet à Cassou, nous sommes en 1938, et les circonstances inquiètent l’ancien combattant : « Hier soir, j’écoutais à la T.S.F. les hurlements d’Hitler. Ces hommes-là, s’ils se battent, sont perdus, parce que l’enthousiasme n’est pas un état d’âme de guerrier et que leur exaspération les marque pour la mort. Mais à quel prix ? Tu sens moins que moi, sans doute, l’horreur où nous entrons, parce que tu viens de mettre ton courage à l’épreuve, tu as vécu en Espagne de ces instants qui attendent nos amis. Et moi j’ai honte de vivre. J’ai l’impression bizarre et barbare qu’il aurait fallu achever tous les mutilés pour empêcher la guerre de revenir. Ne m’en veux pas trop de me montrer si défait. Je me sens au-dessous de tout. Je m’efforce en vain de travailler. Ah ! mais si la guerre n’éclate pas : quel engagement je contracte d’aimer enfin ma vie et de l’aimer pour elle, moi qui suis sûr de ne pouvoir l’aimer pour moi. » La guerre éclata, Bousquet cloué à son lit en fut le témoin doublement humilié. Quant à Cassou, démis des fonctions qu’il occupait au musée d’Art moderne en septembre 1940, il se jeta dans la résistance, d’abord à Paris. Le réseau du musée de l’Homme, une centaine de membres, comptait parmi eux Jean Paulhan, le patron de la NRF auquel Cassou avait donné maintes chroniques et dont Bousquet deviendrait très proche en dépit de l’hypothèque surréaliste. Leur correspondance, confiée à Paul Giro, se prépare aux éditions Claire Paulhan. Cassou porta très vite le combat dans le Sud-Ouest, où il fut emprisonné. Qui n’a pas lu ses Trente-trois sonnets composés au secret ? La Libération le rétablit au musée d’Art moderne, qu’il dirigea de main de maître. Il aura entretemps croisé le fer avec Paulhan au sujet des comités d’épuration, Paulhan opposa à leurs excès « le droit à l’erreur », qu’il distinguait du « droit à l’innocence ». Mais certains communistes, comme l’a rappelé Franz-Olivier Giesbert, avaient tant de choses à faire oublier. Pardonner ? On lava dans le sang le pacte germano-soviétique. SG /Joe Bousquet, Lettres à Jean Cassou 1930-1950, édition établie par Dominique Bara et Hubert Chiffoleau, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 25€. Au sujet de la remarquable (et primée) biographie que Paul Giro consacre, en trois temps, à Joe Bousquet, voir ma recension, « La mort dans la vie », Revue des deux mondes, juillet-août 2025.