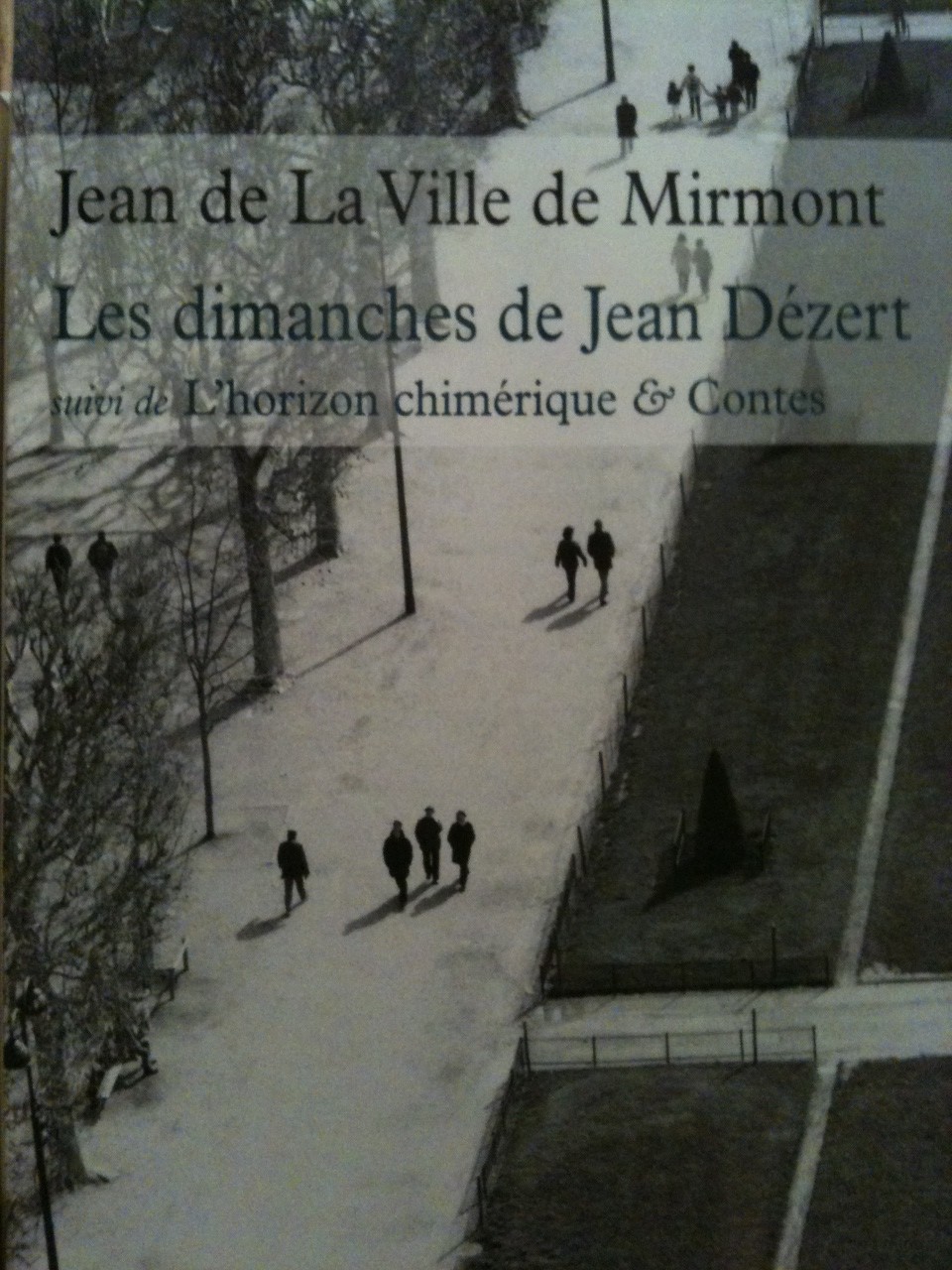Picasso décida très tôt d’éprouver sa fuyante substance ontologique, ce qu’on appelle son moi, à travers les aléas du désir et d’une multiplicité stylistique que le formalisme a vidé de son sens par myopie. L’exposition du Courtauld, à l’inverse, nous ouvre les yeux sur la différence qu’il importe de maintenir entre la supposée vérité des êtres et leur impatience à s’assigner un destin. Becoming Picasso, devenir Picasso, qu’est-ce à dire ? Le titre que Barnaby Wright a donné à son exposition résonne de toutes les interrogations que l’histoire de l’art actuelle fait miroiter autour de l’artiste, de son nom, de la légende et du sens qu’il lui attacha dès son expérience parisienne inaugurale. En 1901, Picasso signe pour la première fois ses tableaux du nom de sa mère. On y verra moins l’aveu de sa part de féminité, tarte à la crème de notre époque écrasée de « politiquement correct », que le premier masque d’un homme qui chérissait la culture du secret et les arlequinades. Elles résistent aux explications biographiques brutales, qu’on se penche sur la vie sexuelle de l’artiste ou sa fulgurante carrière, qui ne serait que la traduction de la première dans le domaine pictural et la réussite financière. Picasso est toujours au-delà des coups de force dont son parcours est émaillé. Assurément, Paris, en 1901, fut le lieu d’une affirmation de soi, ou d’une invention de soi, la première d’une longue série. Devenir Picasso, en 1901, c’est d’abord devenir français, prendre place dans le tissu parisien. La vingtaine de tableaux réunis à Londres, intense expérience, sont autant de tentatives d’appropriation. Les échos variés de Daumier, Manet, Degas, Cézanne, Lautrec, Gauguin et Van Gogh s’y mêlent aux souvenirs de Vélasquez, Goya et même Zuloaga. Le fameux Yo Picasso vampirise le plus autoritaire des autoportraits de Poussin. Ce déguisement-là prolonge l’énergie nietzschéenne que libèrent les oranges, les jaunes, les bleus et les blancs du tableau. L’œuvre constituait le parfait manifeste de l’exposition Vollard, étape décisive, en juin 1901, dans la conquête du monde de l’art. Isolés, comme à Londres, les tableaux de cette année cruciale retrouvent la puissance d’impact qu’on leur reconnut aussitôt. Et les sujets ajoutaient à la palette explosive des œuvres. Picasso peut maçonner comme Van Gogh ou lisser comme les Nabis, il n’en saisit pas moins tous les aspects du Paris contemporain, le carnaval joyeux ou sordide de la rue et des cafés. Le naturalisme à résonnance sociale des débuts catalans ne s’est pas évaporé sous la mutation formelle. On notera aussi une forte prégnance mélancolique en alternance avec la fascination positive, française, des marginaux et de la petite enfance. Quant à la formule du dédoublement, ce Janus de Picasso la scrute et la fortifie déjà au contact d’Ingres, son parfait surmoi. N’est-on pas en droit, ainsi, de mettre en relation un chef-d’œuvre comme L’Arlequin et sa compagne (notre image) avec le portrait de Mme Moitessier, clivé à souhait ? Stéphane Guégan
– Becoming Picasso : Paris 1901, The Courtauld Gallery, jusqu’au 26 mai 2013. Catalogue, sous la direction de Barnaby Wright, d’une remarquable densité intellectuelle (Paul Holberton publishing, 30£). En plus des riches contributions du commissaire lui-même et de celles de Marilyn McCully, grande experte du domaine, on signalera l’essai que Gavin Parkinson consacre à l’impact possible des lectures de Nietzsche sur le dyonysisme picassien et l’iconographie de L’Enterrement de Casagemas, l’un des coups de clairon de l’exposition londonienne.
– Rosalind Krauss, Les Papiers de Picasso, Macula, 26€. Évidemment, il fallait traduire ce classique de la littérature picassienne, vieux d’une quinzaine d’années, mais qui continue de féconder le débat. On ne saurait lire chose plus excitante et plus irritante sur les papiers découpés de l’artiste et sa « sortie » du cubisme au seuil de la guerre de 14. Le sentiment mêlé qu’on en retire tient au mélange de formalisme et de sémiologie, le tout très chic new-yorkais, dont l’auteur est l’une des dernières représentantes. Sa méthode, avouons-le, convient à l’exégèse des différents procédés qui gouvernent les collages de Picasso à partir de 1912, en raison même du trouble visuel et sémantique que l’artiste y introduit avec humour, mélancolie ou sadisme. À cet égard, la première partie de l’essai est de loin la meilleure. Mais les choses se gâtent avec le deuxième chapitre. Peut-on réellement réduire la frénésie citationnelle et réaliste qui saisit le Picasso post-cubiste, où Rosalind Krauss en moderniste voit un échec massif (« des œuvres de plus en plus ineptes » écrit-elle), à la volonté de parodier le mécanisme euphorique, sériel et apparemment impersonnel, auquel obéissent à la fois la « straight photography » et une partie de l’avant-garde (Picabia, Duchamp). L’exégèse s’épuise alors dans les considérations stériles d’une lecture qui se veut héroïquement interne, définitivement formaliste, en dépit des concessions heureuses de Rosalind Krauss à l’approche biographique. Pour autant, le lecteur a bien du mal à retrouver ses petits dans l’argumentation sinueuse, hétérogène du livre en ces dernières pages. Mais un classique reste un classique. Autrement dit, on y perd jamais son temps ni son argent. Les Papiers de Picasso marquent, vices et vertus, un moment de l’historiographie. On dira que le travail de John Richardson (voir notamment les volumes II et III de sa biographie en cours) a largement disqualifié les approches trop autarciques du Picasso des années 1914-1919.
 Écrire, s’écrire, c’était, pour Barbey d’Aurevilly, du pareil au même. Epistolier né, il se voulait plus « homme du monde » qu’artiste, plus causeur emporté que phraseur lissé. Jusque dans sa correspondance, la plus belle du siècle avec les lettres de
Écrire, s’écrire, c’était, pour Barbey d’Aurevilly, du pareil au même. Epistolier né, il se voulait plus « homme du monde » qu’artiste, plus causeur emporté que phraseur lissé. Jusque dans sa correspondance, la plus belle du siècle avec les lettres de  *Barbey d’Aurevilly, Lettres à
*Barbey d’Aurevilly, Lettres à  Ce qu’il y a de bien avec les peintres secondaires – secondaires, non négligeables ni surfaits, c’est qu’ils ne peuvent que nous surprendre en exposition. Et nous apporter d’imprévisibles bonheurs. Commençons avec Marie Laurencin et l’exposition bien calibrée que lui consacre Daniel Marchesseau, son meilleur connaisseur et avocat, au musée Marmottan. Dans les beaux quartiers, la biche se meut comme un poisson dans l’eau. De cette eau qui donne à ses bons tableaux un air d’aquarelle élégamment exténuée et un accent de mondanité aussi savoureux. Entre la modernité des années 1900-1920, sa première famille, et le snobisme éternel de la jet set, Marie Laurencin a tiré le bon fil. Ce fil a ses dangers. Mais
Ce qu’il y a de bien avec les peintres secondaires – secondaires, non négligeables ni surfaits, c’est qu’ils ne peuvent que nous surprendre en exposition. Et nous apporter d’imprévisibles bonheurs. Commençons avec Marie Laurencin et l’exposition bien calibrée que lui consacre Daniel Marchesseau, son meilleur connaisseur et avocat, au musée Marmottan. Dans les beaux quartiers, la biche se meut comme un poisson dans l’eau. De cette eau qui donne à ses bons tableaux un air d’aquarelle élégamment exténuée et un accent de mondanité aussi savoureux. Entre la modernité des années 1900-1920, sa première famille, et le snobisme éternel de la jet set, Marie Laurencin a tiré le bon fil. Ce fil a ses dangers. Mais  Dans la famille des célébrités du temps jadis,
Dans la famille des célébrités du temps jadis,  *Félix Ziem, « J’ai rêvé le beau », Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, catalogue Paris-Musées, 33,80€.
*Félix Ziem, « J’ai rêvé le beau », Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, catalogue Paris-Musées, 33,80€. Il y eut bien un autre Jean Clair que le Jean Clair que nous connaissons et qu’il est d’usage, aujourd’hui, de peindre en réac incurable. La polémique qu’il attise à toute occasion s’est vengée de ses coups de gueule en l’iconisant. Une fois pour toutes,
Il y eut bien un autre Jean Clair que le Jean Clair que nous connaissons et qu’il est d’usage, aujourd’hui, de peindre en réac incurable. La polémique qu’il attise à toute occasion s’est vengée de ses coups de gueule en l’iconisant. Une fois pour toutes,  *André Malraux, Lettres choisies 1920-1976, édition établie et annotée par François de Saint-Chéron, préface de
*André Malraux, Lettres choisies 1920-1976, édition établie et annotée par François de Saint-Chéron, préface de  Comme nos économies, la réputation des écrivains n’échappe pas au risque des chutes les plus sévères. Un jour, sans qu’on sache très bien pourquoi, les lecteurs cessent de faire crédit à certaines étoiles du panthéon national. La piété collective change d’objet, efface l’ardoise, ouvre à d’autres sa boîte à rêve. Voilà un mois, le Figaro littéraire publiait la liste des chouchous du moment, c’était à pleurer. Encore ne s’agissait-il que des romanciers dits contemporains. Si l’on avait questionné les sondés sur leurs préférences en matière de grands morts, la surprise n’eut pas été moins grande. Lit-on encore, par exemple, Paul Éluard ? En 1982, rappelez-vous, il y avait foule à Beaubourg pour visiter l’exposition qu’on consacrait à l’homme de Liberté, au mari de Gala et de Nusch, au cœur saignant du surréalisme, au complice de Picasso, à l’homme de Moscou… Mais la cote d’Éluard a dégringolé depuis. Pas de biographie récente et pas de recherches fouillées sur sa critique d’art. Les belles publications de Jean-Charles Gateau ont trente ans elles aussi ! Ce vide très regrettable, l’exposition d’Évian et son catalogue ne prétendent pas le combler. Issue essentiellement des collections du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, ville dont Éluard était originaire et qu’il a couverte de dons généreux, la liste des œuvres « données à voir », selon la formule aujourd’hui galvaudée du poète, souffre de terribles lacunes. Pour un sublime Picasso, le bien connu Portrait de Nusch de 1941 en divinité pompéienne, pour un Chirico et un Toyen de premier plan, combien d’abonnés absents ? Et le Sommeil d’André Marchand, curieuse rêverie autour de Gala, de ses petites rondeurs appétissantes et de son Eros glacé, ne saurait faire oublier le
Comme nos économies, la réputation des écrivains n’échappe pas au risque des chutes les plus sévères. Un jour, sans qu’on sache très bien pourquoi, les lecteurs cessent de faire crédit à certaines étoiles du panthéon national. La piété collective change d’objet, efface l’ardoise, ouvre à d’autres sa boîte à rêve. Voilà un mois, le Figaro littéraire publiait la liste des chouchous du moment, c’était à pleurer. Encore ne s’agissait-il que des romanciers dits contemporains. Si l’on avait questionné les sondés sur leurs préférences en matière de grands morts, la surprise n’eut pas été moins grande. Lit-on encore, par exemple, Paul Éluard ? En 1982, rappelez-vous, il y avait foule à Beaubourg pour visiter l’exposition qu’on consacrait à l’homme de Liberté, au mari de Gala et de Nusch, au cœur saignant du surréalisme, au complice de Picasso, à l’homme de Moscou… Mais la cote d’Éluard a dégringolé depuis. Pas de biographie récente et pas de recherches fouillées sur sa critique d’art. Les belles publications de Jean-Charles Gateau ont trente ans elles aussi ! Ce vide très regrettable, l’exposition d’Évian et son catalogue ne prétendent pas le combler. Issue essentiellement des collections du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, ville dont Éluard était originaire et qu’il a couverte de dons généreux, la liste des œuvres « données à voir », selon la formule aujourd’hui galvaudée du poète, souffre de terribles lacunes. Pour un sublime Picasso, le bien connu Portrait de Nusch de 1941 en divinité pompéienne, pour un Chirico et un Toyen de premier plan, combien d’abonnés absents ? Et le Sommeil d’André Marchand, curieuse rêverie autour de Gala, de ses petites rondeurs appétissantes et de son Eros glacé, ne saurait faire oublier le  Malgré ses lacunes, l’exposition n’en reste pas moins à voir. En plus des œuvres que nous avons signalées, art moderne et arts premiers, sa profusion de manuscrits et de photos, certaines très peu connues, la rend indispensable à qui s’occupe du siècle passé ou s’y intéresse. Indispensable aussi, et pour les mêmes raisons, le récent volume des Entretiens de la
Malgré ses lacunes, l’exposition n’en reste pas moins à voir. En plus des œuvres que nous avons signalées, art moderne et arts premiers, sa profusion de manuscrits et de photos, certaines très peu connues, la rend indispensable à qui s’occupe du siècle passé ou s’y intéresse. Indispensable aussi, et pour les mêmes raisons, le récent volume des Entretiens de la  Le génial Klimt avait de l’or dans les mains. Non qu’il fût riche, même au soir d’un parcours plutôt brillant, partagé entre commandes publiques et mécénat privé. L’imprévoyance, il est vrai, semble avoir été la vertu première du peintre, qui croqua la vie comme il aima les femmes, sans jamais compter. À partir de 1899, les enfants pleuvent, fruits des étreintes qu’abrite son atelier trompeusement sévère. Les modèles ont toujours eu de l’électricité pour deux. Elles furent, ces souveraines de l’ombre, le trait d’union entre l’art de Klimt et sa vie, les garantes d’une sève qui épargna au peintre les névroses du symbolisme chronophage. On raconte même que ses maîtresses et compagnes plus légitimes assistèrent en grand nombre à sa mise en terre. Stupeur de l’assistance et sourire de Dieu. Le faune rendait les armes à moins de 56 ans. Il n’y eut alors aucun Vasari moderne pour écrire que l’amour du beau sexe avait précipité sa chute. Tant mieux. Klimt s’endormit donc en paix tandis que la
Le génial Klimt avait de l’or dans les mains. Non qu’il fût riche, même au soir d’un parcours plutôt brillant, partagé entre commandes publiques et mécénat privé. L’imprévoyance, il est vrai, semble avoir été la vertu première du peintre, qui croqua la vie comme il aima les femmes, sans jamais compter. À partir de 1899, les enfants pleuvent, fruits des étreintes qu’abrite son atelier trompeusement sévère. Les modèles ont toujours eu de l’électricité pour deux. Elles furent, ces souveraines de l’ombre, le trait d’union entre l’art de Klimt et sa vie, les garantes d’une sève qui épargna au peintre les névroses du symbolisme chronophage. On raconte même que ses maîtresses et compagnes plus légitimes assistèrent en grand nombre à sa mise en terre. Stupeur de l’assistance et sourire de Dieu. Le faune rendait les armes à moins de 56 ans. Il n’y eut alors aucun Vasari moderne pour écrire que l’amour du beau sexe avait précipité sa chute. Tant mieux. Klimt s’endormit donc en paix tandis que la  Le livre que Wagner consacra à Beethoven fin 1870, à l’occasion du centenaire de la naissance du musicien et au moment où s’effondre le
Le livre que Wagner consacra à Beethoven fin 1870, à l’occasion du centenaire de la naissance du musicien et au moment où s’effondre le  La prison a toujours libéré les écrivains d’eux-mêmes. Prenez Le Dernier jour d’un condamné : Hugo s’était rarement montré aussi avare de mauvais lyrisme qu’en épousant la réclusion de son malheureux. Brièveté du récit, brièveté de la vie, silence de la cellule, mutisme des mots. Du très grand art.
La prison a toujours libéré les écrivains d’eux-mêmes. Prenez Le Dernier jour d’un condamné : Hugo s’était rarement montré aussi avare de mauvais lyrisme qu’en épousant la réclusion de son malheureux. Brièveté du récit, brièveté de la vie, silence de la cellule, mutisme des mots. Du très grand art.  *Verlaine emprisonné, musée des Lettres et Manuscrits, MLM/Gallimard, 29€). Cellulairement entre à cette occasion dans la collection Poésie/Gallimard, édition de Pierre Brunel, accompagnée du fac-similé du manuscrit original, 9,90€.
*Verlaine emprisonné, musée des Lettres et Manuscrits, MLM/Gallimard, 29€). Cellulairement entre à cette occasion dans la collection Poésie/Gallimard, édition de Pierre Brunel, accompagnée du fac-similé du manuscrit original, 9,90€.