
Napoléon, que le navet de Ridley Scott salit en pure perte, n’aura passé que 300 jours sur ce rocher-là. Que d’imprudences, il est vrai ! Confier l’Aigle à un Britannique volage, l’obliger à nicher entre la Corse, qui le poussait à agir, et la Toscane, qui le poussait à revenir. Ecoutons François Furet, en 1988 : « C’est l’aventure la plus extraordinaire de cette vie extraordinaire. L’île d’Elbe est mal gardée, la France vaguement inquiète, le grand homme inconsolé dans son minuscule royaume d’exil. Il a gardé intacte cette puissance d’imaginer. » Plusieurs historiens ont déroulé le film des Cent-Jours avec maestria, de Jean Tulard à Emmanuel de Waresquiel, et peint l’évadé auquel le pays fit un accueil mitigé, mais suffisant, avec l’aide de l’armée, à son retour. On est moins disert quant à l’épisode précédent, plus terne de prime abord. La détention confortable et la fuite du souverain déchu, pauvres en péripéties, réclamaient donc l’intervention d’un vrai romancier. Né coiffé, coiffé d’un bicorne veux-je dire tant le régime des abeilles continue à bruisser à ses oreilles et tenter son encrier, Jean-Marie Rouart a lui aussi réussi l’impossible, greffer un livre d’évasion sur celle de Buonaparte, pour parler comme le Chateaubriand de 1814, rallié aux Bourbons par haine de la tyrannie et génie du rebond. D’habitude, le roman historique laisse en coulisse ses figures les plus éminentes, par peur qu’elles paraissent inférieures à l’idée que nous nous en faisons. Affaire de vraisemblance, que les romantiques, dont Rouart est le digne héritier, ont vivement discutée. Bien qu’il ait cherché à accompagner Louis XVIII jusqu’à Gand, comme d’autres mousquetaires du roi, Alfred de Vigny ne croyait pas blasphémer en offrant à ses lecteurs le spectacle complet des infortunes et des insuffisances du pouvoir royal sous Louis XIII : c’est la leçon politique et esthétique de Cinq-Mars en 1826. Elle règle la marche de La Maîtresse italienne, autrement dit la comtesse Miniaci, dont les charmes indéniables débordent la place que les chroniqueurs du temps lui ont accordée. Avec Rouart, elle saute le pas et joue sur la scène des grands. Le colonel Neil Campbell, le geôlier à galons et absences, s’est laissé enfumer par « l’ogre corse » et son apparent renoncement à remettre ça. Il s’est surtout jeté dans les bras et les draps de la belle Italienne, comme l’agneau écossais dans la gueule du loup florentin. On découvre vite que notre tunique rouge est aussi aveuglée par le sexe qu’obsédée par le sac de Badajoz, moins le siège de 1812, du reste, que les jours d’orgie et de sang qui couronnèrent la victoire des Anglais. Se sera-t-il rendu coupable lui aussi des viols et des meurtres en série qui s’abattirent sur la ville espagnole, alors aux mains des Français ? Rouart ne le dit pas, il laisse toutefois deviner que l’officier n’a pas su retenir ses soudards ou qu’il les imita. En pensée, at least. Cet homme à visions lugubres souffre pourtant d’une réelle cécité, et laissera filer deux proies en une, la maîtresse d’une nuit, l’empereur de toujours.
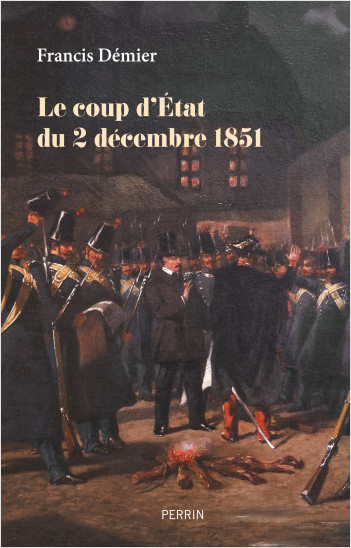
Et Waterloo n’y fera rien : la légende napoléonienne ne se brise pas sur 1815, elle s’y renforce du prestige que confère une chute héroïque. La puissance des « souvenirs » et leur mythologisation par les mots et l’image, en plus de ce qui survécut de 1789 dans l’Empire, allaient donner des ailes à l’ambition autoritaire du « neveu » et une caution possible à plusieurs courants de gauche. On ne saurait comprendre le 2 Décembre 1851, et le plébiscite plus victorieux qui s’ensuivit, en les soustrayant à cet entre-deux, où Francis Démier précisément replace le coup d’Etat. En signe d’impartialité, cet historien de la Restauration – mais d’une Restauration qu’il disqualifie politiquement pour mieux s’intéresser à sa dimension sociale, cite Maurice Agulhon, qui fut le meilleur connaisseur de 1848 et de son rapide naufrage. Passer de Lamartine à Bonaparte, n’était-ce pas un aveu d’échec ? Après les erreurs et le manque d’audace du gouvernement de février, que Baudelaire foudroya en son temps, la politique des élites apeurées favorisa l’étrange épiphanie de décembre, qui vit l’élection massive de Louis-Napoléon au suffrage universel (masculin). Or le regretté Agulhon, fier et ferme républicain, en appelait à une lecture éclairée du 2 Décembre, aussi loin de ses « légendes noires » que de ses « légendes roses ». Comment le vainqueur des élections de 1848, le porteur d’un nom (et d’un programme) à cheval sur l’ordre (rétabli), la représentation (nationale) et les promesses (sociales), n’aurait-il pas senti le moment venu de frapper un coup fatal aux errances du régime, fin 1851, lorsque la Chambre des députés lui interdit de briguer un second mandat ? Ses chances de réussite s’étaient même accrues des prudences suicidaires d’une assemblée de notables, inquiète de la rue et de la virulence de la Montagne où siégeaient les amis de George Sand et Hugo lui-même. Au-dessus des factions, « le neveu » distribua des garanties aux uns (la politique romaine) et des gages aux autres (il désapprouva la loi électorale du 31 mai 1850 qui avait racorni l’exercice du suffrage universel). Au matin du deux décembre, Paris se couvrit d’affiches. Démier nous les fait relire. Leur habileté consista à convertir la violation du Droit en rétablissement de la souveraineté du Peuple ; une certaine rhétorique convoquait « l’oncle », Brumaire, voire l’île d’Elbe : « Je ne veux plus d’un pouvoir qui est impuissant à faire le bien, me rend responsable d’actes que je ne peux empêcher et m’enchaîne au gouvernail quand je vois le vaisseau courir vers l’abîme. » Dès février 1851, en rupture ouverte avec la Chambre, il s’était dit refuser et le « retour à l’ancien régime, quelle que soit la forme qui le déguise », et « l’essai d’utopies funestes et impraticables ». S’il rétablit le suffrage universel, préalable à l’onction du plébiscite, il trahit vite sa parole et sortit du pacte républicain un an plus tard. Pour les victimes et les proscrits de décembre 1851, députés d’un Paris ensanglanté et tétanisé, ruraux du Sud-Ouest, du Centre et du Midi, le crime avait déjà eu lieu. Napoléon III en porterait la marque jusqu’à Sedan et son exil anglais.
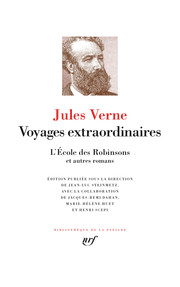
Les destins du neveu et de Jules Verne ont cela de commun qu’ils s’inscrivent entre deux îles. Quand paraît Cinq semaines en ballon (1863), l’écrivain nantais, 35 ans et enfin maître de sa forme, laisse entendre clairement son admiration pour Daniel Defoe et son Robinson Crusoé (1719), découvert enfant à travers la traduction de Pétrus Borel (1836) et les multiples adaptations récréatives à l’usage du jeune public. Le papier engendrant le papier en littérature, l’image l’image au XIXe siècle, et donc l’illustre naufragé le naufrage illustré, cette rencontre du tendre âge déterminera l’inspiration du romancier et les éditions Hetzel, également iconophiles, au-delà de ce que l’on soupçonne aujourd’hui. Ainsi le créateur des Voyages extraordinaires, lecteur aussi du Gordon Pym de Poe, auquel il donnera une suite après l’avoir lu dans la langue splendide de Baudelaire, a-t-il multiplié les robinsonnades, les voulant tantôt ironiques, tantôt seulement toniques. Jean-Luc Steinmetz, aussi féru de Borel que de Verne, a réuni trois d’entre elles, et les a lestées d’une bonne partie de leur illustration originelle. Car les romans de Verne possèdent deux langues, et invitent à jouir de l’une par l’autre, comme à rejoindre le troisième mode de l’intertextualité qui commande chacun de ses livres. C’est là où ce nouveau volume de La Pléiade produit le plus d’étincelles. Le désir tenace de refaire Robinson, que Verne a lui-même associé au délice de frayeurs précoces, ne pouvait aboutir à de banales contrefaçons. Prolonger Defoe ou Johann David Wyss, père d’un Robinson suisse plus rousseauiste et sermonneur, exigeait davantage du prosélyte français. L’Ecole des Robinsons (1882), hommage déclaré aux grands aînés, arbore la fantaisie du « plaisant » (Verne à Hetzel), et presque du comique. La scène d’entrée, au cours de laquelle se vend aux enchères une île devenue « inutile » au large de San Francisco, est à se tordre, autant qu’à méditer sur la marche et le marché du monde. L’humour domine ici jusqu’au bout, et la révélation, qu’on taira, de l’origine des félins prédateurs. A l’étape suivante (Deux ans de vacances, 1888), Robinson, quittant la gentry américaine, se réincarne et se démultiplie. A l’adulte déniaisé se substitue un groupe d’enfants, tout « un pensionnat de Robinsons » venus d’Auckland, et prêts à démontrer leur débrouillardise ou leur culture livresque. L’un des aventuriers en herbe prête voix à Verne et, note Steinmetz, au dévoilement cocasse des artifices de la fiction : « Il y a toujours un moment, s’écrie-t-il, où les sauvages arrivent, et toujours un moment où l’on en vient à bout. » L’Autre, chez Verne, se dédouble, avatars éduqués de Vendredi ou anthropophages irrécupérables. La prétendue « bonne conscience coloniale » affiche une plus grande fragilité dans ce qui forme l’ultime réponse à Defoe et, plus encore, à Wyss : Seconde patrie (1900), titre éloquent, se raccorde aussi à l’utopie de l’île bienfaisante, abri d’une refondation économique et sociale, sur qui soufflent les vents tièdes de Thomas More et de Chateaubriand, fils de Saint-Malo, autre phare de Jules Verne. Stéphane Guégan
*Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, La Maîtresse italienne, Gallimard, 19€ // Francis Démier, Le Coup d’Etat du 2 décembre 1851, Perrin, 24,50€ // Jules Verne, Voyages extraordinaires. L’Ecole des Robinsons et autres romans, édition sous la direction de Jean-Luc Steinmetz, avec la collaboration de Jacques-Remi Dahan, Marie-Hélène Huet et Henri Scepi, La Pléiade, Gallimard, 65€.



