
Il est le premier des modernes selon Vasari : au seuil de la nouvelle peinture, celle des émotions fortes, des volumes en saillie, de l’espace mesurable, de l’infini perdu, Masaccio brosse Adam et Eve quittant le Paradis, dans leur douleur et leur nudité partagées… L’Enfer et le travail de la Grâce fixent désormais le seul horizon des Florentins de 1425 en qui se résume l’humaine condition. A moins de réduire les murs de la chapelle Brancacci à l’une des pages inaugurales de la Renaissance, il est permis d’y voir « le produit d’une relation sociale », comme les aimait Michael Baxandall (1933-2008), éminente figure d’une histoire de l’art qui ne se contentait pas de gloser sur le sexe ou l’épiderme des anges. Son chef-d’oeuvre, l’indémodable Œil du Quattrocento, rejoint le catalogue de Tel et devrait, il faut l’espérer, toucher une autre génération de lecteurs. Je ne connais pas de meilleure invitation à regarder et faire parler la peinture du premier XVe siècle, à travers les catégories mentales, c’est-à-dire tout à la fois culturelles, religieuses, économiques et politiques, qui conditionnent les images de la cité, pratique et réception. Peu d’entre elles alors, y compris les peintures à destination domestique, ne découlent d’une commande étroitement définie et presque servilement suivie. L’idée du libre créateur, mythe forgé par les humanistes, connaît de sévères correctifs dès cette époque. La nôtre, comme l’a montré Nathalie Heinich, n’est pas moins soumise aux puissances extérieures, elles relèvent seulement davantage de la tyrannie de l’argent et du peu de résistance que les institutions et musées lui opposent. Dans la Florence du XVe siècle, un équilibre plus sain des motivations civiques, pieuses et matérielles s’observe pour qui sait regarder. Baxandall commence par étudier, contrats en mains, la structure du marché, épluche les correspondances et les comptes, nous confronte à la réalité interpersonnelle des plus grands chefs-d’œuvre du temps. Ils résultent tous d’un modus operandi où interviennent le commanditaire, le peintre et le cadre conventionnel d’ensemble. Ce jeu à trois serait impossible si les décideurs n’estimaient pas qu’il ait de meilleures dépenses, de plus vertueuses, que d’autres…

Loin d’être abandonnés au splendide isolement de leur seul génie, les artistes se voient donc signifier toutes sortes de contraintes, obligations iconographiques, emplacement, choix des matériaux, participation ou non des collaborateurs, délais de fabrication et étapes de validation. Au poids des directives, que les peintres doivent faire leurs, s’ajoute ce que Baxandall nomme les formes de l’attention en s’appuyant sur la phénoménologie de la perception. Même un Piero della Francesca, pas plus mystique que Fra Angelico, tient compte des dispositions visuelles de son public et, par exemple, met en relief leur commune maîtrise des mathématiques ou de la géométrie. Le troisième et dernier chapitre de L’Œil du Quattrocento, le plus fascinant, explore les mots dans lesquels la peinture du XVe siècle se formule en milieu savant. Baxandall, à cette fin, exhume le témoignage de Cristoforo Landino, et notamment le commentaire que ce grand humaniste avait joint en 1481 à son édition du Dante. L’Enfer toujours… Attaché à l’administration médicéenne, cet ami d’Alberti manie avec la précision du scribe officiel tout un lexique d’époque. Si attaché soit-il à défendre les peintres de Florence comme une famille unie et unique, Landino distingue la rudesse de Masaccio, « imitateur de la nature », de la « merveilleuse grâce » de Filippo Lippi, douceur de relief et élégance de ligne qu’il partagerait seulement avec le sculpteur Desiderio da Settignano. Mais le jeu des comparaisons ne s’arrête pas là. Plus loin, c’est Fra Angelico et « l’enjouement » de sa peinture aux accords charmeurs qui se voient rapprocher de Desiderio et sa douceur « charmante ». Le « stil dolce », qui peut s’égarer dans le séraphique et l’ineffable, trouve son contraire dans l’aria virile qu’outre Masaccio Botticelli sait greffer à ses figures si séduisantes. De cette peinture qui refuse toute effémination, l’image canonique est justement Adam et Eve chassés du Paradis, où Michael Baxandall a montré comment le rude fresquiste de la chapelle Brancacci avait représenté « deux inflexions différentes d’une même émotion », à partir de l’aspect contrasté des visages et des corps du couple biblique, Adam exprimant la honte, Eve la souffrance. Pensons aussi à Piero della Francesca et la retenue expressive, très réfléchie, du cycle d’Arezzo. Y règnent une sorte de sérénité solaire et une souveraineté de la forme pure, tant que le drame adamique n’oblige le peintre à rompre cette harmonie par l’irruption d’une manière de cri. A maints égards, cette dialectique du calme et du drame annonce la réflexion du Laocoon de Lessing au sujet des limites qu’il convient de fixer à l’exacerbation de certains sentiments dans l’ordre de l’image. Au Panthéon de la peinture occidentale, le Paradis et l’Enfer se rejoignent. Stéphane Guégan
Michael Baxandall, L’Œil du Quattrocento. L’usage de la peinture dans l’Italie de la Renaissance, édition largement illustrée, traduit de l’anglais par Yvette Delsaut, Tel, Gallimard, 14,50€.
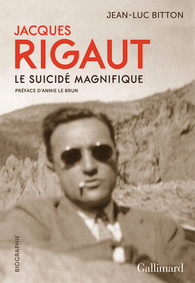
A propos du beau livre de Jean-Luc Bitton, Jacques Rigaut. Le suicidé magnifique, Gallimard, 35€, livre dont le jésuitisme actuel n’a pas parlé autant qu’il le méritait, voir ma recension, Tu éjaculais le néant, dans le numéro de février 2020 de la Revue des Deux Mondes.

 Mais revenons à l’essentiel, à Donatello et ses contemporains justement, à cette Florence heureuse, fière de ses richesses, de sa République patricienne, et de ses artistes décidés à y faire revivre les formes de l’Antiquité en les réinventant. Nul doute que leur plus géniale invention fut le concept même de Renaissance dans le rejet qu’il induit du Moyen Âge, temps obscur, voire obscurantiste, et qui aurait tout ignoré de l’héritage des anciens, la perspective comme les autres principes de la bonne imitation. Qu’un tel mépris soit infondé, l’exposition du Louvre nous le rappelle dès nos premiers pas. D’une part, le gothique italien reste plus marqué qu’ailleurs par le panthéon païen ; d’autre part, dès l’époque de Giotto, la volonté de renouer avec la leçon de Rome pousse les sculpteurs à accentuer de plus en plus le sens de l’humain, le drame terrestre et l’illusion poignante. À cette Renaissance qui s’invente dans les mots et les faits après 1400, les Français n’associent pas aussitôt le rôle qui échut à la statuaire. Le propos des commissaires, Marc Bormand et Beatrice Paolozzi Strozzi, est de dissiper le mythe de son «retard» au regard de la peinture et de la fameuse «fenêtre» qu’elle ouvre sur le monde. La métaphore vient du De Pictura d’Alberti. Sait-on que ce dernier citait trois sculpteurs parmi les acteurs essentiels de la Renaissance florentine? Voilà le Louvre justifié. Après nous avoir rappelé avec finesse combien ces sculpteurs avaient butiné les sarcophages, les médailles et la grande statuaire du monde gréco-romain, il importait de les confronter aux peintres, d’Andrea del Castagno à Lippi. D’une salle à l’autre, les chefs-d’œuvre pleuvent, la palme revient tout de même à Donatello et à la Madone Pazzi, dont l’impact se prolonge jusqu’à
Mais revenons à l’essentiel, à Donatello et ses contemporains justement, à cette Florence heureuse, fière de ses richesses, de sa République patricienne, et de ses artistes décidés à y faire revivre les formes de l’Antiquité en les réinventant. Nul doute que leur plus géniale invention fut le concept même de Renaissance dans le rejet qu’il induit du Moyen Âge, temps obscur, voire obscurantiste, et qui aurait tout ignoré de l’héritage des anciens, la perspective comme les autres principes de la bonne imitation. Qu’un tel mépris soit infondé, l’exposition du Louvre nous le rappelle dès nos premiers pas. D’une part, le gothique italien reste plus marqué qu’ailleurs par le panthéon païen ; d’autre part, dès l’époque de Giotto, la volonté de renouer avec la leçon de Rome pousse les sculpteurs à accentuer de plus en plus le sens de l’humain, le drame terrestre et l’illusion poignante. À cette Renaissance qui s’invente dans les mots et les faits après 1400, les Français n’associent pas aussitôt le rôle qui échut à la statuaire. Le propos des commissaires, Marc Bormand et Beatrice Paolozzi Strozzi, est de dissiper le mythe de son «retard» au regard de la peinture et de la fameuse «fenêtre» qu’elle ouvre sur le monde. La métaphore vient du De Pictura d’Alberti. Sait-on que ce dernier citait trois sculpteurs parmi les acteurs essentiels de la Renaissance florentine? Voilà le Louvre justifié. Après nous avoir rappelé avec finesse combien ces sculpteurs avaient butiné les sarcophages, les médailles et la grande statuaire du monde gréco-romain, il importait de les confronter aux peintres, d’Andrea del Castagno à Lippi. D’une salle à l’autre, les chefs-d’œuvre pleuvent, la palme revient tout de même à Donatello et à la Madone Pazzi, dont l’impact se prolonge jusqu’à  On ne quittera pas l’exposition sans mentionner son ultime point d’orgue, la salle de portraits dominée par Desiderio da Settignano, que les contemporains rapprochaient de la «merveilleuse grâce» de Lippi ou de «l’enjouement» de Fra Angelico. Son Olympias, reine des Macédoniens, ouvre une autre modernité… Nous étions au Louvre, restons-y. Deux étages plus haut, et un siècle plus tard, voilà les Cousin, père et fils. Le premier est célèbre, l’autre oublié. À voir leurs œuvres rapprochées, dans l’exposition si précise de Cécile Scailliérez et Dominique Cordellier, cela se comprend. Aux créations du père, à son maniérisme sans frontière, capable de glorifier l’Église comme la force militaire, le mal d’amour ou l’inverse, apte aussi à s’associer à la mode des puissants (ah le plastron de l’infortuné François II!), le fils n’ajoutera que constance et virtuosité. Cousin père, c’est avant tout un tableau et un seul, l’un des plus envoûtants de l’art français, l’Eva Prima Pandora, présentée ici comme le point de fuite d’une création à la fois polymorphe et centrifuge. Un tel tableau repousse les murs. Sous le cartouche qui la nomme, la belle impure repose, occupant tout l’espace du tableau et concentrant sa lumière vénéneuse. À travers une arcade digne de Léonard, l’arrière-plan, très clair aussi, s’hérisse d’une ville fantôme, image du monde déchu. La chute, le tableau ne parle que de ça. Un crâne, un serpent, deux vases, l’un fermé, l’autre ouvert, fatalement. Le tableau s’inscrit dans le double héritage de la Bible et des Grecs, réunis par la force de l’art, qui sut toujours tourner le vice en vertu.
On ne quittera pas l’exposition sans mentionner son ultime point d’orgue, la salle de portraits dominée par Desiderio da Settignano, que les contemporains rapprochaient de la «merveilleuse grâce» de Lippi ou de «l’enjouement» de Fra Angelico. Son Olympias, reine des Macédoniens, ouvre une autre modernité… Nous étions au Louvre, restons-y. Deux étages plus haut, et un siècle plus tard, voilà les Cousin, père et fils. Le premier est célèbre, l’autre oublié. À voir leurs œuvres rapprochées, dans l’exposition si précise de Cécile Scailliérez et Dominique Cordellier, cela se comprend. Aux créations du père, à son maniérisme sans frontière, capable de glorifier l’Église comme la force militaire, le mal d’amour ou l’inverse, apte aussi à s’associer à la mode des puissants (ah le plastron de l’infortuné François II!), le fils n’ajoutera que constance et virtuosité. Cousin père, c’est avant tout un tableau et un seul, l’un des plus envoûtants de l’art français, l’Eva Prima Pandora, présentée ici comme le point de fuite d’une création à la fois polymorphe et centrifuge. Un tel tableau repousse les murs. Sous le cartouche qui la nomme, la belle impure repose, occupant tout l’espace du tableau et concentrant sa lumière vénéneuse. À travers une arcade digne de Léonard, l’arrière-plan, très clair aussi, s’hérisse d’une ville fantôme, image du monde déchu. La chute, le tableau ne parle que de ça. Un crâne, un serpent, deux vases, l’un fermé, l’autre ouvert, fatalement. Le tableau s’inscrit dans le double héritage de la Bible et des Grecs, réunis par la force de l’art, qui sut toujours tourner le vice en vertu. Contrairement à sa sœur Olympia, Eva ne nous regarde pas, et fixe en se détournant on ne sait quel songe. À ce titre, elle aurait pu figurer, au Luxembourg, dans les salles de l’exposition consacrée à la Renaissance et au rêve, non loin du Lotto de Washington. Affrontant les yeux ouverts le conflit interne entre Voluptas et Virtus, cette jeune fille, sur laquelle un amour vaporise une nuée de fleurs blanches, est la seule à échapper au sommeil. La nuit, ses visions et ses chimères, étend son empire sur le reste de la sélection où abondent les merveilles, du grand Véronèse de Londres au plus soufflant encore
Contrairement à sa sœur Olympia, Eva ne nous regarde pas, et fixe en se détournant on ne sait quel songe. À ce titre, elle aurait pu figurer, au Luxembourg, dans les salles de l’exposition consacrée à la Renaissance et au rêve, non loin du Lotto de Washington. Affrontant les yeux ouverts le conflit interne entre Voluptas et Virtus, cette jeune fille, sur laquelle un amour vaporise une nuée de fleurs blanches, est la seule à échapper au sommeil. La nuit, ses visions et ses chimères, étend son empire sur le reste de la sélection où abondent les merveilles, du grand Véronèse de Londres au plus soufflant encore