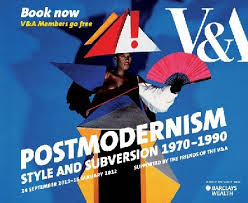Eté meurtrier… je parle de celui de 2023 au cours duquel Jean Canavaggio s’en est allé, nous privant désormais de sa connaissance unique de Cervantès. Je lis Don Quichotte dans sa traduction (La Pléiade, 2001) et, autre opus triomphant de la mort, je retourne régulièrement à son Dictionnaire Cervantès, un modèle du genre (Bartillat, 2021). Le savoir qu’il concentre, la maîtrise de langue qu’il manifeste, en fait le parfait compagnon des lecteurs soucieux de vagabonder utilement parmi les résonnances infinies du plus grand des romans de chevalerie. D’éminents défenseurs de sa cause, tout patriotisme bu, l’ont dit avant nous, Dostoïevski en Russie, Dickens et Sterne en Angleterre, pour ne pas parler de l’irrésistible Retour de Don Quichotte de Chesterton et de son humour hispanique à revendre ; chez nous, si l’on songe à Madame de Sévigné et à Diderot, les fanatiques se bousculent dès avant le romantisme. De traduction en traduction, d’illustrateurs en illustrateurs, un monument unique s’élève alors, que le XXe siècle a maintenu et consolidé. Pas plus que le dictionnaire de Canavaggio, Picasso, le plus français des hidalgos, n’a effacé de sa/notre mémoire ceux qui tentèrent de donner un visage, un corps, et une âme ardente à travers eux, au héros de Cervantès. D’ailleurs, Tony Johannot, Daumier et Gustave Doré n’ont pas été sans effet sur la lecture que Mérimée, Flaubert, Gautier ou Tourgueniev firent de Don Quichotte. Et l’on énumère ici que les aigles de sa réception. Le brillant essai de Jean Seznec (Wildenstein, 1948), au-delà des images suscitées par le succès viral de Cervantès, identifiait des cheminements oubliés. La France classique, la France des Lumières avait l’Espagne dans le sang. Avec Don Quichotte, concluait Seznec, « le génie français a noué plusieurs siècles de complicité ». Il reconnaissait à nos dessinateurs, mais aussi à nos écrivains, le privilège de ne pas avoir réduit les aventures du guerrier halluciné à leur apparent burlesque, ou à une parabole simpliste. Selon les romantiques allemands, il n’y serait question que du combat éternel entre l’idéal et la réalité, le rêve et la prose de l’existence ordinaire. Les Français, que le catholicisme de Cervantès incommode moins – catholicisme dont Jean Canavaggio a montré qu’il était près du dogme et notamment du péché originel, ont propagé une autre idée de Don Quichotte lui-même, cet être de feu plus fier et tragique que purement chimérique. A partir de Chateaubriand, qui parle de la « gaieté cruelle » du livre, la littérature française, anticipant Kundera, lui prête une philosophie plus active que mélancolique : pour se heurter aux obstacles du réel, voire plus métaphysiquement à ses limites, les bravades du seigneur de la Manche n’en sont pas moins dignes de sa grandesse et révélatrices d’une moralité d’ensemble que la vis comica de Cervantès sert moins à déjouer qu’à seconder. Jean Canavaggio n’était pas seulement conscient de la tournure unique que prit le destin posthume de Cervantès en France, il en était une brillante personnification.
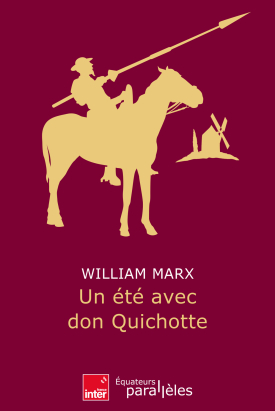
La collection où se sont illustrés Antoine Compagnon, Sylvain Tesson et Régis Debray vient de s’attacher William Marx. Son Eté avec Don Quichotte, couverture cardinalice et moulin au loin, est dédié à la mémoire de Jean Canavaggio et de Milan Kundera, autre disparu de 2023. La complexité, le singulier préféré au général, le fait substitué à son explication binaire, ce sont autant d’attributs de la vraie littérature ; Kundera n’a cessé de le proclamer, en accord avec la probité de Cervantès et l’ouverture de compas propre à Don Quichotte. « C’est un livre sur tout, observe William Marx : l’idéal, le physiologique, l’économique, le politique, la religion, l’amour, les minorités, les femmes. » Avec lui, j’ajouterai : les pouvoirs de la fiction. Ils s’exercent autant sur le chevalier errant, Emma Bovary avant l’heure, que sur le lecteur, sans cesse interpellé ou interloqué quand l’auteur sort de son invisibilité. Don Quichotte vient de la polyphonie des récits à tiroirs et conduit à la polyphonie moderne, laquelle induit un nouveau pacte de lecture et une conscience accrue de soi ; elle pousse le héros de Cervantès à analyser sa pente à l’affabulation et à comprendre qu’il est le protagoniste d’un livre en train de s’écrire. A la recherche du temps perdu, William Marx le note justement, s’annonce ici et là. Du reste, bien que Proust affecte de proclamer le contraire, l’amour différé, mais souverain, n’est-il pas l’une des croix de Don Quichotte, en mal de l’inaccessible Dulcinée, mais entretenant résolument la quête ? « Nous sommes de l’avis de Don Quijote, écrivait Gautier en 1843 : Dulcinée existe, elle est belle, elle est jeune, elle est charmante. » La cristallisation amoureuse, si l’on se tourne vers Stendhal, autre afficionado, est aussi affaire de représentations. Il n’est pas de frontière nette entre la réalité de l’être désiré et l’image intérieure qui en précède le surgissement. A ce propos, la thèse centrale de William Marx s’autorise des références fréquentes de Cervantès aux Evangiles. Don Quichotte voit, et nous fait voir, comme les grands peintres, à travers ses yeux, les yeux de l’amour. En cela, le bon chrétien parle en lui : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » (Jean, 20, 29). La grande chevauchée qui nous est contée donne une place éminente à plusieurs types de croyance, et à plusieurs croyances, pour revenir à William Marx, très sensible à la diversité religieuse que prend en charge Cervantès, retenu cinq ans dans les prisons algéroises, peu de temps après Lépante où il fut durement blessé. Le père de Don Quichotte a-t-il masqué, à Rome et en terre d’Inquisition, son « agnosticisme raisonnable », à la Montaigne, avant de l’insinuer entre les lignes du futur roman ? A rebours de Jean Canavaggio ou de Miguel de Unamuno, prêt à élever notre chevalier au statut de « Christ castillan », William Marx croit Cervantès moins orthodoxe, et le dit porteur d’un christianisme en froid, en lutte peut-être, avec les intolérances de l’époque. Plutôt que de les départager, on citera l’aphorisme final, très valéryen, qu’il en tire : « la valeur de la littérature réside dans l’ambiguïté. » Stéphane Guégan

Jean Canavaggio, Dictionnaire Cervantès, Bartillat, 2021, 28€ /// William Marx, Un été avec Don Quichotte, France Inter / Equateurs parallèles, 14,50 € /// A venir : Orsay vu par le Collège de France, auditorium du musée d’Orsay, 16 octobre 2024, midi, William Marx et Stéphane Guégan autour de Degas, Mallarmé et Paul Valéry.