
Pour qu’il y ait génocide, il ne suffit pas que le massacre de vies humaines soit hors norme, il faut que le criminel ait agit avec méthode et détermination, le « cœur fermé à la pitié », comme Hitler l’intimait à ses soldats. L’abattoir s’inscrit dans un plan, reçoit une justification officielle, repose sur une organisation et des intermédiaires aguerris. Cela, et plus encore, la commission Vincent Duclert vient de l’établir au sujet du Rwanda. Raymond Kervokian en fut l’un des membres et, semble-t-il, l’un des plus actifs quand il s’est agi d’éditer le rapport du collectif. Nous le retrouvons derrière la publication du terrible Journal d’une déportée du génocide arménien, qui exhume ensemble un document accablant et l’image radieuse de son auteure, Serpouhi Hovaghian. Rarissimes sont les témoignages directs du martyre où, durant le printemps et l’été 1915, près de deux millions des siens périrent majoritairement ou furent assimilés de force, sans qu’il entrât la moindre charité, le plus souvent, dans le sauvetage de rares femmes et enfants. Jeune mère de 22 ans, Serpouhi dispose d’armes certaines au moment du drame qui l’emporte, sa beauté, sa haute éducation, sa fermeté de caractère. Lorsqu’elle quitte Trébizonde, sur la Mer Noire, en juillet 1915, son fils Jiraïr (photographie ci-contre) l’accompagne, non sa fille, hospitalisée, qu’elle ne reverra pas. Les seuls hommes qui ont grossi le convoi des « exilés », selon l’euphémisme turc, sont des vieillards. Car l’élimination des plus valides, commencée en avril à Istanbul, s’est poursuivie à l’Est du territoire, le plus proche de l’ennemi russe. Les alliés du Reich dans le conflit mondial ont trouvé là un des « motifs » du génocide dont les pogroms de 1894-1896 avaient sonné l’annonce. Après avoir vu mourir la plupart de ses coreligionnaires, victimes de la faim, de la soif, de la fatigue et des coups, voire d’exécutions sommaires, Serpouhi faussa compagnie à ses « gardiens » à la faveur de complaisances intéressées. Son Journal dit aussi sa détresse, sa culpabilité, lorsqu’elle remit son fils à des paysans turcs, probablement sans enfants, pour le sauver. Le récit des années clandestines qui s’ensuivirent ne serait pas si bouleversant s’il ne dénotait pas un souci des détails insupportables, un effarement avoué devant les « scènes dantesques » auxquelles elle assista et une qualité littéraire aussi paradoxale qu’indéniable. Elle est le fruit d’une scolarité en Terre sainte où son père, haut ingénieur ferroviaire du royaume ottoman, l’avait envoyée étudier, notamment le français dans lequel est écrite une partie du manuscrit que publie, l’ayant reçu en don, la BNF. Ces pages arrachées à l’oubli et au silence des négationnistes rejoignent les preuves déjà réunies par l’Histoire, et elles font mentir la Phèdre de Sénèque : non, les grandes douleurs ne sont pas toutes muettes. De l’Enfer, Serpouhi a voulu rapporter une image exacte de ses rouages, mais ce carnet vaut aussi reconnaissance de dettes. Dettes envers les disparus, d’abord, dettes envers la littérature qui l’aida à survivre, Corneille, Voltaire, Hugo, Vigny, Stendhal, Dumas… Il est heureux que son Journal ait désormais la France, rejointe en 1921, pour dépositaire et foyer de rayonnement.

Aux Arméniens chassés de leur ancien fief, d’autres destinations s’offraient. Mais la France de l’après-guerre de 14, où tradition républicaine et tolérance religieuse faisaient meilleur ménage qu’aujourd’hui, devait accueillir, nul hasard, un grand nombre d’entre eux. Terre des libertés, elle incarnait aussi la grandeur d’une civilisation où la littérature, modelée par l’héritage judéo-chrétien, jouissait d’un prestige unique au monde. Deux des plus grandes intelligences d’alors, Ernst-Robert Curtius et Friedrich Sieburg devaient bientôt théoriser la prééminence que nous accordons au littéraire dans sa triple dimension d’opération de l’esprit, de principe spirituel et d’abri aux courants religieux et idéologiques qui nous définissent depuis Clovis. Malgré le schisme de 1905, l’esprit du Concordat de 1802, coup de génie de Bonaparte, semblait encore régner sur nos têtes. Il anime plus certainement les convictions profondes de Jean-Marie Rouart chez qui la mémoire napoléonienne, insupportable aux sots, s’accorde au catholicisme de ses père et grand-père. Quand on descend de Louis, l’éditeur de Maritain et Claudel, et d’Augustin, le peintre dont le Petit-Palais va bientôt recevoir quelques toiles, on refuse soi-même d’associer fanatiquement le bonheur des hommes, le vivre-ensemble et la stabilité des pouvoirs publics au pur laïcisme, au refus d’un sacré, d’une éthique, d’un surnaturel logés au-dessus des individus. À la confusion actuelle, au naufrage de certaines de nos valeurs les plus vitales et la langue qui les portait, aux hésitations du gouvernement face au séparatisme, l’essayiste du Pays des hommes sans Dieu oppose l’enseignement oublié de l’Histoire et des écrivains. Rouart ne croit pas à l’éradication du religieux, il plaide la cohabitation des cultes, islam compris, et relève avec dépit qu’Emmanuel Macron, après avoir lancé l’idée judicieuse d’un « nouveau Concordat », semble en avoir écarté l’hypothèse. Seule la coexistence réglée et surveillée des cultes, assortie d’une France, et donc d’une république forte, sûre de son droit, fière de son passé, fidèle à ses racines comme à tout ce qui l’a constituée, peut ouvrir le chemin d’une pacification sociale et d’un sursaut chrétien. Ce ne serait pas le premier. Le brillant essai de Rouart ne cache rien de la famille de pensée où l’auteur, dès l’enfance, qui fut presque mystique, a cherché ses lumières. Sans craindre de laisser résonner en soi les paroles si différentes de Chateaubriand et Renan, de Pascal et Jean Guitton, d’Isabelle Eberhardt et autres Européens gagnés au soufisme, il se sera donné la capacité de mieux comprendre le destin de l’Église, affaiblie et « enlaidie » par Vatican II, comme la dérive des sociétés en mal de surplomb. Les dangers de la radicalisation sont bien là, ils se mesurent au nombre croissant des attentats et assassinats sur notre sol. Ils s’accroissent aussi des errements de nos nouveaux laïcards prêts à instaurer un « droit au blasphème » par haine des cultes, quels qu’ils soient, et folie vertueuse. L’incrédulité comme religion faisait déjà sourire de pitié un Jacques Rigaut, que Rouart cite en exergue. Hier même, le grand-rabbin Korsia disait ceci : « La laïcité ne peut être utilisée pour fonder une société athée. » Aux sourds de l’entendre.

Au XVIIe siècle, la France étant toujours la fille aînée de l’Église, la sculpture, art du tangible, du politique et des vanités sociales, se devait aussi d’ouvrir les portes du Ciel. Nul n’excella plus qu’Antoine Coysevox dans l’exercice spirituel du monument funéraire. C’est que sa capacité unique à sonder et fixer le réel, à portraiturer le vif des âmes, fit de lui l’intercesseur des « visions de l’au-delà », pour le dire comme Alexandre Maral, son dernier et plus complet historien. Le livre qu’il signe avec Valérie Carpentier-Vanhaverbeke se range à côté de son monumental Girardon puisqu’il n’est plus permis de les opposer, comme on opposerait l’eau et l’huile, le classique et le baroque. Sans le citer, la préface de Geneviève Bresc-Bautier désigne l’auteur de ce paragone trop court, Sir Anthony Blunt, dont le cœur (d’espion communiste travaillant pour la Couronne) penchait résolument en direction du fougueux Coysevox, sorte de Bernin français (ne fut-il pas choisi pour lancer dans l’immortalité le cardinal Mazarin qui avait rêvé de confier ses restes au génial Italien ?). Cela dit, bien que vieillie, la synthèse de Blunt sur l’art français (1ère parution anglaise en 1953, l’année de la mort de Staline) reste de grande valeur, et contient des fulgurances superbes, inspirées par les artistes qui défièrent les limites de leur art. L’un de ses morceaux de bravoure est la page consacrée au Louis XIV du Salon de la Guerre, à Versailles, où Coysevox fut vite amené à donner le meilleur de lui-même. Son royal cavalier crève l’écran et révolutionne le genre de la frise par des saillies audacieuses, des torsions inouïes et un sens réaliste de l’allégorie. Blunt portait aux nues « la sculpture la plus baroque qu’ait produit à cette date l’atelier versaillais ». Ce que ses critères formels l’empêchaient de comprendre, ce dont précisément les auteurs de la présente somme nous livrent les clefs, c’est la dimension collective, extraterritoriale, du miracle que Charles Le Brun et Jules Hardouin-Mansart, « les donneurs d’ordre et de modèles », rendirent possible. Le baroque versaillais ne résulte d’aucune greffe italienne directe (Coysevox ne fut pas romain, à rebours de Girardon), il représente l’une des voies que le château et son monarque empruntèrent parmi d’autres, en fonction des commandes et de l’idiosyncrasie des créateurs. Rien ne résistait, pas même le marbre, aux frissons nouveaux dont Coysevox fut le messager idéal. Bouleversants sont ses portraits qui n’éteignent pas la vie par nécessité d’immortaliser : le vieux Cézanne copiait encore au Louvre le buste sublime de Le Brun (dessin dans la collection de Louis-Antoine Prat) ! Et que dire de celui de Robert de Cotte, au regard jeté latéralement, où Blunt devinait tout le XVIIIe siècle ? Et que dire encore de l’inspiration funéraire étudiée par Maral avec un soin religieux ? L’exploration documentaire et stylistique est poussée si loin que chaque monument, ceux de Vaubrun, Colbert, Créqui, Le Brun et donc Mazarin, semble s’enfanter devant nos yeux. Les grands hommes, vices et vertus, se présentent à Dieu sans l’assurance du Salut éternel. Mais ils vivent, nous interpellent, nous saisissent, d’en-Haut déjà. Stéphane Guégan

*Serpouhi Hovaghian, Journal d’une déportée du génocide arménien, édition critique par Raymond Kervokian et Maximilien Girard, Bibliothèque Nationale de France, 19€. Signalons aussi de Sonya Orfalian, née en Libye de parents arméniens, ses Paroles d’enfants arméniens 1915-1922, traduit de l’italien par Silvia Guzzi, avec la collaboration de Gérard Chaliand, Joël Kotek et Yves Ternon, Gallimard, 2021, 18€. Trente-six témoignages de survivants, chacun précédé d’une lettre de l’alphabet arménien, se succèdent hors de toute rhétorique victimaire, ils parlent la langue de l’enfance trahie. Comment les années auraient-elles pu effacer chez les adultes que Sonya Orfalian a interrogés le souvenir des atrocités sans nom, et le regard même de ces filles et garçons trop jeunes pour comprendre le nettoyage ethnique, les marches de la mort, ces colonnes où l’on voit tomber les siens, les pillages sans fin et le troc de chair humaine ? La mémoire de l’innommable retrouve les mots, les sensations, la peur radicale des victimes livrées à elles-mêmes, brisées à jamais. « J’ai passé beaucoup de temps à écouter, au sein de mon entourage familial diasporique et auprès d’amis, descendants comme moi de rescapés du génocide, ces paroles d’enfants », explique Sonya Orfalian. Plus que tout, en Turquie comme dans l’Allemagne nazie, les agents du génocide (le mot a été forgé par Raphael Lemkin au lendemain de la Shoah et en référence aussi aux Arméniens) redoutaient qu’on sût, que les témoins se vengeassent. L’extermination, c’était l’oubli assuré. Or l’écho des massacres, viols et rapines a traversé le siècle de leur difficile reconstruction. Ce livre indispensable y contribue parce que ces récits « de mort et de souffrance infinie », écrit Joël Kotek, spécialiste de la Shoah, nous glacent d’effroi. SG
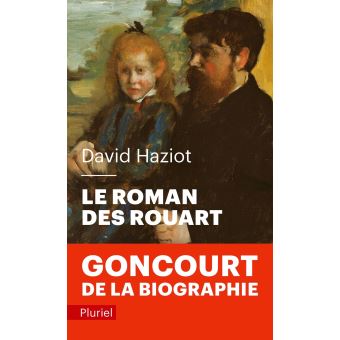
*Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, Ce pays des hommes sans Dieu, Bouquins essai, 2021, 19€. L’auteur vient de faire une importante donation au Petit Palais (où elle sera visible à partir du 1er juin) de douze œuvres (Henri et Augustin Rouart, Henry Lerolle Maurice Denis), douze œuvres qui peignent, à leur tour, le destin d’une dynastie familiale et de son cercle. Signalons, à cet égard, la reparution de l’excellent Roman des Rouart de David Haziot, Fayard/Pluriel, 2020, 11€. On relira, entre autres, le chapitre consacré à Louis Rouart, « le Condottiere », selon le mot de son petit-fils. En quelques pages, la figure se dresse de cet homme impétueux dans son patriotisme, sa ferveur catholique, son goût des arts (il préférait Degas et Lautrec à Moreau et Mallarmé), ses amours… Avant de créer la Librairie de l’art catholique, sise place Saint-Sulpice, le cadet des fils d’Henri Rouart fut l’un des principaux collaborateurs de L’Occident, où certains des futurs cadres de la NRF firent leurs armes à partir de décembre 1901. Puis la Loi de séparation de 1905, après l’Affaire Dreyfus, sema la zizanie. Pour certains, l’esprit des missionnaires demandait à renaître. Parmi d’autres sacrilèges, celui de la laideur de nouvelles églises blessait au plus profond le jeune éditeur. Proche de Maurice Denis, Louis préférait Fra Angelico aux sucreries malséantes de la Belle Epoque. Sa position, sur ce point-là , ne faiblit jamais. Car régénérer l’art catholique, c’était « restituer à la foi sa force et sa jeunesse. » SG
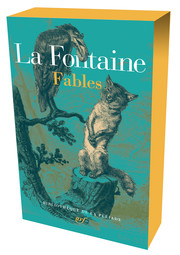
*Alexandre Maral et Valérie Carpentier-Vanhaverberke, Antoine Coysevox (1640-1720). Le sculpteur du Grand Siècle, ARTHENA, 2020, 139€. Autant que Le Brun et les artistes placés sous son autorité, La Fontaine se passionna pour le théâtre intime des passions, et fit œuvre d’anthropologue en rapprochant sphère humaine et sphère animale sans fixer de nette frontière entre elles. La loi métamorphique à laquelle obéissaient Versailles et ses groupes sculptés, si bien mise en évidence par Michel Jeanneret, convenait bien au génial fabuliste. Bien qu’en délicatesse avec Louis XIV, La Fontaine a chanté la grotte de Thétis, le parc et sa conversion de la nature sauvage en terre des miracles. Son monde, du reste, tient la mobilité et la subtilité pour souveraines, comme le rappelle Yves Le Pestipon en préface du tirage spécial de La Pléiade qui rassemble l’ensemble des fables et toutes les gravures dont Grandville les illustra (1837-1840). Le volume y joint une bonne partie des dessins préparatoires de ce dessinateur qui effrayait Baudelaire par sa fantaisie implacable. Parce qu’il ne tranche jamais entre deux options, animaliser les hommes ou humaniser les animaux, La Fontaine souriait à la bizarrerie du caricaturiste romantique. Ils aiment, tous deux, troubler le contour des règnes ou en inverser la hiérarchie. Les plus grands moralistes, tel La Rochefoucauld, ne se lassèrent jamais de la lecture des fables, où les pires instincts et les plus beaux élans alternent avec bonheur. L’homme et ses masques ne peuvent rien contre la drôlerie du texte, sa vivacité diabolique, qui a fait parfois dire (Fabrice Luchini) qu’on n’avait jamais aussi bien écrit le français. Les spécialistes du XVIIe siècle, du reste, avouent encore leur perplexité devant l’audace de certaines allitérations et certains rejets. La Fontaine fouille et irrigue le vers, comme Coysevox ses draperies et ses visages. Tout doit parler et parle, émouvoir et émeut. En émule revendiqué des Anciens, il prend pour modèle « l’ingénieux » Ésope et laisse deviner derrière les « apparences puériles » mille « vérités importantes ». C’était agir en chrétien, conscient qu’il n’est pas d’homme innocent, et ramener ses lecteurs au merveilleux de leur enfance, quand tout était matière à plaisir, même la brutalité du présent. SG (La Fontaine, Fables, tirage spécial illustré, préface d’Yves Le Pestipon, édition de Jean-Pierre Collinet, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 49,90€).








