
De la fascination que Drieu exerça sur François Mauriac (1885-1969), son aîné de presque dix ans, les preuves abondent, diverses, passionnées et donc contradictoires. Cet attrait multiple, qui ne fut pas sans retour, résista à tout ce qui les séparait, socialement, politiquement et sexuellement. Est-ce le mystère d’un tel miracle, pour parler comme nos deux catholiques, qui gêne celles et ceux que ce rapprochement a occupés ou préoccupés (1) ? Commençons par les faits, si chers à Drieu : Mauriac a beaucoup écrit sur son cadet, sur lui, pour lui et contre lui. En comparaison, les héritiers putatifs du feu follet des lettres françaises, nos Hussards, ont préféré la concision extrême, se contentant le plus souvent d’un salut amical au-dessus de la mort héroïque, propre, du grand frère disparu. Le silence des orphelins possède sa beauté, ils n’en sortent qu’avec pudeur. Ainsi le Nimier de 1949, résumant ce que fut la littérature de l’entre-deux-guerres, déclasse-t-il sans hésiter le surréalisme, rival institué du sartrisme, au profit du « romantisme des années 1930 ». A sa tête, il place « l’accent fiévreux » de Drieu et lui associe Céline et Bernanos, mais aussi Malraux, mais encore Mauriac, ne l’oublions pas… Chez Nimier, l’écrivain peut faiblir, faillir, le lecteur ne se trompe jamais. Mauriac, pareillement, a lu et très bien lu Drieu, dès le début des années 1920, alors que le jeune écrivain fréquente le milieu Dada, la faune du Bœuf sur le toit et la NRF. Son cadet lui apparaît dans l’éclat rimbaldien des poètes que la guerre de 14 a brisés et révélés du même élan. Le nietzschéisme d’Interrogation (1917) et d’Etat-civil (1921) aurait pu l’en détourner, il ne suffit pas à désarmer Mauriac, quoique de longue date hostile à l’exaltation de la violence et de la force salvatrices. Au contraire, la folle jeunesse de l’après-guerre, ces survivants en surchauffe, suscite autant sa compassion, sa curiosité qu’elle le tente, et active les désirs d’une homosexualité qui n’ose se vivre, se dire, et que Drieu a tôt devinée. Nous mesurons mieux aujourd’hui le vif intérêt que Mauriac et son ami Jacques-Emile Blanche portent alors à Jacques Rigaut, dadaïste sans œuvre et bisexuel suicidaire, que Drieu a sauvé de la mort fin 1920, avant de multiplier les tombeaux littéraires et les chants funéraires, La Valise vide préfigurant la fin tragique de son modèle, Le Feu follet la consacrant et la désacralisant tout à la fois (2). Mauriac, plutôt révolté par la nouvelle de 1923, fut de ceux, rares si l’on en juge par le mutisme de la NRF, que secoua le roman de 1931 : Le Feu follet a confirmé Drieu, sa vigueur neuve, ironique, comme son «rôle de témoin», note lucidement Mauriac dans Les Nouvelles littéraires d’août 1932. Avant qu’il ne soutienne ainsi ce « portrait magistral d’un des enfants perdus que nous n’avons pas été dignes de sauver », l’auteur de Thérèse Desqueyroux a plébiscité le Blèche de Drieu (1928), roman analogue aux siens en ce qu’ils creusent l’écart entre « la sexualité des personnages et leur religion ». Mauriac tenta de faire obtenir un prix littéraire à cette satire de l’imposture bourgeoise et des sacrifices trompés, récompense qui eût consacré sa proximité avec Drieu à la veille des grandes turbulences.

L’affaire éthiopienne et la guerre d’Espagne, en 1935-36, sont facteurs de clivage. De Mauriac avec lui-même : celui qui avait milité avec Le Sillon, à vingt ans, s’est rapproché de l’antiparlementarisme de droite au temps de l’affaire Stavisky et des remous du 6 février 1934. De Mauriac avec Drieu, qui cherche du côté du néo-socialisme à poigne : l’éloignement s’aggrave après juin 1940, et le choix de la collaboration où s’engage Drieu selon des modalités et une attitude qu’on aime à simplifier ou à caricaturer. Mauriac, qui fut longtemps barrésien, n’afficha guère de sympathie pour le Front Populaire, se rangea parmi les Munichois avant de se déclarer un temps maréchaliste, avait beaucoup aimé Gilles. La lettre qu’il adresse à Drieu en janvier 1940 n’hésite pas à parler d’un livre « essentiel, vraiment chargé d’un terrible poids de souffrance et d’erreur ». C’est aussi par son érotisme cru, roboratif, œcuménique, que Gilles est « grand », « beau », générationnel. Le point d’achoppement, ce sera donc ce socialisme fasciste où Drieu, greffier des couleurs instables d’une époque mouvante, joue sa vie après juin 40, non sans comprendre très vite que le cours des choses trahira ses espoirs de révolution européenne. La critique actuelle reproche à Drieu d’avoir agi et parlé en guerrier lors des polémiques de l’Occupation, oubliant que ses adversaires en faisaient autant et que le niveau de tolérance, d’une zone à l’autre, était assez élevé. On sait que Drieu n’épargne pas Mauriac dans La Gerbe du 10 juillet 1941, alors qu’a débuté l’invasion allemande de la Russie, il l’accuse de faire, comme en 1936 par anti-franquisme, le jeu des communistes, sous couvert d’indiquer aux catholiques le bon chemin. En usant du double entendre, Mauriac venait de donner un article en ce sens à L’Hebdomadaire du Temps nouveau, revue d’inspiration chrétienne et crypto-gaulliste qui succédait à Temps présent : « Vous avez rompu le silence, écrit-il à Mauriac, le 15 juillet 1941, je ne puis le garder. » Par courrier privé, Mauriac fit savoir à Drieu ce qu’il pensait de cette attaque qu’il jugeait inique, il n’estima pas toutefois utile de se brouiller avec le polémiste endiablé, contrairement à ce que certains historiens laissent entendre afin d’incriminer chaque parole prononcée par Drieu sous la botte. En février précédent, Mauriac avait dîné chez son ami Ramon Fernandez, en compagnie de l’auteur de Gilles, et noté leur commune peur des représailles « en cas de défaite ». Les menaces d’assassinat sont pourtant loin d’avoir abattu les deux hommes de la NRF… Tout en regrettant la ligne que Drieu avait donnée à la revue depuis décembre 1940, Mauriac n’a pas condamné la relance de la prestigieuse vitrine du génie français, opérée sous l’œil de l’occupant. N’envisagea-t-il pas, quelque temps encore, de contribuer à la revue de Gallimard, pourvu que son directeur en transformât la teneur, la mît au-dessus ou en dehors de la politique ? Ce qui le refroidit, en revanche, ce fut la recension que Drieu y signa de La Pharisienne en septembre 1941, terrible par ses réserves quant à l’écrivain cette fois, et cruel quant à la noirceur jugulée de ce roman trop plein de son narrateur et trop sage au regard de ceux de Dostoïevski, leur commune admiration. Plus dures sont les conclusions de Notes pour comprendre le siècle (Gallimard, 1941) dont les astres en matière d’écriture catholique sont Rimbaud, Huysmans, Léon Bloy, Péguy, Claudel et Bernanos… Au printemps 1942, alors que Paulhan entendait prendre le contrôle de la NRF par un effet de billard à trois bandes, il crut possible de faire entrer Mauriac dans un nouveau comité de rédaction. Mais Drieu refusa net et laissa dériver encore le vaisseau amiral jusqu’au début 1943. Les ponts étaient alors coupés avec l’auteur du Cahier noir (3), ils se reverront pourtant aux funérailles parisiennes de Ramon Fernandez, le 5 août 1944, moins d’une semaine avant que Drieu ne tente de mettre fin à ses jours. Se parlèrent-ils ? C’est plus surement la mort de Drieu, le 15 mars 1945, qui pousse le dialogue à renaître. Mauriac, le 20, dans Le Figaro, se garde bien de hurler avec les loups de L’Humanité et de Front national. S’il juge durement les choix politiques de Drieu, il dit « l’amère pitié » que lui inspire la fin de « bête traquée » du combattant de 14, « ce garçon français qui s’est durant quatre ans battu pour la France, qui aurait pu mourir aux Dardannelles ». Mauriac n’en avait pas fini avec « Drieu, le beau, le prestigieux Drieu des années mortes (4). » Stéphane Guégan

(1) L’excellent Dictionnaire François Mauriac (sous la direction de Caroline Casseville et Jean Touzot, Honoré Champion Editeur, 2019, 150€) consacre l’une de ses notices les plus fournies à Drieu la Rochelle. Claude Lesbats y fait son miel des similarités de départ : milieu bourgeois, père disparu ou nié, collèges marianistes (erreur : mariste, dans le cas de Drieu), expérience écrasante de la guerre de 14… Il pointe les convergences des années folles, mais sacrifie banalement à la vulgate sartrienne (la haine de soi) ou à la thèse de l’homosexualité refoulée, cause supposée chez Drieu de son donjuanisme et de sa conversion au fascisme (lequel se voit presque réduit au culte de la force virile). Julien Hervier (Drieu la Rochelle. Une histoire de désamours, Gallimard, 2018) a déconstruit le mythe de l’inversion rentrée et donc sa valeur heuristique. Il eût plutôt fallu souligner la séduction physique que Drieu exerçait, sciemment parfois, sur les hommes de son entourage, autant que son libéralisme en matière de libido. Quant à son évolution politique et son attitude réelle sous l’Occupation, notamment l’aide qu’il apporta à Paulhan ou Colette Jéramec (sa première épouse, Juive de très bonne famille, qu’il sauva en avril 1943 de Drancy, et qui tenta de l’arracher en 1944-1945 aux Fouquier-Tinville de l’heure), il fait mentir les généralités du genre : « Chez Drieu la vision politique conditionne l’éthique individuelle, chez Mauriac la morale individuelle, fondée sur la foi, engendre l’engagement politique. » On ne saurait ignorer, par ailleurs, l’ancrage des choix de Drieu, en septembre 1940, dans les aspirations néo-socialistes, anti-capitalistes, anti-modernes, qu’il embrasse au cours de l’entre-deux-guerres (comme l’écrivait Pierre Andreu en 1958, « Drieu croyait à quelque chose »). La notice de Claude Lesbats minimise l’enthousiasme de Mauriac pour Blèche, Le Feu follet et Gilles, glose trop peu les articles que Mauriac a rédigés sur Drieu et, plus encore, ceux de Drieu sur Mauriac. Par exemple, sa magnifique contribution à La Revue du siècle, en juillet-août 1933 (« Signification sociale »), attribue à l’auteur du Désert de l’amour le terrible bilan de santé d’une bourgeoisie provinciale aux désirs aigres et nauséeux, au catholicisme rance. Il nous manque aussi, au-delà des travaux de Jean-Baptiste Bruneau, une évaluation complète des hommages réconciliateurs que Mauriac a rendus à Drieu après 1945. De manière dispersée, mais cohérente (notices Brasillach, Chardonne, Paulhan, né en 1884, et non 1886), le Dictionnaire Mauriac rappelle comment ce dernier, après avoir fait partie du Comité national des écrivains téléguidé par les communistes, s’en fit le pourfendeur véhément et irrésistible. Les notices consacrées à l’Occupation et à Temps présent ne condensent pas la richesse des recherches de Jean Touzot sur le Mauriac d’alors. Ces réserves faites, cet ouvrage de 1200 pages force l’admiration à bien des égards /// (2) Voir Jean-Luc Bitton, Jacques Rigaut. Le suicidé magnifique, Gallimard, 2019, et ma recension dans La Revue des deux mondes, « Tu éjaculais le néant », février 2020 /// Au sujet du Cahier noir, voir mon blog du 27 novembre 2016 /// Pour citer Claude Mauriac et l’une des superbes pages du Temps immobile.
Verbatim (de saison)
« Drieu est celui qui, dans une épidémie, est frappée plus complètement, plus définitivement que les autres – celui qu’il ne faut pas quitter d’une semelle si l’on veut comprendre. » (Ramon Fernandez, « Plainte contre inconnu par Pierre Drieu la Rochelle », N. R. F., janvier 1925)
« Je dis homme de droite en parlant de Drieu. Je sais que l’expression n’est pas exacte. Drieu était plutôt au centre, non pas au centre politique, mais au centre nerveux, au centre magnétique des attractions et des tentations d’une génération. Il ressentait très fort tous les courants, tous les passages de force d’une époque. » (François Mauriac, « Présence de Drieu la Rochelle », Défense de l’Occident, février-mars 1958)
Le mélodrame dans Cold War de Pawel Pawlikowski / Valentine Guégan

Cold War, réalisé en 2018 par Pawel Pawlikowski, confirme les liens de proximité et de distance que le cinéaste entretient avec le mélodrame. Dès la première scène, lorsqu’on voit un groupe de paysans polonais jouer un air traditionnel au beau milieu de la campagne enneigée, s’amorce l’ambiguïté esthétique qui fait la richesse de l’œuvre : un contexte proprement mélodramatique, musical, populaire; des personnages qui nous prennent à partie en nous regardant droit dans les yeux; une pure chorégraphie musicale (la caméra panote successivement sur chacun des musiciens à mesure qu’ils se relaient dans le chant) sans lien avec la diégèse; mais aussi, en contre-point, la sobriété d’une esthétique du « tableau » méticuleusement composé, une recherche de réalisme acerbe qui rappelle la carrière de documentariste de Pawlikowski. Ultime « anomalie » dans cette scène introductive potentiellement annonciatrice d’un mélodrame, le réalisateur ne la clôt pas sur les musiciens qui, leur numéro fini, s’effaceraient pour laisser place à la fiction; il révèle par un dernier panoramique un enfant au visage marquant la perplexité et l’incompréhension, qui contemple la scène. Extérieure à l’action, cette figure d’incompréhension annonce la non-identification des protagonistes à la « chorégraphie » de l’histoire. Cold War raconte en effet une histoire d’amour impossible entre deux musiciens, Wiktor et Zula, ballotés entre les deux « blocs » est/ouest au temps de la guerre froide. Nouveaux Roméo et Juliette, les personnages tentent de s’aimer des deux côtés d’un monde irréconciliable et leur malheur provient justement de ce qu’aucun lieu ne semble épargné par la bipartition, aucun espace n’est suffisamment neutre pour accueillir le désintéressement amoureux. Ce « manque d’espace » est au cœur du projet esthétique de Pawlikowski qui épouse, par sa mise en scène, l’idée de la passion manquée faute d’espace (ce qui devient en langage scénique: faute de cadre). Partant, le film s’apparente moins à un mélodrame qu’à son envers: il est l’histoire d’un mélodrame impossible car les ingrédients qui s’y rattachent sont dans un même temps résorbés, contenus, frustrés, les sentiments ne semblant pas trouver d’issue mélodramatique – spectaculaire et pathétique – pour s’épancher.
Cold War se rattache à un certain nombre de topoï mélodramatiques, au premier rang desquels une conception de l’amour absolu, transcendant et assimilable, sous certains aspects, au conte de fée. Le destin semble provoquer leur rencontre, au cours d’une scène où les personnages se « reconnaissent », saisis par l’évidence du coup de foudre: Wiktor, responsable d’une école de musique dont l’objectif est de former une troupe de musiciens folkloriques en l’honneur du parti soviétique, fait passer un casting afin d’en recruter les membres. C’est alors que Zula, l’une des candidates, s’impose à lui en dehors de toute rationalité (ses talents artistiques ne la distinguent pas particulièrement). Il dit d’elle qu’elle a « quelque chose », une grâce inexplicable. L’amour qui se développera entre Wiktor et Zula, de nature transcendante, apparaîtra durant tout le film comme la seule chose échappant au rationalisme (dans un monde où tout geste a une portée politique) mais aussi comme le domaine du « non-lieu » par excellence, résistant au temps et à l’absence (les personnages passent plus de temps séparés qu’ensemble). Cet amour absolu est aussi un amour « u-topique » au sens où aucun lieu ne semble être à même de l’accueillir.
Car le drame du film réside dans l’incapacité des personnages à choisir un lieu et à s’y ancrer. D’un côté ou de l’autre, le sacrifice semble trop lourd à porter. A l’Est, au sein de la troupe de musique, Viktor ne supporte pas la pression des autorités qui voudraient faire des spectacles une célébration de Staline, mais lorsqu’il s’installe à Paris et que Zula vient le voir, le déracinement et la stigmatisation qu’elle ressent en tant qu’étrangère rendent à Zula la vie infernale. L’espace est bien ce qui constitue, pour reprendre la formule de Jean-Loup Bourget (Le Mélodrame hollywoodien, 1985), « l’obstacle au bonheur » des personnages. Plus qu’un affrontement, la guerre froide est montrée comme étant un phénomène de politisation et de stigmatisation de l’espace, celui-ci étant sujet à une dichotomie que le film ne laisse pas de signaler. Ainsi les séquences à Paris font apparaître une ville d’émancipation, de licence, de désinvolture tandis que les séquences de spectacles à l’Est qualifient un espace de contrainte, de censure et de réglementation. Paris est montré dans tous les clichés qui lui sont attachés: des amoureux s’embrassant sur les bords de Seine, des cafés, des clubs de jazz où les corps se déchaînent. A l’Est, au contraire, c’est la rigueur, les formes rectilignes, la synchronisation. La musique redouble l’antithèse: à la frénésie créatrice et désordonnée du jazz s’oppose les chants populaires extrêmement ordonnés et mesurés, filmés par Pawlikowski comme une succession de tableaux à la composition figée.


Pour autant, le film ne s’en tient pas à la représentation d’un monde duel et encore moins ne prend le parti d’un côté plutôt qu’un autre. Si Paris métonymise le monde occidental et semble être un espace de liberté, les protagonistes n’y trouvent pas davantage le bonheur qu’à l’Est. Le film évacue ainsi tout manichéisme et finalement rejette la dichotomie car la tragédie de Cold War réside dans le fait que tout lieu est une entrave à la liberté et qu’il n’y a finalement pas d’espace pur. Se distanciant de la nature manichéiste du mélodrame, l’esthétique de Pawlikowski est davantage l’expression d’une quête tragique et sans fin d’absolu, une vaine tentative de sortie de la dialectique du bien et du mal, dans un monde incompatible avec de telles aspirations, où est exclue toute forme de spectaculaire, de pathos et dès lors, de mélodramatique. Pour traiter d’un drame « spatial », le réalisateur élabore une véritable problématique de l’espace dans la composition des plans et dans leur agencement, qui contrebalance sans cesse les accents mélodramatiques que l’on penserait voir s’affirmer. Les deux héros ont en effet rarement un « cadre » à eux-seuls, un espace d’isolement. Les quelques cadres qui leur sont propres sont eux-mêmes le signe d’une privation d’intimité: une scène d’amour dans les toilettes d’un train, une des scènes finales où Zula, ivre morte, s’échoue à ses côtés, une fois encore, dans des toilettes. L’espace des toilettes est l’indice marquant d’un amour réduit à la basse clandestinité et condamné à demeurer en dehors de la normalisation. Quelques autres scènes nous les montrent seuls: les séquences à Paris, une échappée dans une prairie qui a trait, pour un court instant, au lieu archétypal de la romance pastorale. Mais très vite les personnages se disputent, tout comme à Paris, ce qui laisse penser que leur amour, de nature clandestine, s’abîme dans l’intimité, car celle-ci leur révèle la nature illusoire de leur idylle. Aussi les deux héros ne bénéficient-ils pas de « favoritisme » visuel à l’écran, au sens où la caméra leur refuse l’intimité du cadre.

Ce qui permet au film de poser la question du rapport entre individualité et collectif en Europe de l’Est où tout participe à l’effacement de l’individuation. La mise en scène porte ainsi l’accent, durant les représentations de la troupe (à mesure que celle-ci se plie aux exigences du Parti) sur l’homogénéité des corps et des visages, souriants, unidirectionnels, soumis. Zula y est peu isolée par la caméra et pourtant, le spectateur ne doute pas que son attention est toute entière portée sur Wiktor qui, de l’autre côté, dans le hors-champ du chef d’orchestre, coordonne l’ensemble. Pawlikowski, refusant la commodité d’un découpage qui isolerait Zula et Wiktor du reste et satisferait le spectateur (habitué que nous sommes au cinéma à ce que le découpage différencie le tout du monde insignifiant et les protagonistes singularisés par l’intrigue), s’impose ainsi la même épreuve que celle infligée aux héros: expérimenter la possibilité d’une histoire individuelle, singulière, au sein d’une collectivité qui tend vers l’uniformité et l’abolition de l’intime. Par ailleurs, la sobriété est également de mise dans le jeu des acteurs. L’accent n’est jamais mis sur l’extériorisation des sentiments mais au contraire, sur la contenance et la retenue dont font preuve les personnages jusqu’au bout. Les visages sont souvent impassibles, peu expressifs, mais les regards longs et pénétrants, sans que le réalisateur explicite toujours « l’objet » du regard. Dans la scène de la petite réception qui succède à la première représentation de la troupe à Varsovie, Wiktor est adossé à un miroir mural avec une collègue, dans un grand angle qui laisse apercevoir la foule derrière eux. En réalité la foule se situe devant eux mais le miroir trompe le regard. Parmi cette foule indifférenciée, floutée à l’arrière-plan, Zula est assise à une table, sans que l’on puisse la discerner précisément. Pendant toute la longueur (assez conséquente) du plan, on ne sait pas si le regard de Wiktor est plongé dans la contemplation d’une chose en particulier ou tout à fait perdu vers l’horizon. Ce n’est qu’à la fin de la scène que la caméra révèle, en contre-champ, Zula en train de lui rendre son regard plein de désir.
Leur complicité est donc comprise rétrospectivement et « intellectuellement », comme c’est souvent le cas dans le film qui privilégie la pudeur, la discrétion et en appelle à la réflexion du spectateur au détriment de la dramatisation et de la mission première du mélodrame: émouvoir. En cela, la caméra répressive de Cold War laisse souvent le spectateur dans la frustration de ce qu’il voudrait voir. Pawlikowski s’en tient à montrer le strict nécessaire à la compréhension, éliminant tout le superflu, notamment dans son refus quasi systématique du champ/contre-champ. Il s’approprie le concept du « montage interdit » bazinien selon lequel le réalisme prend en ampleur et en valeur (au sens métaphysique du terme) sans découpage et sans montage car ainsi le mystère du réel demeure entier et l’intelligence du spectateur sollicitée pour le sonder. Ainsi, au montage qui explicite l’espace et les points de vue des personnages, le réalisateur substitue des longs plans fixes, épousant un unique point de vue, obligeant le spectateur à penser le hors-champ et parfois à douter de ce qui se joue. Le film trompe ainsi nos attentes, nos envies de romantisme justement héritées de la tradition mélodramatique. La caméra s’en tient à une frontière infranchissable ne permettant pas le raccord, laissant les personnages dans leur séparation. Ce choix du non-raccord peut se considérer comme étant la formule esthétique d’un film portant sur la séparation et la frontière.
Le fait de réduire le découpage à son utilisation la plus restreinte renforce aussi le sentiment d’immobilité produit par le plan long et fixe, sentiment qui semble être à l’origine du désespoir des personnages. La narration rend en effet visible une contradiction: le fait que les personnages, alors même qu’ils traversent une multiplicité de lieux et de décors (le film s’étale sur la période 1949-1959), éprouvent un sentiment permanent de « sur place », sentiment de stagnation qui les suit au fil des années et en dépit de leurs évolutions spatiales. Cette contradiction dément une fois de plus une des caractéristiques du mélodrame évoquée par Françoise Zamour dans Le Mélodrame dans le cinéma contemporain (2016): la tendance à considérer « le récit comme un parcours, une traversée, plus que comme un tableau ». Cold War porte davantage sur l’immobilisme, politique comme amoureux et s’apparente bien à un film-tableau, non à une traversée. Le tragique du film réside davantage dans le statu quo que dans l’évolution des choses et la transformation psychologique des personnages. La représentation de l’espace creuse la dichotomie des lieux, des cultures, des mentalités comme un état du monde enraciné. Rien ne laisse entrevoir une possibilité de changement. La structure cyclique du film, qui s’ouvre comme il se termine (dans une petite chapelle perdue dans la campagne polonaise) ne produit pas l’effet rassurant du retour à l’ordre évoqué par Jean-Loup Bourget au sujet de certains mélodrames. Ici, c’est la noirceur de l’ironie qui triomphe quand on comprend que cette chapelle où les personnages se rendent à la fin du film pour sacraliser leur union est l’endroit où Lech Kaczamrek, le supérieur de Wiktor dans l’école de musique, fervent staliniste, a uriné dans un des premiers plans du film. La construction cyclique, loin d’apaiser le spectateur, approfondie le sentiment désespérant de l’immuabilité de l’histoire (à petite et grande échelle).

Cette immuabilité est aussi le fait des personnages qui eux-mêmes ne sont pas des combattants, n’aspirent à aucun changement ou du moins, n’agissent pas dans ce sens. Aspirant à la liberté pour elle-même, ils ne la confondent avec aucune idéologie. D’ailleurs Zula épousera Lech, émanation de l’autoritarisme soviétique, et Wiktor lui devra sa sortie de prison à la fin du film, après qu’il a tenté de rentrer en Pologne en passant la frontière clandestinement. Tout ce à quoi les personnages aspirent, semble-t-il, c’est de changer de côté, inlassablement, pour mieux fuir le constat qu’aucun lieu n’est accordable à leur bonheur. Sur les mots de Zula, « allons de l’autre côté », le film se referme, laissant les personnages sortir du champ pour cadrer fixement leur banc vide. Cet « autre côté », perspective d’avenir toujours renouvelée et destinée à ne jamais donner satisfaction aux personnages, est précisément ce dont nous prive la caméra, dans un ultime refus du contre-champ. Bien plutôt le réalisateur nous invite à scruter le paysage du « côté » délaissé et nous imprégner de son absurde tranquillité. Ambiguïté de fin qui rappelle celle du début et est à l’image d’un film qui se distingue du mélodrame par son pessimisme politique fondamental mais s’y rattache indubitablement par sa croyance en l’absolu de l’amour, en la création artistique et la beauté, qui demeurent une issue, si tragique soit-elle, au prosaïsme. C’est ce que ce cadre final, où il n’est plus question d’hommes mais de nature, une fois les personnages sortis, semble offrir comme espoir à la contemplation du regard. Valentine Guégan


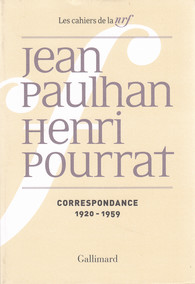


 De tous les hommes pressés de la Libération, Jean-Paul Sartre ne fut pas le dernier à prendre la parole et à se situer. Il le fit vite, il le fit bien. J’entends par là qu’il refusa de se dérober aux responsabilités que lui assignait son parcours sous l’Occupation, un parcours dont il dira lui-même – si on le lit bien au lieu de l’agonir bêtement – qu’il avait été aussi
De tous les hommes pressés de la Libération, Jean-Paul Sartre ne fut pas le dernier à prendre la parole et à se situer. Il le fit vite, il le fit bien. J’entends par là qu’il refusa de se dérober aux responsabilités que lui assignait son parcours sous l’Occupation, un parcours dont il dira lui-même – si on le lit bien au lieu de l’agonir bêtement – qu’il avait été aussi  Un mois plus tard, « Paris sous l’occupation » parut dans La France libre, mensuel né à Londres dès novembre 1940. Raymond Aron en était à la fois la tête pensante et la cheville ouvrière. De ce texte majeur, qui se rattache à la tradition des Choses vues d’Hugo et des
Un mois plus tard, « Paris sous l’occupation » parut dans La France libre, mensuel né à Londres dès novembre 1940. Raymond Aron en était à la fois la tête pensante et la cheville ouvrière. De ce texte majeur, qui se rattache à la tradition des Choses vues d’Hugo et des  Sartre notait enfin que le « mur », non content de couper le pays en deux, l’avait isolé de l’Angleterre et de l’Amérique. Ce fut une souffrance pour cet amateur de littérature et de cinéma anglo-saxons. Il put s’en gaver à nouveau lors du séjour rappelé plus haut. L’Office américain d’information sur la guerre lui permit ainsi de passer quelques mois entre New York et Los Angeles. Il lui était donné tout loisir d’observer la nation américaine dans ses ultimes efforts de guerre et les premiers moments de la Reconstruction. Sans négliger sa feuille de route, quitte à l’étendre aux sujets qui fâchent comme le « problème noir », Sartre glisse très vite du bilan impersonnel à la collecte d’impressions aussi vivantes que variées. Les bars, la rue, le cinoche, les filles… Il croise en chemin l’amour de Dolorès Vanetti et quelques artistes exilés, qui se préparent à rentrer…
Sartre notait enfin que le « mur », non content de couper le pays en deux, l’avait isolé de l’Angleterre et de l’Amérique. Ce fut une souffrance pour cet amateur de littérature et de cinéma anglo-saxons. Il put s’en gaver à nouveau lors du séjour rappelé plus haut. L’Office américain d’information sur la guerre lui permit ainsi de passer quelques mois entre New York et Los Angeles. Il lui était donné tout loisir d’observer la nation américaine dans ses ultimes efforts de guerre et les premiers moments de la Reconstruction. Sans négliger sa feuille de route, quitte à l’étendre aux sujets qui fâchent comme le « problème noir », Sartre glisse très vite du bilan impersonnel à la collecte d’impressions aussi vivantes que variées. Les bars, la rue, le cinoche, les filles… Il croise en chemin l’amour de Dolorès Vanetti et quelques artistes exilés, qui se préparent à rentrer…  À sa mort, en 1924, il n’était déjà plus que l’homme d’un seul tableau, qui datait des années glorieuses. Jean Geoffroy avait choisi son heure pour exposer Le Jour de visite à l’hôpital, le Salon de 1889 coïncidant avec le centenaire de la grande révolution. Son tableau, qui pinçait la corde sensible avec une retenue dont le peintre n’était pas coutumier, montre un prolétaire endimanché au chevet de son fils dont l’immense lassitude est merveilleusement rendue. Un léger sourire flotte sur ce beau visage fiévreux aux yeux clos. La pâleur de l’enfant, d’abord inquiétante, s’accorde en fait à la blancheur dominante, heureuse, du tableau. C’est qu’il s’agit de montrer avec éclat combien la santé et l’hygiène publiques sont désormais une des priorités de la République radicale. Paul Mantz, vieux romantique converti au réalisme et ancien directeur des Beaux-Arts (1881-1882), pouvait y aller d’un commentaire très favorable : « Il y a du sentiment dans cette peinture, mais une sorte de sentiment silencieux et sans gestes. Le tableau est très moderne, et c’est un des meilleurs que M. Geoffroy nous ait encore montrés. » Mantz ne se trompait pas puisque Vuillard et
À sa mort, en 1924, il n’était déjà plus que l’homme d’un seul tableau, qui datait des années glorieuses. Jean Geoffroy avait choisi son heure pour exposer Le Jour de visite à l’hôpital, le Salon de 1889 coïncidant avec le centenaire de la grande révolution. Son tableau, qui pinçait la corde sensible avec une retenue dont le peintre n’était pas coutumier, montre un prolétaire endimanché au chevet de son fils dont l’immense lassitude est merveilleusement rendue. Un léger sourire flotte sur ce beau visage fiévreux aux yeux clos. La pâleur de l’enfant, d’abord inquiétante, s’accorde en fait à la blancheur dominante, heureuse, du tableau. C’est qu’il s’agit de montrer avec éclat combien la santé et l’hygiène publiques sont désormais une des priorités de la République radicale. Paul Mantz, vieux romantique converti au réalisme et ancien directeur des Beaux-Arts (1881-1882), pouvait y aller d’un commentaire très favorable : « Il y a du sentiment dans cette peinture, mais une sorte de sentiment silencieux et sans gestes. Le tableau est très moderne, et c’est un des meilleurs que M. Geoffroy nous ait encore montrés. » Mantz ne se trompait pas puisque Vuillard et