
C’est parfois en écrivant qu’on devient écrivain, et c’est assurément en guerroyant qu’on se découvre soldat. Daniel Cordier (1920-2020) sera mort avec la conviction de n’avoir pas écrit, au sens plein, et le regret de ne pas s’être assez battu. Le lecteur enthousiaste de ses Mémoires, magnifiques d’élan et de cran comme le fut son existence, butte sans cesse sur l’amertume de l’ancien résistant, qui se pensait incapable de littérature et eût préféré tuer des « boches » aux missions du renseignement, bien qu’elles l’aient associé à l’homme qu’il admira le plus au monde, Jean Moulin. Mauvais juge de ce qu’il aura accompli lui-même, aidé en cela par les conflits internes de la France libre dont il reste un des témoins les plus sûrs, Cordier laisse une œuvre. Même si on le soupçonne ici et là de ne pas avoir pu tout dire, il est parvenu à imprimer au récit de sa vie l’authenticité d’un vrai diariste et l’éclat d’un roman à multiples rebondissements. Chocs politiques et chocs esthétiques furent vécus et sont présentés comme autant de révélations qui engageaient l’essentiel. La foi maurrassienne de son adolescence […] s’était effondrée en juin 40, l’évolution de l’Action française achevant de le convertir à De Gaulle et à Londres, où l’attendaient deux ans de formation et l’amitié de Raymond Aron.

Suite d’Alias Caracalla, La Victoire en pleurant refait l’aveu du péché d’extrême-droite devant les zizanies de la Libération. On y trouve également les traces d’un autre culte naissant, la peinture, découverte au Prado, en mai 1944. Entre l’arrestation de Moulin et le démantèlement du groupe de Cordier, « brûlé » dès la fin 1943, il s’écoula quelques mois. Il lui faut rentrer à Londres par l’Espagne, long et harassant détour. Mais la récompense, imprévisible, ce fut Greco, Velázquez, Goya. […] Caracalla a reçu en pleine poitrine la décharge du Tres de Mayo, et l’aura fantomatique des Ménines a réveillé tant de camarades effacés, exécutés ou déportés on ne sait où. Porteuse d’une tragédie plus haute ou d’une barbarie éternelle, la peinture lui offre plus qu’un réconfort provisoire. D’autres futurs, d’autres combats s’annoncent soudain, que rien n’entravera, à commencer par la pagaille qui entoure en 1945-46 les règlements de compte de la Libération, au sein même des vainqueurs, et la démission de De Gaulle. Le troisième volet des Mémoires de Cordier, Amateur d’art, débute à cette époque ; il quitte alors le cabinet du colonel Passy et les services secrets. Stéphane Guégan, « Caracalla ouvre boutique », lire la suite dans La Revue des deux mondes, mai-juin 2024 / Daniel Cordier, Amateur d’art, 1946-1977, édition préfacée, établie et annotée par Bénédicte Vergez-Chaignon, Gallimard, 2024, 23€. Les deux premiers volumes de ses Mémoires sont désormais disponibles dans la collection Folio.
ENTRE-DEUX-GUERRES
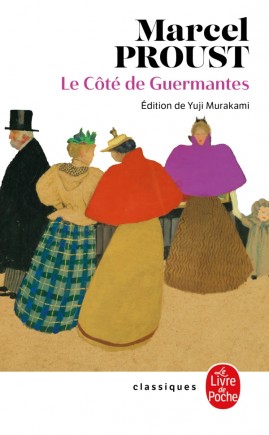
D’abord à deux temps, la Recherche de Proust s’en donne un 3e au début de 1912. Ainsi naît Le Côté de Guermantes et se déploient, entre rires et larmes, l’entrée dans le monde et la sortie de l’innocence, en deux temps aussi, du Narrateur : décès de la grand-mère, soit la perte inconsolable de la mère, et décès (annoncé) de Swann, soit la conquête du beau à relever. La toile de fond du théâtre proustien, à ce stade, nous ramène à 1898 : après en avoir rêvé, le Narrateur accède aux salons du faubourg Saint-Germain, il en exalte la grandeur généalogique autant qu’il en vitriole les vanités (le snobisme de la naissance). D’un côté, l’éclat d’un monde qui croit survivre à son déclin par fanatisme de race, selon le mot que Proust décline ; de l’autre, le séisme de l’affaire Dreyfus et les comportements souvent asymétriques qu’elle enclenche. Yuji Murakami en est le meilleur connaisseur. Son édition de Guermantes donne un bel avant-goût du livre qu’il prépare sur le sujet, central dès Jean Santeuil et promis à innerver, comme la guerre de 14 et surtout l’homosexualité, le reste de La Recherche. Dans son édition de Sodome et Gomorrhe, qui paraît aussi au Livre de poche, Alexandre de Vitry commence par rappeler sa solidarité avec Guermantes, dont le volume II, en 1921, s’étoffait contre toute attente d’une brève extension consacrée aux « descendants de ceux des habitants de Sodome qui furent épargnés par le feu du ciel ». C’est l’amorce et l’annonce d’une nouvelle relance du récit, dont Charlus et Albertine seront les principaux instruments. Le fou de Balzac et Baudelaire qu’était Proust se fait biblique et, à l’occasion, priapique, en se refusant au blâme et à l’éloge, exclus de son régime de vérité, et de son approche polyfocale du monde et de sa propre sexualité. Pas plus qu’il ne catégorise, résume Vitry, Proust ne catéchise, plus proche de Vautrin que du Corydon (1920) de Gide. SG Marcel Proust, Du côté de Guermantes, édition de Yuji Murakami ; Sodome et Gomorrhe, édition d’Alexandre de Vitry, Le Livre de poche, sous la direction de Matthieu Vernet, 10,90€ et 9,90€. Chaque volume est doté d’un substantiel appareil de notes et d’un dossier.

Avant que, centenaire oblige, le Manifeste du surréaliste ne réveille en fanfare l’œcuménisme bébête dont bénéficient encore son auteur, son groupe et leur « aventure », relisons les trois lettres, rendues publiques, que Drieu adressa à Aragon et aux siens entre août 1925 et juillet 1927. Bertrand Lacarelle les a réunies, il les éclaire d’une préface alerte et les agrémente de textes contemporains. Entre la première et la dernière, Aragon et Breton ont cédé aux sirènes du communisme, c’est-à-dire à la double fascination fractionnelle (rupture avec sa classe, convergence des violences, avant-gardiste et politique). Le peuple est le cadet de leurs soucis. La Lettre ouverte à Paul Claudel, en janvier 1925, s’était même abaissée à idéaliser l’Orient sotto voce, exotisme de potache supposé conforter l’horreur de la France et l’anticléricalisme dont le surréalistes font profession. Tout cela sidère Drieu, qui a marché avec eux tant que « le culte du tumulte » visait à rétablir de vraies valeurs sur les ruines fumantes de 14-18. Mais voilà que ses petits camarades brandissent l’antipatriotisme et l’irresponsabilité morale comme les hochets d’une révolte dérisoire. Moscou et ses agents parisiens n’attendaient que cela pour les mettre au pas. Lacarelle pense que Drieu a été probablement tenté par le communisme, je dirais plutôt qu’il eut rapidement toutes les raisons de résister à cette pulsion. Dès mars 1921, il dit son fait aux nouvelles formes de l’autoritarisme politique, indifférent aux véritables révolutions sociales et économiques : réactionnaires, démocrates, socialistes and, last but not least, bolcheviques sont pointés du doigt, le même doigt qui, à la mort de son ami Raymond Lefebvre, maurrassien passé à l’Est, ou de Jacques Rigaut, victime lui de ses « amis » surréalistes, tracera une croix sombre sur les « erreurs » où mène le sacrifice de sa conscience. SG / Pierre Drieu la Rochelle, Trois lettres aux surréalistes, édition de Bertrand Lacarelle, Les Cahiers de la NRF, 17,50€. Sur l’été 1926, crucial dans cette brouille, voir ma présentation de Drôle de voyage (qu’Aragon crucifia en bon stalinien) dans Drieu la Rochelle, Drôle de voyage et autres romans, Bouquins, 2023).

« Solitaire, nomade et toujours étonnée… » Le 4 avril 1936, depuis Bruxelles, Colette décrit ainsi Anna de Noailles dont elle occupe désormais le fauteuil au sein de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Hommage dans l’hommage, elle a emprunté à la dolente poétesse qu’elle salue par-delà la mort ce vers baudelairien. L’étonnement, en mode actif ou passif, fut le mot de passe des modernes. Et celle dont Valère Gille, lors de cette séance enregistrée, dit qu’elle fut « audacieusement romantique et foncièrement romantique » se l’applique à son tour. « Où aurais-je puisé, dans ma carrière, autre chose que de l’étonnement ? » Ne s’enfermer dans aucune routine, entretenir le doute de soi, Colette, à 63 ans, distribue ses recettes de jeunesse et d’écriture avec une émotion non feinte. Le 33e fauteuil, qu’elle illustrera encore 18 ans, accueillerait son dauphin en 1955, Jean Cocteau, dont Proust, Diaghilev, Picasso et Radiguet n’eurent pas à beaucoup stimuler la force d’envoûtement. Ces deux élections, la cordée qu’elles nouent, et le symbole que personnifiait Colette, plume sensuelle et dissidence sexuelle, sont tour à tour commentés, chacun avec sa sensibilité propre, par André Guyaux, Bénédicte Vergez-Chaignon et Antoine Compagnon. Puis, comme un phonographe, ce remarquable Colette à l’Académie ressuscite les voix facétieuses, si françaises par le style de conversation, des complices du Palais-Royal. La Belgique de Sido, ne l’oublions pas, en abrita et démultiplia les échos… Heureuse de rejoindre le panthéon des grands aînés, Colette n’a jamais désespéré de ceux qui venaient. Fin 1934, elle écrivait ceci d’un ami de Bertrand de Jouvenel, son ex-amant et le directeur de La Lutte des jeunes, revue étonnante : « Souvent, j’écoute mes cadets parler de Drieu avec feu, et j’y puise une certaine mélancolie, moi qui ne l’aime que parce qu’il a beaucoup de talent. » Pour Colette et Cocteau, vieillir, c’était trahir. SG / Antoine Compagnon, de l’Académie française, André Guyaux, Bénédicte Vergez-Chaignon, Laurence Boudart, Jean Cocteau, Colette, Valère Gille, Colette à l’Académie, Académie royale de langue et de littérature françaises, 2023, 17€.

Si Aragon fut antimunichois sur ordre de Moscou, Drieu l’est par patriotisme, respect de la parole des Français envers la Tchécoslovaquie et profonde sympathie pour Edvard Bénès, qu’il a rencontré à Paris fin 1933. A rebours de Morand, Emmanuel Berl et Giono, partisans des Accords, sans être bien sûrs qu’ils éviteront une nouvelle boucherie, mais préférant cette infime chance de paix à la crainte de provoquer ou de précipiter la guerre, d’autres écrivains, de Montherlant à Julien Green, stigmatisent la politique de l’apaisement, où Chamberlain s’aveugle en croyant se grandir, utopie qui condamne la Bohème redessinée par le traité de Versailles à l’abattoir. L’indécision de Daladier le plongera dans un enfer tout autre, celui d’un très long remords. De ce qui fut une faute morale et un échec politique, Maurizio Serra rouvre le dossier en se gardant de juger de haut. Le procès vertical du passé, l’indifférence à ses multiples paramètres et au moi de ses acteurs, n’est pas de bonne méthode en Histoire. Avant d’y revenir plus longuement dans une prochaine livraison de Commentaire, il faut souligner le réexamen du rôle de Mussolini, précoce et tenace rempart à Hitler, auquel se livre Serra. Le quatrième homme, humilié par l’Anschluss de mars 38, était peut-être le plus déterminé à arrêter le Führer. SG / Maurizio Serra, de l’Académie française, Munich 1938. La Paix impossible, Perrin, 2024, 24€.

Parution,
le 16 mai 2024,
à l’occasion de la Quinzaine de la Pléiade.



