
La caricature, Marius de Zayas (1880-1961) en fut l’un des maîtres, il en est désormais la victime expiatoire. Il paie de sa réputation, de sa postérité, le désaveu actuel, massif, du primitivisme européen des années 1910-1930 où l’on ne veut plus voir qu’appropriation esthétique et racisme déguisé. Le monde de l’art contemporain, ce village aux intérêts bien compris, s’est dé-mondialisé à cet égard. Les mêmes qui chantaient la rencontre entre art occidental et art non-occidental, voilà encore un demi-siècle, sont les premiers à stigmatiser l’époque, de Gauguin à la mort de Picasso, où elle triompha, ce frottement des cultures devenant alors gage d’authenticité reconquise, d’innocence retrouvée ou encore de sacré possible. Le tout avait conditionné ce que l’on nommait assez naïvement, avant la guerre de 14, la libération des formes. Autres temps, autres heurts. Artisan essentiel des premières expositions new-yorkaises d’art africain à partir de novembre 1914, avec la complicité de Paul Guillaume et donc d’Apollinaire, Marius de Zayas assortit ce coup de force d’un livre qui ne passe plus… Le fait est qu’African Negro Art : Its Influence on Modern Art (1916) reste largement tributaire de l’anthropologie globalisante et racialiste du XIXe siècle, à l’aune de laquelle l’Afrique noire, souffrant d’un niveau d’évolution retardataire en raison de son milieu naturel et social, n’aurait pu encore développer une capacité analytique et représentative égale à celle des Européens. Marius de Zayas ne dépréciait pas en totalité la « vie purement sensorielle » de cette humanité restée dans l’enfance et la superstition : elle est, selon lui, la chance de leurs artistes, anonymes et admirables. L’intellectualisme, la sophistication, a tué l’art occidental, tournons-nous vers ceux pour qui la statuaire est extériorisation puissante des affects et des croyances, construction intérieure et non plate imitation. On ne saurait plus aujourd’hui soutenir un tel évolutionnisme, plus proche de Lévy-Bruhl que de Lévi-Strauss, bien que rien n’interdise d’en suivre les ramifications diverses chez d’autres figures, hautement valorisées elles, de l’avant-garde. Ne prenons qu’un exemple, tiré de l’entourage même de Marius de Zayas, Guillaume Apollinaire. En décembre 1907, au sujet de Matisse qui les collectionne, il écrit : « les statuettes des nègres africains [sont] proportionnées selon les passions qui les ont inspirées ». Il parle, ailleurs, le grand Pan en tête, de « passions paniques ». Ou encore de « fétiches [qui] ressortissent tous à la passion religieuse qui est la source d’art la plus pure ».

Il y a plus. Dans « Mélanophilie et mélanomanie » (Mercure de France), le 1er avril 1917, tout en critiquant la flambée spéculative qu’il entretient lui-même par ses liens très actifs avec le marché, Apollinaire ne se borne pas à souligner le fait que sa génération a été la première à « considérer ces idoles nègres comme de véritables œuvres d’art ». Il se désolidarise de Gobineau mais en accepte l’idée que les descendants de Cham ont joué un rôle prépondérant « en ce qui concerne, dans l’histoire des progrès humains, la naissance et le développement du sentiment artistique ». À partir de mai 1918, toujours militaire malgré les séquelles de sa terrible blessure de 1916, il est affecté au ministère des colonies où il encourage, d’une ardeur inentamée, à « cataloguer les pièces d’art nègre par régions et parfois par ateliers ». Bref, la ligne de partage entre Marius et Guillaume, que durcit trop le dernier livre de Philippe Dagen (Primitivisme II. Une guerre moderne, Gallimard, 2021) n’a pas l’étanchéité qu’on lui prête. Les choses se compliquent un peu plus lorsqu’on réalise que le caricaturiste, bien avant d’immortaliser son cercle, de Stieglitz et Steichen à Apollinaire justement, eut des débuts très politiques, stigmatisant aussi bien le dictateur mexicain Porfirio Diaz, les prémisses du génocide arménien et les lois ségrégationnistes en vigueur au Sud des Etats-Unis. Nous l’apprenons de la lecture de l’ample publication que Rodrigo de Zayas, le fils de Marius, vient de lui consacrer. Sous le même coffret, elle propose le survol d’une vie et d’une carrière autrement plus riches que nous le pensions, combiné à la première traduction française d’un manuscrit mythique, rédigé à la demande d’Alfred Barr, le directeur du MoMA (Quand, comment et pourquoi l’art moderne est allé de Paris à New York).

Rejeton d’une ancienne famille sévillane qui fit souche à Cuba et au Mexique, où Marius voit le jour en 1880, il hérita d’une solide fibre libérale : la fidélité aux Lumières françaises s’entrelaçait à l’expérience de ses aïeux frottés aux révolutions qui disloquèrent l’ancien empire colonial espagnol. L’autre tropisme familial, c’est la presse engagée et illustrée, tournée assez vite vers la communauté hispanophone d’Amérique. Dès avant la chute de Diaz, la famille de Marius quitte le Mexique sous la menace. Nous sommes en 1907 et notre homme dessine déjà en maître. Son trait, encore très Belle-Epoque quelques années plus tôt, se débarrasse soudain de toute joliesse et presque de toute rondeur en dehors des lignes qui dynamisent à l’extrême chaque planche. Au New York Evening World, il croque bientôt la vie mondaine et situe sa satire sociale entre Sem et le Juan Gris précubiste des instantanés parisiens. En 1910, deux premières : son mariage et la découverte de Paris. Le rapprochement avec Stieglitz s’est déjà opéré, et la petite galerie du génial photographe, au 291 de la Ve avenue, a déjà exposé les caricatures du premier avec succès, après Rodin et avant Matisse… À Paris qui en regorge sous toutes les formes, Marius cartographie assez vite le cubisme. À distance, il rend possible l’exposition Picasso qui, en mars-avril 1911, lance définitivement la galerie de Stieglitz. Le catalogue reprend les éléments d’un entretien crucial que le peintre avait accordé à Marius de Zayas : « Picasso tente de produire, au travers de son œuvre, une impression non pas du sujet mais de la manière dans laquelle il l’exprime. […] il veut que le spectateur recherche l’émotion, ou l’idée produite par le spectacle, non pas le spectacle lui-même. […] Il ne couche pas sur la toile le souvenir d’une sensation passée ; il décrit ainsi une sensation présente. »

Les années 1912-1914, galvanisées par l’Armory show et le choc de l’exposition africaine, le voient agir sur tous les fronts. La galerie 291, où il expose ses dessins ciselés et ses amis, y est pour beaucoup. Picabia devient l’un d’eux. De ce dernier, qui prend congé du cubisme à l’ombre des gratte-ciel de la ville verticale, Marius de Zayas disait que, tel Cortès, il avait brûlé ses vaisseaux derrière lui. En 1915, c’est l’ouverture de la Modern Gallery, centre de toutes les attentions durant la guerre. Avant de s’affranchir de Stieglitz, Marius de Zayas lui rend hommage dans Camera Work et, au sujet du photographe qui « en cherchant le vrai […] devint créateur », cite Boileau : « Rien n’est beau que le vrai ». Puis viennent les expositions Picabia, un Picabia aux « machines pour rire », Van Gogh, Diego Rivera, Derain, Marie Laurencin, Vlaminck… Sa seconde exposition d’« art nègre » fit autant de bruit que la plaquette controversée déjà mentionnée (Fernand Léger devait y puiser une partie de l’inspiration de La Création du monde). Ses coups de chapeau aux caricaturistes et aux dessinateurs de mœurs marquèrent aussi les esprits. En 1917, Jos Hessel, via Paul Guillaume, lui prête des peintures de Lautrec, il ajoute une poignée de Daumier et quelques Constantin Guys. Dans The New York Sun du 11 février 1917, Henry McBride se fait manifestement son porte-parole : « Baudelaire nous dit que nous devons considérer Guys comme un homme-enfant, comme un homme à chaque minute en possession du génie de l’enfance, un génie pour lequel aucun aspect de la vie n’est jamais défraîchi. Et que s’il était souvent bizarre, violent, excessif, il était toujours poétique et savait concentrer dans ses dessins, en même temps que l’amertume, la saveur exaltante du vin de la vie. » Après que la Modern Gallery eut périclité et avant qu’un second mariage ne l’éloigne de la rat race, comme l’écrit son fils, Marius organisera, chant du cygne, une exposition tri-nationale notable entre Paris (Durand-Ruel) et New York (Wildenstein Galleries). Plus tard, croisant Alfred Barr à Paris, il lui promettra, nous l’avons dit, une chronique du mouvement moderniste tel qu’il l’avait vécu et largement servi. Elle sera remise en 1947 au directeur du MoMA et se compose essentiellement de coupures de presse. Un demi-siècle de plus s’écoulera avant que ce document très précieux ne soit publié aux Etats-Unis, non sans avoir perdu la mention de Paris dans son titre. Les Américains sont incorrigibles… Sa traduction nous est enfin offerte, et elle a rétabli la bonne itinérance ! Paul Guillaume, qui lui avait confié sa collection d’art africain en 1914, 18 pièces de Côte d’Ivoire et du Gabon, disait de Marius de Zayas à Tristan Tzara : « C’est l’homme le plus répandu des milieux avancés des États-Unis. » Nous sommes désormais mieux équipés pour le mesurer et d’autant plus regretter l’hypothèque que fait peser sur notre homme, l’artiste comme l’influenceur infatigable, le livre de 1916.
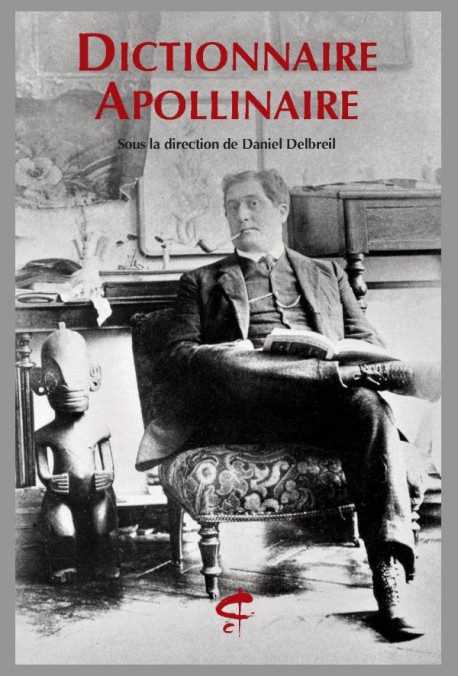
L’amnésie volontaire des historiens de l’art envers Marius de Zayas, écarté de certains livres récents sur Picabia, n’a pas cours dans le très utile Dictionnaire Apollinaire qu’a dirigé pour les éditions Honoré Champion Daniel Delbreil. De son propre aveu, l’esprit de l’ouvrage reste celui des travaux décisifs de Michel Décaudin. Une équipe internationale de 50 chercheurs, reflet direct de la gloire de ce poète si français hors de nos frontières, a planché avec sérieux et connaissance d’une bibliographie pléthorique, plus tournée toutefois vers la littérature que les arts visuels. Qu’on se rassure, ils sont loin d’être oubliés ici. Maintes notices touchent aux artistes, galeristes, collectionneurs, expositions en tout genre, puisque le journaliste très prolixe que fut Guillaume les couvrit sans exclusive. Raison pour laquelle une de ses chroniques de Paris-Journal, en juillet 1914, fait grand cas des caricatures de Marius de Zayas, accordées qu’elles sont « avec l’art des peintres contemporains les plus audacieux ». Belle, très belle, fut « l’amitié immédiate » qui jaillit entre les deux hommes au printemps précédent, alors que l’agent de Stieglitz est de retour en ville. La notice de Willard Bohn a raison d’y insister, car cette manière de coup de foudre portera loin. En juin 1914, Picabia a servi d’intermédiaire, et Les Soirées de Paris de catalyseur. La « plus moderne des revues actuelles » bénéficiait depuis un an de la nouvelle impulsion que lui donnaient Apollinaire et ses éminents acolytes, Serge Férat et Hélène d’Oettigen, auxquels notre époque rend enfin justice. Prenant tous les risques, la revue rajeunie fera des émules. Avant Nord-Sud et SIC, 291, par la volonté de Marius de Zayas, devait naître à New York un an plus tard. Les calligrammes dont Les Soirées de Paris furent le laboratoire traversèrent ainsi l’Atlantique sur leurs ailes d’imprimerie, ainsi que quelques caricatures de Marius de Zayas qui valaient les meilleurs portraits. Ce ne fut pas le seul fruit du transfert essentiel dont le poète et son ami américain restent les symboles. Tant que dura son second séjour parisien, Marius de Zayas roula toutes sortes de projets, l’un d’eux eût consisté à réunir les textes d’Apollinaire sur le douanier Rousseau afin d’accompagner de cette plaquette une exposition, en plein Manhattan, du primitif de l’intérieur. À défaut, les deux complices se colletèrent à cette pantomime un peu folle, mais au titre révélateur de la primauté française, À quelle heure un train partira-t-il pour Paris ? Cette farce n’avait pas besoin de mots pour broder sur toutes sortes de mythes, avec une nette préférence pour les ébats dionysiaques. Deux piments notoires y mêlaient leur charge tonique, la musique d’Alberto Savinio (frère de Chirico et acteur clef de cette avant-guerre) et les décors de Picabia et Marius de Zayas. Le spectacle eût sidéré le nouveau monde où notre quatuor rêvait de le transporter, mais le fracas des armes en décida autrement. La guerre, si elle mit fin au rêve américain d’Apollinaire, investit Marius de Zayas du devoir de relève. La Modern Gallery et la revue 291, dès 1915, en seraient les leviers.

Quoique venu tard à Apollinaire, je comprends qu’on puisse s’y attacher tôt et ne jamais s’en détacher. Baudelaire, Gautier, Verlaine, Rimbaud et Germain Nouveau m’en ont longtemps écarté, mais je me suis rattrapé, et je tiens Alcools pour l’un des cinq plus beaux livres de la poésie française, je donnerai même tout le surréalisme, Le Paysan de Paris compris, pour ce recueil dont certains exemplaires de l’édition originale ont été corrigés par l’auteur avant envoi. Les fétichistes comprendront toute l’émotion que peuvent contenir ces pattes de mouche… C’est dire que l’improvisation et l’incurie étaient peu du genre d’Apollinaire, joueur et jouisseur sérieux en tout. François Sureau, à le lire, lui doit plus qu’un compagnonnage lyrique, il parle d’un véritable « déplacement d’air » qui n’aurait pas molli depuis l’adolescence, lorsqu’il s’enticha, au sens presque amoureux, du poète. La passion littéraire, à 15-16 ans, ne pardonne pas, elle exige un certain mimétisme, ou frôle le culte. De la fameuse photographie prise dans l’atelier de Picasso croisée au lycée (elle sert de couverture au Dictionnaire Champion), Sureau retint la pipe Gambier et le costume à la fois strict et déstructuré. Mode et modernité s’épousent toujours. Quant au Tiki des îles Marquises, bien sage à gauche, c’est le mystère du monde que les poètes et les jeunes gens ont en partage. Comment défaire de pareils nœuds ? À la vie, à la mort… Ainsi Apollinaire, tel le fantôme des Cerfs-volants de Romain Gary (son dernier et meilleur roman), n’a-t-il jamais quitté Sureau d’une semelle. Alors que le service militaire l’appelle sous les drapeaux, le souvenir remonte de la Case d’Armons, du « ravissement sincère » (Francis Ponge), que l’artilleur, puis l’officier d’infanterie, connut en 14, lui qui se fit de France, en se battant pour elle. La chose militaire importe à Sureau qui en parle avec une sobre intensité, en homme de terrain, de territoire. « Il y a de belles ordures dans Calligrammes », braillait le jeune Aragon, qui découvrira le patriotisme sur le tard. De l’or dur, plutôt. Et du plus fin. Pour être « l’âme de la patrie », les poètes sont aussi nos frères en vagabondage, mot qui résumait Apollinaire pour Paul Léautaud (petit génie qui imposa Alcools au Mercure de France). Le goût des voyages décentrés, des saisons mortes, des lieux oubliés, des mémoires résiduelles, ce goût parcourt le livre de Sureau, qui se teinte aussi du mysticisme, assez catholique, dont Apollinaire et sa singulière piété devinaient la présence derrière les rébus de Picasso. Cet hommage à l’amitié que forgent nos premières lectures n’oublie pas que Guillaume eut sa bande et, parmi elle, ses favoris. On voudrait qu’il eût écrit au sujet de Marius de Zayas, né en 1880 comme lui, ces lignes du Poète assassiné : « quand la porte s’ouvrit ce fut dans la brusque lumière la création de deux être et leur mariage immédiat. » Car cette double reconnaissance – l’amitié vraie n’est que cela – eut bien lieu, et Sureau mentionne la pantomime avortée de 1914 comme une de ses expériences collectives où Apollinaire puisait son « eau de vie ». Aucune raison, après cela, de croire à la fin de l’ivresse. Ne serait-ce pas la morale de ce livre écrit en temps de pandémie ? Tout est merveille dans la vie, foi de poète. Stéphane Guégan
*Rodrigo de Zayas, Marius de Zayas / Marius de Zayas, Quand, comment et pourquoi l’art moderne est allé de Paris à New York, deux livres sous coffret, près de 500 illustrations, Editions / ATELIER BAIE, 97€. Cette publication, qui ne se veut pas universitaire, n’est pas sans petits flottements quant à l’information factuelle, le cheminement du propos, les légendes et origines des images, elle n’en constitue pas moins la plus récente et courageuse tentative de se ressaisir d’un acteur essentiel et controversé du mouvement moderne. Un autre livre demande à exister, celui qui rassemblera, avec appareil critique, l’ensemble des textes de Marius de Zayas ! Quant aux positions d’Apollinaire en matière d’art africain, le bilan le plus fin reste celui de Francine Ndiaye, « Guillaume Apollinaire, Paul Guillaume et l’art « nègre » : défense et illustration », in Apollinaire critique d’art, Paris-Musées / Gallimard, 1993.
**Daniel Delbreil (sous la direction), Dictionnaire Apollinaire, Honoré Champion, 35€. Willard Bohn consacre une bonne notice à « L’Art nègre », étrangement dé-corrélée de celle qu’il consacre à Marius de Zayas, laquelle ne fait pas état, plus étrange, de ses liens avec Paul Guillaume et de leur passion commune pour la statuaire africaine. Bien qu’il s’en tienne aux positions du poète en matière de « mélanophilie » et aux fluctuations du langage où elle s’exprime, il n’eût pas été inutile de rappeler qu’elles rejoignent à certains égards celles de Marius de Zayas. « Zone », au seuil d’Alcools, chante « les fétiches d’Océanie et de Guinée », ces « Christ d’une autre forme et d’une autre croyance ».
***François Sureau, Ma vie avec Apollinaire, Gallimard, 16 €.

 L’esthétique du quotidien ne concerne pas seulement le soin attendrissant, au dire d’Henri de Régnier, avec lequel Mallarmé, dès sa jeunesse, a meublé et orné son intérieur malgré de faibles moyens. «Décorer, écrit Barbara Bohac, est pour le poète une manière d’habiter le monde, de le rendre perméable au rêve.» Les mardis de la rue de Rome auraient perdu une part de leur attrait si les murs du petit appartement n’avaient exhibé quelques Manet, peintures et estampes, autour du fameux poêle. Un certain éclectisme régnait à Paris et Valvins, où l’avant-garde picturale et le kitch de la porcelaine de Saxe faisaient cause commune. De même qu’il n’assigne pas aux beautés visibles un espace réservé, louant aussi bien l’estampe japonaise que les meubles néo-Renaissance de Fourdinois, poussant à égalité la mode vestimentaire sous la IIIe République et la peinture la plus décriée, Mallarmé ne conçoit pas sa poésie comme étrangère à cet univers matériel. À rebours de
L’esthétique du quotidien ne concerne pas seulement le soin attendrissant, au dire d’Henri de Régnier, avec lequel Mallarmé, dès sa jeunesse, a meublé et orné son intérieur malgré de faibles moyens. «Décorer, écrit Barbara Bohac, est pour le poète une manière d’habiter le monde, de le rendre perméable au rêve.» Les mardis de la rue de Rome auraient perdu une part de leur attrait si les murs du petit appartement n’avaient exhibé quelques Manet, peintures et estampes, autour du fameux poêle. Un certain éclectisme régnait à Paris et Valvins, où l’avant-garde picturale et le kitch de la porcelaine de Saxe faisaient cause commune. De même qu’il n’assigne pas aux beautés visibles un espace réservé, louant aussi bien l’estampe japonaise que les meubles néo-Renaissance de Fourdinois, poussant à égalité la mode vestimentaire sous la IIIe République et la peinture la plus décriée, Mallarmé ne conçoit pas sa poésie comme étrangère à cet univers matériel. À rebours de  – Michel Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes. Vingt ans de poésie française 1895-1914, préface de Jean-Yves Debreuille, Champion classiques essais, 18€.
– Michel Décaudin, La Crise des valeurs symbolistes. Vingt ans de poésie française 1895-1914, préface de Jean-Yves Debreuille, Champion classiques essais, 18€.