 Deux yeux intelligents, un immense sourire, silhouette nerveuse et chevelure d’époque, Hélène Hoppenot (1894-1990) était de ces femmes qui ne voudraient obéir qu’à leur intrépide amour du monde. Incapables de rester en place, elles le parcourent, le savourent, et jouissent sans compter de cette nationalité multiple qu’offrent les professions voyageuses. Mois après mois, année après année, un véritable trésor s’accumule, une moisson d’images, d’impressions, de rencontres, heureuses ou pas. Certaines, plus têtues, demandent à survivre. Photographe et écrivaine, mais étanche au moindre cabotinage, Hélène Hoppenot ne s’est pas dérobée à la tâche, et nous a transmis le meilleur de son univers aux frontières mouvantes, bien décidée à le préserver de l’oubli et des menaces qui tiraient l’Europe vers le chaos. Photographier apprend à voir, active les perceptions et, au fil du temps, leste d’une émotion unique ce qu’on lui arrache. Plus profondément s’ancre le besoin de s’écrire, de livrer au papier la trace presque quotidienne de ses actes, pensées et doutes, à côté des rumeurs de la grande histoire. Hoppenot dont Claire Paulhan poursuit la savante publication du Journal, attribuait à son kodak et à sa plume une valeur de révélation différente, elle leur communiqua l’élégance et le mordant d’une femme d’ambassadeur… Le quai d’Orsay fut autrefois une pépinière d’écrivains, Claudel, Paul Morand, Saint-John Perse, autant de noms que nous croisons en la lisant avec ceux de Léon-Paul Fargue, Valery Larbaud ou des Milhaud, autant de figures qu’elle croque d’un trait, juste, vif, jamais cruel. Dans le cas des Hoppenot, en effet, c’est la femme qui tient la plume.
Deux yeux intelligents, un immense sourire, silhouette nerveuse et chevelure d’époque, Hélène Hoppenot (1894-1990) était de ces femmes qui ne voudraient obéir qu’à leur intrépide amour du monde. Incapables de rester en place, elles le parcourent, le savourent, et jouissent sans compter de cette nationalité multiple qu’offrent les professions voyageuses. Mois après mois, année après année, un véritable trésor s’accumule, une moisson d’images, d’impressions, de rencontres, heureuses ou pas. Certaines, plus têtues, demandent à survivre. Photographe et écrivaine, mais étanche au moindre cabotinage, Hélène Hoppenot ne s’est pas dérobée à la tâche, et nous a transmis le meilleur de son univers aux frontières mouvantes, bien décidée à le préserver de l’oubli et des menaces qui tiraient l’Europe vers le chaos. Photographier apprend à voir, active les perceptions et, au fil du temps, leste d’une émotion unique ce qu’on lui arrache. Plus profondément s’ancre le besoin de s’écrire, de livrer au papier la trace presque quotidienne de ses actes, pensées et doutes, à côté des rumeurs de la grande histoire. Hoppenot dont Claire Paulhan poursuit la savante publication du Journal, attribuait à son kodak et à sa plume une valeur de révélation différente, elle leur communiqua l’élégance et le mordant d’une femme d’ambassadeur… Le quai d’Orsay fut autrefois une pépinière d’écrivains, Claudel, Paul Morand, Saint-John Perse, autant de noms que nous croisons en la lisant avec ceux de Léon-Paul Fargue, Valery Larbaud ou des Milhaud, autant de figures qu’elle croque d’un trait, juste, vif, jamais cruel. Dans le cas des Hoppenot, en effet, c’est la femme qui tient la plume.
 En épousant son mari, jeune diplomate ambitieux, Hélène avait épousé une vie qu’elle savait promise à changer perpétuellement d’horizons. Elle allait vite le vérifier et devenir la gardienne de leur commune itinérance. Le Brésil, l’Iran et l’Amérique du Sud, au sortir de la guerre de 14, sont encore des destinations fabuleuses, à mille lieux, en tous sens, de l’Europe saignée et saignante. Vint ensuite la Chine, trois formidables années qui lui déchirent le cœur au moment du départ, et creusent le Journal d’une longue éclipse. Entre novembre 1933 et Noël 1936, elle choisit de se taire. L’étrange envoûtement que lui a causé Pékin et ses alentours n’aura eu que la photographie pour traductrice. Quelques-uns de ces clichés au grain caressant, vides de toute présence humaine ou riches d’une altérité secrète, sont visibles à Montpellier : on ne saurait faire moins exotique, moins « dominateur », plus « ouvert » au miracle d’avoir été là. Le deuxième volume du Journal redémarre donc en décembre 1936, et s’ouvre sur une citation de l’Anabase de Saint-John Perse : « Nous n’habiterons pas toujours ces terres jaunes, notre délice. » L’écriture est à nouveau possible, nécessaire : « Je crois que c’est la raison qui me pousse à reprendre cette conversation avec moi-même, ce Journal interrompu depuis trois ans par cette surcharge de bonheur. »
En épousant son mari, jeune diplomate ambitieux, Hélène avait épousé une vie qu’elle savait promise à changer perpétuellement d’horizons. Elle allait vite le vérifier et devenir la gardienne de leur commune itinérance. Le Brésil, l’Iran et l’Amérique du Sud, au sortir de la guerre de 14, sont encore des destinations fabuleuses, à mille lieux, en tous sens, de l’Europe saignée et saignante. Vint ensuite la Chine, trois formidables années qui lui déchirent le cœur au moment du départ, et creusent le Journal d’une longue éclipse. Entre novembre 1933 et Noël 1936, elle choisit de se taire. L’étrange envoûtement que lui a causé Pékin et ses alentours n’aura eu que la photographie pour traductrice. Quelques-uns de ces clichés au grain caressant, vides de toute présence humaine ou riches d’une altérité secrète, sont visibles à Montpellier : on ne saurait faire moins exotique, moins « dominateur », plus « ouvert » au miracle d’avoir été là. Le deuxième volume du Journal redémarre donc en décembre 1936, et s’ouvre sur une citation de l’Anabase de Saint-John Perse : « Nous n’habiterons pas toujours ces terres jaunes, notre délice. » L’écriture est à nouveau possible, nécessaire : « Je crois que c’est la raison qui me pousse à reprendre cette conversation avec moi-même, ce Journal interrompu depuis trois ans par cette surcharge de bonheur. »
 Revenu à Paris, triste privilège des longues absences, le couple découvre que leurs amis ont très bien vécu sans eux. Le temps, en revanche, les a changés, courbés, d’autant plus que l’atmosphère, en 1937, n’est pas à l’optimisme. Même le faste des soirées poétiques de Paul-Louis Weiller, protecteur de Francis Jammes et de Claudel, se laisse entamer par les minces illusions dont chacun se berce. Mieux informée que quiconque du cours des « affaires étrangères », Hélène Hoppenot noircit son Journal des verbatim de son cercle, précieux dépôt. On entend ainsi Saint-John Perse, toujours lui, se plaindre de la veulerie de ses supérieurs, incapables d’opposer la moindre fermeté aux provocations d’Hitler. On voit un Abel Bonnard, plaider, au contraire, la nécessité d’une guerre, fût-ce pour préparer « l’aube des temps nouveaux ». Entre la chute de Léon Blum et les accords de Munich, l’angoisse monte : « Nous abordons à l’un des moments les plus périlleux de notre histoire depuis 1914 et, en scrutant l’horizon, il est impossible d’apercevoir un chef capable de nous tirer de là. » Daladier, Gamelin et Reynaud lui semblent déjà condamner le pays à l’échec L’attitude trop conciliatrice de Chamberlain, elle le pressent, mène au déshonneur. Le Reich, elle l’a compris, ne peut plus échapper à la logique belliciste de son chancelier et à ses brunes poussées de fièvre. Gisèle Freund, qui a laissé un merveilleux portrait d’elle, lui a raconté comment on y dépouillait déjà les Juifs et traitait les opposants au programme d’épuration ethnique. Rentré d’Allemagne, à la fin septembre 1938, Saint-John Perse en rapporte le détail des rencontres préparatoires aux « accords de Munich ». Des confidences du poète, qu’Hitler et Mussolini ont flatté, elle tire une page d’anthologie, grosse d’orages, de l’affaire des Sudètes et du Pacte Ribbentrop-Molotov. Peu avant que le volume ne se referme, en date du 22 août 1939, cette fusée : « Louis Aragon, dans Ce soir, se réjouit de la nouvelle politique des Soviets et ceux qui estimaient qu’il fallait à tout prix s’entendre avec Hitler triomphent. L’avenir est sombre et il nous faut vivre au jour le jour. » Le temps de l’avant-guerre, privé de futur, se disloque.
Revenu à Paris, triste privilège des longues absences, le couple découvre que leurs amis ont très bien vécu sans eux. Le temps, en revanche, les a changés, courbés, d’autant plus que l’atmosphère, en 1937, n’est pas à l’optimisme. Même le faste des soirées poétiques de Paul-Louis Weiller, protecteur de Francis Jammes et de Claudel, se laisse entamer par les minces illusions dont chacun se berce. Mieux informée que quiconque du cours des « affaires étrangères », Hélène Hoppenot noircit son Journal des verbatim de son cercle, précieux dépôt. On entend ainsi Saint-John Perse, toujours lui, se plaindre de la veulerie de ses supérieurs, incapables d’opposer la moindre fermeté aux provocations d’Hitler. On voit un Abel Bonnard, plaider, au contraire, la nécessité d’une guerre, fût-ce pour préparer « l’aube des temps nouveaux ». Entre la chute de Léon Blum et les accords de Munich, l’angoisse monte : « Nous abordons à l’un des moments les plus périlleux de notre histoire depuis 1914 et, en scrutant l’horizon, il est impossible d’apercevoir un chef capable de nous tirer de là. » Daladier, Gamelin et Reynaud lui semblent déjà condamner le pays à l’échec L’attitude trop conciliatrice de Chamberlain, elle le pressent, mène au déshonneur. Le Reich, elle l’a compris, ne peut plus échapper à la logique belliciste de son chancelier et à ses brunes poussées de fièvre. Gisèle Freund, qui a laissé un merveilleux portrait d’elle, lui a raconté comment on y dépouillait déjà les Juifs et traitait les opposants au programme d’épuration ethnique. Rentré d’Allemagne, à la fin septembre 1938, Saint-John Perse en rapporte le détail des rencontres préparatoires aux « accords de Munich ». Des confidences du poète, qu’Hitler et Mussolini ont flatté, elle tire une page d’anthologie, grosse d’orages, de l’affaire des Sudètes et du Pacte Ribbentrop-Molotov. Peu avant que le volume ne se referme, en date du 22 août 1939, cette fusée : « Louis Aragon, dans Ce soir, se réjouit de la nouvelle politique des Soviets et ceux qui estimaient qu’il fallait à tout prix s’entendre avec Hitler triomphent. L’avenir est sombre et il nous faut vivre au jour le jour. » Le temps de l’avant-guerre, privé de futur, se disloque.
 Qu’y croire ? Sur qui compter ? L’un des informateurs les plus aigus de l’observatrice a belle figure et n’est autre qu’André François-Poncet. S’il aime à friser sa moustache et tenir son auditoire sous les effets de sa parole étincelante, notre ambassadeur, fort actif à Berlin et Paris depuis 1931, se répand en indiscrétions et prévisions de moins en moins rassurantes. « A son avis, écrit Hoppenot, Hitler est un inverti de tendance. L’inversion en Allemagne étant considérée plutôt comme un signe de sur-masculinité que de dégénérescence : l’homme fort ne pouvant se contenter des seuls rapports intimes avec l’être inférieur qu’est la femme. » Homosexuelles ou pas, les frustrations du dictateur n’ont pas attendu Chaplin pour s’afficher. François-Poncet, que de mauvaises langues aiment à dire fasciné par le national-socialisme, a surtout été un témoin averti de son triomphe électoral et, une fois atteint, de la rouerie d’Hitler, « parjure né ». Le Français n’aura cessé de bombarder de documents et d’alertes le quai d’Orsay, et trompé ses hôtes sur ce qu’il pensait d’eux… L’un de ses livres majeurs, Souvenirs d’une ambassade à Berlin 1931-1938, reparaît chez Perrin, enrichi du beau travail de Jean-Paul Bled, grand connaisseur du personnel hitlérien où beaucoup de médiocres se haussaient du col. Mais le propre des tyrans, cela se voit ailleurs qu’en politique, n’est-il pas de s’entourer d’intelligences modestes et d’âmes serviles ? Normalien et bon germaniste quant à lui, François-Poncet n’épargne guère les représentants de la « race supérieure », si petit-bourgeois de goût, pas plus que les rodomontades d’une France piégée par sa « politique d’apaisement ». Le haut fonctionnaire, à défaut de la croire suffisante, y aura toutefois contribué de la manière la plus efficace possible. Étrangement, il nous parle peu d’une entreprise négligée par les historiens, l’exposition d’art français, et d’art moderne, que l’ambassadeur organisa, à Berlin, en juin 1937, avec l’aide de Robert Rey, critique d’art aujourd’hui malfamé pour avoir publié Contre l’art abstrait (Flammarion, 1938) et surtout La Peinture moderne ou l’art sans métier (Que sais-je, 1941).
Qu’y croire ? Sur qui compter ? L’un des informateurs les plus aigus de l’observatrice a belle figure et n’est autre qu’André François-Poncet. S’il aime à friser sa moustache et tenir son auditoire sous les effets de sa parole étincelante, notre ambassadeur, fort actif à Berlin et Paris depuis 1931, se répand en indiscrétions et prévisions de moins en moins rassurantes. « A son avis, écrit Hoppenot, Hitler est un inverti de tendance. L’inversion en Allemagne étant considérée plutôt comme un signe de sur-masculinité que de dégénérescence : l’homme fort ne pouvant se contenter des seuls rapports intimes avec l’être inférieur qu’est la femme. » Homosexuelles ou pas, les frustrations du dictateur n’ont pas attendu Chaplin pour s’afficher. François-Poncet, que de mauvaises langues aiment à dire fasciné par le national-socialisme, a surtout été un témoin averti de son triomphe électoral et, une fois atteint, de la rouerie d’Hitler, « parjure né ». Le Français n’aura cessé de bombarder de documents et d’alertes le quai d’Orsay, et trompé ses hôtes sur ce qu’il pensait d’eux… L’un de ses livres majeurs, Souvenirs d’une ambassade à Berlin 1931-1938, reparaît chez Perrin, enrichi du beau travail de Jean-Paul Bled, grand connaisseur du personnel hitlérien où beaucoup de médiocres se haussaient du col. Mais le propre des tyrans, cela se voit ailleurs qu’en politique, n’est-il pas de s’entourer d’intelligences modestes et d’âmes serviles ? Normalien et bon germaniste quant à lui, François-Poncet n’épargne guère les représentants de la « race supérieure », si petit-bourgeois de goût, pas plus que les rodomontades d’une France piégée par sa « politique d’apaisement ». Le haut fonctionnaire, à défaut de la croire suffisante, y aura toutefois contribué de la manière la plus efficace possible. Étrangement, il nous parle peu d’une entreprise négligée par les historiens, l’exposition d’art français, et d’art moderne, que l’ambassadeur organisa, à Berlin, en juin 1937, avec l’aide de Robert Rey, critique d’art aujourd’hui malfamé pour avoir publié Contre l’art abstrait (Flammarion, 1938) et surtout La Peinture moderne ou l’art sans métier (Que sais-je, 1941).
 Le fait que Lucien Rebatet ait tenu en estime cet inspecteur général des Beaux-Arts, nommé par le Front populaire, n’a guère disposé la postérité en sa faveur. Ainsi Michèle C. Cone, en 1998, donnait-elle de l’exposition de juin-juillet 1937, voulue par le gouvernement Blum, un bilan plutôt négatif. Tout en reconnaissant que le critère de nationalité, alors indiscuté, excluait de facto les artistes juifs de l’Ecole de Paris ou l’espagnol Picasso, elle ne soulignait pas assez l’audace qui consistait à montrer en Allemagne, déjà très avancée dans la stigmatisation de « l’art dégénéré », des tableaux de Matisse (qui prêta son concours enthousiaste), Braque, Léger, Vlaminck, Derain et autres Fauves. Derrière les intentions de François-Poncet, soucieux de rappeler que l’art français véhiculait un parfum de civilisation autrement plus libéral et une esthétique moins régressive que les valets néoclassiques du Reich, il faudrait voir une démarche réactionnaire, et complaisante envers les Nazis ! Le Départ de Chapelain-Midy et Le Goûter des enfants de Maurice Asselin (notre photographie) ayant séduit la presse allemande par leurs thèmes et leurs accents quattrocentistes, Cone croyait tenir la confirmation de sa thèse, que conforterait la présence de Vuillard, Lucien Simon, George Desvallières, Maurice Denis, Despiau et Maillol parmi les exposants. Son erreur, assez courante, venait d’une confusion entre l’éclectisme ouvert de Robert Rey, conforme aux habitudes de l’administration des Beaux-Arts, et l’esthétique antisémite et étroitement nationaliste, selon les termes de Cone, qui définiraient la culture vichyste. Outre que le canon officiel, sous la botte, ne romprait guère avec toutes les options du Front populaire, la stratégie de François-Poncet tranchait, elle, sur la caporalisation nazie de l’art germanique. Laissons-lui, d’ailleurs, le mot de la fin : « En juin [1937], une exposition de peinture française moderne est organisée à Berlin par l’Académie des beaux-arts de Prusse. Hitler, dont les goûts, en la matière, ne vont pas au-delà de la peinture romantique du milieu du XIXe siècle et pour lequel l’impressionnisme et le cubisme, qu’il confond, ne sont que des produits de l’esprit juif, prend, cependant, la peine de venir la voir et d’y acheter une statuette. » Dont acte. Stéphane Guégan
Le fait que Lucien Rebatet ait tenu en estime cet inspecteur général des Beaux-Arts, nommé par le Front populaire, n’a guère disposé la postérité en sa faveur. Ainsi Michèle C. Cone, en 1998, donnait-elle de l’exposition de juin-juillet 1937, voulue par le gouvernement Blum, un bilan plutôt négatif. Tout en reconnaissant que le critère de nationalité, alors indiscuté, excluait de facto les artistes juifs de l’Ecole de Paris ou l’espagnol Picasso, elle ne soulignait pas assez l’audace qui consistait à montrer en Allemagne, déjà très avancée dans la stigmatisation de « l’art dégénéré », des tableaux de Matisse (qui prêta son concours enthousiaste), Braque, Léger, Vlaminck, Derain et autres Fauves. Derrière les intentions de François-Poncet, soucieux de rappeler que l’art français véhiculait un parfum de civilisation autrement plus libéral et une esthétique moins régressive que les valets néoclassiques du Reich, il faudrait voir une démarche réactionnaire, et complaisante envers les Nazis ! Le Départ de Chapelain-Midy et Le Goûter des enfants de Maurice Asselin (notre photographie) ayant séduit la presse allemande par leurs thèmes et leurs accents quattrocentistes, Cone croyait tenir la confirmation de sa thèse, que conforterait la présence de Vuillard, Lucien Simon, George Desvallières, Maurice Denis, Despiau et Maillol parmi les exposants. Son erreur, assez courante, venait d’une confusion entre l’éclectisme ouvert de Robert Rey, conforme aux habitudes de l’administration des Beaux-Arts, et l’esthétique antisémite et étroitement nationaliste, selon les termes de Cone, qui définiraient la culture vichyste. Outre que le canon officiel, sous la botte, ne romprait guère avec toutes les options du Front populaire, la stratégie de François-Poncet tranchait, elle, sur la caporalisation nazie de l’art germanique. Laissons-lui, d’ailleurs, le mot de la fin : « En juin [1937], une exposition de peinture française moderne est organisée à Berlin par l’Académie des beaux-arts de Prusse. Hitler, dont les goûts, en la matière, ne vont pas au-delà de la peinture romantique du milieu du XIXe siècle et pour lequel l’impressionnisme et le cubisme, qu’il confond, ne sont que des produits de l’esprit juif, prend, cependant, la peine de venir la voir et d’y acheter une statuette. » Dont acte. Stéphane Guégan
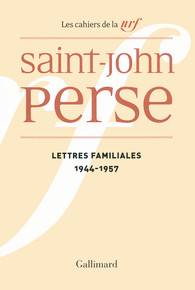 *Hélène Hoppenot, Journal 1936-1940, Editions Claire Paulhan, édition établie et annotée par Marie France Mousli, 49€. Le controversé Alexis Leger (Saint-John Perse), en raison du non-interventionnisme qu’il aurait soutenu jusqu’à son renvoi en mai 1940, sort grandi du témoignage de Hoppenot. Où se situe la vérité ? La lecture des Lettres familiales 1944-1957 (Cahiers Saint-John Perse, n°22, édition établie, présentée et annotée par Claude Thiébault, Gallimard, 19,50€) confirme l’étrange situation où il se trouve à l’heure des règlements de compte que l’on sait. Interdit de séjour en France, où cette « crapule » de Paul Reynaud reprend du service et le tient pour responsable du « Pacifisme » qui avait perdu le pays, Saint-John Perse, très anti-gaulliste, vit d’expédients à Washington, rime peu et souffre de cet exil prolongé. Son statut littéraire le préoccupe, évidemment. Que Gaëtan Picon l’ait intégré à son Panorama de la Nouvelle Littérature française le rassure. Début 1953, Paulhan l’associera à la N.R.F, qui renaît après quelques années de bâillon. Le futur Prix Nobel, Ulysse peu commode, devra patienter encore avant de revoir sa patrie. SG
*Hélène Hoppenot, Journal 1936-1940, Editions Claire Paulhan, édition établie et annotée par Marie France Mousli, 49€. Le controversé Alexis Leger (Saint-John Perse), en raison du non-interventionnisme qu’il aurait soutenu jusqu’à son renvoi en mai 1940, sort grandi du témoignage de Hoppenot. Où se situe la vérité ? La lecture des Lettres familiales 1944-1957 (Cahiers Saint-John Perse, n°22, édition établie, présentée et annotée par Claude Thiébault, Gallimard, 19,50€) confirme l’étrange situation où il se trouve à l’heure des règlements de compte que l’on sait. Interdit de séjour en France, où cette « crapule » de Paul Reynaud reprend du service et le tient pour responsable du « Pacifisme » qui avait perdu le pays, Saint-John Perse, très anti-gaulliste, vit d’expédients à Washington, rime peu et souffre de cet exil prolongé. Son statut littéraire le préoccupe, évidemment. Que Gaëtan Picon l’ait intégré à son Panorama de la Nouvelle Littérature française le rassure. Début 1953, Paulhan l’associera à la N.R.F, qui renaît après quelques années de bâillon. Le futur Prix Nobel, Ulysse peu commode, devra patienter encore avant de revoir sa patrie. SG
**Alain Sayag et Marie France Mousli, Hélène Hoppenot. Le monde d’hier, Hazan, 24,95€. L’exposition du Pavillon Populaire, espace d’art photographique de la ville de Montpellier, se tient jusqu’au 29 mai 2016. Cinq albums, tous publiés en Suisse, succéderont au Chine de 1946, que Skira accompagne d’un texte de Claudel. Les focales courtes de Hoppenot sont celles d’une diariste attentive au motif plus qu’aux effets.
***André François-Poncet, Souvenirs d’une ambassade à Berlin 1931-1938, préface et notes de Jean-Paul Bled, Perrin, 24€.
 ****Peu de temps après l’exposition de juin 1937, et en manière de réponse, Entarte Kunst ouvrait ses portes à Munich. Parmi les artistes « dégénérés » qu’elle livrait aux rires de la foule en les apparentant aux bacilles dont la culture allemande devait se nettoyer, on trouvait deux « experts » honnis des déformations monstrueuses. Otto Dix (1891-1969) n’en était pas à son premier procès. Sous la République de Weimar, sa Tranchée de 1923 lui avait valu une bordée d’insultes. Ce De Profundis verdâtre, bouillie de corps anonymes et de terre éventrée, souleva alors le cœur de Meier-Graefe : « Le cerveau, le sang, les entrailles sont peints de façon à porter à leur paroxysme nos réactions animales. » Le procureur voyait juste, la « peinture infâme » de Dix annulait la distance mentale qu’induit l’esthétique traditionnelle. Nul ménagement, c’est, l’année suivante, la morale de Der Krieg, série de 50 eaux-fortes que l’artiste réalise en défiant Callot, Goya et Géricault, note Marie-Pascale Prévost-Bault dans sa présentation du rare exemplaire complet qu’abrite L’Historial de la Grande Guerre. Sa publication très soignée (Gallimard, 24€), papier et encrage, sert parfaitement le propos du peintre, croix de fer de 1915, et n’écoutant plus que le fracas de ses souvenirs et la voix éteinte de ses camarades de combat. Le pire se situe peut-être au-delà des motifs, cadavres obscènes, corps déchiquetés, macédoines de visage, fous errants, putes à soldats…
****Peu de temps après l’exposition de juin 1937, et en manière de réponse, Entarte Kunst ouvrait ses portes à Munich. Parmi les artistes « dégénérés » qu’elle livrait aux rires de la foule en les apparentant aux bacilles dont la culture allemande devait se nettoyer, on trouvait deux « experts » honnis des déformations monstrueuses. Otto Dix (1891-1969) n’en était pas à son premier procès. Sous la République de Weimar, sa Tranchée de 1923 lui avait valu une bordée d’insultes. Ce De Profundis verdâtre, bouillie de corps anonymes et de terre éventrée, souleva alors le cœur de Meier-Graefe : « Le cerveau, le sang, les entrailles sont peints de façon à porter à leur paroxysme nos réactions animales. » Le procureur voyait juste, la « peinture infâme » de Dix annulait la distance mentale qu’induit l’esthétique traditionnelle. Nul ménagement, c’est, l’année suivante, la morale de Der Krieg, série de 50 eaux-fortes que l’artiste réalise en défiant Callot, Goya et Géricault, note Marie-Pascale Prévost-Bault dans sa présentation du rare exemplaire complet qu’abrite L’Historial de la Grande Guerre. Sa publication très soignée (Gallimard, 24€), papier et encrage, sert parfaitement le propos du peintre, croix de fer de 1915, et n’écoutant plus que le fracas de ses souvenirs et la voix éteinte de ses camarades de combat. Le pire se situe peut-être au-delà des motifs, cadavres obscènes, corps déchiquetés, macédoines de visage, fous errants, putes à soldats…
 Le pire surgit du cœur même de l’ancienne figuration que Dix déchire à pleines dents ou sublime ironiquement. No man’s lands lunaires et paysages de terreur, sous la lumière des fusées éclairantes, touchent au merveilleux des Calligrammes d’Apollinaire. Ce dernier, avant d’enfiler l’uniforme français, avait bataillé pour la survie du nu en peinture. Le fait qu’il n’ait jamais chanté ceux de Modigliani (1884-1920) n’en est que plus curieux, d’autant que les deux hommes eurent le temps de se fréquenter : il existe un portrait du poète par l’Italien, Juif de Livourne, auquel les nazis firent bel accueil, à l’été 1937, dans l’exposition d’art dégénéré… Celle du LaM (visible jusqu’au 5 juin 2016), sculptures et peintures de toute beauté, fait revivre le Montparnasse dont l’Allemagne hitlérienne voulait purger l’art d’Etat. Si Ingres et ses rondeurs imprévisibles sculptent en partie les nus de Modi, les portraits en portent également la marque, à égalité avec Greco, Picasso (fût-ce le Picasso ingresque) et la statuaire égyptienne ou africaine. Il en fallait plus pour effrayer le Paris des années 1910, et moins pour connaître les foudres de la propagande nazie. Le catalogue (Gallimard, 35€), sourd à la légende du maudit et du reclus, explore tous les liens, esthétiques, poétiques et commerciaux, qui inscrivaient l’apatride dans le paysage. Le Nu Dutilleul et le Nu d’Anvers en sont deux des fleurons. SG
Le pire surgit du cœur même de l’ancienne figuration que Dix déchire à pleines dents ou sublime ironiquement. No man’s lands lunaires et paysages de terreur, sous la lumière des fusées éclairantes, touchent au merveilleux des Calligrammes d’Apollinaire. Ce dernier, avant d’enfiler l’uniforme français, avait bataillé pour la survie du nu en peinture. Le fait qu’il n’ait jamais chanté ceux de Modigliani (1884-1920) n’en est que plus curieux, d’autant que les deux hommes eurent le temps de se fréquenter : il existe un portrait du poète par l’Italien, Juif de Livourne, auquel les nazis firent bel accueil, à l’été 1937, dans l’exposition d’art dégénéré… Celle du LaM (visible jusqu’au 5 juin 2016), sculptures et peintures de toute beauté, fait revivre le Montparnasse dont l’Allemagne hitlérienne voulait purger l’art d’Etat. Si Ingres et ses rondeurs imprévisibles sculptent en partie les nus de Modi, les portraits en portent également la marque, à égalité avec Greco, Picasso (fût-ce le Picasso ingresque) et la statuaire égyptienne ou africaine. Il en fallait plus pour effrayer le Paris des années 1910, et moins pour connaître les foudres de la propagande nazie. Le catalogue (Gallimard, 35€), sourd à la légende du maudit et du reclus, explore tous les liens, esthétiques, poétiques et commerciaux, qui inscrivaient l’apatride dans le paysage. Le Nu Dutilleul et le Nu d’Anvers en sont deux des fleurons. SG

 *Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, Gallimard, Folio, 8,40€.
*Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, Gallimard, Folio, 8,40€. *Paul Valéry, Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945, Gallimard, 35€.
*Paul Valéry, Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945, Gallimard, 35€.