
Le don de capter les intensités de « la vie présente », dès leur rencontre, aimante Picasso et Apollinaire. L’Éros le moins muselé est aussi du partage en ces années roses. La guerre de 14, en revanche, devait les séparer, les opposer. Picasso jugera suffisant d’accrocher de petits drapeaux tricolores aux excroissances de ses natures mortes étrangement pimpantes de l’été 1914. Quant à se battre… A l’instar de Cendrars, de Kupka et tant d’autres étrangers de France, Guillaume, alors que rien ne l’y oblige, enfile l’uniforme de notre pays, patrie de cœur. Ses difficultés à rejoindre le front sont bien connues, elles lui valurent, à Nice, en septembre 1914, de recevoir une balle en plein cœur. L’armée ne voulait pas de lui, tant pis, il déclare sa flamme à Louise de Coligny, de mœurs peu huguenotes malgré son amiral d’ancêtre. Mais la comtesse, si peu chaste et bégueule pourtant, l’éconduit en douceur, elle a compris, cette lectrice de Sully Prudhomme, qu’elle vient de rencontrer un poète de race, le plus grand du XXe siècle. Fidèle ou presque à Charles Cousin, le fameux Toutou, embrigadé dans les Vosges, elle repousse Apollinaire jusqu’au moment où lui aussi, jugé enfin apte, s’apprête à connaître une prompte préparation militaire. Les pertes de l’été ont été si effroyables que la France ne peut plus faire la fine bouche. Le 7 décembre 1914, Louise rejoint son canonnier à Nîmes, et se laisse « prendre », son mot favori… C’est la première de leurs « nuits de folie », selon l’expression du poète qui, prose ou vers libres, va désormais la couvrir de lyrisme direct autant que d’étreintes violemment assénées et consenties.
 Aussi fameuses soient-elles, les Lettres à Lou, bréviaire sadien et ronsardisant à la fois, laissaient au lecteur un peu d’amertume dans les yeux et l’âme. Il y manquait une voix, aussi crue et perverse que l’autre, mais féminine, féline, câline, superbement impudique. Car, à une dizaine près, les lettres de Lou s’étaient évaporées. Du moins, le croyait-on… L’acharnement de ce grand chercheur qu’est Pierre Caizergues a donc payé. Cinquante missives inédites nous sont rendues et confirment miraculeusement ce que Guillaume lui-même en disait. Exemple : le 10 février 1915, après réception de l’une des lettres « perdues », Apollinaire y répond : « Tu es un écrivain charmant et puissant. Tu sais l’art des développements et connais les mots qui peignent. Toute la scène avec l’Anglais est épatante comme gradation, mais tu en seras châtiée. » Nous pouvons désormais lire ce qui motiva tant d’enthousiasme, c’est l’une des perles de l’inédit collier. Celle qui attendait de son Gui « tout le vice et toute la volupté », l’allume à distance en lui racontant comment elle a joui, sous les vibrations du train et le regard d’un officier britannique, qui n’a pas eu besoin de perdre son flegme pour la combler. Tout ce merveilleux recueil brûle de tels transports, remèdes contre le spleen, autre mot de Lou, et les petits tracas du quotidien, la comtesse est souvent fauchée… Ils ne se reverront plus après mars 1915. Mais leur correspondance, quelques mois encore, les fouette, en tous sens, et les ravit, au ciel des houris.
Aussi fameuses soient-elles, les Lettres à Lou, bréviaire sadien et ronsardisant à la fois, laissaient au lecteur un peu d’amertume dans les yeux et l’âme. Il y manquait une voix, aussi crue et perverse que l’autre, mais féminine, féline, câline, superbement impudique. Car, à une dizaine près, les lettres de Lou s’étaient évaporées. Du moins, le croyait-on… L’acharnement de ce grand chercheur qu’est Pierre Caizergues a donc payé. Cinquante missives inédites nous sont rendues et confirment miraculeusement ce que Guillaume lui-même en disait. Exemple : le 10 février 1915, après réception de l’une des lettres « perdues », Apollinaire y répond : « Tu es un écrivain charmant et puissant. Tu sais l’art des développements et connais les mots qui peignent. Toute la scène avec l’Anglais est épatante comme gradation, mais tu en seras châtiée. » Nous pouvons désormais lire ce qui motiva tant d’enthousiasme, c’est l’une des perles de l’inédit collier. Celle qui attendait de son Gui « tout le vice et toute la volupté », l’allume à distance en lui racontant comment elle a joui, sous les vibrations du train et le regard d’un officier britannique, qui n’a pas eu besoin de perdre son flegme pour la combler. Tout ce merveilleux recueil brûle de tels transports, remèdes contre le spleen, autre mot de Lou, et les petits tracas du quotidien, la comtesse est souvent fauchée… Ils ne se reverront plus après mars 1915. Mais leur correspondance, quelques mois encore, les fouette, en tous sens, et les ravit, au ciel des houris.
 Parvenu au front, Apollinaire se fait envoyer des volumes d’Alcools, il les destine en bon soldat à ses supérieurs. Manière aussi d’affirmer que sa poésie, en 1913, contenait déjà les prolongements étoilés, picturaux qu’expérimentent alors, outre les poèmes amoureux envoyés à Lou, Case d’Armons et Calligrammes. La poésie moderne percute, dit le Drieu d’Interrogation (NRF, 1917), il faut qu’elle jaillisse et chavire, pense Guillaume. Un vent mallarméen, dans le sens typographique et spatial du terme, agite la page blanche, en bouleverse et recharge les signes. C’était demander au cubisme ce qu’Apollinaire lui avait donné dès 1907, les ailes de la fantaisie. Certains peintres de son entourage l’ont mieux saisi que d’autres et se situèrent, avec lui, aux confins des lettres et des arts visuels. Marcoussis, bel exemple de ces échanges qui comptèrent plus que la supposée destruction de la mimesis, a nourri, sa vie entière, une passion pour Apollinaire et, singulièrement, Alcools. Il a laissé des preuves irréfutables de cette double religion, elles sont réunies, pour la première fois, en un coffret aussi élégant qu’abordable. Édité au compte-goutte, Eaux-fortes pour Alcools ne circula que parmi une vingtaine de bibliophiles avertis, de Paul Guillaume à Pierre Loeb, d’André Breton à André Lefèvre, auquel appartint, de plus, un exemplaire du livre de 1913 enluminé d’aquarelles dignes du subtil Marcoussis. Détentrice de l’ouvrage et de la série des Eaux-fortes que l’artiste lui offrit au nom de sa mécène Helena Rubinstein, la Bibliothèque nationale de France s’est associée à Gallimard afin de les faire connaître au plus grand nombre. Jean-Marc Chatelain accompagne le tout d’un livret particulièrement informé et sagace.
Parvenu au front, Apollinaire se fait envoyer des volumes d’Alcools, il les destine en bon soldat à ses supérieurs. Manière aussi d’affirmer que sa poésie, en 1913, contenait déjà les prolongements étoilés, picturaux qu’expérimentent alors, outre les poèmes amoureux envoyés à Lou, Case d’Armons et Calligrammes. La poésie moderne percute, dit le Drieu d’Interrogation (NRF, 1917), il faut qu’elle jaillisse et chavire, pense Guillaume. Un vent mallarméen, dans le sens typographique et spatial du terme, agite la page blanche, en bouleverse et recharge les signes. C’était demander au cubisme ce qu’Apollinaire lui avait donné dès 1907, les ailes de la fantaisie. Certains peintres de son entourage l’ont mieux saisi que d’autres et se situèrent, avec lui, aux confins des lettres et des arts visuels. Marcoussis, bel exemple de ces échanges qui comptèrent plus que la supposée destruction de la mimesis, a nourri, sa vie entière, une passion pour Apollinaire et, singulièrement, Alcools. Il a laissé des preuves irréfutables de cette double religion, elles sont réunies, pour la première fois, en un coffret aussi élégant qu’abordable. Édité au compte-goutte, Eaux-fortes pour Alcools ne circula que parmi une vingtaine de bibliophiles avertis, de Paul Guillaume à Pierre Loeb, d’André Breton à André Lefèvre, auquel appartint, de plus, un exemplaire du livre de 1913 enluminé d’aquarelles dignes du subtil Marcoussis. Détentrice de l’ouvrage et de la série des Eaux-fortes que l’artiste lui offrit au nom de sa mécène Helena Rubinstein, la Bibliothèque nationale de France s’est associée à Gallimard afin de les faire connaître au plus grand nombre. Jean-Marc Chatelain accompagne le tout d’un livret particulièrement informé et sagace.
 On s’en félicite d’autant plus que les historiens du cubisme, depuis la mort de Jean Cassou, n’ont pas témoigné d’un intérêt démesuré pour Marcoussis, il est ainsi quasi absent de l’exposition que le Centre Pompidou consacre au mouvement (on y reviendra). L’occasion se présentait, en cette vague de centenaires, de fêter et Apollinaire et ce Ludwig Markus, d’origine polonaise comme lui, et que le poète rebaptisa en lui associant deux noms, Corot et Nerval, aussi lumineux que sa manière. En effet, Marcoussis, après avoir fait cause commune avec les cubistes et abandonné à Picasso Eva Gouel sans dépit, s’est battu pour la France avec une vaillance que n’annonçait pas son art sans éclats superflus. Décoré de la Croix de guerre, il devint naturellement l’un des gardiens du souvenir, et Apollinaire sa ligne des Vosges. Du poète assassiné par la grippe espagnole, il avait reçu, en plus de l’étincelle orphique, maints dons. Comme Picasso, La Fresnaye et Dufy, il se vit notamment gratifier d’un des vingt-trois exemplaires de tête, sur Hollande, de l’édition originale d’Alcools, dont Jean Bonna est l’heureux propriétaire. Le rare appelant le rare, Marcoussis y a collé deux caricatures dues à Picasso, et recopié, en les personnalisant, des vers de Cortège. On y verra l’aveu d’une gémellité qu’annonçait, un an plus tôt, le portrait gravé d’Apollinaire, dérivé de Quentin Metsys et du besoin d’ancrer la modernité.
On s’en félicite d’autant plus que les historiens du cubisme, depuis la mort de Jean Cassou, n’ont pas témoigné d’un intérêt démesuré pour Marcoussis, il est ainsi quasi absent de l’exposition que le Centre Pompidou consacre au mouvement (on y reviendra). L’occasion se présentait, en cette vague de centenaires, de fêter et Apollinaire et ce Ludwig Markus, d’origine polonaise comme lui, et que le poète rebaptisa en lui associant deux noms, Corot et Nerval, aussi lumineux que sa manière. En effet, Marcoussis, après avoir fait cause commune avec les cubistes et abandonné à Picasso Eva Gouel sans dépit, s’est battu pour la France avec une vaillance que n’annonçait pas son art sans éclats superflus. Décoré de la Croix de guerre, il devint naturellement l’un des gardiens du souvenir, et Apollinaire sa ligne des Vosges. Du poète assassiné par la grippe espagnole, il avait reçu, en plus de l’étincelle orphique, maints dons. Comme Picasso, La Fresnaye et Dufy, il se vit notamment gratifier d’un des vingt-trois exemplaires de tête, sur Hollande, de l’édition originale d’Alcools, dont Jean Bonna est l’heureux propriétaire. Le rare appelant le rare, Marcoussis y a collé deux caricatures dues à Picasso, et recopié, en les personnalisant, des vers de Cortège. On y verra l’aveu d’une gémellité qu’annonçait, un an plus tôt, le portrait gravé d’Apollinaire, dérivé de Quentin Metsys et du besoin d’ancrer la modernité.
 Vendémaire, l’ultime poème d’Alcools, semble déjà une parole de guerrier, guettée par l’effacement et l’oubli : « Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi ». Le dernier poilu français ayant été rasé du sol national avant l’heure, les actuelles commémorations du 11 novembre se sont ouvertes dans le silence et le vide des rescapés de l’abattoir. Ce silence avait sa noblesse, sa grandeur. Il aura fallu qu’une poignée d’«indignés», très sonores et très oublieux de ce qui distingue l’histoire de la compassion mémorielle, troublent l’appel du Président de la République à l’intelligence du passé et de ses acteurs, Pétain compris. Ne croyons pas qu’Apollinaire ait échappé au tri qu’il sied désormais d’opérer entre les grands morts, paraît-il, selon qu’ils seraient coupables ou non des crimes dont la nouvelle vindicte les poursuit. Et l’on sait que la liste s’en allonge chaque jour, à mesure que les fièvres réparatrices de la société actuelle s’imposent comme le seul critère d’évaluation historique. Apollinaire, bien qu’accusé de gâtisme patriotique par les surréalistes et leurs clones, reste présent à la conscience des écrivains d’aujourd’hui. C’est le premier soulagement que l’on tire du beau et fort volume, Armistice, réalisé à l’initiative de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale. « Il est apparu évident dès le départ que nous devions laisser la parole à des hommes et des femmes de nationalités diverses », précise la préface d’Antoine Gallimard, l’autre maître d’œuvre.
Vendémaire, l’ultime poème d’Alcools, semble déjà une parole de guerrier, guettée par l’effacement et l’oubli : « Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi ». Le dernier poilu français ayant été rasé du sol national avant l’heure, les actuelles commémorations du 11 novembre se sont ouvertes dans le silence et le vide des rescapés de l’abattoir. Ce silence avait sa noblesse, sa grandeur. Il aura fallu qu’une poignée d’«indignés», très sonores et très oublieux de ce qui distingue l’histoire de la compassion mémorielle, troublent l’appel du Président de la République à l’intelligence du passé et de ses acteurs, Pétain compris. Ne croyons pas qu’Apollinaire ait échappé au tri qu’il sied désormais d’opérer entre les grands morts, paraît-il, selon qu’ils seraient coupables ou non des crimes dont la nouvelle vindicte les poursuit. Et l’on sait que la liste s’en allonge chaque jour, à mesure que les fièvres réparatrices de la société actuelle s’imposent comme le seul critère d’évaluation historique. Apollinaire, bien qu’accusé de gâtisme patriotique par les surréalistes et leurs clones, reste présent à la conscience des écrivains d’aujourd’hui. C’est le premier soulagement que l’on tire du beau et fort volume, Armistice, réalisé à l’initiative de la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale. « Il est apparu évident dès le départ que nous devions laisser la parole à des hommes et des femmes de nationalités diverses », précise la préface d’Antoine Gallimard, l’autre maître d’œuvre.
 On ajoutera qu’ils sont aussi d’âges différents et qu’ils ne viennent pas tous de familles marquées par cette guerre qui s’éloigne à grand pas. Certaines, certains parlent d’un grand-père, d’autres, comme le regretté Roger Grenier, d’un père, « ancien combattant type », balayé avec deux millions de ses semblables depuis 1918. Cette guerre des tranchées immobiles s’est retranchée ; on en parle, écrit Alexis Jenni, « sans l’avoir vue », pour l’avoir lue. De leur côté, Danièle Sallenave et François Cheng ramènent à la lumière les oubliés de ce conflit qu’on dit mondial, et qui le fut plus qu’on ne le croit, étendu qu’il était à l’Afrique et à la Chine, nous rappellent-ils à partir d’expériences concrètes et généralement tues. La mort, qui n’a épargné personne, a aussi crucifié la nature, comme certains peintres, las d’empiler des corps déchiquetés, l’ont montré en mettant la représentation à nu. Sans chercher à illustrer, Armistice donne voix à l’iconographie de la guerre, tant il est vrai que les images de paix nous semblent factices au regard de celles qui fixèrent la mémoire des combats. Encore la préférence est-elle souvent donnée aux plus sordides. Mais Apollinaire avait prévenu, la guerre de 14 eut sa beauté. Et le jeune Aragon lui-même, plébiscitant les vers du jeune Drieu, écrivait que tous deux l’avaient aimée, cette guerre, comme une négresse. Remercions Marine Branland, responsable du choix et du commentaire des gravures qui imposent ici leur propre texte, d’avoir ouvert son magnifique corpus au-delà de nos frontières nationales et mentales. Stéphane Guégan
On ajoutera qu’ils sont aussi d’âges différents et qu’ils ne viennent pas tous de familles marquées par cette guerre qui s’éloigne à grand pas. Certaines, certains parlent d’un grand-père, d’autres, comme le regretté Roger Grenier, d’un père, « ancien combattant type », balayé avec deux millions de ses semblables depuis 1918. Cette guerre des tranchées immobiles s’est retranchée ; on en parle, écrit Alexis Jenni, « sans l’avoir vue », pour l’avoir lue. De leur côté, Danièle Sallenave et François Cheng ramènent à la lumière les oubliés de ce conflit qu’on dit mondial, et qui le fut plus qu’on ne le croit, étendu qu’il était à l’Afrique et à la Chine, nous rappellent-ils à partir d’expériences concrètes et généralement tues. La mort, qui n’a épargné personne, a aussi crucifié la nature, comme certains peintres, las d’empiler des corps déchiquetés, l’ont montré en mettant la représentation à nu. Sans chercher à illustrer, Armistice donne voix à l’iconographie de la guerre, tant il est vrai que les images de paix nous semblent factices au regard de celles qui fixèrent la mémoire des combats. Encore la préférence est-elle souvent donnée aux plus sordides. Mais Apollinaire avait prévenu, la guerre de 14 eut sa beauté. Et le jeune Aragon lui-même, plébiscitant les vers du jeune Drieu, écrivait que tous deux l’avaient aimée, cette guerre, comme une négresse. Remercions Marine Branland, responsable du choix et du commentaire des gravures qui imposent ici leur propre texte, d’avoir ouvert son magnifique corpus au-delà de nos frontières nationales et mentales. Stéphane Guégan
 *Louise de Coligny-Châtillon, dite Lou, Lettres à Guillaume Apollinaire, édition établie, présentée et annotée par Pierre Caizergues, Gallimard, 12€.
*Louise de Coligny-Châtillon, dite Lou, Lettres à Guillaume Apollinaire, édition établie, présentée et annotée par Pierre Caizergues, Gallimard, 12€.
**Guillaume Apollinaire, Alcools, fac-similé de l’exemplaire enluminé d’aquarelles par Louis Marcoussis, le coffret contient la série des Eaux-fortes pour Alcools de 1934 et une Étude de Jean-Marc Chatelain, directeur de la réserve des livres rares de la BNF, Gallimard/ BNF éditions, 35€. La collection Poésie/Gallimard, où il est un long-seller, fête doublement Apollinaire. D’où le coffret qui réunit les six titres de la collection et l’anthologie qui en contient la quintessence (Tout terriblement, 8,30€, couverture ci-dessus). Si la poésie est la langue du désir et de l’inquiétude, pour citer Laurence Campa, elle a pu être celle de la guerre et de tout ce qu’elle réveille en l’homme.
***Collectif, Armistice, préface d’Antoine Gallimard, iconographie par Marine Branland, Gallimard / Mission du Centenaire de 14-18, 35€
D’autres guerres, d’autres mondes
*Cas d’auto-dévoration classique, le soldat Švejk aura vite englouti son créateur, le praguois Jaroslav Hašek (1883-1923). Son roman de guerre paraît en 1921, à point nommé pour être porté en triomphe par les dadaïstes et les expressionnistes allemands. Ils en établissent à jamais la réputation satirique, incarnée en Švejk, manière d’Ubu slave, plus malin qu’hardi, et insatiable buveur de bière. Une sorte de décomposition galopante partout le récit burlesque des exploits misérables d’un héros qui n’en a plus que le nom. Švejk parle, mais agit peu, et guère en faveur de sa patrie. Le verbiage qu’il débite ad libitum, note Jean Boutan, creuse la « crise du langage » que diagnostiquaient les  Viennois, ses voisins, depuis le début du XXe siècle. Le conflit mondial, en dépeçant la monarchie habsbourgeoise, ne peut plus confier au roman que le devoir de dire une réalité humaine et un édifice politique en miettes. Aussi célèbre que celui du Voyage de Céline, l’incipit des Aventures du brave soldat Švejk édicte tout un programme de démolition avec le sourire : « Et voilà. Ils ont tué Ferdinand. » On comprend que cette épopée carnavalesque ait déplu aux Tchèques. De plus, les anciennes connivences bolcheviques de l’auteur donnaient des aigreurs, plus légitimes, il est vrai. Le plus drôle est que cet enfant de Lénine, cet ancien soldat de l’armée rouge, enrôlé dans la légion tchécoslovaque en mars 1916, soit mort en nostalgique de l’empire austro-hongrois (Jaroslav Hašek, Les Aventures du brave soldat Švejk pendant la Grande Guerre, édition de Jean Boutan, Gallimard, Folio Classique, 8,30€)
Viennois, ses voisins, depuis le début du XXe siècle. Le conflit mondial, en dépeçant la monarchie habsbourgeoise, ne peut plus confier au roman que le devoir de dire une réalité humaine et un édifice politique en miettes. Aussi célèbre que celui du Voyage de Céline, l’incipit des Aventures du brave soldat Švejk édicte tout un programme de démolition avec le sourire : « Et voilà. Ils ont tué Ferdinand. » On comprend que cette épopée carnavalesque ait déplu aux Tchèques. De plus, les anciennes connivences bolcheviques de l’auteur donnaient des aigreurs, plus légitimes, il est vrai. Le plus drôle est que cet enfant de Lénine, cet ancien soldat de l’armée rouge, enrôlé dans la légion tchécoslovaque en mars 1916, soit mort en nostalgique de l’empire austro-hongrois (Jaroslav Hašek, Les Aventures du brave soldat Švejk pendant la Grande Guerre, édition de Jean Boutan, Gallimard, Folio Classique, 8,30€)
**Dans Anthologie de l’humour noir, son livre le plus significatif, André Breton déploie un art du raccourci qui a tout des fulgurances d’une guerre renouée au seuil de nouveaux désastres… Saluant avec émotion la figure intimidante de Jacques Vaché, « l’homme que j’ai le plus aimé au monde », le surréaliste en chef théorise « la désertion de l’intérieur » à grands renforts de freudisme expéditif. Il n’envisage que deux réponses au surmoi patriotique, le consentement au sacrifice aveugle  et le dandysme de la résistance oblique, « le soi reprenant le dessus comme dans le cas d’Ubu ou du brave soldat Chvéïk (tiens, tiens) ». Vaché, inutile de le préciser, appartient à l’armée de l’ombre, au club du rire corrosif et aux forces de la nuit, celles qui l’entraîneront au suicide par overdose d’opium, sous l’uniforme, en 1919. L’impeccable édition augmentée des Lettres de guerre, chef-d’œuvre étanche aux rides, sera-t-elle l’occasion de les sortir du carcan où les penseurs de l’insoumission ont enfermé cette étonnante chronique, qui fleure plus l’aristocratisme meurtri que le défaitisme béat ? Lecteur du Zarathoustra au front, comme Drieu, Vaché mérite mieux que de finir en breloque de la défilade (Jacques Vaché, Lettres de guerre 1914-1918, édition établie et annotée par Patrice Allain et Thomas Guillemin, préface par Patrice Allain, Gallimard, 24€). SG
et le dandysme de la résistance oblique, « le soi reprenant le dessus comme dans le cas d’Ubu ou du brave soldat Chvéïk (tiens, tiens) ». Vaché, inutile de le préciser, appartient à l’armée de l’ombre, au club du rire corrosif et aux forces de la nuit, celles qui l’entraîneront au suicide par overdose d’opium, sous l’uniforme, en 1919. L’impeccable édition augmentée des Lettres de guerre, chef-d’œuvre étanche aux rides, sera-t-elle l’occasion de les sortir du carcan où les penseurs de l’insoumission ont enfermé cette étonnante chronique, qui fleure plus l’aristocratisme meurtri que le défaitisme béat ? Lecteur du Zarathoustra au front, comme Drieu, Vaché mérite mieux que de finir en breloque de la défilade (Jacques Vaché, Lettres de guerre 1914-1918, édition établie et annotée par Patrice Allain et Thomas Guillemin, préface par Patrice Allain, Gallimard, 24€). SG
***Avant de quitter un monde qu’il ne désespérait pas de déniaiser, le regretté Bernard de Fallois eut l’idée de rééditer un livre introuvable, très oublié, en dehors de ceux qui s’intéressent à l’histoire réelle du bolchevisme et de ses complicités françaises. Comme une bonne idée peut en cacher une autre, l’éditeur confia à Jean-Claude Casanova le soin d’en rédiger la préface. On y apprend l’essentiel de ce qu’il faut savoir de Boris Kritchevski et de son brûlot, Vers la catastrophe russe, sur lequel s’abattit, dès décembre 1917, l’éteignoir des socialistes proches du léninisme radical. Ils devaient, trois ans plus tard, grossir les 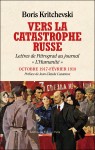 rangs du PCF naissant. Casanova ouvre le feu en citant Léon Bloy et son Journal en date du 18 mars 1917 : « Le tsar Michel proclame la pleine souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple en Russie ! En 1789, la Terreur s’est fait attendre trois ans. Les Russes iront plus vite. » Au départ, Boris Kritchevski n’a pas de telles préventions. Russe de naissance, marxiste réformiste et donc dénoncé par Lénine pour tiédeur dès 1902, il avait quitté son pays et ses prisons dix ans plus tôt. Parvenu en France au seuil du nouveau siècle, très lié aux socialistes allemands, l’exilé surveillé collabore à L’Humanité à partir de 1916. Il est naturellement envoyé couvrir la révolution d’octobre, qui va priver les alliés du contre-feu russe. Kritchevski aura d’autres déceptions, d’autres indignations. Elles jettent L’Humanité dans la tourmente. Mais la censure l’emporte et le feuilleton s’arrête. Ces Lettres de Petrograd, qu’on voulait faire taire, paraissent en volume et en 1919, l’année de la mort de leur auteur vengé. Les lire aujourd’hui est une seconde vengeance sur le complot du silence communiste (Boris Kritchevski, Vers la catastrophe russe. Lettres de Petrograd au journal L’Humanité (octobre 1917 – février 1918), préface de Jean-Claude Casanova, Éditions de Fallois, 18€).
rangs du PCF naissant. Casanova ouvre le feu en citant Léon Bloy et son Journal en date du 18 mars 1917 : « Le tsar Michel proclame la pleine souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple en Russie ! En 1789, la Terreur s’est fait attendre trois ans. Les Russes iront plus vite. » Au départ, Boris Kritchevski n’a pas de telles préventions. Russe de naissance, marxiste réformiste et donc dénoncé par Lénine pour tiédeur dès 1902, il avait quitté son pays et ses prisons dix ans plus tôt. Parvenu en France au seuil du nouveau siècle, très lié aux socialistes allemands, l’exilé surveillé collabore à L’Humanité à partir de 1916. Il est naturellement envoyé couvrir la révolution d’octobre, qui va priver les alliés du contre-feu russe. Kritchevski aura d’autres déceptions, d’autres indignations. Elles jettent L’Humanité dans la tourmente. Mais la censure l’emporte et le feuilleton s’arrête. Ces Lettres de Petrograd, qu’on voulait faire taire, paraissent en volume et en 1919, l’année de la mort de leur auteur vengé. Les lire aujourd’hui est une seconde vengeance sur le complot du silence communiste (Boris Kritchevski, Vers la catastrophe russe. Lettres de Petrograd au journal L’Humanité (octobre 1917 – février 1918), préface de Jean-Claude Casanova, Éditions de Fallois, 18€).
****Le naufrage de la Russie tsariste n’a pas suspendu longtemps le bon vieil impérialisme local, il change seulement de drapeau et trompeusement d’idéal. De même, la Realpolitik conduira-t-elle bientôt le peu scrupuleux Lénine à s’entendre avec Atatürk, autre  bienfaiteur de l’humanité, très prisé d’Hitler, au-dessus des plaies de la guerre de 14. La jeune république arménienne sera l’une de leurs victimes, au mépris du Traité de Sèvres. Ce n’est pas la seule conséquence funeste de l’armistice du 11 novembre 1918 et de ses démembrements territoriaux qu’aborde l’exposition très bien faite du Musée de l’armée, A l’Est, la guerre sans fin 1918-1923 (jusqu’au 20 janvier, catalogue coédité par Gallimard, 29€). Pouvait-on construire rapidement, et solidement, sur les cendres des empires russe, autrichien et ottoman ? Ce fut l’une des grandes illusions de la Paix, aggravée par la naïveté et l’impuissance des vainqueurs à faire appliquer les fameux traités… De la poudre aux yeux, voire de la poudre tout court, annonciatrice du bourbier des Balkans que l’on sait, et de l’arrogance turque, négationniste et belliqueuse, que l’on sait aussi. La guerre de 14 fut le suicide de l’Europe et la bombe à retardement du XXe siècle en son entier. Une guerre sans cesse recommencée, oui, et auquel 1923 ne mit pas fin. SG
bienfaiteur de l’humanité, très prisé d’Hitler, au-dessus des plaies de la guerre de 14. La jeune république arménienne sera l’une de leurs victimes, au mépris du Traité de Sèvres. Ce n’est pas la seule conséquence funeste de l’armistice du 11 novembre 1918 et de ses démembrements territoriaux qu’aborde l’exposition très bien faite du Musée de l’armée, A l’Est, la guerre sans fin 1918-1923 (jusqu’au 20 janvier, catalogue coédité par Gallimard, 29€). Pouvait-on construire rapidement, et solidement, sur les cendres des empires russe, autrichien et ottoman ? Ce fut l’une des grandes illusions de la Paix, aggravée par la naïveté et l’impuissance des vainqueurs à faire appliquer les fameux traités… De la poudre aux yeux, voire de la poudre tout court, annonciatrice du bourbier des Balkans que l’on sait, et de l’arrogance turque, négationniste et belliqueuse, que l’on sait aussi. La guerre de 14 fut le suicide de l’Europe et la bombe à retardement du XXe siècle en son entier. Une guerre sans cesse recommencée, oui, et auquel 1923 ne mit pas fin. SG
 *****A propos de La Cathédrale incendiée. Reims, septembre 1914, de Thomas Gaehtgens, Bibliothèque illustrée des Histoires, Gallimard, 29€, voir ma note dans la dernière livraison de la Revue des deux mondes, novembre 2018.
*****A propos de La Cathédrale incendiée. Reims, septembre 1914, de Thomas Gaehtgens, Bibliothèque illustrée des Histoires, Gallimard, 29€, voir ma note dans la dernière livraison de la Revue des deux mondes, novembre 2018.