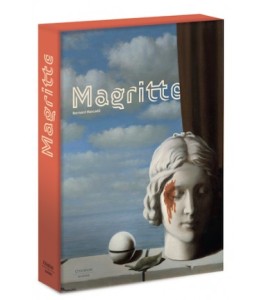Le piéton de Paris, dès qu’il est un peu écrivain, marche dans un rêve. C’est que la capitale tient du navire qui la symbolise depuis le XIVe siècle, elle vogue sur les mots. La parole des poètes lui sert à gonfler ses voiles qui « jamais ne sombrent ». Poète, grand poète même, grand batteur de pavé aussi, Léon-Paul Fargue le fut assurément. Condisciple d’Alfred Jarry, – ce qui lui vaudra d’être portraituré par le douanier Rousseau (l’œuvre a resurgi en 2005), il eut la vingtaine au milieu des années 1890, et se garda aussi bien des bombes anarchistes (malgré ses sympathies rimbaldiennes pour la cause) que du symbolisme coupé du monde (malgré son admiration pour Mallarmé et les Parnassiens). Il suffira, pour le résumer alors, de le situer du côté de Jean de Tinan et de Pierre Louÿs, ou de Levet, cher à Frédéric Vitoux. Fargue était assez fortuné pour ne pas mourir de sa plume, Gallimard publiait sa poésie d’happy few sans rechigner. L’aristocratie des faux rentiers et des vrais viveurs semblait lui offrir une famille durable. De Montmartre à Montparnasse, il accompagna le transfert de 1909-1910 et, les années passant, connut tout le monde, de Lautrec, qu’il observa avec révérence, à Salmon et Picasso, Drieu, Cocteau et Morand au temps du Bœuf et du Grand écart… Car les années folles l’occupèrent à plein temps, les cafés, de jour, et les boîtes, de nuit. Ses services de noctambule furent si brillants qu’il se tailla sous peu une manière d’autorité en matière de vagabondage littéraire. Il y avait là de l’or à exploiter. L’argent ayant fini par manquer, du reste, Fargue entra en journalisme à partir de 1934, quand la presse renouait avec le reportage d’impressions, accompagné de photographies (jusqu’à Man Ray) ou d’illustrations. Le résultat, s’agissant de Fargue, l’emporte sur la concurrence qui n’a pas sa plastique émue, son esprit, celui de la rue et parfois des Apaches. Si Le Piéton de Paris (Gallimard), grand succès de 1939, continue à faire connaître une partie de ses chroniques pédestres, un grand nombre d’entre elles appelaient l’exhumation que leur ouvrent les excellentes Editions du Sandre. Elles devaient charmer Maurice Blanchot sous l’Occupation, qui les installa immédiatement dans la filiation du poème en prose de Baudelaire. Il n’est de bon spleen que de Paris, pensait Fargue, qui savait sa ville plus rapide à changer « que le cœur d’un mortel ». Toute description un peu sensible de la capitale, on le sait, navigue entre ce qui fut et ce qui sera. Le présent y est plus instable qu’ailleurs, la nostalgie plus poignante, l’attention aux travaux d’urbanisme plus exigeante. Fargue alterne désinvolture et gravité, laisse remonter les souvenirs entassés depuis la Belle époque, qu’il préfère aux années 1920-30, trop hygiéniques, ou trop sérieuses. Il est l’écrivain des odeurs, des ombres, des fantômes, des Parisiennes et des géographies sécrètes, il refuse de décrire froidement ce qui est une part de lui-même. On le sent peu haussmannien, et très hostile à ce qui prépare le règne de la bagnole et de la trottinette. La marche est une éthique, une esthétique, qui le tient près de Verlaine ou de son cher Charles-Louis Philippe, de Gautier, voire du Paris vécu de Léon Daudet (1929, Gallimard).

Rien de Paris ne lui est inconnu, ses pages sur le «Ghetto » (du Marais) sont une merveille, Stefan Zweig y passe une tête, de même que les filles aux yeux verts et ces vieux ivrognes qui ne souhaitent plus que « mourir dans une patrie libérale et facile qui n’autorise pas les pogroms ». Parmi tous les peintres que Fargue nous fait croiser, Modigliani (1884-1920), Juif de Livourne, a droit à des égards de prince. En cette année anniversaire, Thierry Dufrêne consacre un livre formidable, en tous sens, au « bel Italien », selon les mots de Beatrice Hastings qui savait de quoi elle parlait. Le format, d’abord, confère aux images une respiration inouïe et presque un grain, chose importante quand on s’attache, autant que l’auteur, à l’épiderme des toiles et à ce qui fut le triomphe de cette peinture chaude, soit les nus tardifs de l’artiste, où Modi prit tous les risques, le dialogue ouvert avec Ingres et Manet, la tension charnelle qui ne conserve que l’ocre de sa rivalité avec Gauguin et Picasso. Carco, Coquiot et surtout Waldemar-George en furent les lyriques clairons. La fraîcheur d’analyse de Dufrêne récompense sa parfaite connaissance des sources et sa volonté évidente de rendre au peintre une épaisseur que le mythe du génie soûlographe, ne peignant qu’avec ses tripes malades et son primitivisme ressourcé à la seule statuaire africaine, avait largement gommé. On pourrait multiplier les exemples du profit que l’auteur tire des annotations puisées aux marges des dessins, croix de David, élans ésotériques ou christiques, citations du Parallèlement de Verlaine, vitalisme nietzschéen, etc. « Le cœur, la compassion, la beauté sont valorisés au détriment de la tête, du savoir […]. C’est par l’incarnation dans l’œuvre et non par un savoir abstrait que la vertu peut être retrouvée. » Une recommandation s’impose donc à quiconque aborde l’œuvre avec la juste suspicion qu’inspire la mythologie des montparnos : il y a bien, de la part de Modi, « un engagement dans l’œuvre quoi qu’il en coûte ». Une note de 1913, en outre, autorise à dissocier son vocabulaire archaïsant, mêlé d’emprunts à Botticelli, Greco ou Cézanne, d’une simple apologie de l’instinctif : Modigliani y confesse ne pas chercher « le réel, pas l’irréel non plus, mais l’inconscient, le mystère de l’instinctivité de la Race ». Dufrêne s’oppose, du reste, à ceux qui systématisent désormais le prisme de la judéité comme unique lecture de l’œuvre. Par race, Modigliani entendait un atavisme plus large que ses racines juives, et qui passait par l’héritage politique des siens, très libertaire (tendance Kropotkine, comme chez Van Dongen), et englobait une culture artistique dont ce livre très riche dévoile chaque recoin, à notre plus bel étonnement. Formé jeune à l’école des macchiaioli, frotté de culture française par sa mère, goûtant tôt aussi bien Beardsley que Lautrec, Amadeo n’aura pas besoin de céder au fauvisme et au cubisme, encore moins au futurisme, pour se doter d’une légitimité moderne et d’une conscience anti-moderne. Sa vision, écrit Dufrêne, était assez ethnicisée et chaleureuse pour cartographier l’école de Paris sans réduire les individus au type. Ou à quelque essence. Le contingent dessinait une ligne d’horizon ou de contour plus troublante.
Stéphane Guégan

Léon-Paul Fargue, L’Esprit de Paris, édition intégrale des chroniques parisiennes établie et annotée par Barbara Pascarel, Éditions du Sandre, 35€ / Thierry Dufrêne, Modigliani, Citadelles et Mazenod, 235€ / Les éditions Bartillat, toujours bien inspirées, remettent en circulation l’un des plus beaux livres de Théophile Gautier, l’un de ceux qui font mentir sa réputation d’observateur distant, inaccessible à l’émotion ou à la compassion. Tableaux de siège en montra envers les Parisiens qui, comme lui, endurèrent la guerre franco-prussienne et même, quoi qu’on en ait dit, envers les Communards, exécutés ou sous les fers, après la Semaine sanglante. Il faut bien lire les pages qu’on dit haineuses sur la tourbe des révoltés, en raison de la bestialité qu’elles partagent avec celles et ceux qu’elles stigmatisent, mais aussi de l’esprit de charité qu’elles laissent transparaître malgré elles. Son rapport aux forces primitives, à la violence élémentaire, au sublime du mal, a toujours été double, évidemment, comme sa relation au progrès technique. Confiné à l’intérieur des remparts parisiens au cours de l’hiver 1870-1871, Gautier n’a jamais autant nourrri la presse du temps de ses déambulations, pensées intimes et aperçus d’un monde artistique toujours actif. Né de ces articles écrits à chaud, le livre se referme sur un texte que Fargue eût pu signer. Quand Paris fut ainsi menacée de perdre son rôle de capitale, conséquence de la guerre civile qui venait de déchirer le pays, Gautier s’emporta contre cette idée absurde des amis de Thiers. La « lente élaboration des siècles », la centralité artistique et intellectuelle, la beauté de la ville, tout s’y opposait. C’eût été comme vouloir arracher le soleil à son rôle cosmique, ou éteindre le génie français (Théophile Gautier, Tableaux de siège. Paris 1870-1871, édition établie par Michel Brix, Bartillat, 20€).