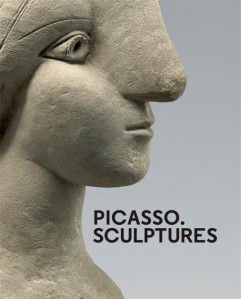 Les voies de la création picassienne ne sont pas insondables. Ceux qui continuent à diviniser Don Pablo, par sotte dévotion au « génial touche-à-tout », sacrifient l’analyse aux mots, effaçant d’autorité le cheminement, long parfois, voire interminable, des œuvres mêmes. Bien que notre époque ait une fâcheuse tendance à préférer l’étude des processus à la pleine jouissance du fruit mûr, l’actuelle exposition du musée Picasso, très différente de sa version new yorkaise, fait son miel de métamorphoses peu glosées habituellement. Le regard se déplace, de l’amont vers l’aval, des sources aux variations, effets de série, mutations de matière et de médium. Là est la nouveauté. Car les sculptures de Picasso, contrairement à ce qui se lit encore, sont loin d’avoir été négligées par les chercheurs, les livres et les expositions. L’artiste n’avait pas agi autrement, qui se prêta à leur diffusion internationale. Très tôt, en effet, le marché de l’art, dont Picasso fut un as, s’enticha de ses multiples. Aussi étonnant que cela paraisse, la bibelot-manie de la Belle époque, féconde en petits bronzes de bureau ou de cheminée, a su s’accoupler avec le flair de Vollard et Kahnweiler. Jusqu’au fameux Verre d’absinthe, concrétion rodinienne et dérivante sous les effets de la fée verte (Picasso en avait mesuré les ravages autour de lui), l’andalou jette ses primes admirations (Rodin, Medardo Rosso, Gauguin, Cézanne, l’Afrique noire) dans le creuset de sculptures déclinables à plus ou moins grande taille et échelle. Cette Joconde alcoolisée et paradoxale du cubisme, dont les 6 variantes sont réunies pour la première fois depuis 101 ans, signale deux choses : nulle frontière ici entre peinture et sculpture, surface et volume ; nulle évolution progressive et progressiste vers l’épure du signe.
Les voies de la création picassienne ne sont pas insondables. Ceux qui continuent à diviniser Don Pablo, par sotte dévotion au « génial touche-à-tout », sacrifient l’analyse aux mots, effaçant d’autorité le cheminement, long parfois, voire interminable, des œuvres mêmes. Bien que notre époque ait une fâcheuse tendance à préférer l’étude des processus à la pleine jouissance du fruit mûr, l’actuelle exposition du musée Picasso, très différente de sa version new yorkaise, fait son miel de métamorphoses peu glosées habituellement. Le regard se déplace, de l’amont vers l’aval, des sources aux variations, effets de série, mutations de matière et de médium. Là est la nouveauté. Car les sculptures de Picasso, contrairement à ce qui se lit encore, sont loin d’avoir été négligées par les chercheurs, les livres et les expositions. L’artiste n’avait pas agi autrement, qui se prêta à leur diffusion internationale. Très tôt, en effet, le marché de l’art, dont Picasso fut un as, s’enticha de ses multiples. Aussi étonnant que cela paraisse, la bibelot-manie de la Belle époque, féconde en petits bronzes de bureau ou de cheminée, a su s’accoupler avec le flair de Vollard et Kahnweiler. Jusqu’au fameux Verre d’absinthe, concrétion rodinienne et dérivante sous les effets de la fée verte (Picasso en avait mesuré les ravages autour de lui), l’andalou jette ses primes admirations (Rodin, Medardo Rosso, Gauguin, Cézanne, l’Afrique noire) dans le creuset de sculptures déclinables à plus ou moins grande taille et échelle. Cette Joconde alcoolisée et paradoxale du cubisme, dont les 6 variantes sont réunies pour la première fois depuis 101 ans, signale deux choses : nulle frontière ici entre peinture et sculpture, surface et volume ; nulle évolution progressive et progressiste vers l’épure du signe.
 Chaque choix stylistique emporte son contraire, ou le libère plus tard. Picasso n’use guère des vides et des pleins en dehors de leur union mouvante. L’effort « plastique », mot d’époque, ne s’autorise d’aucun gel des apparences… Le Monument à Apollinaire, dont les premières maquettes datent de l’automne 1928, ne tisse pas sa toile autour du « rien » de sa vulgate, il émerge du carnet de Dinard et des baigneurs en forme de l’été précédent. Naissent alors les futurs échos phalliques de son hommage posthume au grand poète (mort e 1918) et la production mi-solaire, mi-régressive de Boisgeloup, car héritière des Vénus callipyges de notre préhistoire et tributaire du compagnonnage distant avec les surréalistes. Si Breton excelle à comprendre dès 1933 en quoi le composite picassien fait sens (le statuaire ne cessera plus d’accroitre la part du bricolage et de l’assemblage hétérogènes), c’est Malraux et sa géniale Tête d’obsidienne de 1974 (étrangement absents du catalogue) qui diront le mieux la dimension fractionnelle (au regard de ses amis communistes) et hérétique (vis-à-vis des chapelles modernistes) des années 1950-1960. Avec sa répugnance instinctive pour toute concession sentimentale, Malraux préférait La Femme à la poussette, totem ironique et unique, à L’Homme au mouton, dont la propagande coco s’était emparée.
Chaque choix stylistique emporte son contraire, ou le libère plus tard. Picasso n’use guère des vides et des pleins en dehors de leur union mouvante. L’effort « plastique », mot d’époque, ne s’autorise d’aucun gel des apparences… Le Monument à Apollinaire, dont les premières maquettes datent de l’automne 1928, ne tisse pas sa toile autour du « rien » de sa vulgate, il émerge du carnet de Dinard et des baigneurs en forme de l’été précédent. Naissent alors les futurs échos phalliques de son hommage posthume au grand poète (mort e 1918) et la production mi-solaire, mi-régressive de Boisgeloup, car héritière des Vénus callipyges de notre préhistoire et tributaire du compagnonnage distant avec les surréalistes. Si Breton excelle à comprendre dès 1933 en quoi le composite picassien fait sens (le statuaire ne cessera plus d’accroitre la part du bricolage et de l’assemblage hétérogènes), c’est Malraux et sa géniale Tête d’obsidienne de 1974 (étrangement absents du catalogue) qui diront le mieux la dimension fractionnelle (au regard de ses amis communistes) et hérétique (vis-à-vis des chapelles modernistes) des années 1950-1960. Avec sa répugnance instinctive pour toute concession sentimentale, Malraux préférait La Femme à la poussette, totem ironique et unique, à L’Homme au mouton, dont la propagande coco s’était emparée.
 Le 6 août 1950, une foule compacte devait assister à l’érection du dit mouton sur la place du marché de Vallauris. L’événement se déroule sous la férule du PC, spécialiste des estrades au cordeau. Invité d’honneur, le camarade Picasso siège aux côtés de Françoise Gilot. Paul Eluard et Tristan Tzara, eux, se serrent parmi les membres du bureau politique. Cocteau, le pestiféré, observe le tout depuis le balcon de son hôtel. Claude Arnaud a très bien raconté la scène (Gallimard, 2003), le poète ostracisé jetant ensuite de terribles anathèmes, sous les yeux de James Lord, au sujet de « l’engouement stalinien » du peintre milliardaire. Cocteau réserva-t-il l’une de ses pointes assassines à l’espèce de carnaval auquel Picasso se pliait alors pour coller à l’image du bon « ouvrier de Vallauris » ? Dans le très remarquable numéro spécial des Cahiers d’arts que viennent de diriger Cécile Godefroy et Vérane Tasseau, les photographies d’atelier dont la revue abreuva ses lecteurs et appuya ses analyses nourrissent une série de nouveaux essais. Or, dès sa reprise en 1945, Zervos y seconde les visées hégémoniques du « parti des fusillés » et la mythologie naissante de L’Homme au mouton et du potier en espadrilles. Les Cahiers d’art, du reste, s’étaient toujours conduits en caisse de résonance du culte picassien. Autres temps, autres mœurs, Godefroy et Tasseau ne secouent plus l’encensoir sur les mannes de leur héros. Elles préfèrent le surprendre au travail, sa passion, et interroger, à neuf, le ballet des médiums.
Le 6 août 1950, une foule compacte devait assister à l’érection du dit mouton sur la place du marché de Vallauris. L’événement se déroule sous la férule du PC, spécialiste des estrades au cordeau. Invité d’honneur, le camarade Picasso siège aux côtés de Françoise Gilot. Paul Eluard et Tristan Tzara, eux, se serrent parmi les membres du bureau politique. Cocteau, le pestiféré, observe le tout depuis le balcon de son hôtel. Claude Arnaud a très bien raconté la scène (Gallimard, 2003), le poète ostracisé jetant ensuite de terribles anathèmes, sous les yeux de James Lord, au sujet de « l’engouement stalinien » du peintre milliardaire. Cocteau réserva-t-il l’une de ses pointes assassines à l’espèce de carnaval auquel Picasso se pliait alors pour coller à l’image du bon « ouvrier de Vallauris » ? Dans le très remarquable numéro spécial des Cahiers d’arts que viennent de diriger Cécile Godefroy et Vérane Tasseau, les photographies d’atelier dont la revue abreuva ses lecteurs et appuya ses analyses nourrissent une série de nouveaux essais. Or, dès sa reprise en 1945, Zervos y seconde les visées hégémoniques du « parti des fusillés » et la mythologie naissante de L’Homme au mouton et du potier en espadrilles. Les Cahiers d’art, du reste, s’étaient toujours conduits en caisse de résonance du culte picassien. Autres temps, autres mœurs, Godefroy et Tasseau ne secouent plus l’encensoir sur les mannes de leur héros. Elles préfèrent le surprendre au travail, sa passion, et interroger, à neuf, le ballet des médiums.
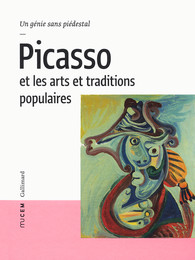 Picasso l’a dit à Pierre Daix, au sujet des œuvres produites après qu’il eut rejoint La Californie : « La peinture et la sculpture ont vraiment discuté ensemble. » la formule, on le sait, vaut pour d’autres époques de sa création, elle s’étend aussi à d’autres effets de capillarité, sur lesquels l’artiste s’est montré moins loquace. Il est des modèles qu’on avoue et d’autres qu’on cache, ou qu’on abandonne aux psychanalystes… A Marseille, sur les hauteurs du Fort Saint-Jean, à l’abri donc du freudisme banalisé, Bruno Gaudichon et Joséphine Matamoros ouvrent maints passages vers cet autre « musée imaginaire » où Raphaël, Rembrandt, Ingres, Goya et Manet s’effacent devant les toiles du père, les ex-voto du cru et toute une imagerie hispanique prête à resurgir dès que la psyché picassienne bute sur l’Éros des baratines et des mantilles, les sacrifices ritualisés de la corrida ou les jeux de l’enfance. Le primitivisme qu’il partage avec son siècle ne s’arrête pas à la supposée virginité de l’art nègre. Il fait sien, autant que son ami Jarry avant lui, l’entier trésor des formes et des pratiques populaires. A Vallauris, après la Libération, sa frénésie céramique fera coup double. Elle réveille son fond d’archaïsme méditerranéen et flatte l’image de l’homme qui, outre l’adhésion claironnée au communisme, a su revêtir son marcel et retrouvé l’humilité de l’artisan pour parler aux simples mortels. L’enfantin et le bricolage relèvent aussi des préoccupations de l’après-guerre et offrent des leviers efficaces à sa création polymorphe. Mais la véritable audace ne pouvait éclater avant que l’énergie du premier âge n’électrise ou ne vandalise les derniers tableaux. Ils sont là aussi, garants d’une jeunesse indomptée, aux portes du barbouillage.
Picasso l’a dit à Pierre Daix, au sujet des œuvres produites après qu’il eut rejoint La Californie : « La peinture et la sculpture ont vraiment discuté ensemble. » la formule, on le sait, vaut pour d’autres époques de sa création, elle s’étend aussi à d’autres effets de capillarité, sur lesquels l’artiste s’est montré moins loquace. Il est des modèles qu’on avoue et d’autres qu’on cache, ou qu’on abandonne aux psychanalystes… A Marseille, sur les hauteurs du Fort Saint-Jean, à l’abri donc du freudisme banalisé, Bruno Gaudichon et Joséphine Matamoros ouvrent maints passages vers cet autre « musée imaginaire » où Raphaël, Rembrandt, Ingres, Goya et Manet s’effacent devant les toiles du père, les ex-voto du cru et toute une imagerie hispanique prête à resurgir dès que la psyché picassienne bute sur l’Éros des baratines et des mantilles, les sacrifices ritualisés de la corrida ou les jeux de l’enfance. Le primitivisme qu’il partage avec son siècle ne s’arrête pas à la supposée virginité de l’art nègre. Il fait sien, autant que son ami Jarry avant lui, l’entier trésor des formes et des pratiques populaires. A Vallauris, après la Libération, sa frénésie céramique fera coup double. Elle réveille son fond d’archaïsme méditerranéen et flatte l’image de l’homme qui, outre l’adhésion claironnée au communisme, a su revêtir son marcel et retrouvé l’humilité de l’artisan pour parler aux simples mortels. L’enfantin et le bricolage relèvent aussi des préoccupations de l’après-guerre et offrent des leviers efficaces à sa création polymorphe. Mais la véritable audace ne pouvait éclater avant que l’énergie du premier âge n’électrise ou ne vandalise les derniers tableaux. Ils sont là aussi, garants d’une jeunesse indomptée, aux portes du barbouillage.
Stéphane Guégan
*Picasso. Sculptures, Musée Picasso, Paris, jusqu’au 28 août. Catalogue sous la direction des commissaires, Virginie Perdrisot et Cécile Godefroy, Somogy Editions d’art/Musée Picasso, 45€. Pourvu d’utiles chronologies (mais d’où Malraux est banni), il propose une série d’essais. Le plus neuf et informé, de loin, est celui de Clare Finn, qui enrichit notre connaissance des bronzes que Picasso fit couler sous l’Occupation, jusqu’à l’été 1942. Il est amusant de penser que la fameuse Tête de mort, bibelot ad hoc des années sombres, ait connu plusieurs tirages malgré la pénurie… Le célèbre crâne serait de 1941, dit Finn, et non de 1943. Correctif que proposait déjà, à titre d’hypothèse, Elizabeth Cowling, à l’occasion de sa marquante exposition Picasso : Sculptor / Painter (Tate Gallery, 1994). Quant à Malraux, La Tête d’obsidienne et Picasso, voir mon Il faut tuer l’art moderne dans la dernière livraison de L’Infini (n°135, Gallimard, Printemps 2016, 20,50€).
** Cécile Godefroy et Vérane Tasseau (dir.), Picasso dans l’atelier, numéro spécial des Cahiers d’art, novembre 2015, 75€. Puisqu’il s’agissait d’éclairer l’« aller-retour entre les médiums » (V. Tasseau) et les échanges que provoque Picasso entre sa création et le reflux du photographique ou du filmique (le matériel de Clouzot), certains essais (Godefroy, Cowling, Tasseau), touchent au but mieux que d’autres. L’ensemble comporte une série d’interviews d’artistes d’aujourd’hui (Longo, Condo, Koons…).
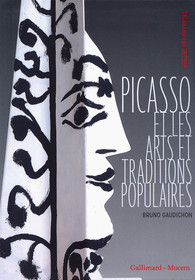 ***Bruno Gaudichon et Joséphine Matamoros (dir.), Un génie sans piédestal. Picasso et les arts et traditions populaires, Gallimard /MUCEM, 35€. Gaudichon signe aussi l’alerte Hors-Série Découvertes (8,90€), chez le même éditeur, qui accompagne le catalogue sans le démarquer. Save the date : Conférence-lecture, Picasso est une fête !, Musée de l’Orangerie, mercredi 25 mai, 19h00, dans le cadre de l’exposition Apollinaire, le regard du poète, avec la participation d’Émilie Bouvard, Emilia Philippot, Stéphane Guégan et de comédiens du centre dramatique national Les Tréteaux de France.
***Bruno Gaudichon et Joséphine Matamoros (dir.), Un génie sans piédestal. Picasso et les arts et traditions populaires, Gallimard /MUCEM, 35€. Gaudichon signe aussi l’alerte Hors-Série Découvertes (8,90€), chez le même éditeur, qui accompagne le catalogue sans le démarquer. Save the date : Conférence-lecture, Picasso est une fête !, Musée de l’Orangerie, mercredi 25 mai, 19h00, dans le cadre de l’exposition Apollinaire, le regard du poète, avec la participation d’Émilie Bouvard, Emilia Philippot, Stéphane Guégan et de comédiens du centre dramatique national Les Tréteaux de France.
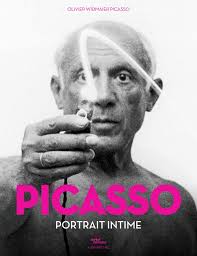
 Le livre de Germain Latour, Guernica. Histoire secrète d’un tableau (Seuil, 21€), est loin d’apporter à son lecteur la moisson d’informations inédites que son titre promet. C’est que le destin du tableau, après la mort de Picasso et de Franco, l’intéresse plus que l’œuvre lui-même. Choix recevable, du reste. Germain Latour n’est pas le premier à noter que le peintre, si favorable fût-il aux Républicains espagnols, n’apporta pas à leur cause l’engagement total qu’ils en attendaient. C’est Zervos qui part en Espagne fin 1936, pas lui, alors qu’on l’a bombardé directeur en titre du Prado! Picasso, on le sait, n’avait pas l’âme d’un Hemingway ni même d’un
Le livre de Germain Latour, Guernica. Histoire secrète d’un tableau (Seuil, 21€), est loin d’apporter à son lecteur la moisson d’informations inédites que son titre promet. C’est que le destin du tableau, après la mort de Picasso et de Franco, l’intéresse plus que l’œuvre lui-même. Choix recevable, du reste. Germain Latour n’est pas le premier à noter que le peintre, si favorable fût-il aux Républicains espagnols, n’apporta pas à leur cause l’engagement total qu’ils en attendaient. C’est Zervos qui part en Espagne fin 1936, pas lui, alors qu’on l’a bombardé directeur en titre du Prado! Picasso, on le sait, n’avait pas l’âme d’un Hemingway ni même d’un