 Que Stendhal n’ait rien entendu à la peinture, on l’a pensé à la suite de Mérimée. Tout occupé des passions que le tableau était censé figurer, mettre en mouvement et donc réveiller chez le spectateur, ce grand amoureux des images aurait ignoré leur spécificité et ravalé la couleur, le dessin, le clair-obscur et la composition au rang d’accessoires, simples leviers d’une dramaturgie électrisante où s’épuisait la fonction des arts visuels. Du reste sa science et son œil étaient si infaillibles que cela ? Pouvait-on faire confiance à un homme qui, à l’occasion, confondait Dominiquin et le cavalier d’Arpin, mentor du Caravage ? Vinci et Bernardino Luini ? Comme le rappelle Daniela Gallo, en tête du présent volume, actes d’un colloque organisé en 2010, Stendhal n’a jamais reçu bon accueil de la part des historiens de l’art, qui ont peine encore à l’admettre parmi eux. Ce n’est évidemment pas le cas des quinze contributeurs de ce livre aux perspectives complémentaires, où les textes de Beyle sur l’Italie tiennent une plus grande place que ceux relatifs à la création de son temps. On peut s’en étonner dans la mesure où « l’histoire de l’art » n’est pas envisagée ici en termes académiques.
Que Stendhal n’ait rien entendu à la peinture, on l’a pensé à la suite de Mérimée. Tout occupé des passions que le tableau était censé figurer, mettre en mouvement et donc réveiller chez le spectateur, ce grand amoureux des images aurait ignoré leur spécificité et ravalé la couleur, le dessin, le clair-obscur et la composition au rang d’accessoires, simples leviers d’une dramaturgie électrisante où s’épuisait la fonction des arts visuels. Du reste sa science et son œil étaient si infaillibles que cela ? Pouvait-on faire confiance à un homme qui, à l’occasion, confondait Dominiquin et le cavalier d’Arpin, mentor du Caravage ? Vinci et Bernardino Luini ? Comme le rappelle Daniela Gallo, en tête du présent volume, actes d’un colloque organisé en 2010, Stendhal n’a jamais reçu bon accueil de la part des historiens de l’art, qui ont peine encore à l’admettre parmi eux. Ce n’est évidemment pas le cas des quinze contributeurs de ce livre aux perspectives complémentaires, où les textes de Beyle sur l’Italie tiennent une plus grande place que ceux relatifs à la création de son temps. On peut s’en étonner dans la mesure où « l’histoire de l’art » n’est pas envisagée ici en termes académiques.
 Malgré notre édition des Salons de Stendhal (Le Promeneur, 2002), ce corpus demeure un vivier possible de renseignements sur les débats esthétiques et politiques qui font de la France des années 1820 un moment décisif de notre modernité. La façon dont l’écrivain y participe sous les Bourbons restaurés, beau sujet de livre, affleure dans les pages lumineuses que Stephen Bann consacre à son cher Delaroche. Si l’antidavidisme de Stendhal reste de nature complexe autour de 1824, il s’énonce avec le tranchant d’un journalisme débâillonné et les arguments d’un homme qui ne dissocie pas la réforme du théâtre et la « révolution » dont la jeune peinture fournit l’autre scène. Delaroche, à rebours des ultimes disciples de David, confronte le public aux drames de l’histoire, à sa chair palpitante, au lieu d’en geler l’aspect, le sens et la temporalité. L’aversion de Beyle pour le style ampoulé, évidente dès ses premières lettres à Pauline, conduit à sa critique de l’« emphase imitée de Talma », dont les « âmes froides » du dernier néoclassicisme sont les terribles perroquets. Doublement imitateurs, figures au carré de la « répétition » honnie, les « vieux sectaires de David » ne font plus entendre qu’une pantomime usée, extérieure au langage des formes, quand le jeune romantisme, fidèle au « quatrième mur » de Diderot, retrouve l’unité perdue de la peinture et du drame, de la peinture et du spectateur.
Malgré notre édition des Salons de Stendhal (Le Promeneur, 2002), ce corpus demeure un vivier possible de renseignements sur les débats esthétiques et politiques qui font de la France des années 1820 un moment décisif de notre modernité. La façon dont l’écrivain y participe sous les Bourbons restaurés, beau sujet de livre, affleure dans les pages lumineuses que Stephen Bann consacre à son cher Delaroche. Si l’antidavidisme de Stendhal reste de nature complexe autour de 1824, il s’énonce avec le tranchant d’un journalisme débâillonné et les arguments d’un homme qui ne dissocie pas la réforme du théâtre et la « révolution » dont la jeune peinture fournit l’autre scène. Delaroche, à rebours des ultimes disciples de David, confronte le public aux drames de l’histoire, à sa chair palpitante, au lieu d’en geler l’aspect, le sens et la temporalité. L’aversion de Beyle pour le style ampoulé, évidente dès ses premières lettres à Pauline, conduit à sa critique de l’« emphase imitée de Talma », dont les « âmes froides » du dernier néoclassicisme sont les terribles perroquets. Doublement imitateurs, figures au carré de la « répétition » honnie, les « vieux sectaires de David » ne font plus entendre qu’une pantomime usée, extérieure au langage des formes, quand le jeune romantisme, fidèle au « quatrième mur » de Diderot, retrouve l’unité perdue de la peinture et du drame, de la peinture et du spectateur.
La pensée et le combat esthétiques de Stendhal, et ce colloque l’a bien montré, s’ancrent dans l’élargissement du « monde de l’art » aux nouveaux publics. Comment leur parler ? Les former ? Le cercle des « happy few » a cessé d’être un club fermé… Ce libéralisme envisage un élargissement des dilettanti par le haut plutôt que leur nivellement par le bas. Il repose sur l’intime conviction que le savoir n’est pas l’ennemi du plaisir. Milovan Stanic et Arnauld Pierre situent très bien cette érotique du regard entre l’âge des Lumières et l’époque de Taine. Si Stendhal est inséparable de la révolution des musées, à laquelle il prit une part active sous Denon, il l’est autant de l’essor de l’esthétique comme science propre et pensée du sensible. Nul besoin d’être un roué pour défendre l’idée que la jouissance s’éduque quel qu’en soit le déclic, le réel et l’imaginaire faisant cause commune en ce domaine. Entre les sentiments amoureux et les sensations esthétiques, Stendhal perçoit une solidarité fondamentale, liée elle-même à sa conception physico-psychique de l’âme humaine. Alexander Auf der Heyde en tire de justes conclusions au sujet du naufrage de la peinture davidienne, inapte à traduire les passions, leur processus, et se contentant d’en produire les « signes ».
 L’électricité chère à Beyle ne saurait passer dans ces conditions… L’ennui du public, du reste, sanctionne l’échec de ces tableaux d’histoire aux formules épuisées. Or, l’accès aux œuvres se démocratisant au XIXe siècle, l’art et son discours ne peuvent ignorer ces nouvelles attentes. Il y a même urgence, selon la formule de Pascal Griener, à développer une « pédagogie des émotions » exempte de la sécheresse des cuistres et des catalographes, chez lesquels l’attribution devient une fin en soi et le jargon technique une autre entrave à la communication élargie dont Stendhal a compris la nécessité. Tous ses écrits sur l’art en découlent. Ils montrent un souci du lecteur et du temps présent où s’abolit la frontière entre le sublime des maîtres anciens et l’actualité la plus chaude. Son Histoire de la peinture en Italie s’est peut-être mal vendue en 1817, elle aura toutefois visé un auditoire en prise sur l’époque. À l’échec commercial succédera, on le sait, une très longue postérité. Ce bréviaire d’énergie, exaltant le beau moderne sous la célébration de Michel-Ange et Léonard, sera lu par tout le romantisme, de Delacroix à Baudelaire et Gautier, avant d’être reçu, selon des modes variables, par l’histoire de l’art patenté. Ainsi que le confirme la riche communication d’Hélène de Jacquelot sur Abraham Constantin, qui rajeunissait Raphaël et Titien en les fixant sur l’émail, et dont parlent Les Promenades dans Rome, Stendhal fut tout sauf un prophète du passé.
L’électricité chère à Beyle ne saurait passer dans ces conditions… L’ennui du public, du reste, sanctionne l’échec de ces tableaux d’histoire aux formules épuisées. Or, l’accès aux œuvres se démocratisant au XIXe siècle, l’art et son discours ne peuvent ignorer ces nouvelles attentes. Il y a même urgence, selon la formule de Pascal Griener, à développer une « pédagogie des émotions » exempte de la sécheresse des cuistres et des catalographes, chez lesquels l’attribution devient une fin en soi et le jargon technique une autre entrave à la communication élargie dont Stendhal a compris la nécessité. Tous ses écrits sur l’art en découlent. Ils montrent un souci du lecteur et du temps présent où s’abolit la frontière entre le sublime des maîtres anciens et l’actualité la plus chaude. Son Histoire de la peinture en Italie s’est peut-être mal vendue en 1817, elle aura toutefois visé un auditoire en prise sur l’époque. À l’échec commercial succédera, on le sait, une très longue postérité. Ce bréviaire d’énergie, exaltant le beau moderne sous la célébration de Michel-Ange et Léonard, sera lu par tout le romantisme, de Delacroix à Baudelaire et Gautier, avant d’être reçu, selon des modes variables, par l’histoire de l’art patenté. Ainsi que le confirme la riche communication d’Hélène de Jacquelot sur Abraham Constantin, qui rajeunissait Raphaël et Titien en les fixant sur l’émail, et dont parlent Les Promenades dans Rome, Stendhal fut tout sauf un prophète du passé.
Stéphane Guégan
*Daniella Gallo (dir.), Stendhal. Historien de l’art, Presses Universitaires de Rennes, 20€.
*Stendhal / Théâtre. Actes du colloque (11/13 juin 2009) de l’université de Paris III, textes réunis par Lucy Garnier, Agathe Novak-Lechevallier et Myriam Sfar, L’Année stendhalienne, n° 11, Éditions Honoré Champion, 2012, 50€.
Si le jeune Beyle se rêva peintre autour de 1800 avant d’échouer au théâtre, il donna au renouveau de la scène, vingt ans plus tard, sa première charte. Les deux éditions de Racine et Shakespeare, qui portent le fer au cœur d’un débat encore mal étudié, en ont longtemps maqué la vigueur sous leur lumière éclatante. Cette onzième livraison de L’Année stendhalienne rouvre le dossier et l’enrichit de façon significative. Elle montre entre autres que le combat d’idées et l’échange intellectuel, sous la Restauration, passent par les réseaux de sociabilité qui n’épousent pas exactement les divisions du champ politique et esthétique. On lira aussi avec profit l’article de Liliane Lascoux sur Stendhal et Delacroix.
*Stendhal, Aux âmes sensibles. Lettres choisies (1800-1842), édition de Mariella Di Maio, Gallimard, Folio Classique, 2011, 7,50€.
 Curiosité : ce volume reprend la matière d’un livre paru en 1942 chez Gallimard. Où l’on croit deviner un réflexe commémoratif, le centenaire de la mort de Stendhal tombant en pleine Occupation, le lecteur d’aujourd’hui découvre un tout autre numéro de charme. La lettre pour l’auteur d’Armance offre le meilleur des laboratoires à la cristallisation amoureuse et intellectuelle. Au roman moderne, genre qu’il va fonder avec Balzac et Flaubert, il revient et même incombe le devoir de prolonger un certain art de la conversation, style et polyphonie. Depuis la première édition du livre, notre connaissance de la correspondance de Stendhal s’est singulièrement étendue. Mais Mariella Di Maio, grande dame du beylisme, a bien fait de maintenir en l’état la sélection de 1942 après avoir nettoyé le manuscrit de ses coquilles, au vu des originaux et des nouvelles transcriptions. Un petit bijou, qui ne sera pas perdu pour les Hussards de l’après-guerre.
Curiosité : ce volume reprend la matière d’un livre paru en 1942 chez Gallimard. Où l’on croit deviner un réflexe commémoratif, le centenaire de la mort de Stendhal tombant en pleine Occupation, le lecteur d’aujourd’hui découvre un tout autre numéro de charme. La lettre pour l’auteur d’Armance offre le meilleur des laboratoires à la cristallisation amoureuse et intellectuelle. Au roman moderne, genre qu’il va fonder avec Balzac et Flaubert, il revient et même incombe le devoir de prolonger un certain art de la conversation, style et polyphonie. Depuis la première édition du livre, notre connaissance de la correspondance de Stendhal s’est singulièrement étendue. Mais Mariella Di Maio, grande dame du beylisme, a bien fait de maintenir en l’état la sélection de 1942 après avoir nettoyé le manuscrit de ses coquilles, au vu des originaux et des nouvelles transcriptions. Un petit bijou, qui ne sera pas perdu pour les Hussards de l’après-guerre.
 C’est un bien joli cadeau de Noël que nous font les éditions Claire Paulhan, si actives dans l’exhumation des journaux intimes et des inédits de la mémoire littéraire, à partir desquels petit à petit il devient possible de faire revivre autrement l’activité créatrice des années d’
C’est un bien joli cadeau de Noël que nous font les éditions Claire Paulhan, si actives dans l’exhumation des journaux intimes et des inédits de la mémoire littéraire, à partir desquels petit à petit il devient possible de faire revivre autrement l’activité créatrice des années d’ Préférerait-on qu’il eût réagi favorablement à l’antisémitisme d’État, à l’étoile jaune, aux excès de la discrimination et aux ultras de la collaboration et de l’Europe allemande, Chateaubriant,
Préférerait-on qu’il eût réagi favorablement à l’antisémitisme d’État, à l’étoile jaune, aux excès de la discrimination et aux ultras de la collaboration et de l’Europe allemande, Chateaubriant, 
 Centrée sur le peintre, cette biographie cursive, lucide mais un peu contrainte, nous prive notamment d’un vrai bilan des années américaines. Or elles furent fastes à bien des titres, au-delà de l’esthétique très ouverte, espace et couleur, des deux ballets mentionnés plus haut. Cette double expérience scénique, en un sens, ramenait Chagall au merveilleux de son cher Bakst et lui donnait l’occasion d’en dépasser l’esthétique. Quand la pente dionysiaque s’ouvrait sous ses pieds et ses pinceaux, il ne se faisait jamais prier… Il faut savoir gré, du reste, à Jackie Wullschläger de ne pas sentimentaliser au sujet des amours du peintre, « l’inconsolable » amant de Bella, et des relations qu’il entretint avec les femmes en général. Voilà qui fait du bien et voilà qui éclaire les dérives du prétendu mystique. Les peintres américains, à l’évidence, ne retinrent que le meilleur de l’artiste. Il fut bien un de ceux qui les poussèrent à sortir de leur coquille formaliste autant que Picasso,
Centrée sur le peintre, cette biographie cursive, lucide mais un peu contrainte, nous prive notamment d’un vrai bilan des années américaines. Or elles furent fastes à bien des titres, au-delà de l’esthétique très ouverte, espace et couleur, des deux ballets mentionnés plus haut. Cette double expérience scénique, en un sens, ramenait Chagall au merveilleux de son cher Bakst et lui donnait l’occasion d’en dépasser l’esthétique. Quand la pente dionysiaque s’ouvrait sous ses pieds et ses pinceaux, il ne se faisait jamais prier… Il faut savoir gré, du reste, à Jackie Wullschläger de ne pas sentimentaliser au sujet des amours du peintre, « l’inconsolable » amant de Bella, et des relations qu’il entretint avec les femmes en général. Voilà qui fait du bien et voilà qui éclaire les dérives du prétendu mystique. Les peintres américains, à l’évidence, ne retinrent que le meilleur de l’artiste. Il fut bien un de ceux qui les poussèrent à sortir de leur coquille formaliste autant que Picasso,  De tous les hommes pressés de la Libération, Jean-Paul Sartre ne fut pas le dernier à prendre la parole et à se situer. Il le fit vite, il le fit bien. J’entends par là qu’il refusa de se dérober aux responsabilités que lui assignait son parcours sous l’Occupation, un parcours dont il dira lui-même – si on le lit bien au lieu de l’agonir bêtement – qu’il avait été aussi
De tous les hommes pressés de la Libération, Jean-Paul Sartre ne fut pas le dernier à prendre la parole et à se situer. Il le fit vite, il le fit bien. J’entends par là qu’il refusa de se dérober aux responsabilités que lui assignait son parcours sous l’Occupation, un parcours dont il dira lui-même – si on le lit bien au lieu de l’agonir bêtement – qu’il avait été aussi  Un mois plus tard, « Paris sous l’occupation » parut dans La France libre, mensuel né à Londres dès novembre 1940. Raymond Aron en était à la fois la tête pensante et la cheville ouvrière. De ce texte majeur, qui se rattache à la tradition des Choses vues d’Hugo et des
Un mois plus tard, « Paris sous l’occupation » parut dans La France libre, mensuel né à Londres dès novembre 1940. Raymond Aron en était à la fois la tête pensante et la cheville ouvrière. De ce texte majeur, qui se rattache à la tradition des Choses vues d’Hugo et des  Sartre notait enfin que le « mur », non content de couper le pays en deux, l’avait isolé de l’Angleterre et de l’Amérique. Ce fut une souffrance pour cet amateur de littérature et de cinéma anglo-saxons. Il put s’en gaver à nouveau lors du séjour rappelé plus haut. L’Office américain d’information sur la guerre lui permit ainsi de passer quelques mois entre New York et Los Angeles. Il lui était donné tout loisir d’observer la nation américaine dans ses ultimes efforts de guerre et les premiers moments de la Reconstruction. Sans négliger sa feuille de route, quitte à l’étendre aux sujets qui fâchent comme le « problème noir », Sartre glisse très vite du bilan impersonnel à la collecte d’impressions aussi vivantes que variées. Les bars, la rue, le cinoche, les filles… Il croise en chemin l’amour de Dolorès Vanetti et quelques artistes exilés, qui se préparent à rentrer…
Sartre notait enfin que le « mur », non content de couper le pays en deux, l’avait isolé de l’Angleterre et de l’Amérique. Ce fut une souffrance pour cet amateur de littérature et de cinéma anglo-saxons. Il put s’en gaver à nouveau lors du séjour rappelé plus haut. L’Office américain d’information sur la guerre lui permit ainsi de passer quelques mois entre New York et Los Angeles. Il lui était donné tout loisir d’observer la nation américaine dans ses ultimes efforts de guerre et les premiers moments de la Reconstruction. Sans négliger sa feuille de route, quitte à l’étendre aux sujets qui fâchent comme le « problème noir », Sartre glisse très vite du bilan impersonnel à la collecte d’impressions aussi vivantes que variées. Les bars, la rue, le cinoche, les filles… Il croise en chemin l’amour de Dolorès Vanetti et quelques artistes exilés, qui se préparent à rentrer…  À sa mort, en 1924, il n’était déjà plus que l’homme d’un seul tableau, qui datait des années glorieuses. Jean Geoffroy avait choisi son heure pour exposer Le Jour de visite à l’hôpital, le Salon de 1889 coïncidant avec le centenaire de la grande révolution. Son tableau, qui pinçait la corde sensible avec une retenue dont le peintre n’était pas coutumier, montre un prolétaire endimanché au chevet de son fils dont l’immense lassitude est merveilleusement rendue. Un léger sourire flotte sur ce beau visage fiévreux aux yeux clos. La pâleur de l’enfant, d’abord inquiétante, s’accorde en fait à la blancheur dominante, heureuse, du tableau. C’est qu’il s’agit de montrer avec éclat combien la santé et l’hygiène publiques sont désormais une des priorités de la République radicale. Paul Mantz, vieux romantique converti au réalisme et ancien directeur des Beaux-Arts (1881-1882), pouvait y aller d’un commentaire très favorable : « Il y a du sentiment dans cette peinture, mais une sorte de sentiment silencieux et sans gestes. Le tableau est très moderne, et c’est un des meilleurs que M. Geoffroy nous ait encore montrés. » Mantz ne se trompait pas puisque Vuillard et
À sa mort, en 1924, il n’était déjà plus que l’homme d’un seul tableau, qui datait des années glorieuses. Jean Geoffroy avait choisi son heure pour exposer Le Jour de visite à l’hôpital, le Salon de 1889 coïncidant avec le centenaire de la grande révolution. Son tableau, qui pinçait la corde sensible avec une retenue dont le peintre n’était pas coutumier, montre un prolétaire endimanché au chevet de son fils dont l’immense lassitude est merveilleusement rendue. Un léger sourire flotte sur ce beau visage fiévreux aux yeux clos. La pâleur de l’enfant, d’abord inquiétante, s’accorde en fait à la blancheur dominante, heureuse, du tableau. C’est qu’il s’agit de montrer avec éclat combien la santé et l’hygiène publiques sont désormais une des priorités de la République radicale. Paul Mantz, vieux romantique converti au réalisme et ancien directeur des Beaux-Arts (1881-1882), pouvait y aller d’un commentaire très favorable : « Il y a du sentiment dans cette peinture, mais une sorte de sentiment silencieux et sans gestes. Le tableau est très moderne, et c’est un des meilleurs que M. Geoffroy nous ait encore montrés. » Mantz ne se trompait pas puisque Vuillard et  On savait que le courant était très bien passé entre Ezra Pound et
On savait que le courant était très bien passé entre Ezra Pound et  L’Italie, Venise notamment, devait s’offrir bientôt comme l’autre trait d’union qui mène de Gautier à Pound ? C’est à Rapallo que l’Américain devait rédiger son précis ironique de littérature, How to read, en 1927-1928. Les éditions
L’Italie, Venise notamment, devait s’offrir bientôt comme l’autre trait d’union qui mène de Gautier à Pound ? C’est à Rapallo que l’Américain devait rédiger son précis ironique de littérature, How to read, en 1927-1928. Les éditions 
 Ils n’en ont pas parlé, ou si peu… Ils ? La presse française, pardi ! Et pourtant la rétrospective Guardi du musée Correr valait mieux que les récentes expositions « parisiennes » sur la peinture « vénitienne ». Le New York Times ne s’y est pas trompé, qui lui a donné une pleine page. Roderick Conway Morris, le 6 novembre dernier, titrait
Ils n’en ont pas parlé, ou si peu… Ils ? La presse française, pardi ! Et pourtant la rétrospective Guardi du musée Correr valait mieux que les récentes expositions « parisiennes » sur la peinture « vénitienne ». Le New York Times ne s’y est pas trompé, qui lui a donné une pleine page. Roderick Conway Morris, le 6 novembre dernier, titrait  S’il ne se dressait pas derrière la sagesse de l’humaniste, aux prises avec le show business dominant les espaces traditionnels du savoir sur les images, on lui appliquerait le mot de
S’il ne se dressait pas derrière la sagesse de l’humaniste, aux prises avec le show business dominant les espaces traditionnels du savoir sur les images, on lui appliquerait le mot de  *Alessandra Boccato, Églises de Venise, traduit de l’italien par Yseult Pelloso, Imprimerie nationale, 98€. Le livre n’est pas très beau, vues extérieures sur fond bleu carte postale, maquette banale, typographie vieillottes, etc. Sa lecture n’en est pas moins indispensable à ceux qui croient connaître le sujet pour être entré aux Frari, à San Marco et San Rocco. Alors que l’Accademia peine lamentablement à sortir de sa gangue de vétusté, indigne de ses collections de peintures, les églises de Venise font leur toilette l’une après l’autre. Des circuits sont proposés aux visiteurs intelligents, rare fraction de la transhumance touristique, auxquels ce livre sera particulièrement précieux. Son auteur étant une spécialiste de l’architecture, elle n’oublie pas de nous faire lever le nez des seuls tableaux. On découvre notamment sous sa conduite les églises qui ont échappé aux « reconstructions » de l’âge baroque ou rocaille. À l’opposé de San Moisè, qui fascina Gautier et abrita ses amours, un certain nombre d’entre elles ont donc « résisté ». Elles se cachent à la jonction des quartiers de San Polo et de Santa Croce. Plus proche de San Marco, San Stefano charme les lecteurs de Ruskin par son gothique fleuri, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les amateurs de viande plus saignante, les fous du Tintoret et du dernier Titien ne seront pas déçus non plus. Quant aux plus raffinés, ceux pour qui le premier XVIIIe vénitien tient lieu d’ultime bréviaire, les bonnes adresses sont là, qui n’attendent qu’à être testées. L’âge de Tiepolo, loin de se retrancher aux Gesuati, est partout à Venise, ou presque, quand on sait s’y promener. Poussez la porte de San Stae ou celle de Sant’Alvise, le Paradis de la peinture s’y est installé. Sebastiano Ricci, Piazzetta, Pellegrini… Un livre, on vous le disait, utile et même dédié aux « pèlerins passionnés » dont Morand parlait en connaissance de cause. Celle de la beauté pure.
*Alessandra Boccato, Églises de Venise, traduit de l’italien par Yseult Pelloso, Imprimerie nationale, 98€. Le livre n’est pas très beau, vues extérieures sur fond bleu carte postale, maquette banale, typographie vieillottes, etc. Sa lecture n’en est pas moins indispensable à ceux qui croient connaître le sujet pour être entré aux Frari, à San Marco et San Rocco. Alors que l’Accademia peine lamentablement à sortir de sa gangue de vétusté, indigne de ses collections de peintures, les églises de Venise font leur toilette l’une après l’autre. Des circuits sont proposés aux visiteurs intelligents, rare fraction de la transhumance touristique, auxquels ce livre sera particulièrement précieux. Son auteur étant une spécialiste de l’architecture, elle n’oublie pas de nous faire lever le nez des seuls tableaux. On découvre notamment sous sa conduite les églises qui ont échappé aux « reconstructions » de l’âge baroque ou rocaille. À l’opposé de San Moisè, qui fascina Gautier et abrita ses amours, un certain nombre d’entre elles ont donc « résisté ». Elles se cachent à la jonction des quartiers de San Polo et de Santa Croce. Plus proche de San Marco, San Stefano charme les lecteurs de Ruskin par son gothique fleuri, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les amateurs de viande plus saignante, les fous du Tintoret et du dernier Titien ne seront pas déçus non plus. Quant aux plus raffinés, ceux pour qui le premier XVIIIe vénitien tient lieu d’ultime bréviaire, les bonnes adresses sont là, qui n’attendent qu’à être testées. L’âge de Tiepolo, loin de se retrancher aux Gesuati, est partout à Venise, ou presque, quand on sait s’y promener. Poussez la porte de San Stae ou celle de Sant’Alvise, le Paradis de la peinture s’y est installé. Sebastiano Ricci, Piazzetta, Pellegrini… Un livre, on vous le disait, utile et même dédié aux « pèlerins passionnés » dont Morand parlait en connaissance de cause. Celle de la beauté pure. La passion qu’il vouait au peintre interlope
La passion qu’il vouait au peintre interlope  De nouveaux combats s’y substitueront, arracher
De nouveaux combats s’y substitueront, arracher – Maria Van Rysselberghe, Le Cahier III bis de la Petite Dame, édition présentée et annotée par
– Maria Van Rysselberghe, Le Cahier III bis de la Petite Dame, édition présentée et annotée par  La presse communiste, à l’automne de 1944, désavoua ce gros livre sans héros positifs ni schématisation radieuse du réel. Trop noir, trop décousu, trop dégagé, d’une certaine manière. Et pourtant… Comme
La presse communiste, à l’automne de 1944, désavoua ce gros livre sans héros positifs ni schématisation radieuse du réel. Trop noir, trop décousu, trop dégagé, d’une certaine manière. Et pourtant… Comme  Pour ne prendre qu’un dernier exemple, qui confirme le patriotisme inentamé des Français, la pratique du double langage n’est pas rare dans les films après 1941, malgré les contrôles officiels. Je me faisais cette réflexion en revoyant le sublime Lumière d’été de Grémillon, en ouverture du festival Prévert de la Cinémathèque. Tourné dans le Sud de la France, alors qu’il vit ses derniers mois de liberté surveillée, le film bute en mai 1943 sur le non têtu de Paul Morand, qui préside alors la censure cinématographique de Vichy. Preuve que Grémillon et Prévert, derrière leur carré d’amoureux et l’opposition de classes qu’ils incarnent, dégagent une vérité humaine, un rien scabreuse et désespérée, peu conforme aux attentes du régime, sans parler de l’appel à la résistance (Les Visiteurs du soir ne sont pas loin). Mais Vichy ne suivra pas l’avis de Morand, preuve d’une tolérance qu’il convient aussi de noter… Sur le tournage, à Nice, le destin d’un autre grand film s’était scellé. Prévert y croise Marcel Carné et Jean-Louis Barrault. Les Enfants du Paradis, dont le scénario original sort enfin, sont nés ! Jusqu’à l’onirisme et aux références shakespeariennes, ce film légendaire doit plus à Lumière d’été qu’on ne le dit. Dès le premier jet, les dialogues de Prévert pétillent, éblouissent, fusent et fusillent. Viendra ensuite le moment du lissage, voire des changements narratifs. Mais Garance y restera la femme de toutes les libertés. Stéphane Guégan
Pour ne prendre qu’un dernier exemple, qui confirme le patriotisme inentamé des Français, la pratique du double langage n’est pas rare dans les films après 1941, malgré les contrôles officiels. Je me faisais cette réflexion en revoyant le sublime Lumière d’été de Grémillon, en ouverture du festival Prévert de la Cinémathèque. Tourné dans le Sud de la France, alors qu’il vit ses derniers mois de liberté surveillée, le film bute en mai 1943 sur le non têtu de Paul Morand, qui préside alors la censure cinématographique de Vichy. Preuve que Grémillon et Prévert, derrière leur carré d’amoureux et l’opposition de classes qu’ils incarnent, dégagent une vérité humaine, un rien scabreuse et désespérée, peu conforme aux attentes du régime, sans parler de l’appel à la résistance (Les Visiteurs du soir ne sont pas loin). Mais Vichy ne suivra pas l’avis de Morand, preuve d’une tolérance qu’il convient aussi de noter… Sur le tournage, à Nice, le destin d’un autre grand film s’était scellé. Prévert y croise Marcel Carné et Jean-Louis Barrault. Les Enfants du Paradis, dont le scénario original sort enfin, sont nés ! Jusqu’à l’onirisme et aux références shakespeariennes, ce film légendaire doit plus à Lumière d’été qu’on ne le dit. Dès le premier jet, les dialogues de Prévert pétillent, éblouissent, fusent et fusillent. Viendra ensuite le moment du lissage, voire des changements narratifs. Mais Garance y restera la femme de toutes les libertés. Stéphane Guégan
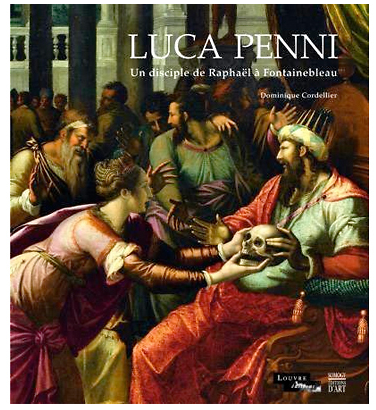

 S’en dégage un parfum de libertinage direct qui le rapproche de Vostell. Rapprochement que Lebel ne récuse pas. Ce serait récuser une part de lui qui déborde son destin individuel, si l’on suit le dernier essai de Philippe Dagen, L’Art dans le monde de 1960 à nos jours. En amont et en aval du demi-siècle qu’il passe au crible, depuis ses frontières élargies, il y aurait un moment duchampien. Les dates lui donnent raison : 1959 voit paraître le livre de Robert Lebel, le père de Jean-Jacques, sur l’insaisissable Marcel, modèle des agitateurs. Du Pop aux Nouveaux réalistes, de Fluxus aux performances les plus déchirées, Duchamp semble la seule boussole d’une communauté artistique en prise sur une époque qui bouge vite dans ses lignes géographiques, économiques, sociales et mentales. De ce bouillon de culture, chauffé à blanc par la fin annoncée des idéologies de l’avant-guerre, ne pouvait naître qu’un art hybride, matériaux, stratégies, et finalités. Qu’ils adoptent ou contestent le nouvel hédonisme issu de la tyrannie de l’éphémère, les créateurs du moment travaillent à partir du réel lui-même, devenu composante de sa représentation ironique. En cela, malgré la fin des démarches collectives, Dagen ne perçoit aucune rupture majeure dans la situation actuelle, bien qu’il épingle un certain brouillage, dernière ruse du marché de l’art, qui fait du moderne pasteurisé et du provocateur officiel de purs produits financiers. Stéphane Guégan
S’en dégage un parfum de libertinage direct qui le rapproche de Vostell. Rapprochement que Lebel ne récuse pas. Ce serait récuser une part de lui qui déborde son destin individuel, si l’on suit le dernier essai de Philippe Dagen, L’Art dans le monde de 1960 à nos jours. En amont et en aval du demi-siècle qu’il passe au crible, depuis ses frontières élargies, il y aurait un moment duchampien. Les dates lui donnent raison : 1959 voit paraître le livre de Robert Lebel, le père de Jean-Jacques, sur l’insaisissable Marcel, modèle des agitateurs. Du Pop aux Nouveaux réalistes, de Fluxus aux performances les plus déchirées, Duchamp semble la seule boussole d’une communauté artistique en prise sur une époque qui bouge vite dans ses lignes géographiques, économiques, sociales et mentales. De ce bouillon de culture, chauffé à blanc par la fin annoncée des idéologies de l’avant-guerre, ne pouvait naître qu’un art hybride, matériaux, stratégies, et finalités. Qu’ils adoptent ou contestent le nouvel hédonisme issu de la tyrannie de l’éphémère, les créateurs du moment travaillent à partir du réel lui-même, devenu composante de sa représentation ironique. En cela, malgré la fin des démarches collectives, Dagen ne perçoit aucune rupture majeure dans la situation actuelle, bien qu’il épingle un certain brouillage, dernière ruse du marché de l’art, qui fait du moderne pasteurisé et du provocateur officiel de purs produits financiers. Stéphane Guégan – Stéphanie Lemoine, L’Art urbain. Du graffiti au street art, Découvertes Gallimard, 13,60 €. Que le Street art ait pignon sur rue désormais, nul n’en doute plus après les expositions du MoCA de Los Angeles, de la Tate Modern et du Grand Palais, sans parler du marché de l’art, lié directement parfois à ces initiatives. Reconnaissance pour les uns, trahison pour les autres, l’engouement actuel fait donc réfléchir les thuriféraires du genre. Mais on ne voit pas pourquoi il émeut plus les belles âmes que la commercialisation et l’institutionnalisation d’autres secteurs de l’art contemporain. Parce qu’il viendrait de la rue et de la misère sociale (mais Basquiat et ses émules n’en viennent pas tous), le graffiti aurait vocation à rester pur. Ceux qui prônent le « splendide isolement » cèdent à une illusion bien connue, assez risible ici. N’est-il pas contradictoire d’exalter l’énergie primitive de la rue et de vouloir la juguler ? Faut-il pratiquer l’enthousiasme œcuménique devant tout ce que les médias rangent sous l’étiquette de l’art urbain, du tag débile, purement masturbatoire, à la fresque géniale, dont les villes célibataires ont parfois bien besoin pour retrouver le sourire. Pas plus que la bombe aérosol n’est garante de talent, la vogue du Street art n’est synonyme de récupération systématique. Il fallait donc poser le problème autrement. C’est ce qu’a fait Stéphanie Lemoine avec l’urgence de son sujet. Et si sa lecture ne vous guérit pas du scepticisme que vous inspirent les peintres de la rue, rien de tel que le Journal de
– Stéphanie Lemoine, L’Art urbain. Du graffiti au street art, Découvertes Gallimard, 13,60 €. Que le Street art ait pignon sur rue désormais, nul n’en doute plus après les expositions du MoCA de Los Angeles, de la Tate Modern et du Grand Palais, sans parler du marché de l’art, lié directement parfois à ces initiatives. Reconnaissance pour les uns, trahison pour les autres, l’engouement actuel fait donc réfléchir les thuriféraires du genre. Mais on ne voit pas pourquoi il émeut plus les belles âmes que la commercialisation et l’institutionnalisation d’autres secteurs de l’art contemporain. Parce qu’il viendrait de la rue et de la misère sociale (mais Basquiat et ses émules n’en viennent pas tous), le graffiti aurait vocation à rester pur. Ceux qui prônent le « splendide isolement » cèdent à une illusion bien connue, assez risible ici. N’est-il pas contradictoire d’exalter l’énergie primitive de la rue et de vouloir la juguler ? Faut-il pratiquer l’enthousiasme œcuménique devant tout ce que les médias rangent sous l’étiquette de l’art urbain, du tag débile, purement masturbatoire, à la fresque géniale, dont les villes célibataires ont parfois bien besoin pour retrouver le sourire. Pas plus que la bombe aérosol n’est garante de talent, la vogue du Street art n’est synonyme de récupération systématique. Il fallait donc poser le problème autrement. C’est ce qu’a fait Stéphanie Lemoine avec l’urgence de son sujet. Et si sa lecture ne vous guérit pas du scepticisme que vous inspirent les peintres de la rue, rien de tel que le Journal de Avec Aragon, c’est tout le contraire, langue et visée, comme nous le rappelle Daniel Bougnoux dans un essai peu bégueule, dont la rumeur parisienne nous dit qu’il aurait été châtré d’un chapitre trop chaud sur les aimables turpitudes de son héros. J’emploie le mot à dessein. S’il fallait le justifier, on aurait l’embarras du choix. Bougnoux, qui va sur ses soixante-dix ans, a analysé et édité le corpus romanesque d’Aragon comme nul autre. Du bénédictin, il a la passion scripturale, non la dévotion asséchante. Son essai « censuré » s’ouvre sur une confession qui rend à l’amour du texte sa juste place, et reconnaît au lecteur sa liberté, en plus du choix de son addiction : « J’aurai passé une bonne part de ma vie plongé dans votre œuvre avec une opiniâtreté dont mes amis s’étonnent, n’aurais-je pu avec le temps changer de sujet ou d’auteur, mon cher Louis ? » Bougnoux s’est entêté à aime ce surréaliste aux yeux ouverts, si dessillés qu’il rompit intellectuellement avec Breton avant de s’éloigner politiquement. La rupture de 1932 est un de ces mythes qui brouillent une opposition plus fondamentale entre les deux hommes. Un conflit précoce, compliqué de désirs inassouvis, comme avec Drieu.
Avec Aragon, c’est tout le contraire, langue et visée, comme nous le rappelle Daniel Bougnoux dans un essai peu bégueule, dont la rumeur parisienne nous dit qu’il aurait été châtré d’un chapitre trop chaud sur les aimables turpitudes de son héros. J’emploie le mot à dessein. S’il fallait le justifier, on aurait l’embarras du choix. Bougnoux, qui va sur ses soixante-dix ans, a analysé et édité le corpus romanesque d’Aragon comme nul autre. Du bénédictin, il a la passion scripturale, non la dévotion asséchante. Son essai « censuré » s’ouvre sur une confession qui rend à l’amour du texte sa juste place, et reconnaît au lecteur sa liberté, en plus du choix de son addiction : « J’aurai passé une bonne part de ma vie plongé dans votre œuvre avec une opiniâtreté dont mes amis s’étonnent, n’aurais-je pu avec le temps changer de sujet ou d’auteur, mon cher Louis ? » Bougnoux s’est entêté à aime ce surréaliste aux yeux ouverts, si dessillés qu’il rompit intellectuellement avec Breton avant de s’éloigner politiquement. La rupture de 1932 est un de ces mythes qui brouillent une opposition plus fondamentale entre les deux hommes. Un conflit précoce, compliqué de désirs inassouvis, comme avec Drieu. On prend soudainement conscience de notre erreur à ne pas avoir lu plu tôt La Mise à mort et Blanche ou l’oubli, deux livres d’un rare baroquisme, fêtés comme tels par le meilleur de la presse littéraire du temps, Jean-Louis Bory en tête. Bon signe, Nadeau faisait grise mine devant cette langue torrentielle, qui pratiquait le métalangage par goût et bravade du haut d’une culture que ne possédaient pas les détracteurs d’Aragon. Il en remontrait à la « linguisterie » (Lacan) du temps, aux fanatiques de l’écriture blanche, aux flaubertiens obtus, aux amants transis du neutre et de la mort du récit, exaspérait enfin les structuralistes oublieux que le romantisme et le surréalisme avaient voyagé avant eux dans le plus beau français qui soit… Pour s’être frotté aux femmes et aux hommes plus que d’autres, délices et calices, Aragon pouvait alors publier des romans d’amours plus cruels que sa poésie tardive,
On prend soudainement conscience de notre erreur à ne pas avoir lu plu tôt La Mise à mort et Blanche ou l’oubli, deux livres d’un rare baroquisme, fêtés comme tels par le meilleur de la presse littéraire du temps, Jean-Louis Bory en tête. Bon signe, Nadeau faisait grise mine devant cette langue torrentielle, qui pratiquait le métalangage par goût et bravade du haut d’une culture que ne possédaient pas les détracteurs d’Aragon. Il en remontrait à la « linguisterie » (Lacan) du temps, aux fanatiques de l’écriture blanche, aux flaubertiens obtus, aux amants transis du neutre et de la mort du récit, exaspérait enfin les structuralistes oublieux que le romantisme et le surréalisme avaient voyagé avant eux dans le plus beau français qui soit… Pour s’être frotté aux femmes et aux hommes plus que d’autres, délices et calices, Aragon pouvait alors publier des romans d’amours plus cruels que sa poésie tardive,