
Jacques-Émile Blanche eut tous les malheurs. Fils d’un riche aliéniste qui avait soigné Nerval et d’autres romantiques au cerveau à éclipses, il avait touché ses premiers pinceaux sous la conduite de Manet et de Gervex, bonnes fées, au début des années 1880. Longtemps tenté par l’écriture, il apprit vite et se décida aussi vite pour la peinture, qui méritait mieux que d’être le passe-temps d’un rentier précoce. Dans le monde qui fut le sien, le meilleur donc, on croisait aussi bien Barrès que Proust, des nationalistes que des républicains, des Juifs que des antisémites, l’aristocratie de souche que la gentry d’argent, des Français de race que les sujets de la reine Victoria, des femmes à tempérament que des jeunes filles à marier, des invertis discrets que des extravertis moins discrets, du genre de Wilde ou de Montesquiou. Un peu avant la guerre de 1914, sur laquelle Blanche a laissé des mémoires qu’il conviendrait de rééditer, surgirent d’autres candidats à la postérité, et non des moindres, Cocteau, Morand, Mauriac. Les meilleurs écrivains reconnurent en lui un frère d’armes, sinon leur égal.
Notre dilettante, l’un des plus heureux portraitistes de société d’une époque qui compta aussi bien Sargent, Whistler que Boldini et La Gandara, avait la plume acérée et le verbe brillant. Tous ses livres, trop ignorés aujourd’hui, démontrent qu’il savait sentir aussi bien que décrire. Comme un Saint-Simon d’avant la Pléiade, Blanche a humblement, mais vivement, fait son travail de chroniqueur, de mémorialiste et presque d’historiographe royal. Sa cour à lui, c’était Paris, Londres, un peu l’Italie, géographie suffisante à son bonheur. Mais fut-il heureux cet homme qui portraitura les heureux de la terre ? Sa correspondance avec Gide ou Mauriac, deux de ses plus proches confidents, ne respire pas toujours l’allégresse. Et pourtant il sut saisir l’éclat des belles heures de la vie sur le visage de ses modèles. Derrière le masque de Proust ou de Barrès, la bonhomie plus souriante de Pierre Louÿs ou de Marguerite de Saint-Marceaux, les yeux déjà un peu éteints de Degas ou les postures équivoques de Désirée Manfred, le regard perçant de Gide ou les hanches féminines de Cocteau, la bouche lippue de Stravinski ou les chinoiseries à ressort de Nijinski, c’est la même ardeur qui pétille, et même brûle au contact de la jeunesse ou du génie. « On se rend compte que ce peintre que l’on disait mondain sait mieux qu’un autre atteindre la seule cible qui compte : celle de la vérité », écrit Pierre Bergé en préface au catalogue de l’exposition qu’accueille sa fondation jusqu’en janvier 2013.
Exposition ou madeleine proustienne ? À chacun d’en décider. Car il n’y manque rien pour favoriser les anamnèses de toute nature. Et la scénographie de Nathalie Crinière regarde du côté de chez Swann… L’artiste, quand il est à son meilleur, s’en tire très bien. Si les tableaux nous rappellent que Blanche posait les pieds de part et d’autre de la Manche, les dessins disent le tropisme fin-de-siècle pour Watteau et le premier rococo. Comme Ingres et Manet, dont il a si bien parlé, il ne détestait pas que la ligne filât droit, quitte à s’attarder sur la nuque ou les épaules des femmes d’avant Coco Chanel. L’exposition de Jérôme Neutres, son commissaire, traverse la Belle Epoque et se referme avec le portrait de Foch qu’on croirait sorti des planches de L’Illustration. Pour ceux qui voudraient poursuivre le voyage jusqu’en 1942, on ne saurait trop recommander la lecture du beau livre de Georges-Paul Collet, qui connaît Blanche et ses amitiés littéraires mieux que personne. Son héros conserva après guerre le don d’attirer à lui la fine fleur des arts. Ce privilège lui permet de ne pas s’en laisser compter. Dada, les surréalistes, Jacques Rigaut, rien ni personne ne l’effarouche. Le Feu follet de Drieu l’affole un peu, mais il se remet vite. Il viendra même au cubisme et à la musique de Milhaud.
Autre publication indispensable aux amoureux de Blanche, la monographie de Jane Roberts, à qui sa connaissance et sa pratique du marché de l’art ont ouvert nombre de portes utiles. Le musée de Rouen et le musée d’Orsay sont loin en effet d’abriter l’œuvre entier d’un artiste qui douta de lui jusqu’à sa mort et dont le corpus reste en grande partie à découvrir. Sans prétendre à l’exhaustivité du catalogue raisonné, le livre de Jane Roberts offre donc un éventail d’images et d’aperçus plus large que la rétrospective rouennaise de 1997. Blanche est mort sans voir paraître sur ses tableaux la monographie qu’ils justifiaient. Lorsqu’il fallut prononcer quelques mots sur le défunt, le 14 novembre 1942, dans les murs surveillés de l’Institut, Maurice Denis parla de sa plume alerte et de son pinceau vigoureux de « peintre de la réalité ». Le livre de Jane Roberts élargit cette définition plus polémique, à sa date, que suffisante. L’auteur rappelle aussi que l’exposition posthume, visible à l’Orangerie au printemps 1943, écarta le portrait du Groupe des Six. Il eût été malséant de montrer le visage du Juif Milhaud dans les espaces qui avaient accueilli les marbres drolatiques de Breker. Mais c’est tout de même Daniel Halévy, grand ami de Blanche, qui signa l’introduction du catalogue. Comme si l’époque ne pouvait plus rien contre la sympathie qu’inspirait toujours un peintre qui n’avait pas été dreyfusard. Stéphane Guégan
– Du côté de chez Jacques-Émile Blanche, Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, jusqu’au 27 janvier 2013. Catalogue, Skira-Flammarion, 30 €.
*Georges-Paul Collet, Jacques-Emile Blanche. Le peintre-écrivain, Bartillat, 28 €.
*Jane Roberts, Jacques-Émile Blanche, Editions Gourcuff-Gradenigo, 39 €.
*François Broche, Vie de Maurice Barrès, Bartillat, 2012, 23 €.
De Maurice Barrès, le dandy, l’anarchiste en escarpins passé au nationalisme effusif, son ami Blanche a laissé deux portraits indépassés, ils se répondent sur les murs de la présente exposition, entre la première et la dernière salle. Une douzaine d’années se sont écoulées de l’un à l’autre, douze ans qui ont fait basculer l’écrivain du « culte du moi » au « culte de l’énergie nationale », comme l’explique François Broche, en empruntant à son modèle les nerfs et la netteté qui font d’une biographie un livre vivant, actuel, dégagé des poncifs qui s’attachent au nouvel enchanteur. On ne peut se contenter d’enfiler les lieux communs dès qu’on affronte la littérature des années 1890-1900, oscillant entre décadentisme et naturalisme, ou le débat intellectuel, et même la grande question de l’antisémitisme, plus virulent à gauche qu’à droite, en raison de son arrière-plan social, voire socialiste. Les lecteurs de Toussenel comprendront ! Broche, comme Blanche, nous peint un Barrès en nuances, lecteur de Gautier et Baudelaire comme de Michelet et Zola. D’emblée, il fut l’homme des formules fracassantes, héritage du journalisme musclé de la IIIe République et des secousses boulangistes. Chacun sa bombe. Mort en 1885 de l’auteur de L’Année terrible : « Hugo gît désormais sue l’Ararat du classicisme national. » La dernière campagne présidentielle a prouvé que Barrès ne se trompait pas. Ce qu’on préfère oublier aujourd’hui, c’est l’impact de son style, qui relie Proust et Blum au jeune Aragon, un peu honteux d’avouer au grand-prêtre Breton sa dilection pour le premier Barrès. Broche a raison, il fut un maître à penser et un maître à sentir.
 Longtemps les modernistes lui reprochèrent d’être l’indésirable grain de sable de leur vision canonique du XXe siècle. En 1933, lors de la première rétrospective du MoMA, Hopper embarrasse, à l’évidence, Alfred Barr. Malgré son dépouillement formel et sa réserve narrative, cette peinture n’était-elle pas trop littéraire, voire littérale, pour accéder au temple des avant-gardes européennes ? Mais Barr, fouetté par la crise de 29, défendait encore l’art américain quel qu’en fût le tonneau. Les clivages se durciraient plus tard… Dès 1930, le jeune MoMa s’était ouvert à la jeune peinture tous azimuts. Le très picassien Gorky y expose pour la première fois de façon notable… Or la peinture d’Hopper se laissait moins facilement enrôler sous la bannière du formalisme, voire de l’abstraction. La voie royale, selon Barr, débutait avec
Longtemps les modernistes lui reprochèrent d’être l’indésirable grain de sable de leur vision canonique du XXe siècle. En 1933, lors de la première rétrospective du MoMA, Hopper embarrasse, à l’évidence, Alfred Barr. Malgré son dépouillement formel et sa réserve narrative, cette peinture n’était-elle pas trop littéraire, voire littérale, pour accéder au temple des avant-gardes européennes ? Mais Barr, fouetté par la crise de 29, défendait encore l’art américain quel qu’en fût le tonneau. Les clivages se durciraient plus tard… Dès 1930, le jeune MoMa s’était ouvert à la jeune peinture tous azimuts. Le très picassien Gorky y expose pour la première fois de façon notable… Or la peinture d’Hopper se laissait moins facilement enrôler sous la bannière du formalisme, voire de l’abstraction. La voie royale, selon Barr, débutait avec  Stupéfiante de beauté et de rigueur intellectuelle, l’actuelle exposition du Grand Palais liquide la stérilité de ces anciennes oppositions sans chausser les gros sabots de la lecture socio-thématique. Peut-on encore réduire le peintre à l’incurable mélancolie qui l’affligerait, lire la suspension, le silence et le vide humain de ses compositions comme autant de symptômes d’une impossibilité à jouir de la vie ? Si le réalisme en son acception banale ne saurait définir l’art d’Hopper, le renoncement est loin d’en constituer la clef psychologique et la morale définitive. Au gré du parcours implacable de la rétrospective et des textes qu’il signe à cette occasion,
Stupéfiante de beauté et de rigueur intellectuelle, l’actuelle exposition du Grand Palais liquide la stérilité de ces anciennes oppositions sans chausser les gros sabots de la lecture socio-thématique. Peut-on encore réduire le peintre à l’incurable mélancolie qui l’affligerait, lire la suspension, le silence et le vide humain de ses compositions comme autant de symptômes d’une impossibilité à jouir de la vie ? Si le réalisme en son acception banale ne saurait définir l’art d’Hopper, le renoncement est loin d’en constituer la clef psychologique et la morale définitive. Au gré du parcours implacable de la rétrospective et des textes qu’il signe à cette occasion,  Tous ces appels de l’esprit et de la chair, Emmanuel Pernoud les résume d’un mot, l’attente. Son livre en décline les modulations de sens et de forme à travers douze chapitres chrono-thématiques abondamment illustrés. L’essentiel de l’œuvre peint, moins de 200 toiles, s’y trouve concentré. Mais Pernoud n’oublie pas l’illustrateur et le graveur que fut aussi Hopper, adaptant à chaque registre de l’image son mépris de l’anecdotique et du sentimental. Sans opposer de façon absolue ses travaux alimentaires et sa peinture, jalousement arrachée aux prescriptions des magazines glamour, son livre en souligne les différences fondamentales, que le contexte n’explique qu’en partie. Les travaux d’illustrations auxquels Hopper se soumet datent pour l’essentiel des années 1910 et fixent l’idéal d’une Amérique à qui tout sourit, même la victoire de son armée en Europe. Travail tendu et consommation heureuse sont les leviers d’une réussite illusoire que l’artiste traduit en lignes tranchantes. Les gravures, entre 1915 et 1923, répondent à cette rhétorique conquérante par leurs situations plus énigmatiques et un encrage musclé. La peinture devait préférer aussi le trouble, l’entre-deux et le temps étiré. Attendre, rappelle Pernoud, c’est tendre vers. Et c’est parfois atteindre.
Tous ces appels de l’esprit et de la chair, Emmanuel Pernoud les résume d’un mot, l’attente. Son livre en décline les modulations de sens et de forme à travers douze chapitres chrono-thématiques abondamment illustrés. L’essentiel de l’œuvre peint, moins de 200 toiles, s’y trouve concentré. Mais Pernoud n’oublie pas l’illustrateur et le graveur que fut aussi Hopper, adaptant à chaque registre de l’image son mépris de l’anecdotique et du sentimental. Sans opposer de façon absolue ses travaux alimentaires et sa peinture, jalousement arrachée aux prescriptions des magazines glamour, son livre en souligne les différences fondamentales, que le contexte n’explique qu’en partie. Les travaux d’illustrations auxquels Hopper se soumet datent pour l’essentiel des années 1910 et fixent l’idéal d’une Amérique à qui tout sourit, même la victoire de son armée en Europe. Travail tendu et consommation heureuse sont les leviers d’une réussite illusoire que l’artiste traduit en lignes tranchantes. Les gravures, entre 1915 et 1923, répondent à cette rhétorique conquérante par leurs situations plus énigmatiques et un encrage musclé. La peinture devait préférer aussi le trouble, l’entre-deux et le temps étiré. Attendre, rappelle Pernoud, c’est tendre vers. Et c’est parfois atteindre. Couples silencieux, figures isolées, lieux indéterminés, intérieurs saisis à la dérobée, personnages rongés par l’incertitude ou la frustration, la liste des thèmes chers à Hopper est bien connue. Si Pernoud les examine à la lumière des sources picturales du peintre et des contemporains plus bavards, le bel essai d’Alain Cueff privilégie la culture philosophique et religieuse d’un artiste plutôt introverti sur lequel ont pesé une sexualité contrainte et une existence conjugale à peine plus épanouie. Il n’était donc pas inutile de se demander pourquoi Hopper a multiplié les nus scabreux et les femmes pulpeuses, jusqu’à incommoder son épouse et le faire suspecter de sexisme ou de misogynie, comme Degas et Forain avant lui. Leur héritier direct a connu son baptême du feu dans le Paris de la Belle-Époque, éminemment décadente aux yeux d’un yankee élevé dans l’horreur du sexe tarifé et des étreintes pré-maritales. Ses figures de prostituées aux corps pleins sont toutefois superbes d’arrogance baudelairienne. La France restera le pays des éternels « what if »… Sa biographie, par la suite, ne laisse guère suspecter de frasques, à peine une liaison ou deux avant que Josephine lui mette le grappin dessus. Mais la peinture prend très tôt sa revanche sur la vie et nous bombarde de créatures ou lolitas en panne d’intrigues. Entre amour du possible et amorces de récits, cette peinture aura toujours usé de l’ambivalence contre la résignation.
Couples silencieux, figures isolées, lieux indéterminés, intérieurs saisis à la dérobée, personnages rongés par l’incertitude ou la frustration, la liste des thèmes chers à Hopper est bien connue. Si Pernoud les examine à la lumière des sources picturales du peintre et des contemporains plus bavards, le bel essai d’Alain Cueff privilégie la culture philosophique et religieuse d’un artiste plutôt introverti sur lequel ont pesé une sexualité contrainte et une existence conjugale à peine plus épanouie. Il n’était donc pas inutile de se demander pourquoi Hopper a multiplié les nus scabreux et les femmes pulpeuses, jusqu’à incommoder son épouse et le faire suspecter de sexisme ou de misogynie, comme Degas et Forain avant lui. Leur héritier direct a connu son baptême du feu dans le Paris de la Belle-Époque, éminemment décadente aux yeux d’un yankee élevé dans l’horreur du sexe tarifé et des étreintes pré-maritales. Ses figures de prostituées aux corps pleins sont toutefois superbes d’arrogance baudelairienne. La France restera le pays des éternels « what if »… Sa biographie, par la suite, ne laisse guère suspecter de frasques, à peine une liaison ou deux avant que Josephine lui mette le grappin dessus. Mais la peinture prend très tôt sa revanche sur la vie et nous bombarde de créatures ou lolitas en panne d’intrigues. Entre amour du possible et amorces de récits, cette peinture aura toujours usé de l’ambivalence contre la résignation.

 Le 20 février 1850, l’architecte Duban, en charge des travaux du Louvre, informait Delacroix d’une commande prestigieuse : peindre le compartiment central de la galerie d’Apollon qu’on restaurait alors au nom de la République. Cet espace était pourtant très marqué par le passé royal du palais. Sous Louis XIV, Charles Le Brun devait y représenter le dieu du soleil sur son char, à l’endroit même où Delacroix interviendrait. Ce dernier choisit de suivre le programme iconographique des années 1660-1670 en l’adaptant au contexte politique du moment. La grande peur de juin 1848 y résonne encore, elle arme pour ainsi dire le bras d’Apollon foudroyant le serpent Python, métaphore transparente des désordres et de la sédition dont la France du prince-président (le futur Napoléon III) devait triompher à jamais. On pourrait y voir la preuve du classicisme secret de Delacroix, tarte à la crème d’une certaine historiographie. Mais la lecture du dernier livre de Michel Jeanneret, Versailles, ordre et chaos, permet d’inverser utilement ce type de lecture. Ce que nous y découvrons avec ravissement, c’est le romantisme des classiques pour le dire d’un mot, que ce livre justifie en explorant « la part d’ombre » du
Le 20 février 1850, l’architecte Duban, en charge des travaux du Louvre, informait Delacroix d’une commande prestigieuse : peindre le compartiment central de la galerie d’Apollon qu’on restaurait alors au nom de la République. Cet espace était pourtant très marqué par le passé royal du palais. Sous Louis XIV, Charles Le Brun devait y représenter le dieu du soleil sur son char, à l’endroit même où Delacroix interviendrait. Ce dernier choisit de suivre le programme iconographique des années 1660-1670 en l’adaptant au contexte politique du moment. La grande peur de juin 1848 y résonne encore, elle arme pour ainsi dire le bras d’Apollon foudroyant le serpent Python, métaphore transparente des désordres et de la sédition dont la France du prince-président (le futur Napoléon III) devait triompher à jamais. On pourrait y voir la preuve du classicisme secret de Delacroix, tarte à la crème d’une certaine historiographie. Mais la lecture du dernier livre de Michel Jeanneret, Versailles, ordre et chaos, permet d’inverser utilement ce type de lecture. Ce que nous y découvrons avec ravissement, c’est le romantisme des classiques pour le dire d’un mot, que ce livre justifie en explorant « la part d’ombre » du  – Michel Jeanneret, Versailles, ordre et chaos, Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires, 376 p., 99 ill., 38 €. Le même auteur édite et préface l’étonnant récit qu’André Félibien à laissé des Fêtes de Versailles (Gallimard, Le cabinet des lettrés, 17,90 €), l’historiographe de Louis XIV ne craignant pas de laisser affleurer la folie des réjouissances sous les besoins de la propagande. Que Versailles ait été le lieu de la démesure dans la maîtrise des formes, on le vérifiera en consultant l’album de Guillaume Picon et Francis Hammond. Les textes de l’un répondent aux photographies de l’autre, et le résultat de leur entreprise commune dépasse la bienséance de son titre (Versailles. Invitation privée, Skira Flammarion, 75 €). À bien y réfléchir, le seul espace du château qui se soit conservé en son état originel et donne l’image exacte d’un «enchantement» propre à «accabler l’imagination» (Mlle de Scudéry), c’est la chapelle royale sur laquelle
– Michel Jeanneret, Versailles, ordre et chaos, Gallimard, Bibliothèque illustrée des histoires, 376 p., 99 ill., 38 €. Le même auteur édite et préface l’étonnant récit qu’André Félibien à laissé des Fêtes de Versailles (Gallimard, Le cabinet des lettrés, 17,90 €), l’historiographe de Louis XIV ne craignant pas de laisser affleurer la folie des réjouissances sous les besoins de la propagande. Que Versailles ait été le lieu de la démesure dans la maîtrise des formes, on le vérifiera en consultant l’album de Guillaume Picon et Francis Hammond. Les textes de l’un répondent aux photographies de l’autre, et le résultat de leur entreprise commune dépasse la bienséance de son titre (Versailles. Invitation privée, Skira Flammarion, 75 €). À bien y réfléchir, le seul espace du château qui se soit conservé en son état originel et donne l’image exacte d’un «enchantement» propre à «accabler l’imagination» (Mlle de Scudéry), c’est la chapelle royale sur laquelle 

 Si Chris Ofili est d’une emphase symbolique assez creuse, et d’une pyrotechnie assommante, Conrad Schawcross et Mark Wallinger convainquent davantage. Trophy, la pièce du premier, dans une version radicale du mythe, associe le sadisme de la déesse à ses frustrations sexuelles. Je lui parle de la mélancolie qui se dégage des déhanchements de son ballet robotique, il me répond « maybe » sans forcer son sourire. Diane, tyran saturnien, devient l’objet de nos désirs secrets chez Wallinger. Sa boîte façon peepshow a enflammé la presse britannique. Car elle abrite une jeune femme nue, plus en chair qu’en os, tatouée, superbe de souveraineté tranquille. Cette petite sœur de Victorine Meurent fait sa toilette sous nos yeux indiscrets. La boîte de Wallinger prend l’air par quatre ou cinq petits trous devant lesquels se contorsionne un public ébahi. Jamais Titien n’aura été si « up to date ». Dans un genre différent, l’exposition Exils se joue des frontières qu’on aime à dresser entre l’ancien et l’actuel, le très et le peu connu… C’est bien le moins qu’on puisse exiger d’elle. N’avance-t-elle pas sous pavillon ovidien, celui des Pontiques et des soupirs noirs ? Ne s’intéresse-t-elle pas à la mobilité, obligée ou volontaire, de certains artistes au cours du XXe siècle ? Guerres et calamités de toutes sortes en ont fait l’âge nomade par excellence.
Si Chris Ofili est d’une emphase symbolique assez creuse, et d’une pyrotechnie assommante, Conrad Schawcross et Mark Wallinger convainquent davantage. Trophy, la pièce du premier, dans une version radicale du mythe, associe le sadisme de la déesse à ses frustrations sexuelles. Je lui parle de la mélancolie qui se dégage des déhanchements de son ballet robotique, il me répond « maybe » sans forcer son sourire. Diane, tyran saturnien, devient l’objet de nos désirs secrets chez Wallinger. Sa boîte façon peepshow a enflammé la presse britannique. Car elle abrite une jeune femme nue, plus en chair qu’en os, tatouée, superbe de souveraineté tranquille. Cette petite sœur de Victorine Meurent fait sa toilette sous nos yeux indiscrets. La boîte de Wallinger prend l’air par quatre ou cinq petits trous devant lesquels se contorsionne un public ébahi. Jamais Titien n’aura été si « up to date ». Dans un genre différent, l’exposition Exils se joue des frontières qu’on aime à dresser entre l’ancien et l’actuel, le très et le peu connu… C’est bien le moins qu’on puisse exiger d’elle. N’avance-t-elle pas sous pavillon ovidien, celui des Pontiques et des soupirs noirs ? Ne s’intéresse-t-elle pas à la mobilité, obligée ou volontaire, de certains artistes au cours du XXe siècle ? Guerres et calamités de toutes sortes en ont fait l’âge nomade par excellence. Distribuée entre trois lieux, topographie conforme à son propos, Exils nous parle de ces peintres et sculpteurs que les circonstances ou leurs convictions ont poussés sur les chemins du monde. Juifs indésirables, étrangers de France, Français de New York,
Distribuée entre trois lieux, topographie conforme à son propos, Exils nous parle de ces peintres et sculpteurs que les circonstances ou leurs convictions ont poussés sur les chemins du monde. Juifs indésirables, étrangers de France, Français de New York,  Un autre exilé, d’autres transfuges : Caravage et ceux qu’on appelle les caravagesques. Grâce à l’aura persistante des peintres noirs, les expositions concomitantes de Montpellier et Toulouse ont drainé un large public cet été, qui devrait se maintenir jusqu’à la mi-octobre. Un succès à mettre au crédit de « la caravaggiomania » dont Olivier Bonfait décortique les mécanismes à travers un essai volontiers iconoclaste. Car l’idée d’une filiation directe entre le maître et ses émules continue à dominer notre vision du caravagisme, formule plus problématique qu’utile désormais pour désigner les artistes qui auront « adhéré », selon le mot de Baglione, à une « manière ». Retournant les étiquettes de l’histoire de l’art, Bonfait fait émerger des différences là où d’autres célèbrent une communauté anti-académique, anti-idéaliste, moderne en un mot. La construction rétrospective des gardiens du temple est patente : les caravagesques n’apparaissent sous ce nom qu’à la fin du XVIIIe siècle. A lire les premiers témoins, l’influence du Caravage, ou plutôt son succès, aura suscité la multiplication des « naturalisti » sur le marché. Mais Bonfait montre ce que cette approche globalisante doit à la mythologie du Caravage, déjà active à sa mort. En découla une minoration des vrais modèles du dit caravagisme, tels Manfredi,
Un autre exilé, d’autres transfuges : Caravage et ceux qu’on appelle les caravagesques. Grâce à l’aura persistante des peintres noirs, les expositions concomitantes de Montpellier et Toulouse ont drainé un large public cet été, qui devrait se maintenir jusqu’à la mi-octobre. Un succès à mettre au crédit de « la caravaggiomania » dont Olivier Bonfait décortique les mécanismes à travers un essai volontiers iconoclaste. Car l’idée d’une filiation directe entre le maître et ses émules continue à dominer notre vision du caravagisme, formule plus problématique qu’utile désormais pour désigner les artistes qui auront « adhéré », selon le mot de Baglione, à une « manière ». Retournant les étiquettes de l’histoire de l’art, Bonfait fait émerger des différences là où d’autres célèbrent une communauté anti-académique, anti-idéaliste, moderne en un mot. La construction rétrospective des gardiens du temple est patente : les caravagesques n’apparaissent sous ce nom qu’à la fin du XVIIIe siècle. A lire les premiers témoins, l’influence du Caravage, ou plutôt son succès, aura suscité la multiplication des « naturalisti » sur le marché. Mais Bonfait montre ce que cette approche globalisante doit à la mythologie du Caravage, déjà active à sa mort. En découla une minoration des vrais modèles du dit caravagisme, tels Manfredi,  Mentionnons enfin une exposition qui, elle, a bien fermé ses portes, début septembre, à Clermont-Ferrand : Géricault au cœur de la création romantique. Le propos, centré sur Le Radeau de la Méduse, son processus de création comme sa volonté d’action, donne sa pleine mesure dans le catalogue qui l’accompagnait (Nicolas Chaudun, 32,50 €). Un format italien pour un tableau panoramique : Géricault y embarque, en effet, le futur de la peinture française et les déchirements politiques de la France de Louis XVIII. On comprend que son radeau prenne l’eau de toutes parts et que l’avenir semble aussi sombre que le ciel du Sénégal par gros temps. Du parti libéral, Géricault incarnait les valeurs fondatrices autant que les contradictions présentes, celles d’une bourgeoisie éclairée qui exigeait l’extension des libertés politiques pour mieux établir le règne du libre-échange. L’expédition à laquelle prit part La Méduse était liée à la question des colonies. Abolir l’esclavage était une chose, affranchir l’Afrique une autre. Le catalogue de Bruno Chenique, grand connaisseur de Géricault, scrute son héros depuis ses limites, qu’il s’agisse de la pratique académique des têtes d’expression ou de la fascination pour Michel-Ange. De là à considérer le Radeau, composition et sens, comme un moderne Jugement dernier ! Why not ?
Mentionnons enfin une exposition qui, elle, a bien fermé ses portes, début septembre, à Clermont-Ferrand : Géricault au cœur de la création romantique. Le propos, centré sur Le Radeau de la Méduse, son processus de création comme sa volonté d’action, donne sa pleine mesure dans le catalogue qui l’accompagnait (Nicolas Chaudun, 32,50 €). Un format italien pour un tableau panoramique : Géricault y embarque, en effet, le futur de la peinture française et les déchirements politiques de la France de Louis XVIII. On comprend que son radeau prenne l’eau de toutes parts et que l’avenir semble aussi sombre que le ciel du Sénégal par gros temps. Du parti libéral, Géricault incarnait les valeurs fondatrices autant que les contradictions présentes, celles d’une bourgeoisie éclairée qui exigeait l’extension des libertés politiques pour mieux établir le règne du libre-échange. L’expédition à laquelle prit part La Méduse était liée à la question des colonies. Abolir l’esclavage était une chose, affranchir l’Afrique une autre. Le catalogue de Bruno Chenique, grand connaisseur de Géricault, scrute son héros depuis ses limites, qu’il s’agisse de la pratique académique des têtes d’expression ou de la fascination pour Michel-Ange. De là à considérer le Radeau, composition et sens, comme un moderne Jugement dernier ! Why not ?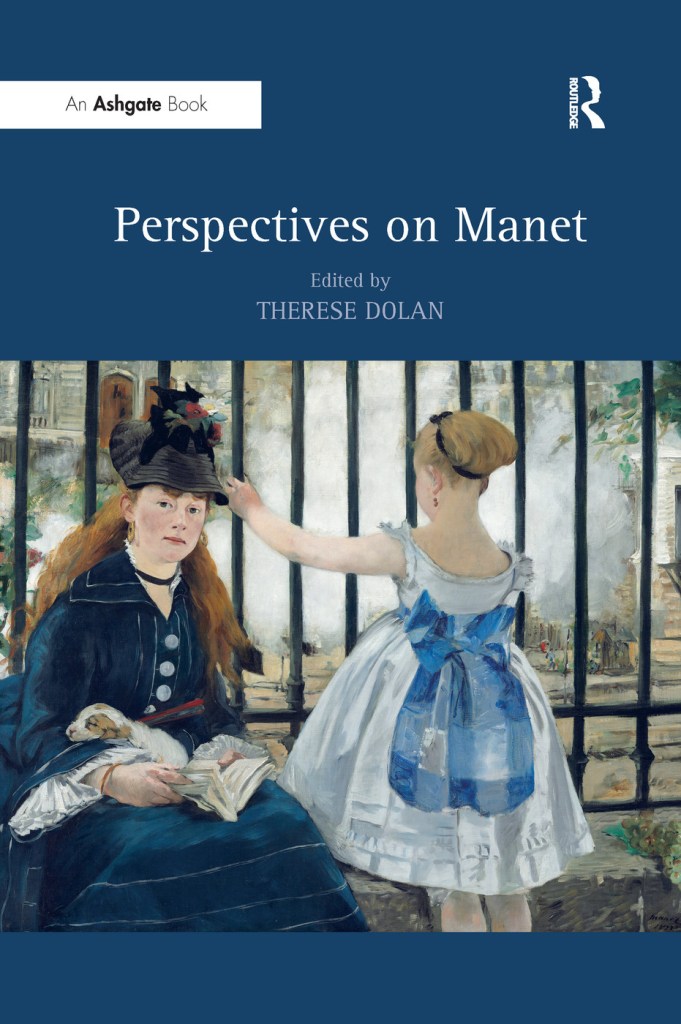
 Les usages que Manet fit de la photographie auraient pu nourrir des approches rafraîchissantes. La modernité, à divers titres, en est inséparable. Monique Sicard vient de consacrer à François Arago une excellente synthèse qui scrute et discute l’onde de choc produite par le nouveau médium dès que fut déclarée publiquement sa naissance. Le grand prêtre laïc de cette révélation, le 19 août 1839, ce fut Arago. Né lui-même en 1786, et mort en 1853 sans s’être rallié au Second Empire, après avoir été un astronome génial, le plus jeune scientifique à intégrer l’Institut, un républicain intraitable sous Louis-Philippe et un ministre actif entre février et juin 1848, il était destiné à survivre dans notre mémoire comme une sorte de Galilée à bonnet phrygien. On conviendra, hélas, que le livre de Monique Sicard est de salubrité publique. Parmi toutes les causes embrassées par Arago, la jeune photographie pourrait prendre des allures d’intruse. Or elle confirme chacune des convictions profondes de cet « homme de la lumière », du républicanisme à la nécessité de partager les fruits de la science. Son soutien à Daguerre s’appuie donc sur une vision sociale qui adoube et destine le potentiel de la photographie à tous les domaines de la recherche et de l’art…
Les usages que Manet fit de la photographie auraient pu nourrir des approches rafraîchissantes. La modernité, à divers titres, en est inséparable. Monique Sicard vient de consacrer à François Arago une excellente synthèse qui scrute et discute l’onde de choc produite par le nouveau médium dès que fut déclarée publiquement sa naissance. Le grand prêtre laïc de cette révélation, le 19 août 1839, ce fut Arago. Né lui-même en 1786, et mort en 1853 sans s’être rallié au Second Empire, après avoir été un astronome génial, le plus jeune scientifique à intégrer l’Institut, un républicain intraitable sous Louis-Philippe et un ministre actif entre février et juin 1848, il était destiné à survivre dans notre mémoire comme une sorte de Galilée à bonnet phrygien. On conviendra, hélas, que le livre de Monique Sicard est de salubrité publique. Parmi toutes les causes embrassées par Arago, la jeune photographie pourrait prendre des allures d’intruse. Or elle confirme chacune des convictions profondes de cet « homme de la lumière », du républicanisme à la nécessité de partager les fruits de la science. Son soutien à Daguerre s’appuie donc sur une vision sociale qui adoube et destine le potentiel de la photographie à tous les domaines de la recherche et de l’art… À la fin de sa vie, Arago regrettait encore que les scientifiques de l’expédition d’Égypte n’aient pu s’équiper de la camera obscura. C’est dire que le vieux républicain, pour s’opposer au neveu de l’empereur, n’accablait pas l’œuvre de Bonaparte par idéologie. N’avez-vous pas remarqué combien l’œuvre du premier Napoléon divise toujours les Français, incapables d’accepter qu’un homme éminent de leur histoire puisse se peindre aussi de noir. Ne faudrait-il pas que le passé s’accordât en tout au présent, à son immense tolérance et à l’intelligence des choses humaines qui nous submerge ? « Ne marchandons pas la grandeur », dit De Gaulle à Malraux, à la fin du nouveau livre de
À la fin de sa vie, Arago regrettait encore que les scientifiques de l’expédition d’Égypte n’aient pu s’équiper de la camera obscura. C’est dire que le vieux républicain, pour s’opposer au neveu de l’empereur, n’accablait pas l’œuvre de Bonaparte par idéologie. N’avez-vous pas remarqué combien l’œuvre du premier Napoléon divise toujours les Français, incapables d’accepter qu’un homme éminent de leur histoire puisse se peindre aussi de noir. Ne faudrait-il pas que le passé s’accordât en tout au présent, à son immense tolérance et à l’intelligence des choses humaines qui nous submerge ? « Ne marchandons pas la grandeur », dit De Gaulle à Malraux, à la fin du nouveau livre de 
 Parce que ces années furent celles d’Apollinaire et de Laurencin, on mentionnera la parution du tome XII des Cahiers de Paul Valéry. Ce sont des haïkus de l’aube, des impromptus du petit matin, des exercices spirituels, hors de toute religion, sinon celle du beau. Raison pour laquelle les deux individus les plus nommés sont des tyrans de la pensée active, Napoléon et Mallarmé. Comme ce dernier, son maître ultime, Valéry pense le travail poétique sur le mode de la peinture, qu’il connaît bien. Julie Manet, mentionnée, c’est la famille… L’oncle de la jeune femme, le grand Édouard, aurait pu dire ce que Valéry écrit pour lui : « Car d’un objet vrai, la peinture peut donner une impression plus forte, plus isolée que l’objet même ne l’a jamais fait. » Mais la poésie, même à chercher à faire image et à reproduire le choc de l’instant, doit rester plus près de la parole et de son flux. D’où, par exemple, cette incise sur la prose de Gautier, souple comme une causerie, quand Flaubert fixe les mots en mosaïque. Du grand art, à chaque page. Une sincérité aussi qui lui fait alterner le banal (les pensées sur la mort) et l’imprévisible.
Parce que ces années furent celles d’Apollinaire et de Laurencin, on mentionnera la parution du tome XII des Cahiers de Paul Valéry. Ce sont des haïkus de l’aube, des impromptus du petit matin, des exercices spirituels, hors de toute religion, sinon celle du beau. Raison pour laquelle les deux individus les plus nommés sont des tyrans de la pensée active, Napoléon et Mallarmé. Comme ce dernier, son maître ultime, Valéry pense le travail poétique sur le mode de la peinture, qu’il connaît bien. Julie Manet, mentionnée, c’est la famille… L’oncle de la jeune femme, le grand Édouard, aurait pu dire ce que Valéry écrit pour lui : « Car d’un objet vrai, la peinture peut donner une impression plus forte, plus isolée que l’objet même ne l’a jamais fait. » Mais la poésie, même à chercher à faire image et à reproduire le choc de l’instant, doit rester plus près de la parole et de son flux. D’où, par exemple, cette incise sur la prose de Gautier, souple comme une causerie, quand Flaubert fixe les mots en mosaïque. Du grand art, à chaque page. Une sincérité aussi qui lui fait alterner le banal (les pensées sur la mort) et l’imprévisible.

 Nous étions dans l’intimité de Jouhandeau et Paulhan, restons-y encore quelques minutes pour rappeler que la peinture moderne en fut l’un des agents les plus sûrs. Et André Masson l’un des piliers ou l’un des phares, comme vous voulez. C’est à propos d’une « note » sur le peintre, promise à la NRF, que
Nous étions dans l’intimité de Jouhandeau et Paulhan, restons-y encore quelques minutes pour rappeler que la peinture moderne en fut l’un des agents les plus sûrs. Et André Masson l’un des piliers ou l’un des phares, comme vous voulez. C’est à propos d’une « note » sur le peintre, promise à la NRF, que 
 Leur correspondance, qui paraît sous l’enseigne des excellentes éditions Bartillat et le contrôle érudit de Jean-Paul Goujon, bruisse d’un drame amoureux singulier et de silences aussi complices qu’humiliants. Au départ, l’admiration du cadet se dit sans réserve : Régnier, après Verlaine et Mallarmé, est « évidemment le poète attendu ». Nous sommes en 1890, au moment où le symbolisme, mot valise, entre dans sa phase de consécration et se donne bientôt des tribunes solides, des Entretiens politiques et littéraires à la Revue blanche, en passant par Le Mercure de France. Les premiers recueils de Régnier, des minces Lendemains (1885) aux Poèmes anciens et romanesques (1890), ont fait connaître et presque imposé un ton hautain et mystérieux d’une grande souplesse métrique. La supposée mélancolie de l’aristo désœuvré (et longtemps désargenté, du reste) est loin d’en être la seule corde à vibrer. Louÿs voit donc un maître en Régnier avant de le traiter en rival. La pomme de discorde possède les rondeurs créoles de Marie de Hérédia, dont le double jeu semble évident. Elle prend donc Régnier pour mari en 1895 et Louÿs pour amant, après deux ans d’un mariage blanc…
Leur correspondance, qui paraît sous l’enseigne des excellentes éditions Bartillat et le contrôle érudit de Jean-Paul Goujon, bruisse d’un drame amoureux singulier et de silences aussi complices qu’humiliants. Au départ, l’admiration du cadet se dit sans réserve : Régnier, après Verlaine et Mallarmé, est « évidemment le poète attendu ». Nous sommes en 1890, au moment où le symbolisme, mot valise, entre dans sa phase de consécration et se donne bientôt des tribunes solides, des Entretiens politiques et littéraires à la Revue blanche, en passant par Le Mercure de France. Les premiers recueils de Régnier, des minces Lendemains (1885) aux Poèmes anciens et romanesques (1890), ont fait connaître et presque imposé un ton hautain et mystérieux d’une grande souplesse métrique. La supposée mélancolie de l’aristo désœuvré (et longtemps désargenté, du reste) est loin d’en être la seule corde à vibrer. Louÿs voit donc un maître en Régnier avant de le traiter en rival. La pomme de discorde possède les rondeurs créoles de Marie de Hérédia, dont le double jeu semble évident. Elle prend donc Régnier pour mari en 1895 et Louÿs pour amant, après deux ans d’un mariage blanc…

 Nous touchons là un des « motifs » qui ont longtemps retardé le « retour » de Benoit. Fin 1944, il eut en effet à répondre de sa conduite sous l’Occupation. Accusé d’avoir manifesté sa foi maréchaliste et fait paraître certains de ses romans dans la presse de la collaboration, sans parler de ses attaches avec une certaine mondanité très compromise, ni de ses contacts avec Otto Abetz et Karl Epting, l’amant de Florence Gould passa quelques mois en prison avant que les comités d’épuration ne lui pardonnent ses « petites fautes ». Passionnante quant à l’écrivain d’avant-guerre, ses débuts de poète parnassien et maurrassien, son goût œcuménique pour Delacroix, Hugo et Barrès, son priapisme cosmopolite, sa modernité paradoxale, son sionisme de terrain, la biographie alerte de Cortanze, trop rapide parfois, refuse l’évidence et attribue à son héros un moment de résistance dont Benoit ne s’est guère prévalu. Etrange. Partisan du rapprochement franco-allemand dès avant 1939, cet homme sans frontières eut le cœur à droite. Pourquoi l’ignorer. Stéphane Guégan
Nous touchons là un des « motifs » qui ont longtemps retardé le « retour » de Benoit. Fin 1944, il eut en effet à répondre de sa conduite sous l’Occupation. Accusé d’avoir manifesté sa foi maréchaliste et fait paraître certains de ses romans dans la presse de la collaboration, sans parler de ses attaches avec une certaine mondanité très compromise, ni de ses contacts avec Otto Abetz et Karl Epting, l’amant de Florence Gould passa quelques mois en prison avant que les comités d’épuration ne lui pardonnent ses « petites fautes ». Passionnante quant à l’écrivain d’avant-guerre, ses débuts de poète parnassien et maurrassien, son goût œcuménique pour Delacroix, Hugo et Barrès, son priapisme cosmopolite, sa modernité paradoxale, son sionisme de terrain, la biographie alerte de Cortanze, trop rapide parfois, refuse l’évidence et attribue à son héros un moment de résistance dont Benoit ne s’est guère prévalu. Etrange. Partisan du rapprochement franco-allemand dès avant 1939, cet homme sans frontières eut le cœur à droite. Pourquoi l’ignorer. Stéphane Guégan
 Amateurs de peinture sage, s’abstenir ! La volupté fut la grande affaire du XVIIIe siècle et l’art français s’y voua plus qu’aucun autre. Dès les années 1720, Eros sort de sa clandestinité, tableaux et gravures de l’ombre, s’empare des cimaises officielles et domine aussi bien la fable que l’évocation du quotidien. La licence fait loi, et le vice florès. Il suffit d’un masque, qui ne trompe personne, pour entrer dans la ronde. Monarque et élites, à l’unisson, saluent l’ivresse des sens et de l’esprit comme leur maître absolu après Dieu. C’est, pour grossir le trait et l’attrait, « le siècle de Louis XV ». Charles-Joseph Natoire (1700-1777) en fut l’un des plus incontestables pourvoyeurs. On n’accorde jamais assez de soin aux peintres luxurieux, chairs frémissantes, sujets lestes et « rois de l’instant », selon le mot si juste de Proust. Leur soleil agace ou aveugle les amateurs de peinture torturée ou asexuée. Et croyez-moi, ils sont encore légion. Le livre de Susanna Caviglia-Brunel, si gazé soit-il, s’adresse aux autres, aux amoureux du charnel et des sensations piquantes, aux partisans du frisson et des ruses de l’image. Ouvrage monumental, il recense tout ce que l’auteur a fini par savoir, et elle en sait beaucoup, de la carrière et de l’œuvre d’un artiste prolixe, dont on saisira mieux désormais la double nationalité. A mesure que nous redécouvrons l’art romain du premier XVIIIe siècle, il paraît de plus en plus clair que les jeunes artistes français, en résidence académique dans la cité des papes, s’y sont forgé une religion propre. Est-il si étonnant, du reste, de les voir regarder l’art du temps présent ? Les modernes qui ont nom Cadès, Masucci et Trevisani, sans parler des Vénitiens avec lesquels on a parfois confondu certaines œuvres mal attribuées de Natoire ? Il n’y a pas que l’antique et les Carrache dans la vie des Prix de Rome, pensionnés par le roi ! Ces jeunes gens hautement inflammables relèvent le gant, assouplissent leur manière, s’ouvrent à un art de l’extase, fût-elle mystique en premier lieu. Car il faudra le contexte parisien des années 1730-1740 pour que s’épanouisse la fermentation du séjour italien et que le transport des âmes change de registre. Celui de la galanterie connaît mille nuances, il convient de les maîtriser pour faire entendre, sous les « grâces » de l’époque, une autre musique. Natoire possédait cette oreille-là et ne peignait pas le décor lascif de l’alcôve de Philibert Orry, contrôleur des finances, sur le même ton que l’hospice des Enfants-Trouvés… Pour Susanna Caviglia-Brunel, l’érudition n’est pas une fin en soi ; ses commentaires prennent en compte l’érotique de la représentation, formes, signes et surtout glissements. Et, comme Natoire, elle a l’art de suggérer.
Amateurs de peinture sage, s’abstenir ! La volupté fut la grande affaire du XVIIIe siècle et l’art français s’y voua plus qu’aucun autre. Dès les années 1720, Eros sort de sa clandestinité, tableaux et gravures de l’ombre, s’empare des cimaises officielles et domine aussi bien la fable que l’évocation du quotidien. La licence fait loi, et le vice florès. Il suffit d’un masque, qui ne trompe personne, pour entrer dans la ronde. Monarque et élites, à l’unisson, saluent l’ivresse des sens et de l’esprit comme leur maître absolu après Dieu. C’est, pour grossir le trait et l’attrait, « le siècle de Louis XV ». Charles-Joseph Natoire (1700-1777) en fut l’un des plus incontestables pourvoyeurs. On n’accorde jamais assez de soin aux peintres luxurieux, chairs frémissantes, sujets lestes et « rois de l’instant », selon le mot si juste de Proust. Leur soleil agace ou aveugle les amateurs de peinture torturée ou asexuée. Et croyez-moi, ils sont encore légion. Le livre de Susanna Caviglia-Brunel, si gazé soit-il, s’adresse aux autres, aux amoureux du charnel et des sensations piquantes, aux partisans du frisson et des ruses de l’image. Ouvrage monumental, il recense tout ce que l’auteur a fini par savoir, et elle en sait beaucoup, de la carrière et de l’œuvre d’un artiste prolixe, dont on saisira mieux désormais la double nationalité. A mesure que nous redécouvrons l’art romain du premier XVIIIe siècle, il paraît de plus en plus clair que les jeunes artistes français, en résidence académique dans la cité des papes, s’y sont forgé une religion propre. Est-il si étonnant, du reste, de les voir regarder l’art du temps présent ? Les modernes qui ont nom Cadès, Masucci et Trevisani, sans parler des Vénitiens avec lesquels on a parfois confondu certaines œuvres mal attribuées de Natoire ? Il n’y a pas que l’antique et les Carrache dans la vie des Prix de Rome, pensionnés par le roi ! Ces jeunes gens hautement inflammables relèvent le gant, assouplissent leur manière, s’ouvrent à un art de l’extase, fût-elle mystique en premier lieu. Car il faudra le contexte parisien des années 1730-1740 pour que s’épanouisse la fermentation du séjour italien et que le transport des âmes change de registre. Celui de la galanterie connaît mille nuances, il convient de les maîtriser pour faire entendre, sous les « grâces » de l’époque, une autre musique. Natoire possédait cette oreille-là et ne peignait pas le décor lascif de l’alcôve de Philibert Orry, contrôleur des finances, sur le même ton que l’hospice des Enfants-Trouvés… Pour Susanna Caviglia-Brunel, l’érudition n’est pas une fin en soi ; ses commentaires prennent en compte l’érotique de la représentation, formes, signes et surtout glissements. Et, comme Natoire, elle a l’art de suggérer.

