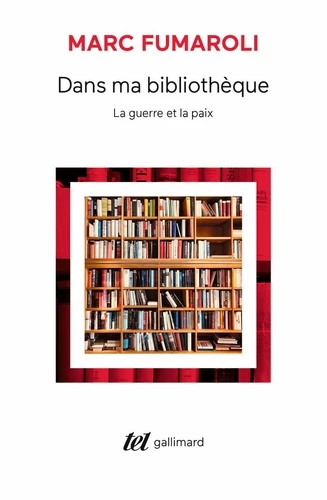
Le rocaille fut la dernière passion de Marc Fumaroli, et le néo-rocaille propre au xixe siècle l’objet de ses attentions et intuitions ultimes. Chaque page de son livre posthume, malgré le souvenir d’À rebours affiché par son titre, témoigne d’une ferveur intacte à l’endroit de ce que l’on n’ose plus appeler le style Louis XV. Mais ses « résurrecteurs », pour citer Dans ma bibliothèque, n’y sont pas moins présents, Edmond et Jules de Goncourt en premier lieu, dont l’éditeur de Madame Gervaisais partageait la faculté à vivre en un autre temps que le sien. Mieux vaudrait dire que les deux frères, loin de rejeter en bloc l’époque de disgrâce qui les vit naître, parvinrent à ressusciter un esprit, une culture, une sociabilité, autant qu’à collectionner Watteau, Boucher, Fragonard et tout ce qu’un marché de l’art de plus en plus tentaculaire mettait à la portée des nouveaux curieux. Rapprocher n’est pas identifier, rappelle Dans ma bibliothèque, et Marc Fumaroli eut l’art de jeter des ponts sans ignorer que rien en histoire ne se répète, et que les réhabilitations sont des réinventions. Sans doute le contexte des années 1970-1990, inséparable des expositions mémorables que Pierre Rosenberg organisa au Grand Palais, encouragea-t-il une compréhension plus fine de l’activité picturale sous la Régence et le début du règne de Louis XV. Watteau, Boucher et Fragonard, justement, mais aussi Chardin, retrouvaient une place éminente dans la conscience collective tandis que la redécouverte du xixe siècle, favorisé par la préfiguration du musée d’Orsay et son ouverture, rendait possible une approche de la modernité des années 1860-1880 moins dépendante des avant-gardes du xxe siècle. Le moment n’était-il pas venu d’historiciser autrement l’émergence, sous le Second Empire, d’une création en prise avec la sphère privée, par ses sujets et ses clients, d’une peinture distincte du système des Beaux-Arts hérité du davidisme et des réformes révolutionnaires, dont le Salon restait l’un des instruments régulateurs et le symbole saillant ? À l’évidence, au-delà des filiations formelles et des emprunts iconographiques qui font dialoguer le temps de Watteau et le temps de Manet, Marc Fumaroli avait saisi toute l’importance de l’écologie des images, les unes déterminées par l’art d’État, les autres par l’otium individuel. En 1748, alors que l’opposition au rocaille est en voie de passer de la presse à l’administration royale, le comte de Caylus, donnant lecture de sa Vie de Watteau à l’Académie, distingue deux modes et deux finalités en peinture, le style gracieux adapté à la fête galante et à la fable érotique ne convenant pas aux tableaux d’histoire, de vocabulaire et à vocation plus graves. En 1720 comme en 1863, « l’erreur des Modernes », aux yeux de leurs censeurs, fut de ne pas avoir amendé leur manière en changeant de registre. C’est la confusion des genres, la corruption du haut par le bas, qui mène au scandale du Déjeuner sur l’herbe et d’Olympia. N’oublions pas que Marc Fumaroli a rencontré « cet illustre inconnu » de Caylus, sur lequel il eût tant aimé écrire un livre, en travaillant sur les prolongements de la Querelle des Anciens et des Modernes au xviiie siècle. L’anticomanie dont Caylus fut le représentant à l’égal de Winckelmann l’intéresse moins que le familier de Crozat et de Mariette qu’il avait été d’abord, l’ami rabelaisien de Watteau et l’animateur d’un cercle aux contours mouvants. On peut lire Dans ma bibliothèque comme la tentative de le recomposer et de nous faire réfléchir, en bonne compagnie, à d’autres « prolongements », ceux qui mènent aux Goncourt de L’Art du xviiie siècle, au Balzac du Cousin Pons et de La Duchesse de Langeais, au Degas Danse Dessin de Paul Valéry, et aux écrits critiques de Baudelaire, dont Marc Fumaroli fit un constant commerce. Les pages qui suivent ont Manet pour protagoniste central, elles n’en sont pas moins tributaires de l’intense réflexion que l’amoureux du rocaille et le biographe interrompu de Caylus nous ont léguée.
Stéphane Guégan

Stéphane Guégan, « Manet rocaille », lire la suite dans Penser avec Marc Fumaroli, textes réunis et introduits par Antoine Compagnon, de l’Académie française, Droz, Bibliothèque des Lumières, 2023, 42€.
Marc Fumaroli, Dans ma bibliothèque. La guerre et la paix, préface de Pierre Laurens, Gallimard, Tel, 18€. Dans ma bibliothèque, peut-être l’un de ses plus beaux livres dans son inaccomplissement même, fut son Rancé (« Que fais-je dans le monde? ») et son Siècle de Louis XV, que Voltaire oublia d’écrire par fanatisme louis-quatorzien et ingratitude.
Trois lectures idoines

La Terreur revient, c’est l’évidence. Robespierre a les faveurs de thèses bienveillantes et Saint-Just, écrivain raté, orateur inquiet et tranchant, est redevenu un objet de fascination. En manière de contrepoids, la lecture du Journal des prisons de Louise-Henriette de Duras pourra être de quelque utilité aux nouveaux apôtres de la violence purificatrice. Née Noailles sous Louis XV, elle a près de cinquante ans lorsque la Révolution, en avril 1793, la met aux fers, sans autre raison que le crime d’exister. La guillotine n’a pas d’égards pour les cheveux blancs. En plus de trois parents, sa mère et son père périssent sous ce que le néoclassicisme de l’époque nomme le glaive de la justice. La duchesse de Duras resta enfermée jusqu’en octobre 1794, au-delà de Thermidor an II qui ne fit donc pas cesser l’arbitraire dès la chute de Maximilien. Le quotidien d’une prisonnière politique n’est pas seulement le produit traumatisant des droits bafoués et des abus de geôlier, il confirme ce qu’est l’homme ou la femme en situation de détresse. Nulle entraide, nulle communauté du malheur : « Je découvris, peu de temps après mon arrivée à Chantilly (sa deuxième prison), que la perte de la liberté ne réunissait ni les esprits ni les cœurs, et qu’on était en détention comme dans le monde. » SG / Louise-Henriette de Duras, Journal des prisons de mon père, de ma mère et des miennes, Mercure de France / Le Temps retrouvé, 11,50€.

Entre 2007 et 2016, Marc Fumaroli s’est démené pour faire mieux connaître la figure et l’œuvre de Claire de Duras (1777-1828), préfaçant notamment une réédition d’Ourika, roman abolitionniste de 1823, qui suscita une « véritable rage », se souviendra Sainte-Beuve dix ans plus tard (l’Angleterre sortait alors de l’esclavage). Une jeune Sénégalaise, arrachée à son pays et à la servitude, puis conduite en France, va y vivre bientôt les espoirs et les épreuves de la Révolution. Mais la pire de ses souffrances est de ne pas être autorisée, devenue femme, mais femme de couleur, à s’unir au jeune homme de son cœur. Belle-fille de Louise-Henriette de Duras, proche de Chateaubriand, la romancière, tout en soulignant de mots forts cette condamnation à la solitude (qui connaissait des exceptions), n’oublie pas de stigmatiser la Terreur et de chanter les vertus apaisantes de la religion chrétienne. A la manière de l’auteur d’Atala, elle pratique le récit dans le récit et, conteuse moins géniale, émaille les siens de scènes qu’elle dit touchantes. Nous attendrir, loin des excès du roman gothique ou romantique, tel est le cap qu’elle se donne. Au passage, elle ne cède jamais à l’angélisme, comme l’atteste la mention horrifiée des « massacres de Saint-Domingue », bain de sang où périrent en 1791 une foule de planteurs blancs. Quoique bien en cour, cette libérale de la Restauration se garde, en effet, d’idéaliser quelque régime ou quelque race que ce soit. Marie-Bénédicte Diethelm, sa subtile éditrice, parle de l’aversion pour la France prérévolutionnaire qu’elle aurait partagée avec Chateaubriand ; cela me semble aussi excessif que d’écrire que la Galatée de Girodet fit davantage sensation, au Salon de 1819, que Le Radeau de la Méduse et ses résonances sénégalaises… Mais remercions-la d’avoir réuni, et finement commenté, l’œuvre complet, ou presque, d’une écrivaine qui sut secouer son époque et son entourage. SG / Claire de Duras, Œuvres romanesques, avec trois textes inédits, édition de Marie-Bénédicte Diethelm, Gallimard, Folio Classique, 10,90€.

De tous les maux qui oppriment Flaubert, le bovarysme est le plus précoce et le plus durable. Adolescent et déjà écrivain féroce, Gustave étouffe dans la vie ordinaire, que ses futurs romans peindront plutôt en gris. Le XIXe siècle, surtout depuis la Normandie, lui fait horreur, ce ne sont que béatitudes au rabais, utiles, futiles, renoncements surtout. Les rêves éveillés du jeune Flaubert, dont on ne cesse de redécouvrir l’œuvre, se remplissent d’extravagantes images, à la fois consolation et aspiration à mieux. En 1836, il a quinze ans et singe Byron en enviant son destin ; il lui faut l’Orient, le ciel bleu, les minarets dorés, les parfums, les femmes et les « fraîches voluptés » du sérail. En grandissant, après s’être frotté à l’Égypte et à la Palestine, il avouera, réalisme oblige, un faible pour les oublis et les dénis de l’orientalisme romantique : la saleté, le sordide, le faisandé, le spectre de la maladie ou de la mort l’excitent. Ses héros frustrés, Emma, Frédéric, lui ressemblent : lectures et voyages, la fiction des unes, la déception des autres, ne sauraient apaiser sa frénésie d’autre chose ou d’ailleurs, et le rut des sens qui fermente en lui. La modernité qu’explore ses romans reste en communication permanente avec le manque qui la fonde, manque où s’engouffre une intempérance de visions anti-saturniennes. Philippe Berthier et son gai savoir nous en ouvrent le chemin dangereux dans un essai brillantissime. Baudelaire et Chateaubriand y croisent, naturellement, le faux ermite de Croisset. Chateaubriand que Marc Fumaroli félicitait Berthier d’avoir rejoint, voilà près de 25 ans, lors d’un colloque fameux, après avoir si bien servi Stendhal et Barbey d’Aurevilly. SG / Philippe Berthier, Le Crocodile de Flaubert. Essai sur l’imagination pendulaire, Champion Essais, 29,90€. Voir aussi Flaubert, Récits de jeunesse, édition de Claudine Gothot-Mersch, révisée par Yvan Leclerc, enrichie notamment des transcriptions de deux manuscrits récemment retrouvés, Pyrénées et Corse et le superbe Novembre.


