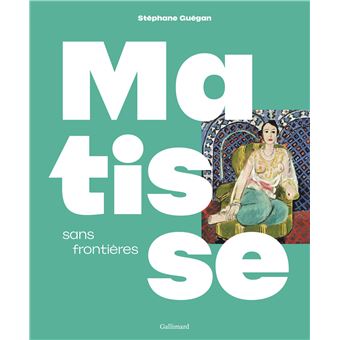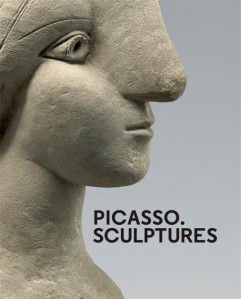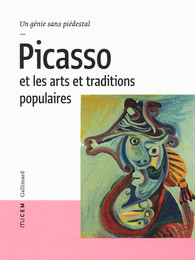Le temps s’est éloigné où le même lit, de génération en génération, nous voyait naître et mourir. Objet tout simple, il était entouré d’un respect religieux, qu’il soit ou non surmonté d’un de ces petits crucifix dont les brocanteurs ne savent plus que faire. Dépouillé aujourd’hui de son ancien apparat, fût-il modeste, le lit conserve sa part de sacré en ce qu’il reçoit et inspire aussi bien les plaisirs de la vie diurne que les mystères de la vie nocturne. Dans L’Empire du sommeil, la très subtile et envoûtante exposition que Laura Bossi a conçue au musée Marmottan Monet, l’empire des sens et l’emprise du rêve se partagent près de 130 œuvres, insignes ou rares, inventaire poétique des multiples résonances de son sujet. Ce qu’il advient de nous quand nous dormons fascine depuis toujours, Grecs et Romains le disent, la Bible le dit davantage, surtout l’Ancien Testament, deux mille ans d’images le confirment. Il fallait choisir, il fallait trouver les bons angles, compte tenu d’espaces peu faits pour le bavardage. Une manière d’antichambre concentre le propos autour du merveilleux tableau de Budapest (ill. 1), cette jeune fille endormie de 1615, légèrement décoiffée, le visage illuminé par le plus doux des sourires, et auréolé du parfum moins innocent des fleurs de jasmin. Indice de ce qui ne peut être qu’à moitié perçu, le brocart tissé d’or, au premier plan, possède l’involontaire beauté d’une métaphore shakespearienne. Tableau sans collier, probablement italien, il a moins retenu les attributionnistes que les explorateurs de l’expérience onirique, tel Victor Stoichita récemment. D’emblée, le visiteur affronte l’ambiguïté de cette petite mort, comme on le dit de l’amour, qu’est le sommeil, moment de suspension, d’abandon, rappelle l’Atys de Lully, aux songes « agréables » et « désagréables ». De part et d’autre du tableau de Budapest, comme en bouquet, Laura Bossi réunit un Ruth et Booz apaisé de Puvis de Chavannes, un Monet de Copenhague, portrait inquiet de son fils Jean en petit Jésus, et une figuration peu courante de saint Pierre, signée Petrini, parfaite allégorie des clés du remords, de la Faute dont rien, pas même l’inconscience du repos, ne saurait nous libérer.

Du doux sommeil aux insomnies que favorisent la vie et le vide modernes, du rêve comme prophétie au rêve comme chiffre du moi (Freud), des délices d’Eros aux terreurs de Thanatos, de l’enfance du Christ à la confiance du croyant, des paradis artificiels aux portes de l’Enfer, du très ancien au très contemporain, le parcours qui suit n’emprunte jamais les sentiers labourés de la vulgate surréaliste. On se laisse charmer et presque bercer par l’oscillation propre à la thématique d’ensemble, on reste pétrifiés devant certains coups de clairon, le Noé de Bellini, dont Robert Longhi partageait l’ivresse, le Gabriel von Max de Montréal et sa mouche chastellienne, l’impudique Pisana d’Arturo Martini, que je préfère à son célèbre Sogno, l’Apollon endormi et inouï de Lotto, Les Yeux clos de Redon, l’un des prêts majeurs d’Orsay et la matrice de tant de Matisse, le Songe d’Ossian du bizarre Monsieur Ingres, en provenance d’une fameuse collection, la très baudelairienne Voyante (plutôt que La Somnambule) de Courbet, chère au regretté Sylvain Amic, les troublantes et addictives Fumeuses d’opium de Previati, le Lit défait de Delacroix (ill.2), véritable anamorphose des ébats que consigne son Journal de jeunesse, la Fanciulla dormiente de Zandomeneghi, l’ami italien de Degas et, clou final, La Phalène de Balthus, en qui revivent chacune des harmoniques de cette exposition qui réveille. Stéphane Guégan
L’Empire du sommeil, Musée Marmottan Monet, jusqu’au 1er mars. Catalogue sous la direction de Laura Bossi, InFine éditions, 35€.

La vida es sueño / Philosopher consiste-t-il à donner sens au monde ou à le dégager du voile d’illusions qui dirige nos existences ? Le Bien en est-il la clef, en dépit des dénis accablants de l’expérience commune, ou le Mal sa révoltante vérité ? A cheval sur deux siècles, héritier de la critique kantienne et des grands sceptiques français qu’il a lus dans le texte (La Rochefoucauld, Voltaire, Diderot, Lamartine), annonçant aussi bien Baudelaire et Huysmans que Nietzsche (son disciple et prosélyte encombrant), Schopenhauer (1788-1860) arrima sa pensée de l’être et des êtres à l’idée que la vie est songe, et l’homme rêves. Calderón et Shakespeare sont deux de ses auteurs préférés, le remarquable index du Monde comme volonté et représentation en fait foi dans l’édition très attendue que viennent de donner Christian Sommer et la Bibliothèque de La Pléiade. A Frédéric Morin parti l’interroger en Allemagne, un an avant sa mort, pour le compte de la Revue de Paris, le Bouddha de Francfort dit son admiration de notre pays et de sa culture déliée, déniaisée, dessillée, et ne cache pas sa détestation des prêtres laïcs de la bonté universelle : « Son optimisme me fait horreur », confie-t-il à Morin au sujet de Leibniz. Le long XIXe siècle, de Théodule Ribot à Italo Svevo et Tolstoï, a résumé un peu vite Schopenhauer à son contraire, le pessimisme. Ceci expliquant cela, on se contentait d’une lecture aphoristique, fragmentaire, du grand livre où s’absorba, d’une version l’autre, le cheminement du philosophe, hors des cercles de l’Enfer. Puisque la volonté de vivre propre au réel est destructrice par essence, puisque le Monde, en ce qu’il maquille cette évidence, procède d’une fantasmagorie tissée de souffrances, la seule manière d’échapper au néant où nous sommes condamnés à vivre reste la compassion éclairée par la raison, l’enseignement du Christ par la leçon de Platon, ou du Don Giovanni de Mozart par Les Saisons de Poussin. Musique et peinture, en plus du réconfort qu’elles lui apportèrent constamment, aident Schopenhauer à définir les voies de la délivrance, autant que l’orientalisme de son époque. Ne nous le représentons pas, en effet, à l’image des chimères narcotiques du Ring de Wagner, qui l’adulait, et revenons plutôt aux éclairantes conclusions de Christian Sommer. Le « monachisme mondain » de Schopenhauer a plus de parenté avec la sagesse du jésuite espagnol Gracián et le pragmatisme de Chamfort, autre élu lu et relu : « Le bonheur n’est pas chose aisée : il est très difficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs. » SG / Schopenhauer, Le Monde comme volonté et représentation, édition de Christian Sommer avec la collaboration d’Ugo Batini, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 77€, en librairie, le 23 octobre prochain.
Femmes de têtes / femmes de fêtes

Les lettres si coriaces et cocasses de La Palatine, véritable Saint-Simon en jupon, ne laissent qu’un regret, celui de ne pas avoir été écrites en français. Il n’est certes pas complétement absent des missives qu’elle adressait aux siens, là-bas en Allemagne, afin de vider son sac presque quotidien de colères et d’indignations. Contrainte d’épouser le frère de Louis XIV à moins de vingt ans et d’abjurer en secret sa foi, ordres d’un père soucieux de son royaume de papier plus que de sa fille, Charlotte-Elisabeth fut condamnée à l’« enfermement » de la vie de cours, résumait Pierre Gascar, très étanche à l’ancienne monarchie, dans sa préface de 1981 au volume qui reparaît aujourd’hui, sous une couverture dérivée de Pierre Mignard. L’enfant qui nous sourit à gauche est le futur Régent, à qui sa mère voulut en vain épargner l’union, exigée par le roi, d’une de ses bâtardes. Pour être allemande, Madame ne s’insurge pas moins contre toute mésalliance. Il y a de quoi pester, la plume à la main, car elles se multiplient au cours du « règne » de Mme de Maintenon, son ennemie jurée. Le premier Louis XIV s’était entiché de cette princesse sans grâce ni prétention à séduire (voir Hyacinthe Rigaud), chasseuse et diseuse de bons mots ; le vieux monarque s’applique à lui rendre presque odieux Versailles et son ballet de courtisans que la dignité et la morale ne tourmentent guère. Sans s’y réfugier, la Princesse Palatine cultive les beaux-arts et au « bon sens » (Madame de Sévigné) ajoute le « bon goût », indéniable quand elle parle de Corneille ou des Poussin de Denis Moreau, premier valet de chambre du duc de Bourgogne. Le petit musée dont Moreau jouit à Versailles émerveille l’épistolière. Vivantes, spirituelles et brutales, disait Sainte-Beuve, ses lettres ne furent pas que le bûcher des vanités et des intrigues d’un monde qui courait à sa perte. SG / Princesse Palatine, Lettres 1672-1722, Mercure de France, Le Temps retrouvé, 12,50€.

On relit toujours Madame Campan avec le même plaisir, celui qu’elle prit à peindre la France d’avant et après 1789. Son sens de l’anecdote fait mouche, il rappelait Colette et son art de mijoter les petits détails à Jean Chalon, le préfacier amusé et amusant de ce volume de 1988, repris sous une couverture nouvelle. Le succès de cette évocation unique de Marie-Antoinette et de son intimité n’a connu aucune éclipse. Il faut lui rendre son vrai titre : en 1823, sous le règne d’un des frères de Louis XVI, l’ouvrage en trois volumes se présente comme des Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre. L’auteur s’est éteinte un an plus tôt, à un âge respectable, elle avait fait ses premiers pas à la cour sous Louis XV, du haut de ses 15 printemps et forte de l’appui que lui assurent son père et bientôt ses mari et belle-famille. Lectrice de Mesdames, les filles du roi, elle est donc livrée jeune, selon son dire, « à la malignité des courtisans ». Mais la Campan n’est pas La Palatine, elle a connu auprès de Marie-Antoinette, de la Dauphine d’abord, puis de la souveraine, le meilleur de son existence ; et sa fidélité jusqu’à la nuit du 10 août lui vaudra les suffrages émus de ses premiers lecteurs, sous la Restauration, mises à part quelques mauvaises langues suspectant à tort qu’elle ait joué dans l’épisode de Varennes un rôle contraire à sa légende. On lui reprochait surtout d’avoir bénéficié des faveurs de Bonaparte, puis de Napoléon, à l’époque où elle dirigeait, nouvelle Madame de Maintenon, une institution pour jeunes filles. Aux élèves de la maison impériale d’Ecouen, l’ancienne fervente de Marie-Antoinette montrait des robes et des objets qui avaient appartenu à sa chère disparue. Un passage très significatif de ses souvenirs touche à Beaumarchais, il est connu ; on évoque moins ce qu’elle écrit de Carle Van Loo et de Boucher, de leur goût « corrompu » : on ne conçoit pas, souligne-t-elle, en contemporaine de David, que ces bergeries et fables galantes « aient pu être l’objet de l’admiration dans un temps aussi rapproché du siècle de Louis XIV ». Campan avait le verbe net, et la larme économe. SG / Mémoires de Mme Campan. Première femme de chambre de Marie-Antoinette, préface de Jean Chalon, notes de Carlos de Angulo, Mercure de France, Le Temps retrouvé, 12€.
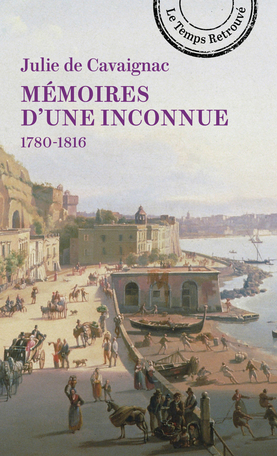
Inconnue, oubliée à tout le moins, Julie Cavaignac (1780-1849) l’était, et le serait restée si le XXIe siècle ne s’était pas intéressé à celle qui fut la mère de deux Cavaignac autrement célèbres, Godefroi le journaliste républicain, fauché en 1845, et Eugène le général, le sabreur de juin 1848. Le gisant du premier, chef-d’œuvre de François Rude, devint une des icônes de la IIIe République, au point que son moulage rejoignit le musée de sculpture comparée en 1889. Cinq ans plus tôt, les Mémoires de Julie étaient exhumées et publiées sans notes ; cette apologie de la France révolutionnaire et impériale n’en avait pas besoin alors ! Elles sont aujourd’hui indispensables, le recul de la culture historique ne cessant de s’aggraver. Honoré Champion, en 2013, confiait à Raymond Trousson le soin d’éclairer l’ancrage politique du texte ; aujourd’hui, la collection du Temps retrouvé en propose une édition annotée par Sandrine Fillipetti. La flamme de 1789 et la haine des Bourbons animent ces pages marquées par le souvenir de Jean-Jacques Rousseau, dont le grand-père maternel de Julie avait été l’ami, et par la disparition précoce de sa fille, déchirure d’où est né le projet de se raconter, et ainsi de raconter les années climatériques ici traversées. Clémente envers la Terreur qu’elle déplore toutefois, l’auteur, quand il s’agit de l’Ancien Régime, s’inscrit dans le sillage avoué des lettres de La Palatine. Versailles se présente à nous comme le lieu du vice et du cynisme les plus répréhensibles. Il y a du rousseauisme dans sa dénonciation virulente de ces « gens-là » et de leurs mœurs. Cela dit, la mémorialiste n’a pas la plume tendre quand elle dépeint la société de son père, créateur du Journal de Paris en 1777, chez qui les écrivains, de La Harpe à Bernardin de Saint-Pierre, les peintres, de Greuze à Vien, et les musiciens, de Grétry à Gossec, fréquentaient. La consolation que Julie trouvait à remonter le temps dans le souvenir de sa fille à jamais chérie ne la portait pas toujours à l’angélisme. SG / Julie Cavaignac, Mémoires d’une inconnue 1780-1816, préface et édition de Sandrine Fillipetti, Mercure de France, Le Temps retrouvé, 11€.

Ecrit-on « pour tout le monde » ? Claude Pichois pensait que Hugo et Colette étaient seuls à y être parvenus, chez nous, sans trahir la littérature par volonté de la distribuer au grand nombre. Certaines images évangéliques hantent involontairement ce genre d’œcuménisme laïc. D’autres diront que Balzac, Molière et La Fontaine, à une hauteur supérieure, ou Dumas père, à un niveau égal, sont parvenus à cette popularité en France. Méfions-nous, du reste, des mirages de la quantité ou de l’immortalité. La jeune Chine, qui semble vouloir nous étonner « en tout », plébiscite aujourd’hui Marguerite Duras aux dépens de La Comédie humaine et des Rougon-Macquart, respectés davantage des générations précédentes, biberonnées au réalisme ! Les temps changent, dit la chanson. Et on se demande, à observer les succès de librairie ou la rumeur médiatique, si Colette n’est pas menacée d’avoir à remettre bientôt son sceptre à d’autres représentantes du beau sexe, moins géniales qu’elles, mais plus conformes. Tant que son trône ne tangue pas trop, rendons-nous à la Bibliothèque nationale, qui la reçoit avec l’éclat dont Baudelaire et Proust, deux écrivains chers à son cœur, ont récemment bénéficié. Murs et vitrines explorent « ses mondes » avec l’ambition généreuse, et réalisée, de ne rien écarter de cet « Amor mundi », si puissant qu’il résiste aux souffrances courantes et ne désespère jamais des plaisirs, des plus humbles aux plus risqués. Colette goûta à tout ce qui bouillonnait en elle, saphisme compris, et donna à sa littérature de la sensation ce mélange d’hédonisme et de libertinage très français, qu’on blesse à vouloir lui faire chausser les gros souliers de l’anti-masculinité. Certains des propos qu’accréditeraient ces livres, même Le Pur et l’impur, l’eussent heurtée, précisément en raison de son amour de l’être, ce donné inconditionnel, et des êtres, ce don du Ciel. Un très bon point : les tableaux qui se glissent au milieu des cahiers de Claudine et des photographies très posées de la fille de Sido, tableaux du cher Blanche, mais aussi, plus rares, d’Eugène Pascau, Jacqueline Marval ou Emilie Charmy. Ajoutez à cela Christian Bérard et Cocteau, quelques feuilles de Matisse ivres de danse, et le tour est joué. Un tour du monde. SG / Emilie Bouvard, Julien Dimerman et Laurence Le Bras (dir.), Les Mondes de Colette, Gallimard / Bibliothèque nationale de France, 35€.
Justice de Dieu, justice des hommes

Au théâtre, tout est permis, comme d’inverser l’ordre des choses ou d’étriller certains garants de la paix sociale. Dans la pièce de Jean-Marie Rouart, qu’on a lue avant l’été et qui a gagné les planches sur les hauteurs de Passy, le monstre, c’est l’homme de loi, le juge couvert d’hermine, devant qui on tremble ou se prosterne, famille, collègues, flics, sdf, tous vassalisés. Quand le rideau se lève, notre juge suprême tente de calmer une impatience très palpable en jouant aux cartes. Elles ne lui sont pas favorables. Mauvais présage ? La promotion qu’il brigue, rien moins que d’accéder à la cour de cassation, le nec plus ultra de l’institution judiciaire, doit lui être annoncée aujourd’hui. Le téléphone rouge à ses côtés va sonner, c’est sûr, et le délivrer des angoisses d’une interminable attente. Lui dont la vie n’a été consacrée qu’à satisfaire sa soif d’honneurs ne fut que déshonneur, trafic d’influences et bienveillances louches envers le monde politique, cet ingrat. L’heure des dividendes ultimes serait-elle arrivée ? Quelques scènes au galop suffisent à édifier le public qui rit noir. Il fait bientôt connaissance avec Madame, probe, mais servile, et ses enfants, deux beaux cas d’indifférence crasse à ce qui n’est pas leur bon plaisir. Au fond, ils ressemblent à leur père au-delà de l’hédonisme décérébré des adolescents et de la frustration sexuelle qui les coupent eux aussi de leurs inférieurs, jusqu’à un certain degré au moins. Un crime a lieu, sous les fenêtres de cette famille unie dans le mal et la dissimulation, une fillette de sept ans en est la victime. Qui paiera ? Mieux vaut une injustice qu’un désordre, proclame le tyran familial, l’homme en rouge sang. Les langues peuvent se délier, Rouart est à l’écoute. SG / Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, Drôle de justice, Théâtre de Passy, 92 rue de Passy, mise en scène de Daniel Colas, avec Daniel Russo, Florence Darel, Thibaut de Lussy, Baptiste Gonthier, Julie Savard et Eliott Cren.
En librairie depuis le 3 octobre 2025 !