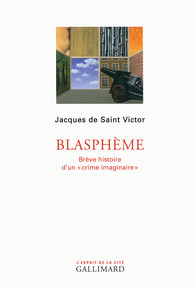La rue a donc parlé. Casseurs de vitres et casseurs de flics nous auraient soudain ramenés à l’époque, voilà un siècle, où socialistes, communistes, anarchistes et fascistes s’entretuaient dans une Italie qui sortait à peine des épreuves de la guerre de 14. En mai 1968, cherchant des excuses à ses origines bourgeoises et son aspiration au plaisir, l’ardeur estudiantine s’était donné un programme politique. Nos insurgés aux méthodes dures s’agitent eux dans les limbes de fausses espérances ou, pire, de fallacieux prétextes. La manif n’est plus alors qu’hubris autorisée. Puisque les médias s’amusent à comparer l’incomparable, ou idéalisent le rebelle en pronostiquant le retour du fascisme, mieux vaut revenir à la vérité des années 20-30, quand la révolution, rouge ou noire, restait un horizon possible.
La rue a donc parlé. Casseurs de vitres et casseurs de flics nous auraient soudain ramenés à l’époque, voilà un siècle, où socialistes, communistes, anarchistes et fascistes s’entretuaient dans une Italie qui sortait à peine des épreuves de la guerre de 14. En mai 1968, cherchant des excuses à ses origines bourgeoises et son aspiration au plaisir, l’ardeur estudiantine s’était donné un programme politique. Nos insurgés aux méthodes dures s’agitent eux dans les limbes de fausses espérances ou, pire, de fallacieux prétextes. La manif n’est plus alors qu’hubris autorisée. Puisque les médias s’amusent à comparer l’incomparable, ou idéalisent le rebelle en pronostiquant le retour du fascisme, mieux vaut revenir à la vérité des années 20-30, quand la révolution, rouge ou noire, restait un horizon possible.
 Deux événements majeurs, on le sait, en furent les mauvaises fées, la révolution de 1917, dont on imagine Poutine préparer le bicentenaire, et le solde monstrueux des tranchées. Après avoir connu le feu et reçu quelques blessures méritoires, Mussolini ne s’y était pas trompé : « La guerre a été révolutionnaire, car elle a noyé, dans un fleuve de sang, le siècle de la démocratie, le siècle du nombre, de la majorité, de la quantité. » L’Europe postrévolutionnaire avait failli en se suicidant, Benito et les siens n’en démordraient plus… Sur ces ruines, le nationalisme pouvait seul reconstruire un état durable et digne de son passé, mais un nationalisme régénéré par la discipline militaire et une vaste redistribution sociale. Raisonnement typique de la « génération perdue », en ce qu’il mêle constat indéniable et dangereuse utopie, l’idéal d’acier des fascistes italiens parut inacceptable, à plus d’un, dans l’Europe du traité de Versailles… C’était le cas de Romain Rolland et de Stefan Zweig, chez qui l’horreur de la guerre avait pourtant ébranlé le pacifisme foncier, et son règlement maladroit accru très vite l’inquiétude de nouveaux cataclysmes. Leur correspondance, qui continue à nous éblouir volume après volume, respire l’air du temps avec une largeur de vue et un souffle littéraire peu communs. L’intelligence et l’art, il n’est pas d’alternative au naufrage de 14-18, et de meilleure réponse à ce qui gagne l’Europe saignée, mutilée et redécoupée en fonction d’une ligne démocratique aux chances précaires. Romain Rolland doute de cette nouvelle Europe, demande des leçons de sagesse à l’Inde de son cher Gandhi et se tourne vers un ordre international dominé par les USA et bientôt l’URSS, aussi réfractaire soit-il à « l’idole moscovite » et à la terreur communiste. Zweig, lui, se cramponne à l’espoir de voir refleurir l’âge d’or de l’ancien Empire austro-hongrois. Il faut avoir le cœur bien accroché, toutefois, pour ne pas flancher. Car le succès de ses géniales nouvelles et biographies, d’Allemagne et de France en Russie, ne l’aveugle pas sur les « courants de folie », noirs et rouges, qui fragilisent déjà la reconstruction européenne, sous l’égide de la SDN et l’impulsion des accords de Locarno. Zweig a les yeux bien ouverts, et la plume intraitable des républicains de 1789, son horizon indépassé. Sur le renouveau nationaliste, l’antisémitisme bavarois sous la poussée nazie dès 1923, sur les profits que tire la stratégie stalinienne de l’antifascisme relayé par L’Humanité ou la revue Clarté d’Henri Barbusse, et sur le milieu artistique tenté à son tour par l’anathème et le délire en chambre, c’est le Juif autrichien au-dessus des communautés et des nations qui a raison, c’est l’émule de Freud et le fou de Balzac qui se montre le plus mordant. Sa défiance des dérives dadaïstes, « anarcho-snobisme » que Rolland épingle aussi, égale son aversion pour les rouges aux yeux doux : « J’apprécie l’antifascisme mais ce n’est pas Barbusse qui doit organiser cela, lui, l’homme de parti, qui jamais ne donnerait une signature pour une protestation contre une violence bolchevique. » Dont acte.
Deux événements majeurs, on le sait, en furent les mauvaises fées, la révolution de 1917, dont on imagine Poutine préparer le bicentenaire, et le solde monstrueux des tranchées. Après avoir connu le feu et reçu quelques blessures méritoires, Mussolini ne s’y était pas trompé : « La guerre a été révolutionnaire, car elle a noyé, dans un fleuve de sang, le siècle de la démocratie, le siècle du nombre, de la majorité, de la quantité. » L’Europe postrévolutionnaire avait failli en se suicidant, Benito et les siens n’en démordraient plus… Sur ces ruines, le nationalisme pouvait seul reconstruire un état durable et digne de son passé, mais un nationalisme régénéré par la discipline militaire et une vaste redistribution sociale. Raisonnement typique de la « génération perdue », en ce qu’il mêle constat indéniable et dangereuse utopie, l’idéal d’acier des fascistes italiens parut inacceptable, à plus d’un, dans l’Europe du traité de Versailles… C’était le cas de Romain Rolland et de Stefan Zweig, chez qui l’horreur de la guerre avait pourtant ébranlé le pacifisme foncier, et son règlement maladroit accru très vite l’inquiétude de nouveaux cataclysmes. Leur correspondance, qui continue à nous éblouir volume après volume, respire l’air du temps avec une largeur de vue et un souffle littéraire peu communs. L’intelligence et l’art, il n’est pas d’alternative au naufrage de 14-18, et de meilleure réponse à ce qui gagne l’Europe saignée, mutilée et redécoupée en fonction d’une ligne démocratique aux chances précaires. Romain Rolland doute de cette nouvelle Europe, demande des leçons de sagesse à l’Inde de son cher Gandhi et se tourne vers un ordre international dominé par les USA et bientôt l’URSS, aussi réfractaire soit-il à « l’idole moscovite » et à la terreur communiste. Zweig, lui, se cramponne à l’espoir de voir refleurir l’âge d’or de l’ancien Empire austro-hongrois. Il faut avoir le cœur bien accroché, toutefois, pour ne pas flancher. Car le succès de ses géniales nouvelles et biographies, d’Allemagne et de France en Russie, ne l’aveugle pas sur les « courants de folie », noirs et rouges, qui fragilisent déjà la reconstruction européenne, sous l’égide de la SDN et l’impulsion des accords de Locarno. Zweig a les yeux bien ouverts, et la plume intraitable des républicains de 1789, son horizon indépassé. Sur le renouveau nationaliste, l’antisémitisme bavarois sous la poussée nazie dès 1923, sur les profits que tire la stratégie stalinienne de l’antifascisme relayé par L’Humanité ou la revue Clarté d’Henri Barbusse, et sur le milieu artistique tenté à son tour par l’anathème et le délire en chambre, c’est le Juif autrichien au-dessus des communautés et des nations qui a raison, c’est l’émule de Freud et le fou de Balzac qui se montre le plus mordant. Sa défiance des dérives dadaïstes, « anarcho-snobisme » que Rolland épingle aussi, égale son aversion pour les rouges aux yeux doux : « J’apprécie l’antifascisme mais ce n’est pas Barbusse qui doit organiser cela, lui, l’homme de parti, qui jamais ne donnerait une signature pour une protestation contre une violence bolchevique. » Dont acte.
 Obsédés par le destin d’une Allemagne brisée, les faiblesses de la République de Weimar (qui a pourtant vaincu l’inflation) et le pangermisme nazi, Rolland et Zweig n’en sont pas moins très attentifs à l’autre révolution nationaliste, la première même de l’après-guerre, celle des squadristi à chemise noire. Le 20 juin 1924, quelques jours après l’assassinat du secrétaire général du PSI, Zweig s’émeut de l’indifférence de l’opinion publique envers Matteotti, froidement liquidé par les phalangistes. Deux ans plus tard, l’instauration des lois fascistes, qui réduisent au silence les ennemis du Duce et condamnent à l’exil certains de leurs amis, révolte l’attachement viscéral des deux écrivains aux « libertés publiques ». Que penser aujourd’hui de l’« abjecte terreur noire » (Rolland) dont l’Italie du pauvre Victor-Emmanuel III fut l’otage plus ou moins docile ? Que penser des exactions sanglantes et des bravades continuelles qui permirent à Mussolini et aux siens de prendre le pouvoir, contre toute attente, à l’issue de la fameuse « marche sur Rome » d’octobre 1922 ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles le livre efficace d’Emilio Gentile répond en croisant les sources et en montrant ce que la logique insurrectionnelle des fascistes italiens doit au « régime de violence » qui intéresse tant les historiens des années 1920 (voir ici ce que disent Maurizio Serra et Guillaume Payen de la virulence guerrière des intellectuels et artistes du temps). L’impôt du sang, le souvenir de la défaite de Caporetto et la solidarité des combattants pesèrent, au lendemain de l’armistice, autant que le sentiment de voir l’Italie frustrée des fruits de sa victoire… Mais la vigueur martiale des milices nationalistes, et bientôt fascistes, fut loin d’être la seule à éclater en 1920-1921. Emilio Gentile brosse un tableau saisissant des baronnies rouges, ces régions sous contrôle socialiste et communiste, et des manifestations de force, en tous sens, dont « les amis du peuple » furent aussi les chantres affichés. De cette guerre civile occultée par la mémoire nationale (et le politiquement correct), nous ignorions le lourd bilan et l’impact. C’est la peur de « l’engouement bolchevique », dont il joue en maître, qui portera en grande partie Mussolini à la tête du gouvernement et lui ouvrira le cœur du patronat comme de la reine mère. L’État libéral, en dépit sa légende, noire elle aussi, résista d’abord à la fronde fasciste et lui tint même tête lors de la fameuse « marche de Rome », dont Mussolini fut loin d’être le principal instigateur. Il en fut, par contre, le principal vainqueur, avec la bénédiction du roi et de l’Église qu’il avait, en bon paysan, roulés dans la farine.
Obsédés par le destin d’une Allemagne brisée, les faiblesses de la République de Weimar (qui a pourtant vaincu l’inflation) et le pangermisme nazi, Rolland et Zweig n’en sont pas moins très attentifs à l’autre révolution nationaliste, la première même de l’après-guerre, celle des squadristi à chemise noire. Le 20 juin 1924, quelques jours après l’assassinat du secrétaire général du PSI, Zweig s’émeut de l’indifférence de l’opinion publique envers Matteotti, froidement liquidé par les phalangistes. Deux ans plus tard, l’instauration des lois fascistes, qui réduisent au silence les ennemis du Duce et condamnent à l’exil certains de leurs amis, révolte l’attachement viscéral des deux écrivains aux « libertés publiques ». Que penser aujourd’hui de l’« abjecte terreur noire » (Rolland) dont l’Italie du pauvre Victor-Emmanuel III fut l’otage plus ou moins docile ? Que penser des exactions sanglantes et des bravades continuelles qui permirent à Mussolini et aux siens de prendre le pouvoir, contre toute attente, à l’issue de la fameuse « marche sur Rome » d’octobre 1922 ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles le livre efficace d’Emilio Gentile répond en croisant les sources et en montrant ce que la logique insurrectionnelle des fascistes italiens doit au « régime de violence » qui intéresse tant les historiens des années 1920 (voir ici ce que disent Maurizio Serra et Guillaume Payen de la virulence guerrière des intellectuels et artistes du temps). L’impôt du sang, le souvenir de la défaite de Caporetto et la solidarité des combattants pesèrent, au lendemain de l’armistice, autant que le sentiment de voir l’Italie frustrée des fruits de sa victoire… Mais la vigueur martiale des milices nationalistes, et bientôt fascistes, fut loin d’être la seule à éclater en 1920-1921. Emilio Gentile brosse un tableau saisissant des baronnies rouges, ces régions sous contrôle socialiste et communiste, et des manifestations de force, en tous sens, dont « les amis du peuple » furent aussi les chantres affichés. De cette guerre civile occultée par la mémoire nationale (et le politiquement correct), nous ignorions le lourd bilan et l’impact. C’est la peur de « l’engouement bolchevique », dont il joue en maître, qui portera en grande partie Mussolini à la tête du gouvernement et lui ouvrira le cœur du patronat comme de la reine mère. L’État libéral, en dépit sa légende, noire elle aussi, résista d’abord à la fronde fasciste et lui tint même tête lors de la fameuse « marche de Rome », dont Mussolini fut loin d’être le principal instigateur. Il en fut, par contre, le principal vainqueur, avec la bénédiction du roi et de l’Église qu’il avait, en bon paysan, roulés dans la farine.
 Ce fut son mot, plus tard, lorsque les besoins de sa propre légende le forcèrent à s’approprier le mérite du coup d’octobre 1922… Comment imaginer qu’il en eût été autrement ? Son charisme en dépendait. Benito avait été physiquement engagé dans chacune des étapes de son parcours providentiel, nul ne devait en douter : le corps du Duce, ainsi que l’analyse le brillant Sergio Luzzatto, le magnétisme qu’il exerce sur les femmes et les hommes, est la « clef du consensus populaire » dont il bénéficia jusqu’au début des années 1940. Dans cette tête à silhouette d’obus, dans cette force ramassée, qui sentait sa Romagne natale, le régime avait trouvé son plus sûr symbole, et le signe de sa durée. Durer, ne jamais hypothéquer l’avenir, tels avaient été les messages adressés aux foules enamourées en 1926, à l’occasion des cérémonies d’anniversaire de « la marche sur Rome ». Jusqu’à son arrestation, le 25 juillet 1943, Mussolini cultiva ainsi son image de dictateur indestructible comme son bien le plus précieux, avec l’appui, certes, d’une propagande efficiente, mais qui se fit plus discrète quand il apparut aux Italiens que la politique de l’Axe signifiait de nouvelles privations et proscriptions, et la mort de ses fils, envoyés sur le stupide front russe. Mais tant que le Duce resta le Duce, ses ennemis n’eurent de cesse d’attenter à sa vie ou, à défaut, au mythe de sa santé miraculeuse. En 1926, le doux Romain Rolland se félicite que notre tyran vive dans une peur constante… On sait que Mussolini fit piètre figure lors de sa mise aux arrêts, avant que les paras d’Hitler ne le remissent en selle. Il fut longtemps admis qu’il s’était comporté de façon plus lamentable encore lorsque les partisans communistes, mettant un point final à la République de Salò, lui firent enfin la peau. « Visez le cœur », lança-t-il. Ce dernier mot, héroïque, rachetait un peu sa fuite calamiteuse, mais il sera tenu secret par ses juges expéditifs. Il fallait que Mussolini fût mort en lâche, il fallait qu’il disparût, corps et âme, de la dévotion, déjà ébréchée, des Italiens. Ce qu’il advint du cadavre du Duce, et de celui de Clara Petacci, son ultime maîtresse, lorsqu’ils furent livrés à la sauvagerie des Milanais, est trop connu pour être redit. Luzzatto a raison d’y insister, ce vent de barbarie collective ne concerna qu’un petit nombre d’individus. S’annonçait déjà le destin posthume de Benito dont le corps éteint allait être un des enjeux symboliques des années 1946-1957, du vol de sa dépouille à son inhumation, en passant par la longue éclipse durant laquelle le gouvernement italien, confronté à l’ardeur retrouvée des néo-fascistes, cacha les restes du Duce dans un couvent franciscain. Cette épopée rocambolesque attendait Luzzatto et son talent de conteur pour faire vraiment sens. Mais son livre apporte aussi une contribution majeure à notre relecture de la seconde après-guerre, trop souvent réduite à la tragédie de la Shoah et à la morale édifiante de la Résistance. De même qu’on ne saurait expliquer la naissance du fascisme italien en dehors du contexte de la terreur rouge des années 1919-1921, on ne peut plus désormais fermer les yeux sur les ambiguïtés de l’autre « guerre civile », celle dont l’Occupation allemande fut le théâtre, de part et d’autre des Alpes. Stéphane Guégan
Ce fut son mot, plus tard, lorsque les besoins de sa propre légende le forcèrent à s’approprier le mérite du coup d’octobre 1922… Comment imaginer qu’il en eût été autrement ? Son charisme en dépendait. Benito avait été physiquement engagé dans chacune des étapes de son parcours providentiel, nul ne devait en douter : le corps du Duce, ainsi que l’analyse le brillant Sergio Luzzatto, le magnétisme qu’il exerce sur les femmes et les hommes, est la « clef du consensus populaire » dont il bénéficia jusqu’au début des années 1940. Dans cette tête à silhouette d’obus, dans cette force ramassée, qui sentait sa Romagne natale, le régime avait trouvé son plus sûr symbole, et le signe de sa durée. Durer, ne jamais hypothéquer l’avenir, tels avaient été les messages adressés aux foules enamourées en 1926, à l’occasion des cérémonies d’anniversaire de « la marche sur Rome ». Jusqu’à son arrestation, le 25 juillet 1943, Mussolini cultiva ainsi son image de dictateur indestructible comme son bien le plus précieux, avec l’appui, certes, d’une propagande efficiente, mais qui se fit plus discrète quand il apparut aux Italiens que la politique de l’Axe signifiait de nouvelles privations et proscriptions, et la mort de ses fils, envoyés sur le stupide front russe. Mais tant que le Duce resta le Duce, ses ennemis n’eurent de cesse d’attenter à sa vie ou, à défaut, au mythe de sa santé miraculeuse. En 1926, le doux Romain Rolland se félicite que notre tyran vive dans une peur constante… On sait que Mussolini fit piètre figure lors de sa mise aux arrêts, avant que les paras d’Hitler ne le remissent en selle. Il fut longtemps admis qu’il s’était comporté de façon plus lamentable encore lorsque les partisans communistes, mettant un point final à la République de Salò, lui firent enfin la peau. « Visez le cœur », lança-t-il. Ce dernier mot, héroïque, rachetait un peu sa fuite calamiteuse, mais il sera tenu secret par ses juges expéditifs. Il fallait que Mussolini fût mort en lâche, il fallait qu’il disparût, corps et âme, de la dévotion, déjà ébréchée, des Italiens. Ce qu’il advint du cadavre du Duce, et de celui de Clara Petacci, son ultime maîtresse, lorsqu’ils furent livrés à la sauvagerie des Milanais, est trop connu pour être redit. Luzzatto a raison d’y insister, ce vent de barbarie collective ne concerna qu’un petit nombre d’individus. S’annonçait déjà le destin posthume de Benito dont le corps éteint allait être un des enjeux symboliques des années 1946-1957, du vol de sa dépouille à son inhumation, en passant par la longue éclipse durant laquelle le gouvernement italien, confronté à l’ardeur retrouvée des néo-fascistes, cacha les restes du Duce dans un couvent franciscain. Cette épopée rocambolesque attendait Luzzatto et son talent de conteur pour faire vraiment sens. Mais son livre apporte aussi une contribution majeure à notre relecture de la seconde après-guerre, trop souvent réduite à la tragédie de la Shoah et à la morale édifiante de la Résistance. De même qu’on ne saurait expliquer la naissance du fascisme italien en dehors du contexte de la terreur rouge des années 1919-1921, on ne peut plus désormais fermer les yeux sur les ambiguïtés de l’autre « guerre civile », celle dont l’Occupation allemande fut le théâtre, de part et d’autre des Alpes. Stéphane Guégan
 *Romain Rolland et Stefan Zweig, Correspondance 1920-1927, préface et édition de Jean-Yves Brancy, Albin Michel, 32€. // La collection Folio Essais (voir couverture plus haut) accueille désormais le dernier chef-d’œuvre de Zweig, Le Monde d’hier (Gallimard, NRF Essais, 7,70€), dernier mais qui fut écrit, à New York, essentiellement en 1941, avant que son auteur ne décide de se tuer. Le suicide d’avril 1942, dont les causes dépassent les circonstances de l’exil et de l’antisémitisme qui l’avait chassé de son Autriche natale, jette encore une ombre crépusculaire sur ce qui ne le fut pas : long et heureux voyage à maints égards, la vie de Zweig ne fut pas cette suite de naufrages qu’une lecture superficielle du Monde d’hier donne à croire. S’il n’y parle pas des femmes qu’il aura aimées, par une sorte de pudeur dont il s’explique, notre nomade de la curiosité, notre polyglotte pétri de cultures comme l’élite juive de Vienne, se méfie de sa propre nostalgie pour l’empire austro-hongrois d’avant 14. La guerre marque bien la sortie du Paradis. Mais ce proche de Freud connaît les pièges de la mémoire des « temps enfuis ». Hannah Arendt aura tort de lui reprocher, en 1943, d’avoir trop idéalisé le cosmopolitisme, la tolérance ethnique et religieuse de l’ancienne Autriche. Écrivain génial, forçant dates et faits dans cette fausse autobiographie, Zweig polit son portrait du vieil Empire, sans l’édulcorer complètement, pour mieux crucifier l’Allemagne d’Hitler et de l’Anschluss. Nous n’avons pas pu, nous intellectuels, nous fiers humanistes, nous créateurs libres, européens et pacifistes, garder en vie ce miracle qu’était la Vienne de Mahler, Hofmannsthal, Klimt… C’était le sens de l’exposition décisive de Jean Clair, en 1986, Vienne 1880-1938. L’Apocalypse joyeuse, qui donna lieu à une série de méprises méprisables ! La nostalgie stimule donc le regard que Zweig porte le monde né de la guerre, et s’y jetant à nouveau. Les pages mi-politiques, mi-freudiennes sur le nationalisme allemand, hitlérien ou pas, sont justement célèbres. Mais il faut relire ses évocations de Paris, ses rues, cafés et écrivains, contrepoint lumineux baigné d’un discret érotisme. Le traducteur de Baudelaire y avait trouvé une de ses patries spirituelles, existentielles. Il faut enfin méditer la longue séquence qu’il consacre à Mussolini, au Mussolini d’avant l’Axe et les lois raciales, un Mussolini admirateur de Zweig et capable de faire une fleur au « citoyen du monde« . SG
*Romain Rolland et Stefan Zweig, Correspondance 1920-1927, préface et édition de Jean-Yves Brancy, Albin Michel, 32€. // La collection Folio Essais (voir couverture plus haut) accueille désormais le dernier chef-d’œuvre de Zweig, Le Monde d’hier (Gallimard, NRF Essais, 7,70€), dernier mais qui fut écrit, à New York, essentiellement en 1941, avant que son auteur ne décide de se tuer. Le suicide d’avril 1942, dont les causes dépassent les circonstances de l’exil et de l’antisémitisme qui l’avait chassé de son Autriche natale, jette encore une ombre crépusculaire sur ce qui ne le fut pas : long et heureux voyage à maints égards, la vie de Zweig ne fut pas cette suite de naufrages qu’une lecture superficielle du Monde d’hier donne à croire. S’il n’y parle pas des femmes qu’il aura aimées, par une sorte de pudeur dont il s’explique, notre nomade de la curiosité, notre polyglotte pétri de cultures comme l’élite juive de Vienne, se méfie de sa propre nostalgie pour l’empire austro-hongrois d’avant 14. La guerre marque bien la sortie du Paradis. Mais ce proche de Freud connaît les pièges de la mémoire des « temps enfuis ». Hannah Arendt aura tort de lui reprocher, en 1943, d’avoir trop idéalisé le cosmopolitisme, la tolérance ethnique et religieuse de l’ancienne Autriche. Écrivain génial, forçant dates et faits dans cette fausse autobiographie, Zweig polit son portrait du vieil Empire, sans l’édulcorer complètement, pour mieux crucifier l’Allemagne d’Hitler et de l’Anschluss. Nous n’avons pas pu, nous intellectuels, nous fiers humanistes, nous créateurs libres, européens et pacifistes, garder en vie ce miracle qu’était la Vienne de Mahler, Hofmannsthal, Klimt… C’était le sens de l’exposition décisive de Jean Clair, en 1986, Vienne 1880-1938. L’Apocalypse joyeuse, qui donna lieu à une série de méprises méprisables ! La nostalgie stimule donc le regard que Zweig porte le monde né de la guerre, et s’y jetant à nouveau. Les pages mi-politiques, mi-freudiennes sur le nationalisme allemand, hitlérien ou pas, sont justement célèbres. Mais il faut relire ses évocations de Paris, ses rues, cafés et écrivains, contrepoint lumineux baigné d’un discret érotisme. Le traducteur de Baudelaire y avait trouvé une de ses patries spirituelles, existentielles. Il faut enfin méditer la longue séquence qu’il consacre à Mussolini, au Mussolini d’avant l’Axe et les lois raciales, un Mussolini admirateur de Zweig et capable de faire une fleur au « citoyen du monde« . SG
**Emilio Gentile, Soudain, le fascisme. La marche sur Rome, l’autre révolution d’octobre, Gallimard, NRF Essais, 29€
***Sergio Luzzatto, Le Corps du Duce. Essai de sortie du fascisme, Gallimard, NRF Essais, 28€