A moins d’être hantée, une collection d’art reste imparfaite. Amasser les chefs-d’œuvre ne suffit pas, encore faut-il les faire vivre ensemble, les frotter à plus modestes qu’eux et doter le tout d’une présence toujours surprenante : le vrai collectionneur assume son âme de sorcier avec une sorte de ferveur inquiète, s’entoure de fantômes familiers et varie leur emplacement dès que revient le besoin d’en réveiller le mystère. Il y a de l’alchimiste qui ne s’ignore pas chez les amants de la beauté. Doucet et Yves Saint Laurent furent de tels magiciens. Une exposition unique les réunit et nous le confirme.
 Jérôme Neutres est ici dans son élément. De Marcel Proust et Jacques-Emile Blanche, passions du commissaire, à Jacques Doucet (1853-1929), le chemin mène tout droit, les lecteurs de La Recherche le savent. Nous voici confrontés au destin romanesque d’un couturier de la Belle Epoque, féru de littérature et de Chine, qui commença par collectionner comme son grand-père, selon son mot, avant d’inventer le goût des petits-enfants qu’il n’eut pas. Quelles sont les intimes motivations et les secrètes divinations qui poussent un même homme à vendre en 1912 ses trésors du XVIIIe siècle et à s’enticher de Brancusi, Modigliani, Matisse, Picabia, Duchamp et Masson, jusqu’à acheter, douze ans plus tard, Les Demoiselles d’Avignon et en faire la pièce maîtresse du fameux pavillon de la rue Saint-James, à Neuilly, meublé de tout ce que l’Art déco compte alors de gloires futures? Doucet, amusé et intrigué par l’audace des « jeunes », précède toujours le mouvement, au point que son Picasso insigne, boudé par l’administration française, rejoindra le MoMA en 1929. No comment… Ce n’était pas faute d’avoir souhaité qu’il en fût autrement. André Breton, l’un de ses conseillers au sortir de la guerre de 14, lui avait fait acheter les Demoiselles parce qu’il fallait maintenir, à tout prix, sur le sol français, l’étendard du mouvement moderne et la toile qui résumait leur besoin commun d’altérité radicale. Pour Doucet, Breton et Picasso, la peinture doit avoir de l’esprit, elle doit même convoquer les esprits, parler de haut et de loin. Il en découlait aussi l’impératif d’une présentation habitée, animée, finement tressée, l’inverse de celle des musées.
Jérôme Neutres est ici dans son élément. De Marcel Proust et Jacques-Emile Blanche, passions du commissaire, à Jacques Doucet (1853-1929), le chemin mène tout droit, les lecteurs de La Recherche le savent. Nous voici confrontés au destin romanesque d’un couturier de la Belle Epoque, féru de littérature et de Chine, qui commença par collectionner comme son grand-père, selon son mot, avant d’inventer le goût des petits-enfants qu’il n’eut pas. Quelles sont les intimes motivations et les secrètes divinations qui poussent un même homme à vendre en 1912 ses trésors du XVIIIe siècle et à s’enticher de Brancusi, Modigliani, Matisse, Picabia, Duchamp et Masson, jusqu’à acheter, douze ans plus tard, Les Demoiselles d’Avignon et en faire la pièce maîtresse du fameux pavillon de la rue Saint-James, à Neuilly, meublé de tout ce que l’Art déco compte alors de gloires futures? Doucet, amusé et intrigué par l’audace des « jeunes », précède toujours le mouvement, au point que son Picasso insigne, boudé par l’administration française, rejoindra le MoMA en 1929. No comment… Ce n’était pas faute d’avoir souhaité qu’il en fût autrement. André Breton, l’un de ses conseillers au sortir de la guerre de 14, lui avait fait acheter les Demoiselles parce qu’il fallait maintenir, à tout prix, sur le sol français, l’étendard du mouvement moderne et la toile qui résumait leur besoin commun d’altérité radicale. Pour Doucet, Breton et Picasso, la peinture doit avoir de l’esprit, elle doit même convoquer les esprits, parler de haut et de loin. Il en découlait aussi l’impératif d’une présentation habitée, animée, finement tressée, l’inverse de celle des musées.
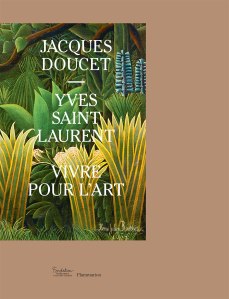 Saisissant, à chaque pas, est le parcours de la fondation Bergé, qui débute sous l’œil du grand Bouddha de Doucet et d’un mur entier de Picasso : Rêverie et Couple, tous deux de 1904, ont conservé les cadres du collectionneur, note de luxe jetée sur l’ambiguïté bleue et brune de ces confessions de jeunesse fortement sexuées. Au centre, L’Homme à la guitare, l’un des chefs-d’œuvre de 1912, frétille d’harmonieuses brisures visuelles. Avant l’achat un peu fou des Demoiselles, Doucet fit sagement l’acquisition de Table, rareté suisse et comble de la synecdoque cubiste ou nègre. A Neuilly, du reste, le cabinet oriental faisait écho à tous les exotismes de l’entre-deux-guerres. Ces liens invisibles ont été retissés, et la Charmeuse de serpent du douanier Rousseau a retrouvé sa place au-dessus du Sofa africain de Marcel Coard, prêt insigne du Virginia Museum of Fine arts. Vitrine de l’Art Déco, meubles et encadrements d’Eileen Gray ou de Pierre Legrain, tapis de Ruhlmann et reliures de Rose Adler, le studio Saint-James se laisse rapidement envoûter par le surréalisme, du précurseur Chirico au catalan Miro. Après 1917, on vit aussi Doucet financer les revues d’avant-garde, de Nord/Sud à Littérature, et faire entrer dans sa fameuse bibliothèque aussi bien Apollinaire, Reverdy, Max Jacob que les nouveaux agités du freudisme à la mode, Breton et Aragon. Ce dernier, la duplicité même, ne ménage pas son protecteur dans sa correspondance intime. La chose vint aux oreilles de Doucet. Il fallut toute la diplomatie de Drieu pour recoller les morceaux. Ne devait-on pas pardonner aux « enfants sublimes » de vivre dans l’absolu, puisque les maîtres du relatif n’y accédaient que sur leurs ailes ? « Les rois sages ont toujours nourri les moines fous. »
Saisissant, à chaque pas, est le parcours de la fondation Bergé, qui débute sous l’œil du grand Bouddha de Doucet et d’un mur entier de Picasso : Rêverie et Couple, tous deux de 1904, ont conservé les cadres du collectionneur, note de luxe jetée sur l’ambiguïté bleue et brune de ces confessions de jeunesse fortement sexuées. Au centre, L’Homme à la guitare, l’un des chefs-d’œuvre de 1912, frétille d’harmonieuses brisures visuelles. Avant l’achat un peu fou des Demoiselles, Doucet fit sagement l’acquisition de Table, rareté suisse et comble de la synecdoque cubiste ou nègre. A Neuilly, du reste, le cabinet oriental faisait écho à tous les exotismes de l’entre-deux-guerres. Ces liens invisibles ont été retissés, et la Charmeuse de serpent du douanier Rousseau a retrouvé sa place au-dessus du Sofa africain de Marcel Coard, prêt insigne du Virginia Museum of Fine arts. Vitrine de l’Art Déco, meubles et encadrements d’Eileen Gray ou de Pierre Legrain, tapis de Ruhlmann et reliures de Rose Adler, le studio Saint-James se laisse rapidement envoûter par le surréalisme, du précurseur Chirico au catalan Miro. Après 1917, on vit aussi Doucet financer les revues d’avant-garde, de Nord/Sud à Littérature, et faire entrer dans sa fameuse bibliothèque aussi bien Apollinaire, Reverdy, Max Jacob que les nouveaux agités du freudisme à la mode, Breton et Aragon. Ce dernier, la duplicité même, ne ménage pas son protecteur dans sa correspondance intime. La chose vint aux oreilles de Doucet. Il fallut toute la diplomatie de Drieu pour recoller les morceaux. Ne devait-on pas pardonner aux « enfants sublimes » de vivre dans l’absolu, puisque les maîtres du relatif n’y accédaient que sur leurs ailes ? « Les rois sages ont toujours nourri les moines fous. »
 On pense à cette fusée de Drieu devant la grande tenture de Burne-Jones, qui montre Melchior, Balthazar et Gaspard venus s’agenouiller aux pieds du Sauveur. Avant de rejoindre Orsay, grâce au don de Pierre Bergé, elle avait longtemps orné la sobre bibliothèque d’Yves Saint Laurent, rue de Babylone. D’une tout autre munificence brillait naturellement le grand salon du grand couturier, qu’évoque le second moment de l’exposition dans l’éclat rocaille des miroirs de Claude Lalanne. Jérôme Neutres y a regroupé quelques-uns des trésors qui furent dispersés en 2009, certains provenant de la collection Doucet, tels le Tabouret curule de Legrain, propriété désormais du Louvre Abu Dhabi, et le Revenant de Chirico, aujourd’hui au Centre Pompidou. Cette toile possède un superbe pedigree, nous apprend Edouard Sebline, puisque Yves Saint Laurent et Pierre Bergé l’acquirent en 1985 auprès des héritiers de Pierre Colle. Avant d’ouvrir boutique, l’ami de Max Jacob avait été un temps le collaborateur de Dior, maître de qui l’ont sait… L’histoire du goût ressemble souvent à une histoire de famille. On est ainsi heureux de revoir, vieilles connaissances, le portrait des enfants Dedreux, l’un des plus beaux Géricault revenus en mains privées, et les quatre Warhol explosifs de 1972, conservés par Pierre Bergé, où s’affirme la modernité que partageaient le peintre Pop et son modèle, saisi ici entre l’action et le songe, le relatif et l’absolu. Stéphane Guégan
On pense à cette fusée de Drieu devant la grande tenture de Burne-Jones, qui montre Melchior, Balthazar et Gaspard venus s’agenouiller aux pieds du Sauveur. Avant de rejoindre Orsay, grâce au don de Pierre Bergé, elle avait longtemps orné la sobre bibliothèque d’Yves Saint Laurent, rue de Babylone. D’une tout autre munificence brillait naturellement le grand salon du grand couturier, qu’évoque le second moment de l’exposition dans l’éclat rocaille des miroirs de Claude Lalanne. Jérôme Neutres y a regroupé quelques-uns des trésors qui furent dispersés en 2009, certains provenant de la collection Doucet, tels le Tabouret curule de Legrain, propriété désormais du Louvre Abu Dhabi, et le Revenant de Chirico, aujourd’hui au Centre Pompidou. Cette toile possède un superbe pedigree, nous apprend Edouard Sebline, puisque Yves Saint Laurent et Pierre Bergé l’acquirent en 1985 auprès des héritiers de Pierre Colle. Avant d’ouvrir boutique, l’ami de Max Jacob avait été un temps le collaborateur de Dior, maître de qui l’ont sait… L’histoire du goût ressemble souvent à une histoire de famille. On est ainsi heureux de revoir, vieilles connaissances, le portrait des enfants Dedreux, l’un des plus beaux Géricault revenus en mains privées, et les quatre Warhol explosifs de 1972, conservés par Pierre Bergé, où s’affirme la modernité que partageaient le peintre Pop et son modèle, saisi ici entre l’action et le songe, le relatif et l’absolu. Stéphane Guégan
Jacques Doucet / Yves Saint Laurent, Vivre pour l’art, Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, jusqu’au 14 février 2016. Catalogue sous la direction de Jérôme Neutres, Flammarion, 39€.
 Pierre Bergé est le plus libéral des collectionneurs et des prêteurs. La propriété exclusive, jalouse, mesquine, le laisse froid. Sitôt achetés, tableaux, livres et manuscrits sont à partager ou montrer au plus grand nombre. Ce qui est figé n’est jamais complet : « J’ai toujours considéré que les livres n’entraient dans ma bibliothèque que d’une manière temporaire, en transit en quelque sorte, et qu’un jour ils partiraient. » Avant de tout vendre, de tout éparpiller aux quatre vents de l’éternelle bibliophilie, il fait circuler. Une de ses dernières trouvailles (2003) tient du miracle : les carnets du jeune Guillaume Apollinaire ne courent pas les rues, ni même les documents de première main sur ce moment d’éclosion du poète français, le plus grand entre Rimbaud et Breton. À quoi rêvent les génies en herbe? Qu’attend-on des aveux opaques d’un adolescent jeté dans une vie nomade, ballottée entre un père absent et une mère très présente, belle et intelligente, mais dépendante des hommes qu’elle charme et qui l’entretiennent avant de disparaître? Là où nous voyons des annonces, il ne percevait aucun signe. C’est même la beauté de ce carnet, une beauté de nuit étoilée, que de tout maintenir en suspension, de résister aux lectures trop intrusives, malgré l’éclairante postface de Pierre Caizergues. Dans la perfection d’un reprint qui conserve jusqu’aux maculatures et aux transferts du crayon gras, une trentaine de dessins nous est révélée, qu’a généralement signés celui qui se nomme encore Wilhelm de Kostrovitzky. Ils s’étalent de sa 12ème à sa 15ème année, de la fin de la 5ème à la fin de la 3ème, alors que le collégien du lycée Saint-Charles, où enseignent des Pères marianistes (Société de Marie) montre sérieux et piété. Mais le passionnel l’habite déjà en ces années 1893-1895. Son besoin extrême de lecture et de religion, son goût précoce des uniformes et des actions d’éclat, son attirance pour la mode féminine et même sa pente à voyager en esprit nous parlent déjà du futur écrivain fantasque et superstitieux, moderne et antimoderne, le seul lyrique qui ait complètement conquis et compris Picasso. Avec Pierre Caizergues, notons aussi la veine noire qui colore d’énigme les pièces chrétiennes et les pages profanes : Noël se construit autour du dialogue angoissé que le narrateur noue avec l’Enfant Jésus qu’il tutoie ; Minuit inscrit le sommeil d’une dormeuse, peut-être chinoise, parmi les figures et écritures d’un calligramme involontaire; Macbeth porte une citation de Shakespeare en anglais (« I’gin to be aweary of the sun ») et réunit en mosaïque les éléments d’un obscur roman familial. Apollinaire, on le sait, se voudra un poète du soleil et de l’amour, son double nervalien, alors naissant, le suivra tout au long de sa courte vie. SG / Guillaume Apollinaire, Un album de jeunesse, préface de Pierre Bergé, postface de Pierre Caizergues, 17,50€
Pierre Bergé est le plus libéral des collectionneurs et des prêteurs. La propriété exclusive, jalouse, mesquine, le laisse froid. Sitôt achetés, tableaux, livres et manuscrits sont à partager ou montrer au plus grand nombre. Ce qui est figé n’est jamais complet : « J’ai toujours considéré que les livres n’entraient dans ma bibliothèque que d’une manière temporaire, en transit en quelque sorte, et qu’un jour ils partiraient. » Avant de tout vendre, de tout éparpiller aux quatre vents de l’éternelle bibliophilie, il fait circuler. Une de ses dernières trouvailles (2003) tient du miracle : les carnets du jeune Guillaume Apollinaire ne courent pas les rues, ni même les documents de première main sur ce moment d’éclosion du poète français, le plus grand entre Rimbaud et Breton. À quoi rêvent les génies en herbe? Qu’attend-on des aveux opaques d’un adolescent jeté dans une vie nomade, ballottée entre un père absent et une mère très présente, belle et intelligente, mais dépendante des hommes qu’elle charme et qui l’entretiennent avant de disparaître? Là où nous voyons des annonces, il ne percevait aucun signe. C’est même la beauté de ce carnet, une beauté de nuit étoilée, que de tout maintenir en suspension, de résister aux lectures trop intrusives, malgré l’éclairante postface de Pierre Caizergues. Dans la perfection d’un reprint qui conserve jusqu’aux maculatures et aux transferts du crayon gras, une trentaine de dessins nous est révélée, qu’a généralement signés celui qui se nomme encore Wilhelm de Kostrovitzky. Ils s’étalent de sa 12ème à sa 15ème année, de la fin de la 5ème à la fin de la 3ème, alors que le collégien du lycée Saint-Charles, où enseignent des Pères marianistes (Société de Marie) montre sérieux et piété. Mais le passionnel l’habite déjà en ces années 1893-1895. Son besoin extrême de lecture et de religion, son goût précoce des uniformes et des actions d’éclat, son attirance pour la mode féminine et même sa pente à voyager en esprit nous parlent déjà du futur écrivain fantasque et superstitieux, moderne et antimoderne, le seul lyrique qui ait complètement conquis et compris Picasso. Avec Pierre Caizergues, notons aussi la veine noire qui colore d’énigme les pièces chrétiennes et les pages profanes : Noël se construit autour du dialogue angoissé que le narrateur noue avec l’Enfant Jésus qu’il tutoie ; Minuit inscrit le sommeil d’une dormeuse, peut-être chinoise, parmi les figures et écritures d’un calligramme involontaire; Macbeth porte une citation de Shakespeare en anglais (« I’gin to be aweary of the sun ») et réunit en mosaïque les éléments d’un obscur roman familial. Apollinaire, on le sait, se voudra un poète du soleil et de l’amour, son double nervalien, alors naissant, le suivra tout au long de sa courte vie. SG / Guillaume Apollinaire, Un album de jeunesse, préface de Pierre Bergé, postface de Pierre Caizergues, 17,50€







