
Qui ne se souvient de l’incipit de Vol de nuit ? « Les collines, sous l’avion, creusaient déjà leur sillage d’ombre dans l’or du soir. Les plaines devenaient lumineuses mais d’une inusable lumière : dans ce pays elles n’en finissent pas de rendre leur or de même qu’après l’hiver, elles n’en finissent pas de perdre leur neige. » Sillage, or, soir : c’est le langage des Fleurs du Mal et la tentation qui s’y lit, ça et là, de peindre sur les ténèbres, en détournant la clarté des étoiles… Antoine de Saint-Exupéry, né avec le siècle, a rempli ses jeunes années de bonnes lectures : on le sait très sensible aux Parnassiens, et d’abord au très baudelairien François Coppée, dont il a retenu, prémonitoires, la mélancolie des départs, les songes humiliés, les petites vies devenues grandes. Et quand la plume se saisit d’Antoine entre 1914 et 1918, la guerre, dont son âge le prive, lui inspire des sonnets indemnes de gloriole. L’un d’entre eux, redécouvert à l’occasion d’une vente aux enchères en 2017, annonce les romans de l’aviateur et le thème de la nuit protectrice et dangereuse, cette peinture à fond noir :
L’Horizon flamboyant jette au travers des bois / Des lueurs où se mêle un rouge de fournaise / Il fait nuit mais au loin comme un morceau de braise / Un village brûlé s’auréole parfois.
Un jeune de vingt ans, sentinelle française / Songe à son vieux logis quitté depuis des mois / Il soupire en glanant ses rêves d’autrefois / Comme on glane les morts quand le combat s’apaise…
Se tournant vers le ciel il y regarde encore / Le sillage éclatant d’un projectile qui fuse / Mais déjà tout s’éteint, plus de sillage d’or
Et le soldat soupçonne en son âme confuse / Qu’en plein essor, noyés dans l’ombre qui les suit, / Nos rêves quelque fois s’éteignent dans la nuit.
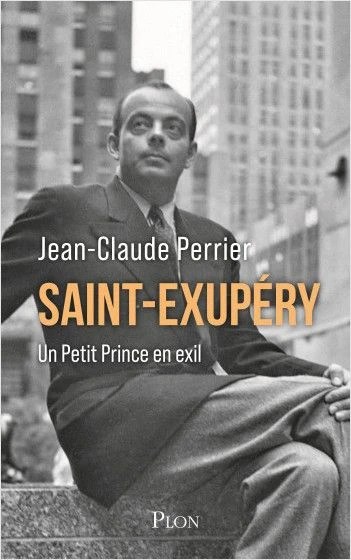
C’est probablement le genre de poésies qu’Yvonne de Lestrange, cousine de sa mère, trouvait aussi prometteuses que sentimentales. Elle n’en poussa que davantage le débutant, à partir de 1919, dans les bras de la N.R.F, rétive aux excès de lyrisme. André Gide comptait parmi les familiers d’Yvonne l’affranchie, bientôt divorcée du duc de Trévise. Dès 1923, Saint-Ex, devenu pilote militaire sous les drapeaux, aimerait voir son nom au sommaire de la revue prestigieuse. Il informe alors sa mère y publier bientôt Un vol. Mais son rêve s’éteint vite, aussi vite que la tentative de donner, en 1927, la scabreuse Manon. On mesure l’amertume de l’écrivain empêché à la lecture de cette lettre adressée à Yvonne en novembre 1926 ; l’aviateur, qui vient de rejoindre la firme Latécoère à Toulouse, découvre les premières pages du Voyage au Congo, plus indolentes et esthètes, il est vrai, que la description acerbe du système colonial qui les suivra : « J’ai lu le récit d’André Gide. J’ai toujours la même impression. D’abord une impression d’effort désespéré pour caractériser les choses, pour en donner un raccourci. Mais elles n’en surgissent jamais. A mesure qu’il les touche, il les empaille. Et ce n’est pas donner un raccourci que de supprimer verbes et articles. […] Comme je me fous d’André Gide exilé sur les mers d’Afrique, constatant que s’en va à droite une hirondelle qui venait de gauche. Comme je me fous de l’instantané qu’il me donne de lui en notant avec le plus grand soin le détail le plus indifférent, le plus banal, le moins chargé d’image, de sens. Et ensuite ? Je sais bien qu’il pissait aussi, monsieur André Gide, en Afrique. » Stéphane Guégan (« Avec Gide », lire la suite dans la Revue des deux mondes, octobre 2024. Voir aussi Stéphane Guégan, « Saint-Ex remet les gaz », Revue des deux mondes, février-mars 2019, p. 160-162 (https://www.jstor.org/stable/26597275)
A propos du Petit Prince : https://moderne.video.blog/2022/04/30/en-revenant-de-lexpo/
A propos de Pilote de guerre : https://moderne.video.blog/2020/11/16/survivre/
A propos de la correspondance Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry : https://moderne.video.blog/2021/06/15/fleurs-etranges/

A lire aussi Jean-Claude Perrier, Saint-Exupéry. Un Petit Prince en exil, Plon, 19€ et Sylvain Fort, Saint-Exupéry penseur, Gallimard, Folio essais, 7,80€. Perrier sait tout de Saint-Ex et le prouve en concentrant le tir sur la période américaine de l’un de ses auteurs d’élection. Entre décembre 1940 et avril 1943, l’ex-aviateur subit le sort de l’albatros de son cher Baudelaire au milieu, dit-il, d’un véritable panier de crabes. On a beaucoup enjolivé la peinture des « Français de New York », grands résistants de l’arrière. Pas assez gaulliste pour les uns, trop catho pour les autres, voire trop enclin à encourager la réconciliation des Français, de tous les Français, contre l’ennemi nazi, et prêt ainsi à obéir à Giraud, s’il le fallait, en Afrique du Nord, Saint-Ex exaspère aussi bien André Breton (au mieux avec Consuelo) que Jacques Maritain, chacun plaidant pour sa paroisse à coup de sermons et de bassesses médiatiques. On ne lui pardonnait pas, en fait, de percer à jour ceux qui se préparaient à « gérer la France de demain » pour bénéfice de leur action présente. Perrier mêle à sa chronique américaine toutes les femmes auprès desquelles Saint-Ex trouvait de meilleures (et plus belles) interlocutrices que les exilés aigris. Le lecteur n’est pas mécontent de suivre son héros sur les ondes martiales et sur le terrain du cinéma, de l’édition et de l’écriture, qui reste l’essentiel. Du temps de la drôle de guerre, un exemplaire « fatigué » de Baudelaire lui avait apporté le soutien que d’autres demandèrent à Pascal. Une de ses notes confirme son catholicisme de salut (personnel) et de combat (collectif) : « Baudelaire : rédemption […]. Baudelaire : la tache indélébile du Mal. » Le soldat ultime aura lui aussi mis son cœur à nu. Sylvain Fort, comme Perrier, cherche la vérité de Saint-Ex (tout être accompli en possède une) au sein de ses tourments, et de ce pessimisme dont il montre fortement « qu’il s’interdit de désespérer ». Son essai, publié initialement par le regretté Pierre-Guillaume de Roux, a la flamme des bilans intimes et le mordant des contempteurs du renoncement. Bernanos, l’un d’eux, lui permet de revenir à Saint-Ex par le chemin catholique, celui d’un homme que la foi de l’enfance a fui, mais qui n’en est pas moins pour autant habité de charité et d’aspiration au sacrifice. Il se trouve que le cadet a bien lu l’aîné, et notamment Le Journal d’un curé de campagne, peu clément envers « les moignons d’homme ». Cette filiation rappelée, Fort, en tacticien, peut donner sa juste dimension à la brouille qui sépara Saint-Ex et Breton. Sans parler de son horreur du spontanéisme en art, le premier refusait du second l’usage ludique de la langue, et le cirque du paraître au lieu d’être. Que même Le Petit Prince ne soit pas un livre lénifiant à l’usage des plus jeunes confirme le feu sacré, le feu du sacré, qui traverse l’œuvre entier. SG
Made in USA : de Saint-Ex à Lovecraft
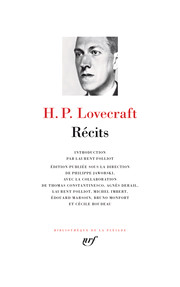
C’est Michel Houellebecq qui doit exulter. Lovecraft, son chéri de toujours, a enfin décroché sa place au firmament de La Pléiade, cinq ans après Huysmans, autre favori de l’auteur d’Anéantir (qui vient d’inspirer un article aussi candide que sot au New York Times). De tous ses romans si peu charitables envers l’humanité courante, et l’humanitarisme bétifiant, le dernier est peut-être le plus proche de son maître américain. Les rapprocher, du reste, me paraît plus légitime que d’associer, comme il se fait ici et là, Le Petit Prince à l’univers de Lovecraft. Car rien n’égale la noirceur de ce dernier, et son humour de même couleur, sinon peut-être la palette de son mentor, Edgar Allan Poe. L’ombre de ce dernier, que le cadet la flatte ou la taquine, circule dans bien des récits rassemblés dans le volume qu’a dirigé et, en partie, traduit Philippe Jaworski. L’ambiance fait tout, pensait Lovecraft, très rétif aux gros effets de la littérature Pulp, l’ambiance et le crescendo dans la peur de l’inconnu ou les marges du rationnel. Très peu de fantastique au bout du compte, mais une horreur latente, un effroi inespérément séduisant. On passe d’un asile d’aliénés à une maison hantée, de la tentation du suicide aux gouffres de la désillusion. De Poe, Lovecraft ne prolonge pas seulement l’art de la brièveté, de la raison mise provisoirement en échec, la duplicité des apparences l’obsède, autant que l’impensé des perceptions : « Rien n’est plus absurde, à mon avis, que cette croyance conventionnelle, qui semble si fréquente dans l’esprit des masses, selon laquelle ce qui est ordinaire ne peut être que sain. » L’autre aspect frappant de ces « tales » envoûtantes tient au raffinement de la langue, sortie directement des décadents et autres raffinés de la fin du XIXe siècle. L’un des personnages de Lovecraft, nous dit la passionnante préface de Laurent Folliot, ressemble à Des Esseintes comme deux gouttes d’absinthe. Les mass media dont Lovecraft tira ses maigres revenus lui donnaient la nausée. Sa morale baudelairienne n’en était que plus inflexible : « L’écrivain d’imagination se consacre à l’art au sens le plus essentiel du terme. Son affaire n’est pas de façonner une jolie babiole pour faire plaisir aux enfants, d’illustrer une morale utile […]. » Voilà de quoi, sans parler du reste, déplaire au New York Times. Mais est-il encore permis de lire Lovecraft aux Etats-Unis? Pas sûr. SG / H. P. Lovecraft, Récits, traductions nouvelles, Philippe Jaworski (dir.), Gallimard, La Pléiade, 76€.

A paraître le 17 octobre 2024, Musée, photographies de Nicolas Krief, texte de Stéphane Guégan, Gallimard, 29€ // Exposition des photographies de Nicolas Krief, à partir du 23 octobre, Galerie Gallimard, 30/32 rue de l’Université, 75007 Paris. Deux signatures, en présence d’Eric Reinhardt : jeudi 24, à partir de 19h30, Libralire, 116 rue Saint-Maur, 75011 ; Galerie Gallimard, 30 octobre, à partir de 18h30.
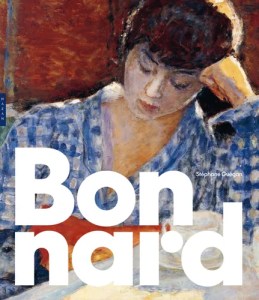
La Classe des Arts de l’Académie royale de Belgique a décerné le prix Philippe et Françoise Roberts-Jones à notre Bonnard (Hazan, 2023), ce qui récompense son auteur, plein de gratitude, et tous ceux qui, depuis l’exposition de Jean Clair (MNAM, 1984) ont contribué à remettre ce peintre génial à sa juste place. L’exposition Amitiés, Bonnard-Matisse de la Fondation Maeght, qui vient de fermer ses portes, l’a confirmé au-delà de son titre un peu anecdotique. Nous reviendrons sur ce que Matisse doit à Bonnard.
 La passion qu’il vouait au peintre interlope
La passion qu’il vouait au peintre interlope  De nouveaux combats s’y substitueront, arracher
De nouveaux combats s’y substitueront, arracher – Maria Van Rysselberghe, Le Cahier III bis de la Petite Dame, édition présentée et annotée par
– Maria Van Rysselberghe, Le Cahier III bis de la Petite Dame, édition présentée et annotée par