 Les expositions Monet et Picasso ne croulent pas toutes sous les idées, l’inédit, l’imprévu… Je m’empresse donc de signaler deux exceptions à cette douloureuse règle, douloureuse pour les œuvres déplacées inutilement, et pour le visiteur dont on se moque. La première vient d’ouvrir à la Fondation Beyeler et a Ulf Küster pour commissaire, la seconde va bientôt fermer ses portes à Paris. Monet, tout d’abord. Monet au prisme des ombres et des reflets qui entraînent le peintre, à partir de 1879, vers l’élargissement de plus en plus insolent de ses propres règles figuratives. La mort de Camille et l’implosion du groupe impressionniste, antérieure à l’ultime exposition de 1886, font alors basculer la vie de Monet. En 1880, à peine sorti d’un des hivers les plus terribles du siècle, il peint la Seine et la débâcle des blocs de glace dans un paysage de fin de monde. « La métaphore est évidente, me dit Ulf Küster. C’en est fini de la cordée impressionniste ». Monet retourne au Salon, expose chez ses marchands et s’autorise plusieurs manières, en fonction des motifs, bien entendu, et des nouveaux destinataires de sa production. Elle ne s’est pas simplement diversifiée par surenchère d’audace : La Corniche de Monaco flamboie comme un Monet grand cru, mais serpente comme un Meissonier d’Antibes. Le pittoresque d’un promeneur s’y autorise une apparition indiscrète. La demande, au cours des années 1880-1900, impacte la source… L’impressionnisme, du reste, n’avait jamais prétendu à quelque pureté ou objectivité que ce soit. Même le bon Zola parlait du « tempérament » à travers lequel la nature prenait forme sur la toile. Ce qui disparaît avec Monet et Renoir, Pissarro et Cézanne, ce n’est pas l’expérience du réel, c’est l’idée qu’une seule image puisse en rendre compte ou en fixer l’aspect. Esclaves des apparences, malgré la vulgate en cours, les impressionnistes ne le furent jamais. A partir de 1879, précise Ulf Küster, « Monet travaille sur les limites de l’image, les réinvente à sa guise, sa peinture prend l’image pour sujet. » On ne saurait mieux s’affranchir des idées connexes de l’œil innocent et de la peinture autonome, fonds de commerce de la tradition rewaldienne !
Les expositions Monet et Picasso ne croulent pas toutes sous les idées, l’inédit, l’imprévu… Je m’empresse donc de signaler deux exceptions à cette douloureuse règle, douloureuse pour les œuvres déplacées inutilement, et pour le visiteur dont on se moque. La première vient d’ouvrir à la Fondation Beyeler et a Ulf Küster pour commissaire, la seconde va bientôt fermer ses portes à Paris. Monet, tout d’abord. Monet au prisme des ombres et des reflets qui entraînent le peintre, à partir de 1879, vers l’élargissement de plus en plus insolent de ses propres règles figuratives. La mort de Camille et l’implosion du groupe impressionniste, antérieure à l’ultime exposition de 1886, font alors basculer la vie de Monet. En 1880, à peine sorti d’un des hivers les plus terribles du siècle, il peint la Seine et la débâcle des blocs de glace dans un paysage de fin de monde. « La métaphore est évidente, me dit Ulf Küster. C’en est fini de la cordée impressionniste ». Monet retourne au Salon, expose chez ses marchands et s’autorise plusieurs manières, en fonction des motifs, bien entendu, et des nouveaux destinataires de sa production. Elle ne s’est pas simplement diversifiée par surenchère d’audace : La Corniche de Monaco flamboie comme un Monet grand cru, mais serpente comme un Meissonier d’Antibes. Le pittoresque d’un promeneur s’y autorise une apparition indiscrète. La demande, au cours des années 1880-1900, impacte la source… L’impressionnisme, du reste, n’avait jamais prétendu à quelque pureté ou objectivité que ce soit. Même le bon Zola parlait du « tempérament » à travers lequel la nature prenait forme sur la toile. Ce qui disparaît avec Monet et Renoir, Pissarro et Cézanne, ce n’est pas l’expérience du réel, c’est l’idée qu’une seule image puisse en rendre compte ou en fixer l’aspect. Esclaves des apparences, malgré la vulgate en cours, les impressionnistes ne le furent jamais. A partir de 1879, précise Ulf Küster, « Monet travaille sur les limites de l’image, les réinvente à sa guise, sa peinture prend l’image pour sujet. » On ne saurait mieux s’affranchir des idées connexes de l’œil innocent et de la peinture autonome, fonds de commerce de la tradition rewaldienne !
 Cette peinture pense, se pense et se montre pensant, telle est donc la thèse de l’exposition de Bâle, aussi intelligente que belle. Elle s’ouvre sur l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’artiste, La Meule au soleil du Kunsthaus de Zurich (fig. 1), qui pourrait bien être la version que Kandinsky a vue, tête en bas, abasourdi par la confrontation possible d’une image sans sujet. Il se trompait, mais son erreur signale le trouble visuel où s’est engagée la peinture de Monet. Ce qu’elle a alors de plus radical joue de la nudité des compositions, de la saturation ou de la disparition des couleurs. L’eau est partout, de l’Epte à la Normandie et à la Bretagne… Quand la mer est grosse, la touche s’emporte ; quand elle est d’huile, elle atteint une subtilité unique à suivre chaque appel du motif et le mystère de son apparition. Songe-t-il au principe mallarméen de l’absence agissante, du frisson d’anéantissement, quand il poursuit les formes brisées du moindre reflet ? Le peintre, de fait, excelle au fantomatique et à l’incertain, chérit les brumes matinales ou le fog urbain. Londres offre fatalement au parcours son point d’orgue. Pas moins de huit vues de Waterloo Bridge et de Charing Cross Bridge s’emparent d’une longue galerie que ponctue deux versions les plus spectrales du Parlement (fig. 2). On est frappé par l’ardeur chromatique poussée jusqu’à l’invraisemblance, la puissance gestuelle et l’attachement aux signes de la modernité industrielle. Les paysages de Creuse, les Meules de 1890 annonçaient cette montée en puissance des rouges, des pourpres, des reflets d’or liquide. Tout un romantisme de la ville spectrale, de la cité engloutie que le fog et ses rares irisations de lumière ne peuvent plus à eux seuls justifier. D’ailleurs Monet ne prend que des notes à Londres. Pour triompher de ceux auxquels il se mesure, Turner, Whistler, il a besoin de la distance et des synthèses de la mémoire. Il achève donc à Giverny ces faux instantanés de Londres, avant de les montrer chez Durand-Ruel. Un journaliste de l’époque se gausse de leur féérie. Monet proteste par voie de presse. La nature, il fait corps avec. La nature et sa magie.
Cette peinture pense, se pense et se montre pensant, telle est donc la thèse de l’exposition de Bâle, aussi intelligente que belle. Elle s’ouvre sur l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’artiste, La Meule au soleil du Kunsthaus de Zurich (fig. 1), qui pourrait bien être la version que Kandinsky a vue, tête en bas, abasourdi par la confrontation possible d’une image sans sujet. Il se trompait, mais son erreur signale le trouble visuel où s’est engagée la peinture de Monet. Ce qu’elle a alors de plus radical joue de la nudité des compositions, de la saturation ou de la disparition des couleurs. L’eau est partout, de l’Epte à la Normandie et à la Bretagne… Quand la mer est grosse, la touche s’emporte ; quand elle est d’huile, elle atteint une subtilité unique à suivre chaque appel du motif et le mystère de son apparition. Songe-t-il au principe mallarméen de l’absence agissante, du frisson d’anéantissement, quand il poursuit les formes brisées du moindre reflet ? Le peintre, de fait, excelle au fantomatique et à l’incertain, chérit les brumes matinales ou le fog urbain. Londres offre fatalement au parcours son point d’orgue. Pas moins de huit vues de Waterloo Bridge et de Charing Cross Bridge s’emparent d’une longue galerie que ponctue deux versions les plus spectrales du Parlement (fig. 2). On est frappé par l’ardeur chromatique poussée jusqu’à l’invraisemblance, la puissance gestuelle et l’attachement aux signes de la modernité industrielle. Les paysages de Creuse, les Meules de 1890 annonçaient cette montée en puissance des rouges, des pourpres, des reflets d’or liquide. Tout un romantisme de la ville spectrale, de la cité engloutie que le fog et ses rares irisations de lumière ne peuvent plus à eux seuls justifier. D’ailleurs Monet ne prend que des notes à Londres. Pour triompher de ceux auxquels il se mesure, Turner, Whistler, il a besoin de la distance et des synthèses de la mémoire. Il achève donc à Giverny ces faux instantanés de Londres, avant de les montrer chez Durand-Ruel. Un journaliste de l’époque se gausse de leur féérie. Monet proteste par voie de presse. La nature, il fait corps avec. La nature et sa magie.
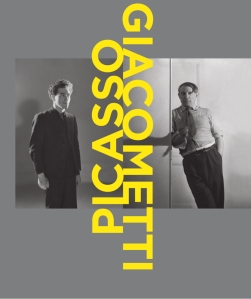 Evacuer le réel, Picasso et Giacometti, qu’une subtile exposition fait dialoguer, n’y ont jamais aspiré. Le quart de siècle qui les séparait explique l’évolution de leurs rapports. A la déférence du cadet allait succéder une émulation réciproque, que briseraient une rivalité prévisible et un de ces coups de Jarnac dont le délicieux Picasso avait le secret… Mais procédons par ordre, à l’instar de l’exposition. Au départ, il y a la puissance d’attraction du cubisme et, plus globalement, de Picasso sur le jeune Suisse, fraîchement débarqué en France. Giacometti n’a pas trente ans et croit encore au volume, au plein, et presque à la plénitude. À ses parents, le 8 avril 1924, il écrit : « Dernièrement j’ai été à une exposition de Picasso qui m’a beaucoup plu. Il y a six ou sept grandes figures assises, deux ou trois saltimbanques et des portraits de femmes. Ils sont très clairs et simples, et très bien dessinés. De toute façon, il s’agit de choses faites d’après nature et très vivantes. Il s’agit, en bref, simplement d’un art sans beaucoup d’histoires. Ce sont les meilleures choses modernes que j’ai vues à ce jour à Paris et sur cette voie, il peut arriver à de très belles choses. » Son naturalisme sensible, celui des premiers portraits de ronde-bosse, se disloque dès 1926, le souffle picassien, primitiviste anime une nouvelle humanité, faite de géométrie organique ou de l’esprit des fétiches. L’élémentaire sexué impose sa loi dans le souvenir des Cyclades et de l’Afrique. Nouvelle étape dans la mise à nu de la dialectique des pulsions et de l’introspection, Femme égorgée, en 1933, vient après les expositions Giacometti et Picasso de l’année précédente, les collaborations du Suisse à la propagande communiste d’Aragon, la création de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires dont il s’éloigne vite… Les grandes turbulences commencent à secouer le milieu de l’art. Picasso et Giacometti, surréalistes distants, intensifient leurs échanges muets jusqu’à l’Occupation, qui renvoie le second à Genève. L’exposition en dresse parfaitement le décor et la réciprocité d’influences, sans parler d’un remarquable mur documentaire, où l’attention est attirée par la plaquette, tirée à 200 exemplaires, du poète Georges Hugnet, illustrée par un Picasso moins bâillonné qu’on ne le dit. Le 1er février 1941, il en adressa un exemplaire à « [son] cher Giacometti ». On y lit que « la forêt [est] belle comme un rendez-vous ». Superbe et prémonitoire. A la Libération, la paire d’amis se reformera avant que Picasso ne s’oppose à ce que Kahnweiler ne mette Giacometti sous contrat. Le roi ne partageait pas tout.
Evacuer le réel, Picasso et Giacometti, qu’une subtile exposition fait dialoguer, n’y ont jamais aspiré. Le quart de siècle qui les séparait explique l’évolution de leurs rapports. A la déférence du cadet allait succéder une émulation réciproque, que briseraient une rivalité prévisible et un de ces coups de Jarnac dont le délicieux Picasso avait le secret… Mais procédons par ordre, à l’instar de l’exposition. Au départ, il y a la puissance d’attraction du cubisme et, plus globalement, de Picasso sur le jeune Suisse, fraîchement débarqué en France. Giacometti n’a pas trente ans et croit encore au volume, au plein, et presque à la plénitude. À ses parents, le 8 avril 1924, il écrit : « Dernièrement j’ai été à une exposition de Picasso qui m’a beaucoup plu. Il y a six ou sept grandes figures assises, deux ou trois saltimbanques et des portraits de femmes. Ils sont très clairs et simples, et très bien dessinés. De toute façon, il s’agit de choses faites d’après nature et très vivantes. Il s’agit, en bref, simplement d’un art sans beaucoup d’histoires. Ce sont les meilleures choses modernes que j’ai vues à ce jour à Paris et sur cette voie, il peut arriver à de très belles choses. » Son naturalisme sensible, celui des premiers portraits de ronde-bosse, se disloque dès 1926, le souffle picassien, primitiviste anime une nouvelle humanité, faite de géométrie organique ou de l’esprit des fétiches. L’élémentaire sexué impose sa loi dans le souvenir des Cyclades et de l’Afrique. Nouvelle étape dans la mise à nu de la dialectique des pulsions et de l’introspection, Femme égorgée, en 1933, vient après les expositions Giacometti et Picasso de l’année précédente, les collaborations du Suisse à la propagande communiste d’Aragon, la création de l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires dont il s’éloigne vite… Les grandes turbulences commencent à secouer le milieu de l’art. Picasso et Giacometti, surréalistes distants, intensifient leurs échanges muets jusqu’à l’Occupation, qui renvoie le second à Genève. L’exposition en dresse parfaitement le décor et la réciprocité d’influences, sans parler d’un remarquable mur documentaire, où l’attention est attirée par la plaquette, tirée à 200 exemplaires, du poète Georges Hugnet, illustrée par un Picasso moins bâillonné qu’on ne le dit. Le 1er février 1941, il en adressa un exemplaire à « [son] cher Giacometti ». On y lit que « la forêt [est] belle comme un rendez-vous ». Superbe et prémonitoire. A la Libération, la paire d’amis se reformera avant que Picasso ne s’oppose à ce que Kahnweiler ne mette Giacometti sous contrat. Le roi ne partageait pas tout.
 Dans les années 1950-1960, désormais chez Maeght, Giacometti va régner sur Montparnasse où Samuel Beckett l’y croise. A ces rencontres, de nuit et de noctambules, fait écho la merveilleuse correspondance de l’écrivain, dont Gallimard continue à assurer la courageuse et salutaire publication. Depuis Ussy, sa campagne, il écrit, le 10 septembre 1951, au peu sympathique Georges Duthuit : « Avant de venir j’ai pas mal vadrouillé à Montparnasse, avec Blin la plupart du temps. Rencontré […] Giacometti, granitiquement subtil et tout en perceptions renversantes, très sage au fond, voulant rendre ce qu’il voit, ce qui n’est pas si sage que ça, lorsqu’on sait voir comme lui. » Dix ans plus tard, alors que le théâtre de l’Odéon est passé sous le pavillon de Jean-Louis Barrault, la reprise d’En attendant Godot rend évidente l’association poétique de l’Irlandais et de Giacometti autour de l’arbre, effilé comme un corps précaire, qui en meuble presque toute la scène… La récente parution du tome III des Lettres de Beckett contient plusieurs mentions de Godot. Il y a d’abord, en 1957, l’éclat du scandale que provoque la représentation de la pièce, à Boston, avec des acteurs de « couleur » : « Godot noir à Boston – ça c’est de la tea-party », écrit Beckett, le 12 janvier… Au critique Kay Boyle qui voit en Godot une allégorie des Français sous l’Occupation, la même année, il dit que sa théorie est un peu tirée par les cheveux mais « redoutablement astucieuse ». Si les années 1940-1944 sont presque absentes de sa correspondance, la littérature de l’après-guerre en découle évidemment. En ces années 1957-1965, la notoriété de Beckett s’est solidement confortée, au point que ce fils spirituel de Joyce connaît des difficultés pour se faire jouer outre-Manche, où on fait barrage à ce que son écriture contient de scabreux et de scatologique. Il faut lire ses échanges désopilants avec sa traductrice allemande, butant sur les mots qui ne traversent pas dans les clous le boulevard de la littérature… Amusant aussi son supposé ralliement au nouveau roman, aux antipodes duquel le situe toute oreille bien faite ! Au sujet de la photographie célébrissime de l’automne 1959, qui le montre au milieu des « bons élèves » de l’écurie Lindon, il déborde d’ironie. C’est Barbara Bray, dont il fut très amoureux, qui suscite les lettres les plus intimes et les plus drôles. L’humour est leur armure. En marge des pièces (Fin de partie), de la fiction (Comment c’est) et d’une époque qui voit le retour de De Gaulle, l’explosion algérienne, les attentats et les manifestes – Beckett ne signe pas celui des 121, en 1960 – le tome III redonne des couleurs au Montparnasse du Select, de la Coupole et de la Closerie des Lilas… Ionesco, Camus, Genet, Duras, Masson, Blanchot, le dernier Cézanne ou la jeune télévision, tout un monde s’y concentre, ce qui n’est pas le moindre charme de sa lecture. Stéphane Guégan
Dans les années 1950-1960, désormais chez Maeght, Giacometti va régner sur Montparnasse où Samuel Beckett l’y croise. A ces rencontres, de nuit et de noctambules, fait écho la merveilleuse correspondance de l’écrivain, dont Gallimard continue à assurer la courageuse et salutaire publication. Depuis Ussy, sa campagne, il écrit, le 10 septembre 1951, au peu sympathique Georges Duthuit : « Avant de venir j’ai pas mal vadrouillé à Montparnasse, avec Blin la plupart du temps. Rencontré […] Giacometti, granitiquement subtil et tout en perceptions renversantes, très sage au fond, voulant rendre ce qu’il voit, ce qui n’est pas si sage que ça, lorsqu’on sait voir comme lui. » Dix ans plus tard, alors que le théâtre de l’Odéon est passé sous le pavillon de Jean-Louis Barrault, la reprise d’En attendant Godot rend évidente l’association poétique de l’Irlandais et de Giacometti autour de l’arbre, effilé comme un corps précaire, qui en meuble presque toute la scène… La récente parution du tome III des Lettres de Beckett contient plusieurs mentions de Godot. Il y a d’abord, en 1957, l’éclat du scandale que provoque la représentation de la pièce, à Boston, avec des acteurs de « couleur » : « Godot noir à Boston – ça c’est de la tea-party », écrit Beckett, le 12 janvier… Au critique Kay Boyle qui voit en Godot une allégorie des Français sous l’Occupation, la même année, il dit que sa théorie est un peu tirée par les cheveux mais « redoutablement astucieuse ». Si les années 1940-1944 sont presque absentes de sa correspondance, la littérature de l’après-guerre en découle évidemment. En ces années 1957-1965, la notoriété de Beckett s’est solidement confortée, au point que ce fils spirituel de Joyce connaît des difficultés pour se faire jouer outre-Manche, où on fait barrage à ce que son écriture contient de scabreux et de scatologique. Il faut lire ses échanges désopilants avec sa traductrice allemande, butant sur les mots qui ne traversent pas dans les clous le boulevard de la littérature… Amusant aussi son supposé ralliement au nouveau roman, aux antipodes duquel le situe toute oreille bien faite ! Au sujet de la photographie célébrissime de l’automne 1959, qui le montre au milieu des « bons élèves » de l’écurie Lindon, il déborde d’ironie. C’est Barbara Bray, dont il fut très amoureux, qui suscite les lettres les plus intimes et les plus drôles. L’humour est leur armure. En marge des pièces (Fin de partie), de la fiction (Comment c’est) et d’une époque qui voit le retour de De Gaulle, l’explosion algérienne, les attentats et les manifestes – Beckett ne signe pas celui des 121, en 1960 – le tome III redonne des couleurs au Montparnasse du Select, de la Coupole et de la Closerie des Lilas… Ionesco, Camus, Genet, Duras, Masson, Blanchot, le dernier Cézanne ou la jeune télévision, tout un monde s’y concentre, ce qui n’est pas le moindre charme de sa lecture. Stéphane Guégan
*Monet. Lumière, ombre et réflexion, Bâle, Fondation Beyeler, jusqu’au 28 mai 2017. Catalogue (en anglais) sous la direction d’Ulf Küster, 62,50 CHF.
 *Picasso-Giacometti, musée Picasso, Paris, jusqu’au 5 février 2017. Le catalogue (Flammarion, 39€) vaut surtout pour les essais liminaires de Serena Bucalo-Mussely et Sarah Wilson.
*Picasso-Giacometti, musée Picasso, Paris, jusqu’au 5 février 2017. Le catalogue (Flammarion, 39€) vaut surtout pour les essais liminaires de Serena Bucalo-Mussely et Sarah Wilson.
« Ce n’est pas un livre illustré, mais un manuscrit enluminé par Picasso », a dit Reverdy du Chant des morts, publié par Tériade en 1948. Sous une couverture différente et dans un format réduit, sa réédition (Poésie Gallimard, 9,90€) en préserve l’essentiel, la sombre beauté des mots cursifs, la fulgurante des signes que Picasso a glissés partout, en haut, en bas, à droite, à gauche. Ivresse d’un alphabet autre. Après avoir abandonné le projet d’illustrations séparées, le peintre a opté pour la calligraphie primitive, archaïque et rupestre parfois. Deux mains, à tous égards, se joignent pour livrer, avec hauteur, un bilan des années noires, souffrances, morts, hontes. Le texte date de l’hiver 1944-1945 et brûle comme une nuit glacée. Mais Reverdy abandonne à d’autres le triste privilège d’user de la poésie en grand justicier. La vindicte et la vendetta, c’est le parti de Moscou. « La tête pleine d’or », Reverdy préfère panser ses plaies. SG
***Samuel Beckett, Lettres III (1957-1965), lettres en français ou traduites de l’irlandais (Gérard Kahn), édition de George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn et Lois More Overbeck, Gallimard, 58€.









