 Depuis l’essai notoire de Roland Barthes sur Cy Twombly, on ne peut plus prendre au mot la star américaine, décédée en 2011. Sa peinture serait de l’ordre du gribouillage et de la trace, elle affectionnerait la rature, la coulure, la salissure et l’allusion déroutante, elle triompherait dans l’étalage illimité de l’illisible. Les mots dont l’artiste a toujours fait un large usage sont «déchiffrables», dit Barthes en 1979. Mais il précise aussitôt qu’ils ne sont pas « interprétables » : ces mots ne disent rien, ne racontent rien surtout, convoquent une « culture » afin de mieux l’éconduire. Le geste, la geste, pose l’exégète, a gommé le sens de ces écritures, qui n’eurent d’autre fin que leur splendide déploiement, leur magnifique isolement… Il n’est pas difficile, malgré les circonvolutions et les préciosités du texte de Barthes, d’y voir agir la vieille hantise des «modernes» envers la «peinture littéraire», réflexe formaliste qu’a clairement analysé et crucifié André Breton dans son virulent Art magique de 1957, à une époque donc où Twombly se démarquait déjà de l’abstraction américaine en sa fraction contemplative. Il aura donc fallu attendre 2016 pour jouir, à Paris, d’une rétrospective qui remît enfin les mots à leur place, et l’artiste à la sienne, parmi ses pairs, Raphaël, Léonard, Poussin, Manet… Qu’est-ce qu’être un «peintre d’histoire» après 1950 ? Cette question, le Centre Pompidou se l’est posée à travers les récentes expositions Richter, Raysse ou Koons. Elle trouve en Twombly une acuité particulière dans la mesure où rien n’avait préparé le disciple du Black Mountain College à peindre la guerre de Troie ou l’assassinat de Commode, à traduire en couleurs Hérodote et Ovide, voire à continuer Lascaux et Pompéi.
Depuis l’essai notoire de Roland Barthes sur Cy Twombly, on ne peut plus prendre au mot la star américaine, décédée en 2011. Sa peinture serait de l’ordre du gribouillage et de la trace, elle affectionnerait la rature, la coulure, la salissure et l’allusion déroutante, elle triompherait dans l’étalage illimité de l’illisible. Les mots dont l’artiste a toujours fait un large usage sont «déchiffrables», dit Barthes en 1979. Mais il précise aussitôt qu’ils ne sont pas « interprétables » : ces mots ne disent rien, ne racontent rien surtout, convoquent une « culture » afin de mieux l’éconduire. Le geste, la geste, pose l’exégète, a gommé le sens de ces écritures, qui n’eurent d’autre fin que leur splendide déploiement, leur magnifique isolement… Il n’est pas difficile, malgré les circonvolutions et les préciosités du texte de Barthes, d’y voir agir la vieille hantise des «modernes» envers la «peinture littéraire», réflexe formaliste qu’a clairement analysé et crucifié André Breton dans son virulent Art magique de 1957, à une époque donc où Twombly se démarquait déjà de l’abstraction américaine en sa fraction contemplative. Il aura donc fallu attendre 2016 pour jouir, à Paris, d’une rétrospective qui remît enfin les mots à leur place, et l’artiste à la sienne, parmi ses pairs, Raphaël, Léonard, Poussin, Manet… Qu’est-ce qu’être un «peintre d’histoire» après 1950 ? Cette question, le Centre Pompidou se l’est posée à travers les récentes expositions Richter, Raysse ou Koons. Elle trouve en Twombly une acuité particulière dans la mesure où rien n’avait préparé le disciple du Black Mountain College à peindre la guerre de Troie ou l’assassinat de Commode, à traduire en couleurs Hérodote et Ovide, voire à continuer Lascaux et Pompéi.
 Jonas Storsve, qui a présidé à cette fête de la peinture, est un des rares conservateurs français à avoir connu Twombly, à s’être entretenu de peinture, de littérature ou de mythologie avec lui, à avoir suivi le fil d’une pensée qui ne se berçait pas de l’insignifiance prétendue de ses actes. La nécessité de commencer par parler de l’accrochage s’impose d’elle-même. Où voit-on, en ce moment, tant de rigueur alliée à tant de force ? Tout ça respire, frappe et fait réfléchir au bon tempo. Et le choc ne se fait pas attendre (fig.1). Les premiers tableaux, peints à moins de 25 ans, sont d’un primitivisme volontairement brutal, pariétal, qui rapproche Pollock et De Kooning du mystère insondable des grottes préhistoriques (l’une des grandes sensations de l’après-guerre). Ces toiles, concentrées et striées, refusent le poncif du gigantisme newyorkais et balancent du figuratif à l’abstrait, sous la poussée de signes susceptibles déjà d’une double lecture. Dans le catalogue, réfutant Rosalind Krauss, John Yau revient savamment sur ces tableaux, où il voit moins l’abandon ironique de l’archaïsme des années 1940 que sa reprise musclée. Alors que Pollock et Rothko s’éloignaient du vocabulaire barbare qui les avait fait connaître, le jeune Twombly lui imprimait un sursaut de sombre énergie. Durant ses études au Black Mountain College, il avait manifesté un intérêt pour Corinth, Soutine, Dubuffet et Gorky, qui ne resterait pas lettre morte. Cet homme aurait un destin européen, c’était programmé. Les voyages l’ont déjà frotté à sa vraie patrie, l’Italie païenne et chrétienne. D’où la blancheur impure de ses toiles griffées au cours des années 1954-1959, qui aboutissent à son installation romaine. L’Arcadie de Twombly se met en place sous le signe du graffito. Les mots se mettent à parler un drôle de langage. « Fuck » tatoue la surface agitée d’Academy et d’Olympia (fig.2). Mais ce fuck-là, outre qu’il nous rappelle que Twombly refuse le puritanisme avant-gardiste, désigne un refus plus fondamental. La doxa US va le lui faire comprendre. Leo Castelli renonce à exposer, en 1959, une peinture qui le déboussole.
Jonas Storsve, qui a présidé à cette fête de la peinture, est un des rares conservateurs français à avoir connu Twombly, à s’être entretenu de peinture, de littérature ou de mythologie avec lui, à avoir suivi le fil d’une pensée qui ne se berçait pas de l’insignifiance prétendue de ses actes. La nécessité de commencer par parler de l’accrochage s’impose d’elle-même. Où voit-on, en ce moment, tant de rigueur alliée à tant de force ? Tout ça respire, frappe et fait réfléchir au bon tempo. Et le choc ne se fait pas attendre (fig.1). Les premiers tableaux, peints à moins de 25 ans, sont d’un primitivisme volontairement brutal, pariétal, qui rapproche Pollock et De Kooning du mystère insondable des grottes préhistoriques (l’une des grandes sensations de l’après-guerre). Ces toiles, concentrées et striées, refusent le poncif du gigantisme newyorkais et balancent du figuratif à l’abstrait, sous la poussée de signes susceptibles déjà d’une double lecture. Dans le catalogue, réfutant Rosalind Krauss, John Yau revient savamment sur ces tableaux, où il voit moins l’abandon ironique de l’archaïsme des années 1940 que sa reprise musclée. Alors que Pollock et Rothko s’éloignaient du vocabulaire barbare qui les avait fait connaître, le jeune Twombly lui imprimait un sursaut de sombre énergie. Durant ses études au Black Mountain College, il avait manifesté un intérêt pour Corinth, Soutine, Dubuffet et Gorky, qui ne resterait pas lettre morte. Cet homme aurait un destin européen, c’était programmé. Les voyages l’ont déjà frotté à sa vraie patrie, l’Italie païenne et chrétienne. D’où la blancheur impure de ses toiles griffées au cours des années 1954-1959, qui aboutissent à son installation romaine. L’Arcadie de Twombly se met en place sous le signe du graffito. Les mots se mettent à parler un drôle de langage. « Fuck » tatoue la surface agitée d’Academy et d’Olympia (fig.2). Mais ce fuck-là, outre qu’il nous rappelle que Twombly refuse le puritanisme avant-gardiste, désigne un refus plus fondamental. La doxa US va le lui faire comprendre. Leo Castelli renonce à exposer, en 1959, une peinture qui le déboussole.
Le marchand aura plus de mal encore à digérer la suite, qui charrie dans l’effroi ou l’allégresse le refoulé du XXe siècle, du rose des humeurs au trait souverain, de la référence aux maîtres à l’histoire antique, de l’ultra-violence des affects à la possibilité de retrouver, autrement, du narratif. La peinture de Twombly flirte moins avec sa propre disparition qu’elle n’affronte l’interdit en un combat nécessairement douteux. Nine Discourses on Commodus (fig.3) fit scandale, en 1964, à New York, au lendemain de l’assassinat de Kennedy. Trop français, disent les critiques les plus généreux. En bon minimaliste, Donald Judd rejette avec horreur le médium, démodé, et l’esprit, pas assez américain. Conclusion de Judd : «L’art européen ne m’intéresse absolument pas, et je pense qu’il est fini.» Andy Warhol, évidemment, posera un regard plus intelligent et complice sur l’exilé. On sait que Twombly a été passablement agacé par la réaction de l’establishment muséo-médiatique. Pas question pour l’heure de quitter Rome où il avait fait un beau mariage et creusait son réseau. En Europe, pendant près de quinze ans, c’est sous le signe du « cool » que s’évalue la peinture de Twombly et s’évacue sa sourde violence. Le texte de Barthes en fixera le canon, avant que Sollers ne ramène l’artiste dans l’orbe de Joyce et de sa liturgie. Ordre de la nature, désordre des hommes… Poussin, en somme. Une nouvelle génération d’artistes, de Schnabel à Basquiat, l’arrache de même à la dictature de la calligraphie et du neutre. Plus rien n’empêche désormais Twombly de se prendre pour Manet ou Tiepolo. Sur l’un des murs de la Chiesa Nuova, à l’instigation des pères oratoriens, il est recommandé au passant de prier pour que l’artiste se meuve dans la splendeur de la beauté divine. Nul doute, après avoir visité l’exposition du Centre, qu’il s’y trouve. Stéphane Guégan
*Cy Twombly, Centre Pompidou, MNAM, jusqu’au 24 avril, excellent catalogue, informé et innovant, sous la direction de Jonas Storsve, Editions du Centre Pompidou, 44,90€.
 **Margot et Rudolf Wittkower, Les Enfants de Saturne, postface de François-René Martin, Macula, avec le soutien du CNL, 35€// Malgré son titre au parfum de mélancolie clivante, le classique des Wittkower n’a pas grand-chose à voir avec les travaux de Panofsky. Le regard qu’ils jettent sur l’étrange population des artistes, de l’antiquité à la fin de l’âge baroque, en passant par Uccello, Raphaël et Caravage, préfère l’ethnologie à la psychologie. Leur objet, annoncent-ils avec un rien d’ironie, c’est «l’aliénation» du créateur, mais non au sens de Marx et Freud, qu’ils brocardent ouvertement. Il n’y a pas lieu de chercher hors de l’artiste, selon eux, les causes de sa servitude. C’est que ce faux paria se soumet délicieusement à l’image très socialisée de l’être à part, sans morale, ni stabilité, qu’on rencontre déjà chez Pline. Les ratés, les faux artistes ont toujours été les premiers à alimenter le folklore de ce que nous continuons à appeler la bohème avec un reste ou un zeste de sentimentalisme. A partir du XVIe siècle, une proto-bohème s’observe dans une Italie où le monde de l’art se dirige à grands pas vers ce que nous connaissons aujourd’hui. Parce qu’ils étudient en historiens tous les comportements «anormaux» de la faune en question, les Wittkower préfèrent les rapporter à une exigence éthique paradoxale ou à un simple hédonisme, plutôt que céder à la vogue de la psychanalyse. Très, trop sévère à l’égard des disciples de Freud, ils entérinent parfois un certain déni du sexuel cher à leur profession. SG
**Margot et Rudolf Wittkower, Les Enfants de Saturne, postface de François-René Martin, Macula, avec le soutien du CNL, 35€// Malgré son titre au parfum de mélancolie clivante, le classique des Wittkower n’a pas grand-chose à voir avec les travaux de Panofsky. Le regard qu’ils jettent sur l’étrange population des artistes, de l’antiquité à la fin de l’âge baroque, en passant par Uccello, Raphaël et Caravage, préfère l’ethnologie à la psychologie. Leur objet, annoncent-ils avec un rien d’ironie, c’est «l’aliénation» du créateur, mais non au sens de Marx et Freud, qu’ils brocardent ouvertement. Il n’y a pas lieu de chercher hors de l’artiste, selon eux, les causes de sa servitude. C’est que ce faux paria se soumet délicieusement à l’image très socialisée de l’être à part, sans morale, ni stabilité, qu’on rencontre déjà chez Pline. Les ratés, les faux artistes ont toujours été les premiers à alimenter le folklore de ce que nous continuons à appeler la bohème avec un reste ou un zeste de sentimentalisme. A partir du XVIe siècle, une proto-bohème s’observe dans une Italie où le monde de l’art se dirige à grands pas vers ce que nous connaissons aujourd’hui. Parce qu’ils étudient en historiens tous les comportements «anormaux» de la faune en question, les Wittkower préfèrent les rapporter à une exigence éthique paradoxale ou à un simple hédonisme, plutôt que céder à la vogue de la psychanalyse. Très, trop sévère à l’égard des disciples de Freud, ils entérinent parfois un certain déni du sexuel cher à leur profession. SG
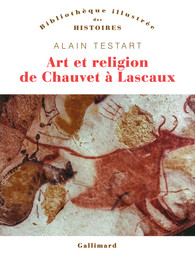 ***Alain Testart, Art et religion de Chauvet à Lascaux, Gallimard / Bibliothèque illustrée des histoires, 26€// Tout le monde me dit que la reconstitution de Chauvet est une merveille et je veux bien croire à cet émerveillement tant les peintures de cette grotte de la Drôme forcent l’admiration et portent au rêve. Ces lions, chevaux et rhinocéros, qui épousent en vigueur les protubérances de la paroi rocheuse, sont d’une vie inouïe, ils sont pourtant vieux de 39 000 ans. Au regard de Chauvet, Lascaux a été peinte hier… ce livre testamentaire fait son miel de leurs similitudes et de leurs différences. Il pousse le comparatisme jusqu’à inclure les peintures de Pech-Merle, étape obligée du Lot, et d’autres sites encore. Alain Testart, en revanche, se refuse à plaquer sur ce corpus ce que l’ethnographie, au XXe siècle, a mis au jour des cultures «primitives» en Afrique ou en Amérique du Sud. Les croyances du paléolithique supérieur ont, évidemment, leur spécificité et ne sont saisissables qu’au filtre d’une lecture iconographique serrée. Alain Testart, décédé avant de voir paraître son dernier livre, y jette sa grande science préhistorienne et sa clarté didactique. J’en retiens surtout que si les premières manifestations artistiques sont indissociables des pratiques mortuaires, elles répondent ici à la hantise de la reproduction, à l’angoisse de voir la vie s’éteindre. Les signes de la féminité répandent partout l’espoir de continuer. SG
***Alain Testart, Art et religion de Chauvet à Lascaux, Gallimard / Bibliothèque illustrée des histoires, 26€// Tout le monde me dit que la reconstitution de Chauvet est une merveille et je veux bien croire à cet émerveillement tant les peintures de cette grotte de la Drôme forcent l’admiration et portent au rêve. Ces lions, chevaux et rhinocéros, qui épousent en vigueur les protubérances de la paroi rocheuse, sont d’une vie inouïe, ils sont pourtant vieux de 39 000 ans. Au regard de Chauvet, Lascaux a été peinte hier… ce livre testamentaire fait son miel de leurs similitudes et de leurs différences. Il pousse le comparatisme jusqu’à inclure les peintures de Pech-Merle, étape obligée du Lot, et d’autres sites encore. Alain Testart, en revanche, se refuse à plaquer sur ce corpus ce que l’ethnographie, au XXe siècle, a mis au jour des cultures «primitives» en Afrique ou en Amérique du Sud. Les croyances du paléolithique supérieur ont, évidemment, leur spécificité et ne sont saisissables qu’au filtre d’une lecture iconographique serrée. Alain Testart, décédé avant de voir paraître son dernier livre, y jette sa grande science préhistorienne et sa clarté didactique. J’en retiens surtout que si les premières manifestations artistiques sont indissociables des pratiques mortuaires, elles répondent ici à la hantise de la reproduction, à l’angoisse de voir la vie s’éteindre. Les signes de la féminité répandent partout l’espoir de continuer. SG



 1968, dont il va adopter la rhétorique libertaire, marque son retour. Le grand chahut du printemps semble avoir rendu plus évidentes les ambiguïtés anticonsuméristes du pop et plus absurde leur succès international. En avril 1970, dans la galerie new-yorkaise d’Alexandre Iolas, s’ouvre sa dernière exposition américaine pour longtemps. Durant l’été, il conçoit la couverture du premier numéro de 20 ans: Lennon, Yoko Ono, un chameau, une poule, du vert et du rose encore, ça plane pour eux et pour lui, qui va faire l’expérience des communautés hippies. À Jean Clay, qui s’interroge sur ces «artistes qui tournent le dos à l’art», il déclare en mai 1972: «J’étais un peintre connu. Maintenant je suis un cinéaste sans moyens.» De fait, il bricole dans la vidéo, le cinéma ou le théâtre. Nouveau tournant en 1977, il renoue avec la figuration grinçante ou le symbolisme appuyé, avoue sa volonté d’inscription: «je suis un peintre français, dans la tradition de la peinture. Et c’est dans cette tradition là que je serai nouveau.» Au milieu des années 1980, François Pinault le prend sous son aile. Les tableaux, de plus en plus grands, bousculent toutes les limites, et d’abord celles du «bon goût», qui préfère alors le trash ou la fausse BD.
1968, dont il va adopter la rhétorique libertaire, marque son retour. Le grand chahut du printemps semble avoir rendu plus évidentes les ambiguïtés anticonsuméristes du pop et plus absurde leur succès international. En avril 1970, dans la galerie new-yorkaise d’Alexandre Iolas, s’ouvre sa dernière exposition américaine pour longtemps. Durant l’été, il conçoit la couverture du premier numéro de 20 ans: Lennon, Yoko Ono, un chameau, une poule, du vert et du rose encore, ça plane pour eux et pour lui, qui va faire l’expérience des communautés hippies. À Jean Clay, qui s’interroge sur ces «artistes qui tournent le dos à l’art», il déclare en mai 1972: «J’étais un peintre connu. Maintenant je suis un cinéaste sans moyens.» De fait, il bricole dans la vidéo, le cinéma ou le théâtre. Nouveau tournant en 1977, il renoue avec la figuration grinçante ou le symbolisme appuyé, avoue sa volonté d’inscription: «je suis un peintre français, dans la tradition de la peinture. Et c’est dans cette tradition là que je serai nouveau.» Au milieu des années 1980, François Pinault le prend sous son aile. Les tableaux, de plus en plus grands, bousculent toutes les limites, et d’abord celles du «bon goût», qui préfère alors le trash ou la fausse BD.
 Pas d’Anglais, au musée de la vie romantique, mais un grand nombre de peintres qui passèrent pour tels, vers 1820. Cette remarquable exposition nous ramène en effet à l’heureux temps où la jeunesse opposait vaillamment Lawrence et Bonington au sec davidien. L’esquisse peinte n’a pas attendu les romantiques pour se voir reconnaitre un statut à part, esthétiquement et économiquement valorisé. Tout au long du XVIIIe siècle, on assiste à cette montée en puissance. Critiques et marchands n’ont pas de mots assez colorés pour dire le feu de l’esquisse, sa capacité à garder et communiquer la pensée plastique et poétique de l’artiste en son jaillissement premier. S’il y a changement progressif après 1800, il résulte à la fois d’une évolution marquante des finalités comme des conduites de la pratique picturale. Que ce mouvement n’ait jamais été homogène, l’exposition le souligne très bien. Forte d’une centaine de numéros, elle intègre largement le cursus académique à son panorama. Car l’esquisse romantique ne s’est pas toujours affranchie des conventions. Cela se vérifie, par exemple, en comparant l’approche qu’eurent les différents disciples de l’atelier
Pas d’Anglais, au musée de la vie romantique, mais un grand nombre de peintres qui passèrent pour tels, vers 1820. Cette remarquable exposition nous ramène en effet à l’heureux temps où la jeunesse opposait vaillamment Lawrence et Bonington au sec davidien. L’esquisse peinte n’a pas attendu les romantiques pour se voir reconnaitre un statut à part, esthétiquement et économiquement valorisé. Tout au long du XVIIIe siècle, on assiste à cette montée en puissance. Critiques et marchands n’ont pas de mots assez colorés pour dire le feu de l’esquisse, sa capacité à garder et communiquer la pensée plastique et poétique de l’artiste en son jaillissement premier. S’il y a changement progressif après 1800, il résulte à la fois d’une évolution marquante des finalités comme des conduites de la pratique picturale. Que ce mouvement n’ait jamais été homogène, l’exposition le souligne très bien. Forte d’une centaine de numéros, elle intègre largement le cursus académique à son panorama. Car l’esquisse romantique ne s’est pas toujours affranchie des conventions. Cela se vérifie, par exemple, en comparant l’approche qu’eurent les différents disciples de l’atelier