
Dans ses Cahiers inédits, qui le restèrent longtemps, Henri de Régnier rapporte en février 1896 : « Je rencontre Bonnières chez Judith Gautier et je lui dis : Si j’ai le plaisir de vous survivre, j’écrirai votre vie. » Trop occupé de lui-même, l’homme au monocle avala sa promesse, il a pourtant survécu plus de trente ans à celui qui contribua à le lancer. Les poètes à rimes fatiguées sont des ingrats. Mort en avril 1905, à 55 ans, Robert de Bonnières disparut assez vite des chroniques et anthologies littéraires de la Belle Epoque. Cet effacement absurde chagrinait Pierre Louÿs, autre cadet qui gagna à son commerce : le singulier érotomane avait bien connu notre « mondain » à la plume nette, aux névroses incurables, il avait aussi partagé son goût des « filles », de la poésie parnassienne, en son versant le moins guindé, et de la bonne peinture, la plus fraîche. Riche d’autres vertus encore, comme l’attachement au Christ et à la patrie, Bonnières appartenait à ces figures dont on prie chaque jour qu’un biographe alerte se saisisse, avec compétence et, selon le mot en vogue, empathie. Patrick de Bonnières, bon sang ne saurait mentir, a magnifiquement remis en selle cet ancêtre au blason terni par un siècle de négligence routinière. De onze ans l’aîné de Marcel Proust, qui jalousa un peu l’accueil que fit le grand monde à ce confrère du Gaulois et du Figaro, Bonnières précéda aussi Marcel dans la peinture acide du gratin. La lecture de Jeanne Avril et du Petit Margemont, deux de ses romans à succès, vous en convaincra en vous amusant. Car Bonnières ne laissait pas sa mélancolie maladive envahir manuscrits et correspondance. La présente biographie, forte des archives familiales, d’un goût sûr pour les arts et d’un vrai sens de l’Histoire, le suit depuis ses brillantes études (Stanislas !), le romantisme forcené de la fin du Second Empire (à vingt ans, il idolâtre Barbey d’Aurevilly !) et la sale guerre de 1870, expérience décisive qui le plonge parmi les pauvres diables de l’armée de la Loire. D’autres que lui, sous la IIIe République si hésitante et bientôt si anticléricale, auraient rejoint de mauvais combats en conservateur déçu, l’antiwagnérisme, l’agitation brouillonne à la Déroulède, l’antisémitisme… Patrick de Bonnières fait preuve de courage et de clairvoyance en dédouanant Robert de cette lèpre. Son analyse des Monach, roman qui observe les alliances multipliées entre la vieille aristocratie et les élites juives, confirme celle des Archives israélites, elle prélude aux pages très fines consacrées à l’Affaire Dreyfus, qui met le patriotisme de Bonnières et son respect de l’armée au supplice. Il était de ces hommes qui ne craignent pas de croiser le fer avec leur entourage, de Maurice Barrès à l’anti-baudelairien Brunetière. Au côté de son épouse Henriette, « beauté botticellienne » que James Tissot, Jacques-Emile Blanche et Albert Besnard ont mieux servie que Renoir, Robert fut aussi le Sainte-Beuve (parent éloigné) ou l’oncle de la vague de 1890, se frottant au monde de La Revue blanche, à Gide et Valéry, à Jean de Tinan, plus qu’au très haineux Jean Lorrain.

Vrai viveur 1900, se gardant bien de sacrifier à sa noblesse d’âme ce que lui dictaient ses désirs, Bonnières scandalisa, à l’occasion, la très effrontée Rachilde. Faste millésime que 1884 ! Ce fut l’année des Monach, d’A rebours et de Monsieur Vénus, peut-être ce que la future Madame Valette a écrit de plus cru, de plus drôle, de plus beau, de plus parfait. Les bonheurs allant par deux, ce bref roman des contorsions hermaphrodites de la libido reparaît en Folio classique flanqué de Madame Adonis. Née en 1860, précoce de plume et du reste, Marguerite Eymery sort de l’adolescence et de l’obscurité des débutantes à coup de petites audaces, un poème envoyé à Hugo en 1875, des publications de contes ici et là, avant de plus certaines témérités. Rachilde, contraction de Rachel et Mathilde, propose Martine Reid, sent l’Orient rococo. Ce sera le surnom, étiré jusqu’en 1953, d’une des grandes dames des lettres françaises, qui n’a pas défendu le beau sexe, semblable en cela à Colette, en pratiquant un féminisme qui l’eût coupée des hommes et de la porosité des genres. Monsieur Vénus, on l’a deviné, joue du transfert et du travestissement, et surtout du fantasme assumé jusqu’aux limites de la vraie cruauté. Rachilde n’a pas écrit pour rien un remarquable Marquise de Sade. Revenons à Monsieur Vénus où l’autre Sade a un petit rôle… Raoule de Vénérande, orpheline moins janséniste que son chaperon de tante, tisse d’imprévisibles liens avec un jeune homme désargenté sur lequel son dévolu prendra toutes les formes, sauf celles dont la nature la ou le prive. Car la chère enfant ne sait plus très bien, et le lecteur avec elle, si elle n’a pas changé d’instrument intime en changeant de masque ou de veston. Bref, c’est délicieusement décadent, déroutant, « abominable », ainsi que l’écrivit le malicieux Barrès, au lendemain d’une brève aventure avec Rachilde. Se succédèrent deux éditions bruxelloises en 1884 et 1885 (le roman sent le soufre), la seconde assortie d’une préface du vieil Arsène Houssaye, que donne le présent volume et que son incipit honore : « Le cœur est une cage où l’on tient enfermé l’Amour avec défense de chanter trop haut. » Il savait sa jeune amie de la race des oiseaux furieux. Du reste, Barrès, préfacier de la 3e édition en 1889, salue « Mademoiselle Baudelaire » en lui faisant gloire, sous l’apparent grief de lui reprocher son insolente impudeur, d’être une « fleur du Mal ». Les échos de Mademoiselle de Maupin ne pouvaient échapper à l’auteur de Sous l’œil des barbares. Mais je m’étonne que ni Barrès, ni Martine Reid, n’aient senti la parenté ironique qui fait de l’intrépide Raoule l’âme sœur ou damnée de certaines héroïnes de George Sand et d’Edmond de Goncourt. Rachilde s’offre même un autre larcin puisque sa Raoule possède un portrait d’elle par Bonnat. Ce dernier n’a pas toujours peint de sages petites filles. Mais le Bonnat de Monsieur Vénus est déjà un Balthus, l’amazone « portait un costume de chasse du temps de Louis XV et un lévrier roux léchait le manche du fouet que tenait sa main magnifiquement reproduite. » Roux comme sa victime à deux sexes, peintre médiocre, lui. « Soyons Régence » : Raoule et Rachilde s’y entendaient. Stéphane Guégan

*Patrick de Bonnières, Vie et tourments d’un homme de lettres fin de siècle, Honoré Champion, 48€ // Rachilde, Monsieur Vénus suivi de Madame Adonis, Gallimard, Folio classique, 9,90€. Signalons aussi la parution de La Tour d’amour (1899), un autre huis clos de Rachilde, moins érotique, mais plus nautique, qui ne retiendra pas que nos frères et fiers bretons (Gallimard, L’Imaginaire, préfaces de Camille Islert et de Julien Mignot, 8,90€). Un peu moins de vingt ans après Henriette de Bonnières de Wierre, Camille Barrère pose en 1906, à Rome, au palais Farnèse dont il est le maître depuis la fin des années 1890, devant Albert Besnard. Au sujet d’Enrico Serra, De la discorde à l’entente : Camille Barrère et l’Italie (1897-1924), Direction des Archives (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) / Ecole nationale des chartes (CTHS), 2023, postface de Maurizio Serra, voir mon compte-rendu dans Commentaire, hiver 2023, p. 919-920.
BONNARD BONNES ONDES
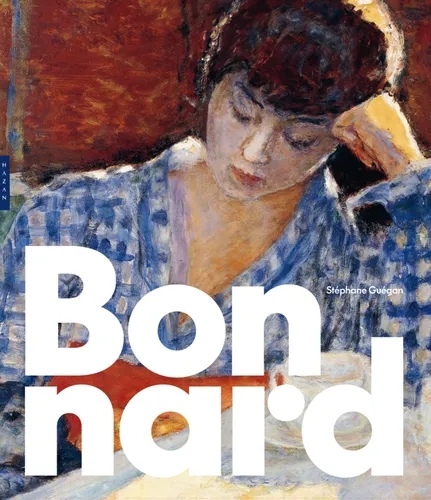
Au sujet de Bonnard (Hazan, 2023), la chronique de Laurent Delmas :
Stéphane Bern, Historiquement vôtre, Europe 1, 10 janvier 2024, La véritable histoire de Marthe et Pierre Bonnard, une histoire d’amour et de secrets :
A venir : Alain Finkielkraut, La Postérité de Bonnard, Répliques, France Culture, 3 février 2024, 9h00, avec Stéphane Guégan et Benjamin Olivennes. J’emprunte le titre de ce blog au dernier livre d’Alain Finkielkraut. Pas plus qu’une apologie de l’opéra de Bizet, malgré ses références à Nietzsche qui faisait grand cas du musicien solaire, Pêcheur de perles (Gallimard, 19,50€) ne défend le fatalisme de l’huître, forgeant son or loin de la boue du réel. Alain Finkielkraut n’a pas déserté la cité et ses maux, le monde et ses fractures, à commencer par l’Europe de son cher Kundera, peut-être le premier à avoir pensé la survie d’une certaine « occidentalité » (verbatim) en dehors de toute intolérance identitaire. Ce n’est pas parce que le peuplement du vieux continent évolue à grande vitesse qu’il faudrait montrer moins d’ardeur à préserver notre culture que les nouveaux arrivants la leur. Il est vrai qu’à la théorie des seuils de coexistence, chère à Lévi-Strauss, l’intelligentsia dominante substitue désormais le miracle diversitaire. La dégradation de plus en plus rapide de la planète ne laisse pas d’autre place, sans doute, à l’eschatologie de l’avenir radieux. De ce dernier avatar du rousseauisme moderne, Alain Finkielkraut a de bonnes raisons de se méfier, soucieux qu’il est davantage du présent et de ses faillites, le fléchissement des humanités, le naufrage scolaire, la criminalisation de l’art, l’abaissement continu de la civilité, l’atomisation sociale, les progrès de la peur et le recul du courage politique. En quinze citations, qui ouvrent chaque chapitre et guident de très actuelles divagations, au sens de Mallarmé, ce livre tire sa morale de la règle qu’il se donne : nos mots et nos idées ont des racines, nous sommes fondamentalement des héritiers, comme Mona Ozouf le disait de Jules Ferry, père d’une école qui n’est plus que l’ombre d’elle-même, et d’une Nation qui ne croit plus en elle. Au même moment, L’Après littérature (Stock, 2021) entre en Folio (Gallimard, 8,90€), cet essai ferme sur une autre forme de déliaison, et bientôt de double divorce : celui des lecteurs avec la littérature d’avant, et de l’écrivain avec son magistère ou sa tendre aura. SG

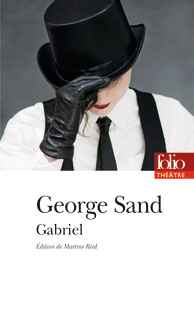
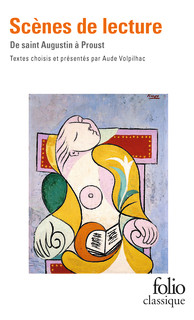
 Dieu que Casanova avait la bougeotte ! Une sorte de mouvement perpétuel règle sa vie et le récit qu’il en fait au soir de son existence haletante. Même quand il lui arrive de se poser quelques mois, il ne cesse de gondoler ici et là, à la faveur des femmes qui le chavirent, de son goût pour les arts, la musique et le théâtre, et de ses besoins d’argent. Les mentors et les protecteurs filent à un rythme aussi effréné que les kilomètres. Devant les yeux de ses lecteurs abasourdis les plus grands noms surgissent et disparaissent sans faire de manière. L’aventure pour ce géant aux appétits féroces cesse d’être une péripétie du destin, un motif de surprise, elle en constitue le moteur permanent. Astronome à ses heures, «chrétien fortifié par la philosophie», comme il le dit pour expliquer la recette du bonheur, Casanova a cru en sa bonne étoile, et s’est doté d’une sérieuse capacité à retourner les situations délicates. La terre tourne, faisons comme elle, c’est sa morale. Car il en a une et la défend, c’est déjà celle de
Dieu que Casanova avait la bougeotte ! Une sorte de mouvement perpétuel règle sa vie et le récit qu’il en fait au soir de son existence haletante. Même quand il lui arrive de se poser quelques mois, il ne cesse de gondoler ici et là, à la faveur des femmes qui le chavirent, de son goût pour les arts, la musique et le théâtre, et de ses besoins d’argent. Les mentors et les protecteurs filent à un rythme aussi effréné que les kilomètres. Devant les yeux de ses lecteurs abasourdis les plus grands noms surgissent et disparaissent sans faire de manière. L’aventure pour ce géant aux appétits féroces cesse d’être une péripétie du destin, un motif de surprise, elle en constitue le moteur permanent. Astronome à ses heures, «chrétien fortifié par la philosophie», comme il le dit pour expliquer la recette du bonheur, Casanova a cru en sa bonne étoile, et s’est doté d’une sérieuse capacité à retourner les situations délicates. La terre tourne, faisons comme elle, c’est sa morale. Car il en a une et la défend, c’est déjà celle de  – Martine Reid, George Sand, Folio/Gallimard, 9,10€. Musset, et le volume de La Pléiade le rappelle, fut l’un des fervents lecteurs de la première édition des Mémoires de Jacques Casanova. Les articles qu’il donna au Temps en 1831 prouvent qu’il ne se laissait pas abuser par la pruderie et les périphrases hypocrites de la publication infidèle de Brockhaus et Laforgue. Jules Sandeau, Sainte-Beuve et Delacroix ne restaient pas froids non plus à sa lecture. Comment George Sand, qui les fréquenta tous et plus encore, aurait-elle pu échapper à l’emprise du «faune en bas de soie» (
– Martine Reid, George Sand, Folio/Gallimard, 9,10€. Musset, et le volume de La Pléiade le rappelle, fut l’un des fervents lecteurs de la première édition des Mémoires de Jacques Casanova. Les articles qu’il donna au Temps en 1831 prouvent qu’il ne se laissait pas abuser par la pruderie et les périphrases hypocrites de la publication infidèle de Brockhaus et Laforgue. Jules Sandeau, Sainte-Beuve et Delacroix ne restaient pas froids non plus à sa lecture. Comment George Sand, qui les fréquenta tous et plus encore, aurait-elle pu échapper à l’emprise du «faune en bas de soie» (