
Le militaire et l’historien partagent la passion du renseignement, l’espion y ajoute celle de la filature, les moins scrupuleux acceptant de trahir par intérêt, vice ou promesse de mort. Des agents doubles, et de toute nationalité, des traques, des individus retournés, selon le jargon en vigueur chez les mouches, le livre de Gérard Chauvy n’en manque pas, ce qui contribue au vertige que procure l’enquête pionnière qu’il a menée au pays de l’Abwehr. Les services secrets allemands, au temps du nazisme, les lecteurs de Modiano et d’Etienne de Montety en connaissaient au moins l’existence, pour avoir savouré Un pedigree du premier, ou l’Honoré d’Estienne d’Orves du second. Les hommes du Lutetia n’ont pas toujours brillé dans l’anticipation des attaques alliées, mais ils contribuèrent fortement à décimer les réseaux de résistance français en concurrence ou en concertation avec la Gestapo. Bien que l’Abwehr ne soit pas sortie toute casquée de la cuisse d’Adolf Hitler, l’espionnage allemand connaît à partir de 1933 une réorganisation complète, elle est confiée à l’amiral Wilhelm Canaris, que Chauvy dit insaisissable afin de mieux percer le sphinx : il finira pendu au petit matin, le 9 avril 1945, nu, au bout d’une corde à piano, garante d’un long supplice. Plus hitlérien qu’on a voulu le dire, Canaris ne semble pourtant n’avoir jamais été mêlé aux complots visant à éliminer le dictateur. Certes, il était resté étranger au groupe des fanatiques, tel Heydrich, qui avait servi sous ses ordres, et surtout Himmler, qui le suspectera de se préparer une porte de sortie auprès des Anglais et des Américains quand lui-même, conscient du désastre proche, pensait pouvoir assurer ses arrières et, changeant de bord, maintenir la lutte contre le communisme. Canaris, insensible aussi aux sirènes de Moscou, fait ses preuves avant de prendre la tête du renseignement : répression du spartakisme, réorganisation de la flotte ensuite, puis création d’un réseau en Espagne, avec des hommes destinés à suivre Franco. Quand la guerre civile y éclate, en juillet 1936, il tient entre ses mains de sérieux atouts. La France et son noyautage sont immédiatement inscrits au programme de Canaris. L’Angleterre, de même, et plus encore après juin 40. Du côté de la Résistance extérieure aux réseaux gaullistes, l’un des premiers coups de filet de l’Abwehr frappe le groupe du musée de l’Homme, au sujet duquel le nom de Jean Paulhan n’est pas cité. Passant des acteurs aux lieux d’action, quels qu’ils soient, Chauvy fait vivre à son lecteur ces opérations de l’ombre qui se multiplient. Les Allemands chassent ; certains Français ou Françaises, Mata Hari au petit pied, livrent, l’horreur s’installe. L’arrestation de Jean Moulin, le 21 juin 1943, conserve sa part d’opacité, comme bien des aspects que Chauvy examine avec prudence. Mais 1943 est aussi l’année où l’Abwehr se « ridiculise », mystifiée par le renseignement britannique, qui parvient à maquiller le débarquement de Sicile. Il ne reste plus à Canaris qu’à quitter la scène, paradoxe, sur des soupçons infondés. Il est arrêté quelques jours après l’attentat du 20 juillet 1944, on connaît la suite.

Notre connaissance de la propagande nazie, en France occupée, s’est surtout nourrie de l’activisme d’Otto Abetz, l’ambassadeur d’Allemagne, francophile et lié à nombre d’écrivains illustres dès avant la défaite. Revenu alors à Paris, cet hitlérien agit en homme de Ribbentrop. Goebbels avait le sien, il s’appelait Heinz Schmidtke et n’avait pas fait, lui, ses premiers pas au sein des organisations du Parti national-socialiste. Officier de carrière, il deviendrait, pensait-on, un agent servile du ministre de l’Éducation. L’avenir n’est jamais écrit. Gourou du dressage des esprits, fou de cinéma et de peinture modernes, Goebbels ne pouvait abandonner la zone nord à d’autres services que ceux qu’il pouvait contrôler à distance. Rattachée au commandement militaire de la capitale, la tentaculaire Propaganda-Abteilung Frankreich attendait son historien. Ses archives peu consultées dorment à Bourges. Pascal Jardin s’y est plongé avec courage ; le produit de son immersion, plutôt que la somme universitaire qu’il faudra un jour en tirer, s’apparente à une synthèse vivement écrite, aussi lisible que cohérente, trop cohérente peut-être. La thèse, assez partagée aujourd’hui, Jardin la résume d’une jolie formule : une « main invisible », d’autant plus efficace qu’elle refusait la censure et la propagande trop brutales, a tenu l’activité éditoriale, journalistique et artistique dans un gant de velours trompeur. La stratégie, en somme, consistait à ne pas stimuler inutilement l’hostilité des Français envers l’Allemagne, et favoriser l’apparence d’une collaboration « correcte ». Au-delà de la stigmatisation ouverte des Juifs, des Francs-Maçons et des communistes (après la lune de miel du Pacte), les forces d’occupation auraient caché leur jeu. Jardin lui-même admet que la presse écrite et radiophonique fit l’objet d’une surveillance étroite, et très « visible », comme le monde du livre et du théâtre. Se serait-elle exercée autrement sur le cinéma et les arts plastiques ? Goebbels pensa un temps asservir le premier, c’eût été aller contre les directives d’Hitler et froisser le public français, qui bouda les produits très démonstratifs venus d’Allemagne. Mais, estime Jardin, « la propagande par le cinéma n’est pas le cinéma de propagande ». En d’autres termes, la liberté abandonnée au 7e art était un piège. On peut, à l’inverse, croire aux effets positifs de l’ambiguïté de cette « surveillance », et reconnaître la force très neuve d’une bonne partie des films produits alors, plus de 200, comme le patriotisme qu’ils armaient à l’abri des salles obscures. Je dirai la même chose des arts plastiques encore moins soumis à la censure, toute faille de l’oppression générale fut bonne à exploiter. On apprend, d’ailleurs, que le lucide Schmidtke était hostile à l’exposition Arno Breker, il en pressentait les effets négatifs derrière l’outrance néoclassique du protégé d’Hitler, ce que l’Ode de Jean Cocteau sut utiliser. Et Comœdia, où elle parut en mai 1942, était moins un symbole de « la compromission », dixit Pascal Jardin, que la preuve des vertus paradoxales de l’équilibrisme. Jean Paulhan n’y eût pas collaboré autrement. Mots et images, en de bonnes mains, savaient montrer deux faces.

L’extermination des Juifs, de façon massive en Europe centrale, s’est accompagnée d’une euphémisation du langage propre à la rhétorique nazie ; elle avait un double avantage si l’on ose dire, disculper illusoirement les hommes et femmes impliquées dans les rouages de la Shoah et dissimuler autant que possible leur réalité au reste du monde. Bien avant de détruire les preuves concrètes de la barbarie rationalisée au soir du IIIe Reich, on détruisit le sens des mots, manière aussi de déshumaniser la victime en la privant de son être et de la réalité du crime perpétré contre elle. Dans la langue des bourreaux, « transférer » ou « éteindre » se substituait à « tuer ». Soixante-dix ans après sa parution, le grand livre du rescapé et combattant Michel Borwicz (1911-1987) bénéficie d’une nouvelle édition très annotée, et confiée aux soins experts de Judith Lyon-Caen : Écrits des condamnés à mort sous l’occupation nazie, témoigne, au sens pascalien, d’un double refus du silence. Le leur, le sien. Loin de s’éteindre, les enfermés, ceux des ghettos, des camps et des prisons de la Résistance, ont protesté de leurs mots, de leurs poèmes souvent, contre le mutisme et la mort planifiés. Cachés tant bien que mal, enterrés souvent en vue de retrouver la lumière quelque jour, – comme « l’ardent sanglot » baudelairien -, ces messages de l’enfer s’adressaient à nous. Le temps qui sépare les lecteurs actuels de la publication de cette étude capitale, à la croisée de l’histoire et l’anthropologie, aurait pu réduire sa valeur documentaire ou analytique. Il n’en est rien. Ce que Michel Borwicz, en formidable éclaireur de la mémoire des « retirés » ou des « écartés », révèle au sujet de la Pologne et de l’Ukraine sous coupe allemande, s’est vu amplifier par ses successeurs : on pense notamment au terrifiant Terres de sang de Timothy Snyder. La leçon vaut aussi pour aujourd’hui et nos phraseurs aux « belles âmes » qui voilent le réel de leurs turpitudes langagières. Stéphane Guégan
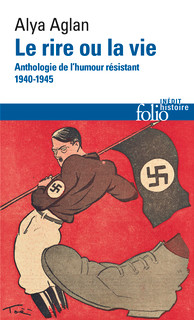
*Gérard Chauvy, L’Abwehr. 1939-1945 : les service secrets allemands en France, Perrin, 24€ // Pascal Jardin, La Stratégie de la main invisible, Bouquins, 24€. Page 370, l’auteur déforme, sauf erreur, les propos de George Desvallières rapportés par Le Matin au sujet du Salon d’Automne, où les artistes juifs ne sont plus autorisés à exposer; Desvallières, peintre important et peu canonique, du reste, ne se réjouit pas de leur exclusion, et n’en fait pas la condition d’un art redevenu plus français et plus classique, mot qu’il faut entendre en contexte aussi. // Michel Borwicz, Écrits des condamnés à mort sous l’occupation nazie, 1939-1945, préface de René Cassin, édition critique de Judith Lyon-Caen, Gallimard, Tel, 16€ // A lire également : Alya Aglan, Le Rire ou la vie. Anthologie de l’humour résistant 1944-1945, Gallimard, Folio Histoire inédit, 9,20€ et Patrick Wald Lasowski, Avant la rafle. Mai 1942, Stilus, 20€, un « roman », dit sa couverture, dont on comprend vite ce qu’il contient de tragédie familiale et de traces personnelles ineffaçables. SG







 L’élimination des Juifs d’Europe, pour le dire comme Hitler et Himmler, ne peut plus être pensée isolément des massacres à grande échelle qu’a connus cette période. Entre l’affamement des millions d’Ukrainiens sacrifiés à la nouvelle économie socialiste et celui des prisonniers de guerre soviétique après l’invasion de la Russie par la Wehrmacht, il se sera écoulé moins de dix ans. Au total, près de 8 millions d’individus furent supprimés avant que la mise en œuvre de la Solution finale n’ajoute ses martyrs à la liste noire. On le sait, jusqu’en 1941, les nazis pensèrent à déporter massivement les différentes populations juives hors de cette Europe qu’ils souhaitaient germaniser. Dès avant son accession au pouvoir, Hitler avait promis de nouvelles terres aux Allemands, un Empire comparable, voire supérieur à ceux de la France et de l’Angleterre. La conquête de la Pologne et l’annexion de la Russie devenaient d’indispensables prémices. Mais il lui fallut vite admettre que Staline, inquiété à l’Est par les Japonais, avait les dents aussi longues en matière de frontières naturelles. Ce qui rend le livre de Snyder si neuf, et sa lecture si fascinante, c’est sa manière d’entrelacer ces deux ambitions et leurs logiques sanguinaires. Si l’antisémitisme est bien l’un des fondements du programme nazi dès les années 1920, s’il donne une assise à la vision raciale, antilibérale et anticapitaliste de Hitler, il ne saurait faire oublier la politique ethnique de Staline et leur commun impérialisme.
L’élimination des Juifs d’Europe, pour le dire comme Hitler et Himmler, ne peut plus être pensée isolément des massacres à grande échelle qu’a connus cette période. Entre l’affamement des millions d’Ukrainiens sacrifiés à la nouvelle économie socialiste et celui des prisonniers de guerre soviétique après l’invasion de la Russie par la Wehrmacht, il se sera écoulé moins de dix ans. Au total, près de 8 millions d’individus furent supprimés avant que la mise en œuvre de la Solution finale n’ajoute ses martyrs à la liste noire. On le sait, jusqu’en 1941, les nazis pensèrent à déporter massivement les différentes populations juives hors de cette Europe qu’ils souhaitaient germaniser. Dès avant son accession au pouvoir, Hitler avait promis de nouvelles terres aux Allemands, un Empire comparable, voire supérieur à ceux de la France et de l’Angleterre. La conquête de la Pologne et l’annexion de la Russie devenaient d’indispensables prémices. Mais il lui fallut vite admettre que Staline, inquiété à l’Est par les Japonais, avait les dents aussi longues en matière de frontières naturelles. Ce qui rend le livre de Snyder si neuf, et sa lecture si fascinante, c’est sa manière d’entrelacer ces deux ambitions et leurs logiques sanguinaires. Si l’antisémitisme est bien l’un des fondements du programme nazi dès les années 1920, s’il donne une assise à la vision raciale, antilibérale et anticapitaliste de Hitler, il ne saurait faire oublier la politique ethnique de Staline et leur commun impérialisme. Cette question concerne aussi les flux, militaires et civils, que met en scène le dernier livre de Ian Kershaw avec un même souci de la documentation de première main. Son récit des ultimes mois de la seconde guerre mondiale, oscillant entre l’horreur et la stupeur, se déroule comme si l’auteur en ignorait l’issue. Du refus de tout finalisme, le livre tire un double avantage : il donne plus de poids à la folle résistance que les Allemands opposèrent sur tous les fronts, il permet de penser autrement les causes de ce combat désespéré. Car ces causes sont multiples. Au gré des archives qui s’ouvrent ici et là, la chute de l’Allemagne nazie est devenue susceptible d’analyses moins globalisantes. Encore fallait-il rompre avec l’idée d’une population de fanatiques, adhérant en bloc et jusqu’au bout au programme impérialiste et raciste que Hitler lui avait fixé dès 1933. Fidèles au führer, obsédés par l’humiliation de 1918, les Allemands auraient refusé de capituler, au nom du grand sacrifice. Le crépuscule des dieux… L’enquête de Kershaw, exemplaire et tragiquement vivante, ne cède rien à Wagner.
Cette question concerne aussi les flux, militaires et civils, que met en scène le dernier livre de Ian Kershaw avec un même souci de la documentation de première main. Son récit des ultimes mois de la seconde guerre mondiale, oscillant entre l’horreur et la stupeur, se déroule comme si l’auteur en ignorait l’issue. Du refus de tout finalisme, le livre tire un double avantage : il donne plus de poids à la folle résistance que les Allemands opposèrent sur tous les fronts, il permet de penser autrement les causes de ce combat désespéré. Car ces causes sont multiples. Au gré des archives qui s’ouvrent ici et là, la chute de l’Allemagne nazie est devenue susceptible d’analyses moins globalisantes. Encore fallait-il rompre avec l’idée d’une population de fanatiques, adhérant en bloc et jusqu’au bout au programme impérialiste et raciste que Hitler lui avait fixé dès 1933. Fidèles au führer, obsédés par l’humiliation de 1918, les Allemands auraient refusé de capituler, au nom du grand sacrifice. Le crépuscule des dieux… L’enquête de Kershaw, exemplaire et tragiquement vivante, ne cède rien à Wagner.