
Les démarrages de Marcel Proust, car il y en eut plusieurs, n’ont pas tous bonne réputation. Chez les plus fanatiques, c’est la Recherche ou rien. On est tenté de les comprendre sans leur pardonner d’écarter les lecteurs de ce bijou 1896 que sont Les Plaisirs et les Jours, dont la réédition récente, presque à l’identique, n’a pas rencontré le succès qu’elle méritait (1). Son ambiance Revue blanche et Figaro, matinée de perversité fin de siècle et d’introspection déjà secrètement proustienne, atteint, à maints endroits, cette vérité nouvelle qui ébranle le lecteur, et non le voyeur, dans la peinture des sentiments amoureux et familiaux. Et que dire des manières que firent certains au sujet des textes, les chutes du premier opus en l’occurence, dont Bernard de Fallois, au seuil de la mort, évita la dispersion, cette autre mort qu’est souvent la vente aux enchères. Au cadeau d’outre-tombe de celui qui fut l’un des éditeurs et commentateurs essentiels de l’écrivain, il faut désormais ajouter un ensemble de manuscrits, les dits Soixante-quinze feuillets entrés à la Bibliothèque nationale de France par sa volonté posthume (2). Ils ne viennent pas abonder le trésor de la centaine de cahiers et carnets, grossir le flux des manuscrits, ils en révolutionnent l’intelligence, comme le soulignent avec soulagement Jean-Yves Tadié et Nathalie Mauriac Dyer, que ces textes inédits en majorité ont fait longtemps rêver. Proust lui-même avait signalé leur existence en 1908 : ces pages, de peu antérieures, datent de ce moment exquis, « moment sacré » (Tadié) où, ne sachant pas encore très bien où il va, et supposé écrire ce qui aurait pu devenir un Contre Sainte-Beuve, Proust ébauche La Recherche en l’ignorant, en l’absence surtout du principe qui va lui permettre de recoller les morceaux de sa vie et d’en tirer un roman qui la raconte, le principe de la mémoire involontaire. La « jointure » manque encore (3), mais le feu est revenu. Plutôt que de pleurer éternellement maman et d’accepter la panne qui a remisé le beau Jean Santeuil en 1898-1899, Marcel, 37 ans, retourne au roman, aux années des primes émois, à Auteuil et Illiers, et aux garçons de Cabourg déguisés en filles et en fleurs. Et le miracle se produit, notamment parce que l’écrivain laisse filer sa plume, libre qu’elle est de tout horizon narratif précis. Proust, note Nathalie Mauriac, « travaille d’abord par coulées d’écritures indépendantes », juxtaposées, en attente d’être composées, tissées. La « petite robe », à quoi il devait comparer La Recherche sans cesse rapiécée jusqu’à sa mort, reste à bâtir. Les croquis et esquisses de 1907-08 se bornent à débrouiller une partie du personnel et des épisodes appelés, plus tard et plus profondément, à établir le futur roman sur son ambition de fresque sociale et son involution de sablier inversé.

Tout brouillons qu’ils soient, la griffe se sent, nous émeut de son léger tremblement, de ses ratures. Quelques exemples ? « Une soirée à la campagne », où s’ébauche le Combray de Du côté de chez Swann, a été peint sur le motif, mais à Auteuil, chez le grand-oncle maternel, Louis Weil, dont on comprend enfin combien il préfigura la figure de l’amant d’Odette autant, voire plus que Charles Haas. La première scène où nous transporte Proust fusionne l’humour à l’humeur, le sourire à la tendresse rétrospective du Narrateur, prenant le parti d’une vieille dame, sa grand-mère, qui reste désespérément attachée à la vie : « On avait rentré les précieux fauteuils d’osier sous la vérandah car il commençait à tomber quelques gouttes de pluie et mes parents après avoir lutté une seconde sur les chaises de fer étaient revenus s’asseoir à l’abri. Mais ma grand-mère, ses cheveux grisonnants au vent, continuait sa promenade rapide et solitaire dans les allées parce qu’elle trouvait qu’on est à la campagne pour être à l’air et que c’est une pitié de ne pas en profiter. » Tout y est, en plus de la longueur du phrasé, aux confins de la lourdeur. C’est l’art suprême. À la suite, les thèmes du baiser maternel et de la culture familiale (Sursum corda) font une apparition encore incertaine. La perfection de La Recherche n’est pas encore passée par là, mais elle se devine aux reprises de certains feuillets, « Jeunes filles », par exemple. Comparons leurs deux amorces : « Un jour, comme deux oiseaux de mer marchant sur le sable et prêts à s’envoler, j’aperçus sur la plage deux fillettes, plus tout à fait des petites filles, pas encore des jeunes filles, dont l’aspect inconnu, la toilette étrange pour moi, me les firent prendre pour des étrangères de passage et que je ne reverrais plus. Elles marchaient, rieuses, hautaines, semblaient ne pas voir les autres êtres humains qui étaient sur la plage, et parlaient fort. » Proust continue, puis s’interrompt et réécrit son début. Cela donne : « Un jour sur la plage marchant gravement sur le sable comme deux oiseaux de mer prêts à s’envoler, j’aperçus deux petites filles, deux jeunes filles presque, que leur aspect nouveau, leur toilette inconnue, leur démarche hautaine et délibérée me firent prendre pour deux étrangères que je ne reverrais jamais ; elles ne regardaient personne et ne me virent pas. » La concision flaubertienne de la version 2 s’accompagne d’une incertitude accrue quant à la nubilité des promeneuses, et du recentrage de la douleur d’être ignorée sur celui qui parle et observe le manège de ces drôles d’oiseaux (Nathalie Mauriac soupçonne des allusions cryptées à Alfred Agostinelli).
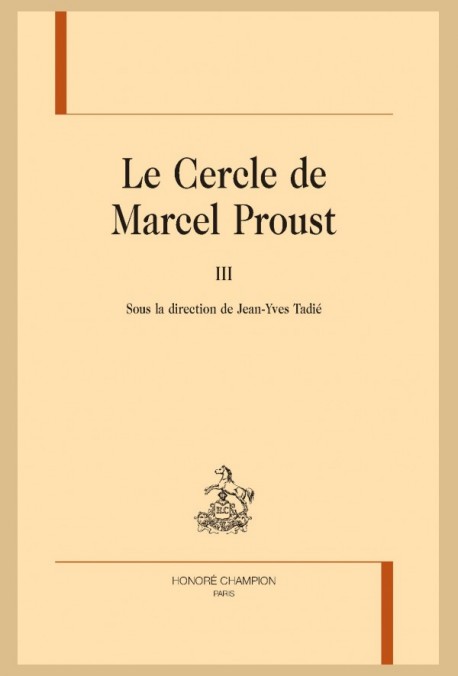
Les Soixante-quinze feuillets ne donnent aucune prise à la judéité de l’auteur, qu’il intègrera à La Recherche, de façon aussi nette que troublante, à travers la figure du grand-père et des remous persistants de l’affaire Dreyfus. Proust, en revanche, n’y fait pas mystère de son attrait pour la vieille aristocratie aux patronymes chargés de terres ancestrales et du temps long de l’histoire de France. Il y a un précoce snobisme armorial chez Marcel, c’est à peu près le seul que lui concèdent les experts d’aujourd’hui, si embarrassés par le mondain effréné qu’est resté Proust jusqu’au bout. Le sujet effraye encore quoique l’information se densifie au gré, notamment, des colloques de la fondation Singer-Polignac : le nom seul de cet endroit exquis nous rappelle le gratin auquel Proust jouissait d’appartenir en dépit des exclusions de caste dans le Paris d’alors. Le plus récent volet éditorial de ces rencontres savantes autour du cercle de Proust vient de paraître et il apporte son lot d’informations (4). Sa lecture est indispensable à toute personne que l’imagerie d’Epinal insupporte. Sans être aussi nombreux que ceux de La Divine Comédie, si souvent cités dans La Recherche pour caractériser les effrois et les bonheurs du grand monde, les cercles proustiens mériteraient un livre. Je remarque que les spécialistes ne s’accordent pas sur ceux et celles qui, par degré d’intimité croissante, les constituent. Preuve que Marcel, grand refusé des clubs les plus sélects de la capitale, s’amusait aussi dans la distribution de ses faveurs. Robert de Billy (1869-1953), diplomate avec lequel Proust potinait au sujet du Quai et des turpitudes cachées de la banque protestante, en fit les frais de temps à autre. Il n’était pas de naissance aussi prestigieuse que le duc de Guiche et que Gabriel de La Rochefoucauld, éclairés ici de nouvelles lumières, ou que Bertrand de Fénelon. Les dévots du Portrait-Souvenir de Roger Stéphane (ORTF, 1962) connaissent par cœur l’instant inoubliable où Paul Morand surgit et raconte d’une voix suraiguë, très faubourg, son déjeuner au Savoy, durant lequel Bertrand de Fénelon l’engage à lire Du côté de chez Swann, livre qui vient de paraître et dont, lecture faite at once, il comparera l’effet explosif à celui de L’Éducation sentimentale.

À y regarder de plus près, le style de La Recherche n’est pas que flaubertien, et le présent volume, en réexaminant les figures essentielles d’Edmond Jaloux et de Lucien Daudet, fait remonter d’autres composantes essentielles de l’esthétique proustienne, celle qui se teinte du roman anglais et russe, comme celle qui s’entrelace à une veine plus française, Stendhal, les Goncourt, Paul Bourget. Jaloux, ce fou de Proust, y insiste pour mieux dissocier l’anti-symbolisme de son héros du naturalisme zolien. Ce goût, où Henri de Régnier contrebalance Mallarmé et Baudelaire, où le cru et le comique s’accompagnent de délicatesses infinies, était commun aux jeunes « visiteurs du soir », ces «intelligences modernes » (Proust), à titres nobiliaires ou pas, que Proust recevait, fort tard, rue de Courcelles ou boulevard Haussmann. Rompu à ce rite de passage durant la guerre de 14, comme Emmanuel Berl et tant d’autres, Morand imitait à la perfection la conversation de son hôte, où il voyait la clef de son style miroitant. De même, retrouvait-il l’air des cercles d’élus dans des livres, aujourd’hui oubliés, comme Le Chemin mort de Lucien Daudet (Flammarion, 1908), roman de l’inversion, qui prélude en bien des points à Sodome et Gomorrhe, comme le note Antoine Compagnon. Ceci nous rappelle que la passion mondaine de Proust, parallèlement aux photographies du grand monde qu’il collectionnait, n’a pas pour cause unique un phénomène aujourd’hui bien étudié, le désir des élites juives à confirmer leur ascension sociale dans un pays qui, malgré les lecteurs de Drumont et l’affaire Dreyfus, restait l’un des plus ouverts d’Europe, au point qu’un grand nombre de jeunes gens bien nés restaurèrent la fortune familiale écornée par un mariage en dehors de leur confession (5). Quelques-uns gravitaient autour de Proust, qui conforta son réseau aristocratique dans les salons soumis à la libéralité d’esprit de leur maîtresse de maison, Mme Emile Strauss ou Anna de Noailles. Au-delà enfin du plaisir d’avoir frayé parmi une partie de la gentry française, de se hisser au-dessus du commun, il y trouvait aussi le lectorat de son journalisme chic et du mélange peu vertueux de raffinement et de cruauté qui fait le génie de La Recherche. Être reçu du grand monde, à l’inverse, c’était se condamner à ne pas être compris de certains milieux littéraires, son rejet par la NRF le confirmera, la haine des surréalistes aussi. Il est vrai que Rimbaud et Apollinaire n’ont pas beaucoup occupé Proust, et moins le cubisme et le futurisme que Vermeer, Monet et Manet. Les experts de Proust nous rétorqueront que la peinture de la noblesse occupe certaines des pages les plus satiriques de leur auteur, qui avait perdu l’innocence de Jean Santeuil. Mais il est d’autres pages… La « terrible malédiction d’être snob » que semble stigmatiser Les Plaisirs et les jours n’en a pas guéri Marcel, bien au contraire. Mais il y a snobisme et snobisme, gentry et gentry, c’en est même une bonne définition (6).
Stéphane Guégan
(1) Les éditions Bernard de Fallois, en 2020, ont réédité Les Plaisirs et les Jours qu’on ne saurait détacher des partitions de Reynaldo Hahn et des illustrations de Madeleine Lemaire. Au sujet de cette réédition et du snobisme consistant à ignorer le snobisme de Proust, passion « indéniable » ( Fernand Gregh), voir Stéphane Guégan, « Une résurrection », Revue des deux mondes, septembre 2020, p. 196-199. /// (2) Marcel Proust, Les soixante-quinze feuillets et autres manuscrits inédits, édition établie par Nathalie Mauriac Dyer, préface de Jean-Yves Tadié, Gallimard, 2021, 21€ /// (3) La meilleure analyse des beautés et incongruités grammaticales propres à Marcel Proust nous est fournie par Isabelle Serça qui montre parfaitement sa profonde répugnance à ponctuer (absence de virgules), aérer (refus des blancs et sauts de lignes) et réduire le flottement syntaxique ou le miroitement des mots, sans lesquels sa langue appauvrirait « le texte sensible du monde » et des individus. L’usage volontairement abusif des parenthèses affiche une parenté avec le roman anglais à détours et caprices, revendiquée dès Jean Santeuil et que Nerval et Gautier eussent applaudie. Auteur « difficile », disent certains critiques en 1913, cauchemar des éditeurs par sa folie balzacienne des épreuves à rallonges, Proust se méfiait autant des modes de liaison traditionnels que de la sécheresse narrative de ces censeurs (Isabelle Serça, Les coutures apparentes de la Recherche. Proust et la ponctuation, Honoré Champion, 2021, 48€) /// (4) Jean-Yves Tadié (sous la direction de), Le Cercle de Marcel Proust III, Honoré Champion, 45€. On lira notamment les contributions de Sophie Bash (Edmond Jaloux), Annick Bouillaguet (Jacques Benoist-Méchin), Antoine Compagnon (Lucien Daudet), Adrien Goetz (Gabriel de La Rochefoucauld), Nathalie Mauriac Dyer (Robert de Billy), Jean-Pierre Ollivier (Armand de Gramont) et Pierre-Louis Rey (Boniface de Castellane) /// (5) Voir Catherine Nicault, « Comment “en être”? Les Juifs et la haute société dans la seconde moitié du XIXe siècle », Archives juives/Les Belles lettres, 2009/1, vo.42, p. 8-32 /// (6) Les volumes précédents du Cercle de Marcel Proust I et II (Honoré Champion, 2015 et 2016) éclairent aussi ce double aristocratisme de classe et de goût, qu’il s’agisse de Bertrand de Fénelon (Pierre-Edmond Robert) ou d’Henri de Régnier (Donatien Grau), ou encore de Jacques de Lacretelle, Jacques-Emile Blanche, Montesquiou et Gabriel de Yturri…
Proustisons encore un peu…

La Fontaine ne brille pas particulièrement parmi les phares littéraires de Proust qui se contente de citer ici et là les fables chères encore à l’institution scolaire. Il semble que ce ne soit plus tout à fait le cas et que le gouvernement actuel en ait fait un objet de mission. Quitte à ramener nos chers bambins à ce génie que l’on n’ose plus dire national, leur faire lire sa première floraison, d’une sensualité immédiatement captivante, ne serait pas une mauvaise idée. Il en va de même des pièces du jeune Corneille, dont les héros ont l’âge de leur auteur, notait Marc Fumaroli, formidable défenseur de la cause de La Fontaine (Fabrice Luchini en est un autre). Ce moment inaugural de l’œuvre possède une intensité presque juvénile, alors que Jean va sur ses quarante ans, ce ne sont que poèmes à thèmes amoureux. Rentier en difficulté financière croissante, il les offre à Fouquet afin d’entrer dans ses grâces. Le temps de Vaux, comme on sait, sera dramatiquement court. Mais on doit à cet éphémère miracle des arts la version initiale d’Adonis, une des plus belles choses de notre poésie. Poussé par Paul Pellisson (prononcez polisson) et Madeleine de Scudéry, l’obligé des cercles parisiens partage leur verve galante, loin de l’héroïsme assommant des antiquaires. Jean est déjà rocaille… Le poème débute donc en se détournant de Troie et de Rome, et dit vouloir chanter « l’ombrage des bois, / Flore, Echo, Zéphyr et leurs molles haleines, / Le vert tapis des prés, et l’argent des fontaines. » On appréciera le dernier hémistiche, l’absence du « comme » que réinventeront les modernes, et la présence biaise du poète dans son verbe. Celui-ci corrige le lyrisme par l’intime et l’aveu, il fait même, écrit Patrick Dandrey, de l’esthétique son éthique, de la volupté aussi admise que contrôlée un art de vivre et de bien dire. Quant au cœur même de la fable, l’effet magnétique d’Adonis sur Vénus, il symbolise, note Céline Bonhert, le pouvoir du visible, image mentale ou réelle, sur le spectateur de ses propres désirs. Voilà qui mériterait en ces temps régressifs, hostiles à l’Eros et à notre idiome, d’être enseigné. SG / Jean de La Fontaine, Les Amours de Psyché et de Cupidon précédé d’Adonis et du Songe de Vaux, édition de Céline Bonhert, Patrick Dandrey et Boris Donné, Gallimard, Folio classique, 9,70€.

Infidèle en amour, hors sa passion filiale, Proust s’est montré cruel envers Loti avec l’âge. Dieu sait pourtant que, jeune, parmi d’autres chefs-d’œuvre, il aima Le Roman d’un enfant, il le fit lire à sa mère, lorsqu’elle perdit la sienne. Maman l’en remercie, le 23 avril 1890 : « Je suis, mon chéri, imprégnée de Loti. » À rebours de Marcel, oublieux de certaines ferveurs littéraires devenues gênantes, ingrat envers celui qui le mit sur la voie de la résurrection affective et intuitive du passé, nous continuons à lire et célébrer les livres de ce voyageur du temps et des cultures. Vers Ispahan (1904) est l’œuvre du dernier des grands Français – le comte de Gobineau fut l’un d’entre eux sous le Second Empire – a avoir mordu la piste iranienne, du Sud au Nord, avant la modernisation du pays à marche forcée. Lui va son rythme et inaugure le nouveau siècle en fuyant ce qu’il a de diabolique. Sa plume n’est que sensations, fines notations, aperçus cueillis, arrêt de l’instant, éclairs et regrets. La longue promenade qu’il effectue à dos de mule et bardé de personnel, à l’instar de Chateaubriand et de Lamartine en Orient, vérifie l’alternance viatique du morne, de l’ennui, de la déception et de l’enchantement. N’y voyons pas comme les adversaires naïfs de l’orientalisme européen un effet des illusions où se berceraient l’arrogance occidentale et son besoin de jouir du pittoresque des peuples inférieurs… Les mœurs qu’il retrouve en terre d’Islam, des femmes voilées au vin clandestin, ne sont pas nécessairement perçues à travers sa nostalgie de l’ancienne Perse, vieil Iran qu’il vénère, architecture, grande statuaire et poésie. Très sceptique quant aux effets de la moderne Russie, très rétif à la part maudite du progrès, il n’en est que plus attentif à l’inconnu, à l’éternité d’une civilisation toujours là. SG // Pierre Loti, Vers Ispahan, excellente préface de Patrick Ringgenberg, Bartillat / Omnia poche, 12€.

La peinture de Sisley, trop subtile pour nos yeux, trop prompte à s’estomper de neige ou de brouillard, était plus appréciée de Proust et de ses contemporains (Adolphe Tavernier, Isaac de Camondo) que des nôtres. Aucune exposition parisienne depuis près de trente ans ! De l’adhésion de Marcel à cet impressionniste de la grâce, de l’élégance anglaise, il est de nombreux indices. Il est vrai qu’ils sont plutôt antérieurs au démarrage de La Recherche où Monet et Manet, comme figures du peintre essentiel, l’emporteront. Jean Santeuil, ce livre abandonné aux contours lâches, comprend un fragment relatif à la visite d’une exposition, galerie Durand-Ruel, que Proust effectua en compagnie de Charles Ephrussi. On y voyait des tableaux de Sisley, artiste dont Marcel parle au duc de Guiche dans une lettre de 1904 citée par Le Voyageur voilé de la princesse Marthe Bibesco. Sisley est alors partout. Depuis janvier 1899, et sa disparition à 60 ans, il a définitivement conquis le marché, lui qui eut tant de mal à valoriser ses tableaux de son vivant. À défaut, il multiplia les toiles à petits prix, malgré les efforts de Georges Petit et de Durand-Ruel pour les pousser. Son catalogue frappe ainsi par une abondance qui ne fut pas toujours heureuse. Il comprenait 884 tableaux en 1959, il s’élève maintenant à plus de mille huiles, et sa nouvelle édition devrait contribuer à une plus juste appréciation du corpus. Il le mérite malgré les redites et les creux. Octave Mirbeau, proche alors de Monet et de Caillebotte, l’enterra, dès 1892, avant l’heure donc, dans Le Figaro : c’est qu’il ne retrouvait pas dans les derniers tableaux, mous de dessin, lourds de couleur, « ce parfum de fleur fraîche que j’aimais tant respirer en elles ». Sisley, en vérité, n’a jamais aussi bien peint qu’en 1872-1876. Mais la source n’était pas aussi tarie que Mirbeau ne le pensait, comme les ultimes tableaux, peints au Pays de Galles, le démontrent avec une force qui dut réjouir l’artiste lui-même, non moins que les lecteurs d’aujourd’hui. Impressionniste de la première heure, il fut aussi l’un des premiers à quitter le bateau, pour n’y revenir qu’une fois, en 1882, sans enthousiasme. Ne pas en tenir compte entrave souvent la bonne intelligence d’un parcours que ce livre imposant permet de suivre pas à pas. SG / Sylvie Brame et François Lorenceau, Alfred Sisley. Catalogue critique des peintures et des pastels, préface de Sylvie Patin, La Bibliothèque des Arts, 150€ (une erreur s’est glissée dans la chronologie du volume, la fameuse lettre de Sisley à Théodore Duret, où il lui explique pourquoi il renonce aux expositions impressionnistes est de 1879, et non de 1880).

Des relations que nouèrent Oscar Wilde et Proust on discute encore, de ce qui lie leurs œuvres aussi. Ils eurent des amis communs (Jacques-Émile Blanche, notamment) et semblent s’être rencontrés dans les salons parisiens au cours des années 1891-1894, à l’heure du lancement polémique de Dorian Gray, et avant la condamnation aux travaux forcés pour sodomie, laquelle entraîna en France une vague de colère et d’indignation. La Revue blanche, dont Marcel était proche, tira la première sur la prude Albion, et Proust manifestera son soutien au proscrit de façon récurrente, mais discrète. Sans l’ignorer, il semble qu’il n’ait pas beaucoup pratiqué l’œuvre de fiction, le sublime Crime de Lord Arthur Savile (dont le patronyme « en français » est peut-être à double entente), comme le grandiose Portrait de Dorian Gray, deux monuments qu’il faut avoir lus au moins une fois en anglais (ce que les éditions bilingues à montage en miroir facilitent). Vis-à-vis de Dorian Gray, dont Roger Allard rapprochera Sodome et Gomorrhe I dans la NRF de septembre 1921, l’ambivalence de Proust est complète. Ce roman qu’il dit « mièvre » à Daniel Halévy a dû beaucoup plus compter qu’il ne préfère le reconnaître. Sa lecture d’Intentions, recueil d’essais (Paris, 1905), semble aussi avérée, notamment Le Déclin du mensonge dont il mettra le passage le plus célèbre dans la bouche de Charlus, le passage selon lequel le plus grand chagrin qu’ait jamais éprouvé Wilde était la mort de Lucien de Rubempré dans Splendeurs et misères des courtisanes. Par ailleurs, on ne peut pas ne pas penser que cette sentence wildienne sur le roman moderne, lisible dans Intentions, ait échappé à Proust : « Quiconque voudrait nous toucher aujourd’hui par une œuvre de fiction serait contraint, soit de créer pour nous un cadre complètement nouveau, soit de nous révéler l’âme de l’homme dans ses mécanismes les plus intimes. » Mais le plus beau, quant au rapprochement des deux esthétiques, se cache au milieu des aphorismes « très Théophile Gautier » (Wilde était fou de Maupin) qui servent de préface à Dorian Gray. Ainsi celui-ci, plus catholique irlandais et duel qu’il n’y paraît : « No artist has ethical sympathies. An ethical sympathy in an artist is a unpardonable mannerism of style. » SG / Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray / Portrait de Dorian Gray, traduit de l’anglais, préfacé et annoté par Jean Gattégno, Gallimard, Folio Bilingue, 9,70€. Voir aussi Emily Eels, « Proust et Wilde », Le Cercle de Marcel Proust, Honoré Champion, 2016, p. 225-236.



