
Les opinions les plus contraires courent sur le compte de La N.R.F. et de sa relance en janvier 1953. La nécessité d’y voir plus clair n’en était que plus grande. A la suite des beaux travaux de Martyn Cornick (1995), Laurence Brisset (2003) et Alban Cerisier (2009), aux champs temporels plus larges que le sien, Camille Koskas propose un inventaire et une analyse poussés des six premières années de cette renaissance, voulue, dès novembre 1944, par Gaston Gallimard, aux lendemains d’une liquidation difficile à avaler. Mais comme l’écrit François Mauriac, fin 1952, avec toute la « tendresse » dont était capable son Bloc-notes, huit ans s’écoulèrent avant que « cette chère vieille dame tondue » ne retrouvent ses cheveux. Quand d’autres s’en indignent à mots feutrés, tels Les Temps modernes de Sartre (dont l’attitude sous l’Occupation n’a pas été aussi exemplaire qu’il le prétendait), quand certains en sourient, telle La Parisienne de Jacques Laurent, Mauriac, soucieux des intérêts de sa chère Table ronde, contre-attaque avec hauteur, mais une humeur partagée, en février 1953. Le sommaire du numéro 1 de La N.N.R.F. [La Nouvelle Nouvelle Revue Française] ne lui a pas semblé d’une nouveauté éclatante, tant les ténors de l’avant-guerre y sont présents. Mais peut-on excuser d’autres survivances ? Le manifeste des deux directeurs, Jean Paulhan et Marcel Arland, deux « anciens », aurait-il noyé le poisson en réclamant la fin des hostilités, au terme d’une longue épuration, et en revendiquant la primauté du littéraire sur l’inféodation idéologique ? « Vous avez le droit de le garder, ce silence, sur la N.R.F. [sic] de lʼOccupation, non sur le garçon qui a occupé ce fauteuil, qui a corrigé les épreuves, assis à cette table. Ce nʼest pas une autre N.R.F. [sic] que celle de Drieu qui reparaît aujourdʼhui : vous avez trouvé dans un tiroir des pages de Montherlant que la libération avait empêché de publier ; et le Thomas qui traite des livres de poèmes doit être, jʼimagine, le même Thomas à qui Drieu avait confié cette rubrique. Vous nʼétiez pas obligé de ressusciter la Revue, mais enfin vous lʼavez fait. Vous nʼavez plus désormais la ressource du silence. » Tandis que l’anti-sartrisme de Jacques Laurent jubile à bon droit, Bernard Frank, sous pavillon sartrien, traite sans égards cette galerie d’ancêtres. Faire cohabiter Montherlant et Jouhandeau avec Malraux, il fallait oser… L’audace venait de Paulhan, qui doit composer avec les réticences d’Arland à accueillir dans ses pages les plumes compromises de la collaboration. Leur cordée, la franchise aidant, ne fut pas de tout repos.

Il est vrai que les contributions d’Arland à la N.R.F. de Drieu, sa large participation à l’équivoque Comœdia, son association aux Nouveaux destins de l’intelligence française, volume offert à Pétain en 1942, ne le disposaient pas à l’indulgence envers ceux qui avaient servi l’occupant, quelles que fussent la motivation de ce choix, sa réalité exacte et sa durée. Sans doute voulait-il faire oublier qu’il avait souscrit à un maréchalisme modéré. Certes, la plupart du temps, Arland obtempérait, non sans empoisonner l’existence de Paulhan de ses perpétuelles remontrances. En septembre 1953, La N.N.R.F donne un inédit de Drieu, le magnifique Récit secret, avant qu’Arland, en trois livraisons, ne récapitule le bien et surtout le mal qu’il pensait de l’auteur de Gilles. La défense du roman, « socle de l’entreprise N.R.F. » (Camille Koskas), comptait toujours parmi les priorités de la N.N.R.F. Aussi Arland se propose-t-il d’évaluer les apports de Drieu au genre majeur. Il s’y était déjà employé, à dire vrai, au cours des années 1920-1930 avec un enthousiasme variable. Seuls La Comédie de Charleroi, unique chef-d’œuvre, et Rêveuse bourgeoisie l’avaient pleinement convaincu, Drôle de voyage et Gilles, pour être moins réussis, manifestaient une force et une cohérence très supérieures, concluait Arland, au reste de la production rochellienne. Ces chipotages paraissent un peu vains aujourd’hui. Ils donnent pourtant la mesure des attentes d’une revue souvent déterminée par la vision assez convenue qu’Arland y développe. Au fond, pas assez carrée, et souffrant d’une sorte d’inachèvement narratif et psychologique, la manière féline de Drieu pâlit en face du dernier Giono, peu apprécié d’Henri Thomas en raison de ses pirouettes de roman feuilleton. La N.N.R.F. promeut aussi André Pieyre de Mandiargues, André Dhôtel, le plaisant Henri Calet, et confie à l’incolore Blanchot une partie de ses chroniques littéraires. Cela sent un peu l’échec. Eut-elle la main heureuse avec les jeunes romanciers ?

A suivre la comptabilité de Camille Koskas, il apparaît que le Nouveau roman, écriture (Robbe-Grillet) et théorie (Nathalie Sarraute) jouisse des faveurs que La N.N.R.F. refuse aux Hussards. Nimier, que poussent Morand et Chardonne, au nom du « style 1925 », n’encombre pas la revue, et Blondin, où Paulhan diagnostiquait du Giraudoux réchauffé, en est tenu écarté. Le fait qu’ils soient très marqués politiquement n’arrangeait pas les choses, bien que Paulhan n’ait pas dissimulé aux lecteurs sa sympathie pour des causes aussi controversées que l’Algérie française ou la réhabilitation de Céline. L’auteur du Voyage au bout de la nuit, que Gaston et Nimier brûlent d’intégrer au catalogue de la maison, offre à La N.N.R.F. l’occasion rêvée de vérifier son credo, à la barbe des fanatiques, communistes ou communisants, de la littérature engagée. Les pamphlets antisémites de Céline, comme ceux de Marcel Jouhandeau, si condamnables soient-ils, ne sauraient autoriser la relégation éternelle de leurs auteurs en dehors de la communauté littéraire. Cette reconstruction, nous dit Camile Koskas, poursuit Paulhan, fou de Jouhandeau, et moins insensible à Drieu qu’il ne le répète… La valeur d’un écrivain, estime-t-il, n’est pas conditionnée par ce que nous estimons être ses erreurs, ses fautes, jusqu’à ses délires xénophobes. Ne confondons pas, comme cela arriva en 1953, la « pureté littéraire » que Paulhan entend restaurer avec l’oubli de l’histoire récente et le désir de « mettre le monde entre parenthèse » (Armand Petitjean). Pas plus que le Drieu des années 1940-43, Paulhan ne croyait à « l’art en vase clos ». Le manifeste qui ouvrait le numéro du renouveau affirmait assez solennellement que le premier devoir de la littérature était de résister « aux Pouvoirs et aux Partis politiques ». Après Drieu, dont le directorat attend toutefois un bilan qui en respecterait les ambiguïtés volontaires, la maison Gallimard ne faisait plus crédit. Une perspective élargie au XIXe siècle montrerait que Paulhan mettait ses pas dans ceux de Gautier et Baudelaire. La reprise de L’Artiste, en 1856, s’était dressée contre la servilité de l’art et son assèchement moral. Stéphane Guégan
*Camille Koskas, Jean Paulhan après la guerre. Reconstruire la communauté littéraire, Classiques Garnier, 2021, 63€. A lire aussi : Drieu la Rochelle, Drôle de voyage et autres romans, édition établie par Stéphane Guégan, Julien Hervier et Frédéric Saenen, Bouquins, 2023, 32€. Le volume comprend un dictionnaire Drieu par les mêmes.
Paulhan, Drieu, Berl…
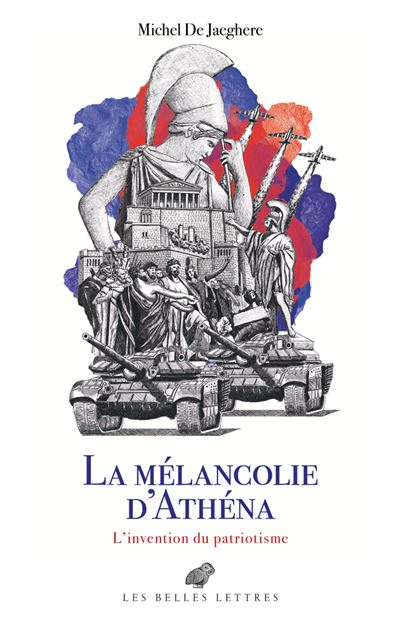
Conteur hors-pair, Michel De Jaeghere sait tout de la Grèce antique, il sait aussi en rendre vivantes les annales et ardente la foi patriotique. La géographie, que Michelet croyait déterminante dans le destin des peuples, aura peu secondé celui des Grecs, aux cités éparses et rivales, mais que la résistance aux Perses va élever au-dessus de leurs intérêts respectifs. En un siècle, le Ve av. J.-C., Athènes transforme ses victoires militaires en puissance hégémonique et impérialiste. On peut regretter ce surcroît de ferveur expansionniste. Michel De Jaeghere a des mots durs, des comparaisons glaçantes, au sujet du panhellénisme détourné de son lit, il nous rappelle, d’un autre côté, que l’héritage des guerres médiques déborde le cours que prirent les choses. Aussi son livre conduit-il une réflexion sur le sacrifice de soi à travers les âges, la Révolution française, l’Europe de Napoléon, les premiers temps de Vichy et fatalement les paradoxes de l’Occupation. Drieu, qui aurait tant aimé revivre la bataille de Marathon aux Dardanelles, s’invite ici et là. Le patriotisme, non le nationalisme, et donc l’Europe dans le souverainisme, l’aura constamment obsédé, et même entraîné aux terribles erreurs de jugement que l’on sait. L’amère morale des Chiens de paille, ultime roman de Drieu auquel la censure allemande fut tentée de refuser l’impression tant il dénonçait les faillites du pangermanisme, ne pouvait pas échapper à Michel de Jaeghere et au souffle de son essai. SG / Michel De Jaeghere, La Mélancolie d’Athéna. L’invention du patriotisme, Les Belles Lettres, 2022, 29€.

Si nul n’ignore l’effervescence poétique que connurent les lettres françaises sous l’Occupation, si les études se multiplient sur les relais de publication, au profit ou non de la Résistance, et en zone libre le plus souvent, on sous-évalue encore la contribution de La N.R.F. de Drieu à cette ferveur batailleuse ou compensatoire. Ce dernier s’en faisait gloire à l’heure du bilan de janvier 1943, préalable au sabordage décidé et proche de la revue. Il est vrai qu’elle avait rendu compte favorablement des volumes d’Eluard et s’était ouverte plus largement encore au meilleur de la poésie non surréaliste, d’Henri Thomas à Jacques Audiberti. Pour Francis Ponge, qui avait rejoint le PCF, et Jean Tardieu, la question ne se posait pas : La N.R.F. leur semblait infréquentable, et Comœdia à peine moins. Dans leur correspondance, document de première main, ils montrent plus d’aversion envers Audiberti, immense poète qu’ils savent proche des idées de Drieu, qu’envers Henri Thomas. Savaient-ils que Paulhan en sous-main appuyait de ses relations et de ses idées La N.R.F. des années sombres, conseillait à certains d’y signer, à d’autres de s’en garder ? Car c’est à lui, et à sa fameuse collection, Métamorphoses, qu’ils confient Le Parti pris des choses (1942) et Le Témoin invisible (1943). D’autres revues, Messages, Fontaine ou Poésie 42, les requièrent, de même que tout une sociabilité de café et d’échanges vifs. Gages d’une amitié ancienne, ces lettres fixent tout un monde. SG / Francis Ponge / Jean Tardieu, Correspondance 1941-1944, édition établie et préfacée par Delphine Hautois, Gallimard, 18€.
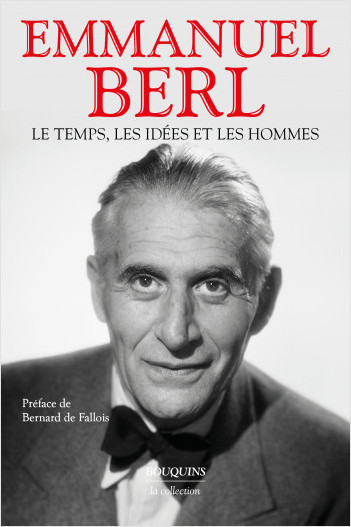
Bernard de Fallois, en janvier 1953, fut de la livraison inaugurale de La N.N.R.F. Ses multiples talents devaient propulser le jeune Hussard aux affinités proustiennes vers toutes sortes de destins éditoriaux. Peu de temps après la mort du grand Emmanuel Berl (1892-1976), grand aussi de l’oubli où il avait commencé à sombrer malgré Patrick Modiano, Jean d’Ormesson et quelques autres, l’idée lui vint de publier, chez Julliard, un florilège d’articles, qu’un autre mordu, Bernard Morlino, avait réunis pieusement. Il reparaît. Politique, société, littérature, peinture, aucune des passions de Berl, aucun des domaines où brillait son anti-conformisme caustique, n’y manque. Juif assimilé, patriote inflexible, bourreau des cœurs et bourreau de travail, fou de journalisme et de justice sociale, il fut vibrionnant par nature, virevoltant par goût, si bien qu’il accepta en partie la caricature que Drieu glissa de lui dans Gilles. Bien plus douloureux, à la lecture du roman, fut de constater qu’il passait sous silence la complicité intellectuelle qui l’avait lié à l’auteur, et ne disait rien notamment des Derniers jours, bimensuel de 1927, qu’ils avaient dirigé et rédigé ensemble. L’espoir d’en finir avec l’ancien monde, son productivisme absurde, son paupérisme alarmant, leur titre l’annonçait avec un accent d’urgence bien dans la manière de ces impatients. A cette amitié, qui colore Drôle de voyage et que le journal centre-gauche Marianne devait entretenir au milieu des années 30, Berl resta toujours fidèle, au-delà du suicide de Drieu, malgré les différends qui s’étaient creusés avant la guerre. On lira ici l’article que le premier publia sur le second en 1953 en essayant d’imaginer la stupeur qu’il causa parmi les ennemis du fasciste, du doriotiste inexcusable. Même l’antisémitisme tardif du père de Gilles, qu’il sait distinct du racisme de stricte obédience, n’empêche pas Berl d’écrire que les comptes de ce contemporain essentiel « sont tous créditeurs ». Berl est aussi le premier, sauf erreur, à révéler que Colette Jéramec, la première épouse de Drieu, qui était juive, « il l’a tirée de Drancy quand c’était très difficile, fût-ce pour de soi-disant collaborateurs ». Le début de l’article de 1953, prélude au superbe Présence des morts de 1956, assigne le travail du deuil à son impossibilité : « Je croyais notre amitié morte : elle était rompue avant qu’il eût cessé de vivre. Je me trompais : envers les morts aussi nous sommes tous changeants. De nouveau, il me semble que j’attends de lui quelque chose, et qu’il attend de moi ce que je n’arrive pas, d’ailleurs, à lui donner. » SG / Emmanuel Berl, Le temps, les idées et les hommes, préface de Bernard de Fallois, Bouquins, 30€.

Le dernier roman de Drieu, très sous-évalué, s’abrite derrière une longue citation de Lao-Tseu, ou de Lao zi, pour se conformer aux usages de La Pléiade : « Le ciel et la terre ne sont pas bienveillants à la manière des hommes, ils considèrent tous les êtres comme si c’étaient des chiens de paille qui ont servi dans les sacrifices. » Rude sagesse, où Drieu devait reconnaître l’alliance explosive du stoïcisme et de la pensée pascalienne. Seules nos actions, sans rachat certain, nous permettent d’accéder à une dimension supérieure de la vie. Ce roman des collaborations (avec Berlin, Moscou ou Londres…) et des tromperies de la politique ne pouvait s’appliquer morale plus adéquate que le taoïsme. Le lecteur du tome I des écrits de Lao zi, Zhuang zi et Lie zi n’est pas long à s’émerveiller d’autres résonances. Osera-t-on dire que leur attachement à la sobriété, au Grand-Tout du vivant, leur souci fondamental du perfectionnement de soi, physique et mental, leur mépris des faux savoirs, leur mode d’approche des phénomènes, nous apparaît plus sincère et efficace que le racolage actuel des officines et des médias en déroute. Du fond de l’ancienne Chine monte la sagesse des adeptes du vide, c’est qu’ils n’ignoraient pas que l’excès est le propre de l’homme. Mais eux ne se payaient pas de mots, en tous sens, ils se soignaient, se dressaient et, quoique partisans de la non-intervention sociale, rendaient le monde plus respirable, et assurément plus durable. SG / Philosophes taoïstes, I. Lao zi, Zhuang zi et Lie zi, édition et traduction du chinois par Rémi Mathieu, La Pléiade, Gallimard, 65€.

Nota bene / Mercredi 18 janvier 2023, à 19h, à l’occasion de la Nuit de la lecture 2023, Maurizio Serra, de l’Académie française, auteur de D’Annunzio le magnifique (Grasset, 2018), proposera une conversation autour de Proust et D’Annunzio, en compagnie de Stéphane Guégan, ponctuée de lectures par le comédien Pierre-François Garel.
Hôtel Littéraire Le Swann, 15 Rue de Constantinople, 75008 Paris.
Ma recension du D’Annunzio de Serra, parue dans la Revue des deux mondes de mai 2018, est accessible en ligne : https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/erotomane-de-laction/





