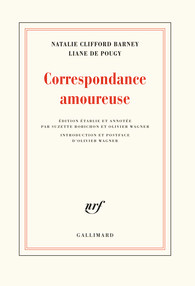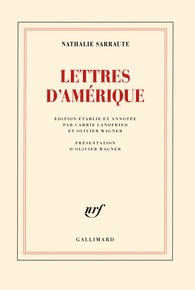Derain avait tout pour rester dans nos mémoires l’un des phares du premier XXe siècle… Y eut-il plus radical que lui ? Dès les années 1901-1904, alors que Picasso hésite entre le bleu et le rose, lui se voit et se trace un avenir du côté des dynamiteurs, Lautrec, Gauguin et Van Gogh, qu’il absorbe en lecteur de Nietzsche. La peinture, c’est la vie, en plus fort, en plus profond. Telle est sa morale, telle est sa peinture dès avant Collioure, Matisse et l’été 1905… Son fauvisme, déclarent certains, serait trop classique ! Matisse, moins servile au motif, aura davantage sabordé les codes. C’est mal interroger Derain que de le croire attiré par l’essence du signe. Au contraire, il s’obstine déjà à réinventer le réalisme sans perdre le lien au réel et à son énergie. Et que dire de son action propre au sein du cubisme ? L’historiographie actuelle lui est si hostile qu’elle préfère gommer, au profit du gentil Braque, la place grandissante de Derain auprès de Picasso à partir de la fin 1906. Les Demoiselles d’Avignon sont alors sur le chevalet mais elles ne ressemblent pas encore à une épiphanie tribale de péripatéticiennes ensauvagées. Ne revenons pas, une fois de plus, sur le débat qui consiste à savoir qui fut le véritable initiateur de la plastique nègre, formule d’époque, à l’heure où chaque atelier parisien semble accoucher d’une baigneuse aux accents africains… Là encore, le choc du British Museum aidant, Derain paraît bien avoir devancé ses petits camarades et amorcer ce qui allait bientôt devenir une mode et un commerce. On peut être cubiste sans se cantonner au compotier, à la bouteille de rhum et au violon, ni tout dématérialiser au nom de Platon ou de Kant. La vieille philosophie était l’un des dadas de Kahnweiler, meilleur marchand que théoricien. On lui préférera Salmon et Apollinaire. Ce dernier n’a pas tardé à enregistrer ce qui distingue le cubisme de Derain, totalement étranger à l’hermétisme picassien et à sa décantation extrême des formes. Il parle de « calme terrible » quand l’artiste lui-même, en baudelairien, disait aspirer à «l’éternel». Fin 1910, Derain quitte Montmartre pour la rue Bonaparte, tout un programme…
Derain avait tout pour rester dans nos mémoires l’un des phares du premier XXe siècle… Y eut-il plus radical que lui ? Dès les années 1901-1904, alors que Picasso hésite entre le bleu et le rose, lui se voit et se trace un avenir du côté des dynamiteurs, Lautrec, Gauguin et Van Gogh, qu’il absorbe en lecteur de Nietzsche. La peinture, c’est la vie, en plus fort, en plus profond. Telle est sa morale, telle est sa peinture dès avant Collioure, Matisse et l’été 1905… Son fauvisme, déclarent certains, serait trop classique ! Matisse, moins servile au motif, aura davantage sabordé les codes. C’est mal interroger Derain que de le croire attiré par l’essence du signe. Au contraire, il s’obstine déjà à réinventer le réalisme sans perdre le lien au réel et à son énergie. Et que dire de son action propre au sein du cubisme ? L’historiographie actuelle lui est si hostile qu’elle préfère gommer, au profit du gentil Braque, la place grandissante de Derain auprès de Picasso à partir de la fin 1906. Les Demoiselles d’Avignon sont alors sur le chevalet mais elles ne ressemblent pas encore à une épiphanie tribale de péripatéticiennes ensauvagées. Ne revenons pas, une fois de plus, sur le débat qui consiste à savoir qui fut le véritable initiateur de la plastique nègre, formule d’époque, à l’heure où chaque atelier parisien semble accoucher d’une baigneuse aux accents africains… Là encore, le choc du British Museum aidant, Derain paraît bien avoir devancé ses petits camarades et amorcer ce qui allait bientôt devenir une mode et un commerce. On peut être cubiste sans se cantonner au compotier, à la bouteille de rhum et au violon, ni tout dématérialiser au nom de Platon ou de Kant. La vieille philosophie était l’un des dadas de Kahnweiler, meilleur marchand que théoricien. On lui préférera Salmon et Apollinaire. Ce dernier n’a pas tardé à enregistrer ce qui distingue le cubisme de Derain, totalement étranger à l’hermétisme picassien et à sa décantation extrême des formes. Il parle de « calme terrible » quand l’artiste lui-même, en baudelairien, disait aspirer à «l’éternel». Fin 1910, Derain quitte Montmartre pour la rue Bonaparte, tout un programme…
 Alice Princet, que Gertrude Stein dit indomptable, l’accompagne, signe que leur ménage, amorcé au Bateau-Lavoir, peut y survivre. Cette brune charpentée allait se révéler plutôt souple en matière domestique. De même qu’il n’est pas à homme à se contenter d’une femme unique, Derain n’est pas peintre à s’enchaîner au cubisme. La chose, du reste, échappe maintenant à ses créateurs. Devenu une passion publique en 1911, et une formule au succès croissant, le cubisme salonnard a d’autres inconvénients. Plus graves, ils tiennent aux limites de cette esthétique du brouillage figuratif et à son puritanisme. Ses lectures, Claudel et Péguy, sans parler de son goût pour l’ésotérisme, détournent aussi Derain de tout confinement formel et iconographique. A rebours de la « peinture pure » dont se gargarise l’époque, la sienne cultive le sens et le commerce sensuel et occulte avec la nature. Un tournant se prend après 1911, d’une radicalité égale, mais inverse au parcours déjà accompli, virage qui pèsera aussi lourd que le voyage de 1941 sur l’image posthume de l’artiste… Des tableaux aussi singuliers que Le Joueur de cornemuse et Samedi empruntent une part de leur charme bizarre aux tocades du moment, de la redécouverte des primitifs français à la revalorisation du Greco. Les deux impulsions, l’une qui pousse à la naïveté fantasque, l’autre à la déformation expressive, obéissent au même besoin de recharger la peinture de tout ce dont Derain estime qu’elle s’est débarrassée trop vite, depuis l’énigme du vivant jusqu’à la reconquête du sacré. N’imaginons pas que cette rupture esthétique l’ait déjà brouillé avec ses anciens amis, Derain anticipe seulement la sortie du cubisme à laquelle Picasso et d’autres vont bientôt se résoudre. La guerre de 14 n’en fut pas responsable. Quelques mois avant son déclenchement, Derain travaille à son œuvre la plus rétive à toute lecture formaliste ou univoque, le fameux Chevalier X. Le titre de l’œuvre, dont Apollinaire pourrait être responsable, ébranle la notion d’identité et confirme la négation de tout progressisme béat. L’œuvre qu’Aragon rapprochera des poupées d’envoûteurs fascine déjà les futurs surréalistes, et Breton jusqu’à sa mort. D’où qu’on la prenne, de fait, elle se dérobe. On y verra donc la métaphore même d’une démarche, celle d’un artiste étanche aux dogmes et aux redites navrantes du moderne. Stéphane Guégan
Alice Princet, que Gertrude Stein dit indomptable, l’accompagne, signe que leur ménage, amorcé au Bateau-Lavoir, peut y survivre. Cette brune charpentée allait se révéler plutôt souple en matière domestique. De même qu’il n’est pas à homme à se contenter d’une femme unique, Derain n’est pas peintre à s’enchaîner au cubisme. La chose, du reste, échappe maintenant à ses créateurs. Devenu une passion publique en 1911, et une formule au succès croissant, le cubisme salonnard a d’autres inconvénients. Plus graves, ils tiennent aux limites de cette esthétique du brouillage figuratif et à son puritanisme. Ses lectures, Claudel et Péguy, sans parler de son goût pour l’ésotérisme, détournent aussi Derain de tout confinement formel et iconographique. A rebours de la « peinture pure » dont se gargarise l’époque, la sienne cultive le sens et le commerce sensuel et occulte avec la nature. Un tournant se prend après 1911, d’une radicalité égale, mais inverse au parcours déjà accompli, virage qui pèsera aussi lourd que le voyage de 1941 sur l’image posthume de l’artiste… Des tableaux aussi singuliers que Le Joueur de cornemuse et Samedi empruntent une part de leur charme bizarre aux tocades du moment, de la redécouverte des primitifs français à la revalorisation du Greco. Les deux impulsions, l’une qui pousse à la naïveté fantasque, l’autre à la déformation expressive, obéissent au même besoin de recharger la peinture de tout ce dont Derain estime qu’elle s’est débarrassée trop vite, depuis l’énigme du vivant jusqu’à la reconquête du sacré. N’imaginons pas que cette rupture esthétique l’ait déjà brouillé avec ses anciens amis, Derain anticipe seulement la sortie du cubisme à laquelle Picasso et d’autres vont bientôt se résoudre. La guerre de 14 n’en fut pas responsable. Quelques mois avant son déclenchement, Derain travaille à son œuvre la plus rétive à toute lecture formaliste ou univoque, le fameux Chevalier X. Le titre de l’œuvre, dont Apollinaire pourrait être responsable, ébranle la notion d’identité et confirme la négation de tout progressisme béat. L’œuvre qu’Aragon rapprochera des poupées d’envoûteurs fascine déjà les futurs surréalistes, et Breton jusqu’à sa mort. D’où qu’on la prenne, de fait, elle se dérobe. On y verra donc la métaphore même d’une démarche, celle d’un artiste étanche aux dogmes et aux redites navrantes du moderne. Stéphane Guégan
*André Derain 1904-1914. La décennie radicale, Musée d’Art moderne, Centre Pompidou, jusqu’au 29 janvier 2018. Catalogue sous la direction de Cécile Debray (Éditions du Centre Pompidou, 42€) avec les contributions de Nicholas-Henri Zmelty, Dominique de Font-Réaulx, Claudine Grammont, Joshua Irvin Cohen, Camille Morando, Valérie Loth et Stéphane Guégan.
Lire, relire Derain
 *André Derain, Lettres à Alice, 1914-1919, sous la direction de Geneviève Taillade et Cécile Debray, avec la collaboration de Valérie Loth et de Christina Fabiani, Paris, Hazan / Éditions du Centre Pompidou, 25€ // Ce document exceptionnel, récemment exhumé, va révolutionner notre lecture des années de guerre, aussi bien la façon dont Derain les a traversées que la vie de l’arrière. Affecté à Lisieux en août 1914, Derain fait rapidement part à Alice qu’il « commence à avoir la passion de la guerre ». La « nouvelle » histoire de l’art, confondant patriotisme et nationalisme, ne lui pardonne pas son enthousiasme à servir le pays : « La perspective de la mort de tant d’hommes […] donne à la vie plus de grandeur, plus de noblesse, on se sent plus heureux d’assister à une épopée et d’y participer. » Son existence, il le sait, ne sera plus jamais la même : « Tout va être changé et on aura des idées plus simples ». Ce que Derain ignore, c’est que son héroïque « campagne contre l’Allemagne » va durer près de cinq années… Cinq ans sans peindre ou presque, cinq ans sans sexe ou presque, cinq ans durant lesquelles, les permissions se faisant rares, la correspondance retrouve sa fonction d’exutoire et d’agent de liaison. Il ne cache pas son mépris pour les embusqués qui considèrent que la guerre n’est pas leur affaire. Ceux qui n’eurent pas le courage d’Apollinaire lui inspirent des mots durs, qu’il étend à l’esthétique de la destruction : « Et la cathédrale de Reims, écrit-il après son bombardement, c’est un drame étonnant, une jalousie féroce, c’est exactement le reflet de l’esprit de tous les types qui venaient faite du cubisme à Paris. La victoire nous en débarrassera, je crois. » A la xénophobie que nos « nouveaux » historiens lui reprochent, Derain céda peu et toujours en raison des dissidences artistiques que le conflit exacerbait. Le feu, il y goûte à partir de septembre 1915, en Somme, avant de gagner la Champagne, et même Verdun, lors de la grande offensive allemande de février-mars 1916. Il fait merveille, et obtient une citation, au sein d’un régiment d’artilleur : « Le canon, le canon, toujours le canon, la boue, la pluie ou la poussière. Rien à bouffer, rien pour se coucher. Et toujours comme ça, toujours sans répit. Et les obus, et les avions la nuit. » Car les « splendides émotions » s’estompent bientôt. Plus il plonge, plus il sent sa hiérarchie indifférente aux hommes qui meurent en foule, plus le sentiment d’un ratage le submerge. Derain navigue entre le cafard et la peur, la révolte et la résignation. Avec Alice, il parle d’argent, de désirs frustrés, du temps perdu et de son sentiment de voir la peinture s’éloigner à jamais. Les lettres de Max Jacob et d’Apollinaire le réconfortent, mais ajoutent à son exaspération. Tandis qu’il se bat, Paris vit comme avant… Les affaires ont vite repris, marchands et intermédiaires permettent d’écouler quelques tableaux que Derain est obligé de vendre au rabais tout en maudissant les profiteurs. Alice et lui ont tant besoin d’argent pour traverser cette épreuve dont seuls les grands écrivains, Dante, Shakespeare ou Rimbaud, lui permettent de sublimer l’inhumaine démesure. Début 17, il est au bout du rouleau, et commence à rêver d’un changement d’affectation. En octobre 1916, un jeune marchand prometteur, Paul Guillaume, a montré sa peinture, avec la complicité d’un autre Guillaume… Sans être parvenu à quitter le front, Derain prête plus d’attention à l’actualité artistique, lit Nord/Sud, conspue le formalisme de Braque qui s’y exprime, et applaudit à la fantaisie géniale du dernier Apollinaire, le seul de ses contemporains en qui il voit brûler un tragique et un humour semblables aux siens. La mort du poète le foudroie. Une page est tournée. Cocteau, Breton et Aragon écriront les suivantes. SG
*André Derain, Lettres à Alice, 1914-1919, sous la direction de Geneviève Taillade et Cécile Debray, avec la collaboration de Valérie Loth et de Christina Fabiani, Paris, Hazan / Éditions du Centre Pompidou, 25€ // Ce document exceptionnel, récemment exhumé, va révolutionner notre lecture des années de guerre, aussi bien la façon dont Derain les a traversées que la vie de l’arrière. Affecté à Lisieux en août 1914, Derain fait rapidement part à Alice qu’il « commence à avoir la passion de la guerre ». La « nouvelle » histoire de l’art, confondant patriotisme et nationalisme, ne lui pardonne pas son enthousiasme à servir le pays : « La perspective de la mort de tant d’hommes […] donne à la vie plus de grandeur, plus de noblesse, on se sent plus heureux d’assister à une épopée et d’y participer. » Son existence, il le sait, ne sera plus jamais la même : « Tout va être changé et on aura des idées plus simples ». Ce que Derain ignore, c’est que son héroïque « campagne contre l’Allemagne » va durer près de cinq années… Cinq ans sans peindre ou presque, cinq ans sans sexe ou presque, cinq ans durant lesquelles, les permissions se faisant rares, la correspondance retrouve sa fonction d’exutoire et d’agent de liaison. Il ne cache pas son mépris pour les embusqués qui considèrent que la guerre n’est pas leur affaire. Ceux qui n’eurent pas le courage d’Apollinaire lui inspirent des mots durs, qu’il étend à l’esthétique de la destruction : « Et la cathédrale de Reims, écrit-il après son bombardement, c’est un drame étonnant, une jalousie féroce, c’est exactement le reflet de l’esprit de tous les types qui venaient faite du cubisme à Paris. La victoire nous en débarrassera, je crois. » A la xénophobie que nos « nouveaux » historiens lui reprochent, Derain céda peu et toujours en raison des dissidences artistiques que le conflit exacerbait. Le feu, il y goûte à partir de septembre 1915, en Somme, avant de gagner la Champagne, et même Verdun, lors de la grande offensive allemande de février-mars 1916. Il fait merveille, et obtient une citation, au sein d’un régiment d’artilleur : « Le canon, le canon, toujours le canon, la boue, la pluie ou la poussière. Rien à bouffer, rien pour se coucher. Et toujours comme ça, toujours sans répit. Et les obus, et les avions la nuit. » Car les « splendides émotions » s’estompent bientôt. Plus il plonge, plus il sent sa hiérarchie indifférente aux hommes qui meurent en foule, plus le sentiment d’un ratage le submerge. Derain navigue entre le cafard et la peur, la révolte et la résignation. Avec Alice, il parle d’argent, de désirs frustrés, du temps perdu et de son sentiment de voir la peinture s’éloigner à jamais. Les lettres de Max Jacob et d’Apollinaire le réconfortent, mais ajoutent à son exaspération. Tandis qu’il se bat, Paris vit comme avant… Les affaires ont vite repris, marchands et intermédiaires permettent d’écouler quelques tableaux que Derain est obligé de vendre au rabais tout en maudissant les profiteurs. Alice et lui ont tant besoin d’argent pour traverser cette épreuve dont seuls les grands écrivains, Dante, Shakespeare ou Rimbaud, lui permettent de sublimer l’inhumaine démesure. Début 17, il est au bout du rouleau, et commence à rêver d’un changement d’affectation. En octobre 1916, un jeune marchand prometteur, Paul Guillaume, a montré sa peinture, avec la complicité d’un autre Guillaume… Sans être parvenu à quitter le front, Derain prête plus d’attention à l’actualité artistique, lit Nord/Sud, conspue le formalisme de Braque qui s’y exprime, et applaudit à la fantaisie géniale du dernier Apollinaire, le seul de ses contemporains en qui il voit brûler un tragique et un humour semblables aux siens. La mort du poète le foudroie. Une page est tournée. Cocteau, Breton et Aragon écriront les suivantes. SG
 **Stéphane Guégan, Derain en 15 questions, Hazan, 15,95€ // Pour ou contre Derain ? Nous ne sommes pas sortis de l’équation dans laquelle Les Chroniques du jour, en janvier 1931, enfermaient leurs lecteurs… La revue avait requis des signatures du monde de l’art, sommées de se prononcer sur le peintre qui, au pinacle de la gloire, déchirait le milieu. Parmi les sondés, modernes et antimodernes se disputèrent la formule qui résumerait l’apostat, supposé avoir troqué le fauvisme et le cubisme de sa jeunesse pour un conservatisme rémunérateur… Il y eut bien quelques exceptions dans ce concert de sottises. Le peintre Ozenfant prit le parti du « désenchanté optimiste », Cocteau célébra l’alliance du potier grec et de la Bugatti; d’autres précisèrent le sens d’une modernité qui refusait de rouler à sens unique. Pour eux, comme pour nous, Derain est d’abord l’homme qui sut dire non aux fausses certitudes, et aux vraies clôtures, de l’avant-gardisme. La rupture, contrairement à la rumeur, ne date pas des années 1920, folle époque où l’on voulait voir en lui, a contrario, l’homme du « retour à l’ordre ». Y eut-il, du reste, jamais rupture ? Le fauvisme s’est inventé au Louvre, face à Poussin et Delacroix, autant qu’auprès de Vlaminck et Matisse. Entre 1911 et 1914, alors qu’il multipliait les apparentes volte-face, Derain récusa moins le cubisme que l’impératif d’en rester là. Qui, en dehors de lui, aura dénoncé si précocement la dictature de « la forme pour la forme », la perte du sens, le recul du sacré, le rejet puritain du corps, l’interdiction faite au xxe siècle de dire le réel ? Quel peintre, à l’inverse, aura autant élargi le réalisme, au point de rallier Apollinaire et Max Jacob, Breton et Aragon, à son imaginaire superbe d’imprévu, hanté par la Bible, la culture du tarot, le rire de Rabelais, l’amour des femmes et de son pays ? Les réactions consternantes que l’actuelle exposition du Musée d’art moderne de la Ville de Paris a suscitées nous rappellent, si nécessaire, que le clivage s’est durci entre le bon et le mauvais Derain, le fauve explosif et le mentor de Balthus et Giacometti. Nommer ces deniers, c’est rappeler combien, au sortir de l’Occupation, la réévaluation du maître indûment stigmatisé aura mobilisé les plus grands. Pensons aussi à Masson et à Duchamp. Derain, écrit celui-ci, « a toujours cru fermement au message artistique vierge de toute explication méthodique ». Il faut donc l’accepter en bloc. Entre don et mystère, refusant la souveraineté de l’œil et le primat de l’inconscient, cette peinture ne s’habille jamais de codes abscons et de symbolisme transparent. Elle se love, au contraire, dans les circonvolutions d’une quête solide, qu’aucun risque n’effraie, pas même celui « du ratage, de l’échec, de la perdition possible ». (Extrait de la préface)
**Stéphane Guégan, Derain en 15 questions, Hazan, 15,95€ // Pour ou contre Derain ? Nous ne sommes pas sortis de l’équation dans laquelle Les Chroniques du jour, en janvier 1931, enfermaient leurs lecteurs… La revue avait requis des signatures du monde de l’art, sommées de se prononcer sur le peintre qui, au pinacle de la gloire, déchirait le milieu. Parmi les sondés, modernes et antimodernes se disputèrent la formule qui résumerait l’apostat, supposé avoir troqué le fauvisme et le cubisme de sa jeunesse pour un conservatisme rémunérateur… Il y eut bien quelques exceptions dans ce concert de sottises. Le peintre Ozenfant prit le parti du « désenchanté optimiste », Cocteau célébra l’alliance du potier grec et de la Bugatti; d’autres précisèrent le sens d’une modernité qui refusait de rouler à sens unique. Pour eux, comme pour nous, Derain est d’abord l’homme qui sut dire non aux fausses certitudes, et aux vraies clôtures, de l’avant-gardisme. La rupture, contrairement à la rumeur, ne date pas des années 1920, folle époque où l’on voulait voir en lui, a contrario, l’homme du « retour à l’ordre ». Y eut-il, du reste, jamais rupture ? Le fauvisme s’est inventé au Louvre, face à Poussin et Delacroix, autant qu’auprès de Vlaminck et Matisse. Entre 1911 et 1914, alors qu’il multipliait les apparentes volte-face, Derain récusa moins le cubisme que l’impératif d’en rester là. Qui, en dehors de lui, aura dénoncé si précocement la dictature de « la forme pour la forme », la perte du sens, le recul du sacré, le rejet puritain du corps, l’interdiction faite au xxe siècle de dire le réel ? Quel peintre, à l’inverse, aura autant élargi le réalisme, au point de rallier Apollinaire et Max Jacob, Breton et Aragon, à son imaginaire superbe d’imprévu, hanté par la Bible, la culture du tarot, le rire de Rabelais, l’amour des femmes et de son pays ? Les réactions consternantes que l’actuelle exposition du Musée d’art moderne de la Ville de Paris a suscitées nous rappellent, si nécessaire, que le clivage s’est durci entre le bon et le mauvais Derain, le fauve explosif et le mentor de Balthus et Giacometti. Nommer ces deniers, c’est rappeler combien, au sortir de l’Occupation, la réévaluation du maître indûment stigmatisé aura mobilisé les plus grands. Pensons aussi à Masson et à Duchamp. Derain, écrit celui-ci, « a toujours cru fermement au message artistique vierge de toute explication méthodique ». Il faut donc l’accepter en bloc. Entre don et mystère, refusant la souveraineté de l’œil et le primat de l’inconscient, cette peinture ne s’habille jamais de codes abscons et de symbolisme transparent. Elle se love, au contraire, dans les circonvolutions d’une quête solide, qu’aucun risque n’effraie, pas même celui « du ratage, de l’échec, de la perdition possible ». (Extrait de la préface)
 ***Patrice Bachelard, Derain. Un fauve pas ordinaire, Découvertes-Gallimard, 15,90€ // A la suite des monographies de Pierre Cabanne (reprise en Folio) et de Jane Lee, la synthèse du regretté Patrice Bachelard, en 1994, avait confirmé le retour de Derain dans les consciences et les débats esthétiques. Un purgatoire de 40 ans prenait fin et ce livre, faussement modeste, prit part aux réjouissances avec une qualité d’analyse et d’écriture qui a traversé le temps. L’auteur y poussait l’audace jusqu’à couvrir le fauvisme, le cubisme et le dernier Derain d’une même ferveur et d’une même hauteur. Une vraie leçon. SG
***Patrice Bachelard, Derain. Un fauve pas ordinaire, Découvertes-Gallimard, 15,90€ // A la suite des monographies de Pierre Cabanne (reprise en Folio) et de Jane Lee, la synthèse du regretté Patrice Bachelard, en 1994, avait confirmé le retour de Derain dans les consciences et les débats esthétiques. Un purgatoire de 40 ans prenait fin et ce livre, faussement modeste, prit part aux réjouissances avec une qualité d’analyse et d’écriture qui a traversé le temps. L’auteur y poussait l’audace jusqu’à couvrir le fauvisme, le cubisme et le dernier Derain d’une même ferveur et d’une même hauteur. Une vraie leçon. SG
 ****Anne Baldassari (direction), Icônes de l’art moderne. La collection Chtchoukine, nouvelle édition brochée, Gallimard/Fondation Louis Vuitton, 29,90€ // Entre 1912 et 1914, Chtchoukine acquit seize Derain auprès de Kahnweiler. Cette exposition marquante et cette publication, qui ne l’est pas moins, n’avaient pas omis le « troisième homme » (façon de parler) au profit des seuls Matisse et Picasso. A cette occasion, nous avions revu Chevalier X. La formidable exposition du MNAM ramène entre autres Samedi sur les bords de Seine. Chtchoukine, cet éclaireur hors-pair, avait bien compris que son cher Gauguin avait trouvé en Derain, profane et sacré, son unique héritier. SG
****Anne Baldassari (direction), Icônes de l’art moderne. La collection Chtchoukine, nouvelle édition brochée, Gallimard/Fondation Louis Vuitton, 29,90€ // Entre 1912 et 1914, Chtchoukine acquit seize Derain auprès de Kahnweiler. Cette exposition marquante et cette publication, qui ne l’est pas moins, n’avaient pas omis le « troisième homme » (façon de parler) au profit des seuls Matisse et Picasso. A cette occasion, nous avions revu Chevalier X. La formidable exposition du MNAM ramène entre autres Samedi sur les bords de Seine. Chtchoukine, cet éclaireur hors-pair, avait bien compris que son cher Gauguin avait trouvé en Derain, profane et sacré, son unique héritier. SG
André Derain exposé /// L’Art est la matière, une émission de Jean de Loisy, avec Cécile de Debray et Stéphane Guégan, France Culture (1/10/17)
https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/andre-derain-1904-1914-diffusion-le-1er-octobre
Le ciné-billet de Valentine
 Nous sommes à l’heure où le cinéma doit à nouveau dépasser les genres et se réinventer par la déroute de ses codes. N’est-ce pas l’ambition d’Amalric avec Barbara, un biopic qui ne serait pas avili par le genre en lui-même, un détournement formel pour raconter une vie sans l’affadir? C’est, en tout cas, ce que sont parvenus à faire avec brio les frères Safdie qui nous livrent, avec Good Time, un faux film d’action, un film d’action qu’on aurait nettoyé de toute idéalisation et héroïsation. Histoire simple, au départ : après un casse qui a mal tourné, un homme tente désespérément de sauver son frère arrêté par la police. Le film relate cette course incessante qui se nourrit de l’espoir d’un ailleurs, la ferveur que met un homme à fuir la fatalité du sort. Mais cet homme, seul face au monde, ne peut pas gagner. Good Time parle d’un casse dont nous pourrions être l’auteur, un casse d’amateurs qui va emporter le protagoniste vers la déchéance sans que l’on s’en rende compte, sans que lui s’en rende compte, car c’est à cela que ressemble la vie.
Nous sommes à l’heure où le cinéma doit à nouveau dépasser les genres et se réinventer par la déroute de ses codes. N’est-ce pas l’ambition d’Amalric avec Barbara, un biopic qui ne serait pas avili par le genre en lui-même, un détournement formel pour raconter une vie sans l’affadir? C’est, en tout cas, ce que sont parvenus à faire avec brio les frères Safdie qui nous livrent, avec Good Time, un faux film d’action, un film d’action qu’on aurait nettoyé de toute idéalisation et héroïsation. Histoire simple, au départ : après un casse qui a mal tourné, un homme tente désespérément de sauver son frère arrêté par la police. Le film relate cette course incessante qui se nourrit de l’espoir d’un ailleurs, la ferveur que met un homme à fuir la fatalité du sort. Mais cet homme, seul face au monde, ne peut pas gagner. Good Time parle d’un casse dont nous pourrions être l’auteur, un casse d’amateurs qui va emporter le protagoniste vers la déchéance sans que l’on s’en rende compte, sans que lui s’en rende compte, car c’est à cela que ressemble la vie.
La préoccupation constante du réalisme (il faudrait dire d’un « ultra-réalisme »), déconstruit d’elle-même le film d’action comme genre. On quitte la figure du héros invincible qui échappe par sa force vitale et son intelligence supérieure à l’emprise de la société pour rejoindre celle de l’homme qui tend vers l’acte héroïque mais est rattrapé par sa faiblesse contre laquelle il ne peut rien. Car elle le définit presque ontologiquement. Le coup de force des réalisateurs est de maintenir une tension entre l’image héroïque que nous nous faisons malgré tout de Connie (Robert Pattinson), et le pathétique qu’il nous inspire. Connie incarne à la fois l’action dans ce qu’elle a de plus brillant, de plus courageux, et l’échec dans ce qu’il y a de plus navrant et pitoyable. Chaque scène est construite sur le mode du héros victorieux, il se sort de toutes les situations en rusant, brave en apparence les obstacles, mais ce n’est que pour s’enfoncer un peu plus dans sa perte imminente. La force du film est là: nous donner l’illusion qu’il s’agit de l’histoire d’un homme qui se sauve et approche de son but, tandis qu’il s’agit de l’histoire d’une perdition totale et banale.
Cette illusion relève de deux formes de mauvaise foi. D’une part, celle du personnage qui ne s’avoue pas qu’au lieu de surmonter les problèmes, il s’y empêtre (de par son obstination aveugle à vouloir sauver son frère) ; d’autre part, celle du spectateur qui ne peut admettre que les choses ne tournent pas en sa faveur, tant il est habitué au dogme qui veut que le héros ait une fin héroïque. Tout au long du film, on accompagne le personnage dans son constat de l’absurdité des événements auxquels il fait face, on assiste à la cascade disproportionnée des conséquences par rapport au braquage initial, exécuté avec une facilité déconcertante. Tout y prend le contre-pied des stéréotypes du film d’action : pas de terreur, pas d’armes, pas d’intimidation, si ce n’est un bout de papier qui s’échange en silence, et qui rend la scène presque grotesque. En un claquement de doigts, les deux frères se retrouvent avec plusieurs millions de dollars en poche, et pourtant, c’est cette facilité même qui va peser sur le personnage d’un poids écrasant. Désespérante constatation que le bonheur soit aussi accessible qu’il est simple de basculer dans le cauchemar le plus complet. Film dostoïevskien, Good Time réveille le souvenir de Raskolnikov, l’anti-héros, par excellence, en ce qu’il est persuadé que l’homme, par sa faiblesse inhérente, ne peut réussir le crime parfait.
En apparence, Pattinson est la force et son frère la faiblesse. Bien évidemment, leurs personnages se reflètent l’un dans l’autre. Le frère de Connie, Nick, incarne le handicap physique et mental. Reste que ce fatum biologique semble venir de sa trop grande honnêteté, qui le rend inapte à suivre son frère sur la voie de la « délinquance ». Il ne supporte ni le mensonge, ni le faux-semblant. Gêné par le masque du braqueur de banque, affolé par l’interpellation de la police, sa trop rapide arrestation confirme son être profond. Nick devient symboliquement ce qui enchaîne Connie, le prive de sa liberté et l’accule à la prison. Le personnage de Connie toutefois n’est pas non plus sans fragilités. En réalité, le film est traversé par la question de l’identité et du choix. Dans une très belle scène où Pattinson et son compagnon d’infortune discutent pour la première fois (au sens où tout à coup ils quittent le terrain du dialogue lié à l’action et à la survie pour celui de l’existence), émerge la question du jugement de soi et du jugement de l’autre. Connie est soudainement rattrapé par le doute qui jusque-là était étouffé par la dynamique de l’action. Là encore, il y a quelque chose de comique et de pathétique à voir ces deux personnages dans un état lamentable, recherchés par la police, voués à échouer, prendre le temps de se juger et s’évaluer moralement. Mais selon quels critères de jugement? Dans cette société assez macabre où la violence est banalisée (une scène très frappante montre une jeune fille désenchantée éprouver plus de sympathie envers un chien maltraité à la TV qu’envers une vieille femme sauvagement agressée), on se demande qui pourrait désormais fournir un critère de jugement, un repère éthique stable. Le film se referme sur ce même trouble identitaire. Nick, qui depuis le début est représenté dépossédé de sa pensée, se confronte enfin à lui-même dans le cadre d’une thérapie de groupe, scène apparemment anodine, mais qui prend une grande profondeur aux yeux du spectateur, tant les réalisateurs sont parvenus à nous plonger dans l’introspection. Ce moment du jeu, ce n’est pas le moment de la vérité, mais, comme l’énonce la règle, la simple possibilité de « make your own truth ». Finalement, il n’y aurait pas à trouver, mais à choisir.
Valentine Guégan // Good Time, film réalisé par Ben et Joshua Safdie, 2017.