
« Où est passé Giraudoux ? se lamentait Le Figaro en 2011, ses meilleures pièces ayant disparu des affiches parisiennes, et leur auteur ayant été réduit au silence par décision du prêt-à-penser actuel. Dix ans plus tard, le déficit de présence scénique et de reconnaissance collective s’est accru malgré les efforts d’une poignée de spécialistes et de quelques lecteurs vaccinés contre la censure. Puisque la machine du monde se détraque et que la patrie agonise, pour le dire comme Giraudoux, et qu’Electre, à défaut d’être jouée, a rejoint Folio Théâtre, rouvrons le dossier de cet infréquentable qui charma, en son temps, deux de ses plus brillants rivaux. Le premier, né en 1882, est son exact contemporain, et son exact opposé, François Mauriac, tempétueux catholique aux passions souvent rentrées, qu’il transfère à ses héroïnes nécessairement plus combustibles. A l’inverse, selon lui, les romans et le théâtre de Giraudoux, si chauds soient-ils, souffrent d’une innocence païenne et d’une froideur de langue où se sentent le bon élève et le diplomate habitué à ne jamais se mouiller. Un éclat sans parfum, un feu sans outrance, résumerait Mauriac s’il s’écoutait… Les appels de la chair, il l’a dit et redit, ne se conçoivent pas en dehors des rappels de Dieu, de l’ombre du mal et d’un verbe plus direct. Relisant Electre aujourd’hui, non sans plaisir, je suis frappé par cette retenue et certains sous-entendus moins chastes. Ils ne sont pas loin, par instants, de l’esprit qu’Offenbach appliquait à la fable antique, quand ils ne rappellent pas le boulevard. Chez Giraudoux, par exemple, cela donne, dans la bouche d’Egisthe s’adressant au jardinier qui croit pouvoir épouser Electre : « Laisse ta figue tiédir, et prends ta femme. » D’autres allusions, inversées ou non, aux attributs sexuels se signalent ici et là, jusqu’au cœur de la sublime tirade de Clytemnestre, où éclate la vérité d’Agamemnon, monarque dérisoire, infidèle, niais et peut-être pas, au lit, aussi puissant que cela. C’est légitimer l’adultère, grand thème d’Electre et de la vie extra-conjugale de son créateur (1). En août 1937, en pleine Exposition Universelle, dont la pièce avait été une des attractions, de même que Guernica ou les pavillons nazis et staliniens, Mauriac consacra un long article au dramaturge. Dès le titre, « Le sourire de Giraudoux », l’intention est assez claire, ni éreinter, ni encenser, mais avouer un attrait aussi irrésistible qu’incomplet ou irritant. « Fleur unique de ce que nos maîtres dévots appelaient l’école sans Dieu », Giraudoux offre à son public, alors large, ce « magnifique petit catéchisme humaniste » aux accents rêveurs, optimistes et presque délivrés du péché originel. Cette littérature que travaille l’actualité politique plus que la métaphysique reste en partie opaque à son auditoire et à elle-même. Avec un précieux, « on n’est sûr de rien », concluait Mauriac, méchant, après avoir assisté à Electre, chef-d’œuvre d’indécision, il est vrai, tragédie riante du choix à trancher entre la victoire de la vérité et le naufrage de la cité d’Argos, ou de la France par ricochet, sous les effets destructeurs d’une justice inflexible et dénaturée. Drieu la Rochelle, l’autre témoin à consulter s’agissant du dernier Giraudoux, n’était pas homme à accepter l’irrésolution ou la simple circonspection en matière nationale, l’imminence du danger le hantait comme un meurtre impuni. Certes, ce qui se passait en Italie, en Allemagne et en Espagne l’avait requis très tôt, l’enthousiasmait pour partie : le « socialisme fasciste » qu’il revendiquait depuis 1934 n’en était pas moins assorti de sévères réserves sur les dictatures du moment, l’archaïsme raciste et belliciste du programme hitlérien notamment.
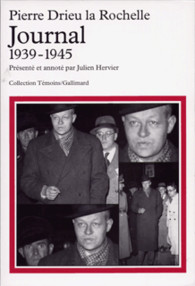
En septembre 1938, Drieu sera farouchement anti-munichois et restera incrédule devant le virage autoritaire que l’auteur d’Electre opéra, après 1939, avec Pleins pouvoirs (Gallimard) et son ralliement ouvert à la nouvelle politique de Daladier au sein du Commissariat général à l’information. Il s’en voit confier la direction par le chef du gouvernement à la veille du déclenchement d’une guerre qui, elle, a bien lieu. Les passages terribles que le Journal de Drieu réserve à Giraudoux se veulent accablants, définitifs. Le normalien diplomate, le peintre de mœurs léger, l’écriture à la fois sèche et enrubannée, la bienveillance envers l’Allemagne brisée par la guerre de 14, le dramaturge rhéteur et pacifiste des années 1930, les ondoiements de la voix de Daladier en 1939-40, les accointances avec Vichy plus tard, rien ne saurait porter le diariste à l’indulgence, hormis la séduction féline, certaine, qu’exerce malgré tout l’œuvre : « Je n’ai pas souvent admiré autant un talent qui enveloppait pour moi une nature aussi antipathique et une conception des choses aussi révoltante », note-t-il, pour lui, en février 1944, quelques jours après la mort mystérieuse de Giraudoux au milieu d’une émotion presque unanime. La parole privée, qu’il est criminel de confondre avec ses déclarations publiques, entraîne souvent Drieu sur les mauvaises pentes d’une colère dégondée. Mais tous les reproches qu’il adresse à l’auteur d’Electre dans le secret du Journal sont-ils infondés ? Il commente peu, étrangement, l’expérience de la guerre de 14 que Giraudoux avait partagée avec l’homme de La Comédie de Charleroi. Ses états de service, pour être moins brillants que ceux de Drieu, dessinent d’étranges parallélismes avec les siens, jusqu’à l’épisode des Dardanelles et le repli, plus précoce dans le cas de Giraudoux, à l’arrière. Mais cette guerre reste leur bien commun, elle ne les fera agir différemment que plus tard. L’aîné, bien sûr, est entré dans la carrière des lettres dès avant l’hécatombe : Giraudoux, auteur Grasset et Emile-Paul, a été remarqué par les membres fondateurs de la NRF, dont il reste le contributeur irrégulier entre 1909 et 1939. Le ton de ses premiers succès romanesques, au début des années 1920, colle à l’épicurisme piquant et distingué dont André Billy rapprochera le Drieu de Plainte contre inconnu, en 1924, pour signaler une influence possible et surtout une inflexion du cadet vers une peinture plus crue des mœurs dissolues de la folle époque. Homme couvert de femmes, à l’instar de son jeune rival, Giraudoux préfère la compagnie de Morand, Cocteau, Max Jacob ou Marie Laurencin. La grande rencontre cependant, c’est celle de Louis Jouvet, nouveau dieu des planches et leur rénovateur, dans le sens de la sobriété scénique et de Jacques Copeau. La création triomphale de Siegfried, en 1928, ouvre une période de succès continus.

Avant de dîner avec Jouvet lors de la « drôle de guerre », Drieu eut l’occasion d’observer le jeu des convergences idéologiques au lendemain de la crise de 1929. Une certaine logique conduit, en effet, des positions de Briand et Herriot, en matière de réparations allemandes, à la stratégie, risquée par défaut, des bienveillants accords de Munich. Or cette logique, précisément, définit assez bien l’attitude de Giraudoux, qui se rapproche des radicaux, et donc de la gauche réconciliatrice, après avoir brocardé Poincaré, l’héritier du Tigre, dans le wilsonien et genevois Bella (1926). Se ralliant à Herriot en 1932, il donne au briandisme et au pacifisme de Stresemann une bannière éclatante, La Guerre de Troie n’aura pas lieu et Electre, à un moindre degré. La nécessité d’entretenir l’entente franco-allemande, coûte que coûte, est ardemment défendue par Giraudoux, Jouvet et leur entourage, Emmanuel Berl comme Gaston Bergery. Or, ce furent tous deux de très grands amis de Drieu ces noceurs, ces séducteurs des années folles dont la politique l’éloigne à regret, l’auteur de Gilles leur réserve, de surcroît, un traitement terrible, sous le masque de Preuss et de Clérences, dans ce roman que Gallimard lançait, fin 1939, comme la plus décapante radiographie des années 1917-1937. On en retient aujourd’hui les railleries au vitriol que Drieu y multiplie à l’endroit de ses protagonistes juifs (non sans y introduire une contradiction et des variables que j’ai dites ailleurs). Le pouvoir en place, à savoir notre Daladier regonflé par la guerre, exige qu’on gomme les cruautés de Gilles sur le personnel de la IIIe République et les pitreries inconséquentes, ou tendancieuses, du milieu surréaliste (Aragon et Breton y sont « arrangés »). Le comique, involontaire, c’est que le grand roman de Drieu connaît la censure officielle au moment où, pour quelques mois encore, Giraudoux dirige la propagande du régime aux abois. Le 11 septembre 1939, amer, il confie à son Journal : « Voilà que le livre d’un écrivain dépend du jugement politique d’un autre écrivain fonctionnaire. […] Nous autres qui étions des bourgeois artistes, des artistes libres, nous n’avons plus qu’à crever».
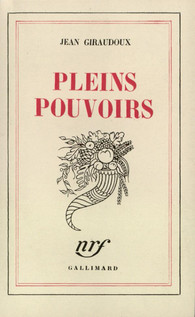
Le protégé de Daladier, Giraudoux, venait de publier, chez Gallimard, Pleins pouvoirs, né de conférences où il en appelait au réveil des écrivains, au durcissement de l’exécutif et au redressement de la France. Ce livre que Drieu dit « en carton », par ironie, constitue la principale source des préventions de notre époque. On lui passerait sa nostalgie pour la France idéale qu’il aspire à restaurer, quelque part entre le royaume de Louis XIV et la vision républicaine, très ancrée, de Michelet. Mais il y a le reste… Afin de stopper la lente dégénérescence qu’il estime gangréner le pays, déjà affaibli par une terrible baisse des naissances, Giraudoux, très rétif à l’avortement, propose des remèdes sur un ton injonctif. L’équilibre s’étant rompu entre la ville et la campagne depuis 1918, il faut s’attaquer au surpeuplement des villes, au cadre urbain dégradé et, thème redevenu d’actualité, à la réintroduction de la nature dans l’espace des déracinés. L’auteur, tennisman accompli, veut mettre les Français au sport depuis les années 1920. A trop négliger son corps, la jeunesse racornit son âme, perd le sens de l’effort et du dépassement de soi, rend la patrie plus vulnérable, d’autant que la population française, à partir de 1931, a vu son immigration exploser: nous sommes devenus, devant les USA, le pays le plus accueillant aux étrangers. On ne s’étonnera pas que le chapitre le plus justement controversé de Pleins pouvoirs soit aujourd’hui « La France peuplée ». Giraudoux est loin d’y plaider la fermeture des frontières, le rejet systématique des « autres » et le renvoi impératif des exilés politiques. Il y a une nécessité migratoire, au-delà des bras qu’elle donne aux campagnes qui se vident. En revanche, vis-à-vis des émigrés d’Afrique du Nord et d’Europe de l’Est, il préconise un accueil sélectif, teinté de pragmatisme, de la peur légitime de l’ennemi de l’intérieur (la guerre approche en juillet 39 !), mais aussi du racialisme de l’époque et d’une méfiance certaine envers les populations juives d’Europe centrale. Rappelons, après Ralph Schor, que les Juifs de France, qu’on pense à Emmanuel Berl, ne se montrèrent pas tous plus généreux alors envers les ashkénazes de Pologne et d’ailleurs… Après avoir quitté ses fonctions, en raison de son inexpérience politique et de son peu d’aptitude à toucher les masses par sa rhétorique policée et son manque de charisme radiophonique, Giraudoux jouera un rôle discret à Vichy, notamment du côté de l’organisation Jeune France (3), et continuera sa carrière de tragédien sophistiqué. Lorsqu’il s’éteint et crée l’émotion que l’on a dite, Drieu ne dénonce pas, tel Brasillach dans La Gerbe, ce germaniste qui avait fini par trahir la cause de la Paix et de l’Entente franco-allemande, il confie toutefois à son Journal, au sujet du grand mort : « C’était bien l’homme de nos Français, surtout ceux de 1920 à 1940. Un monde statique où au fond il ne se passe rien. La tragédie se résout toujours en comédie. L’homme n’est pas vraiment l’ennemi de l’homme ni son ami. Les dieux, on doute de leur existence parce qu’on prétend être à l’abri de leur terrible efficacité. C’est un monde où l’on joue avec l’idée de désastre. […] J’ai horreur de ce style amphigourique et précieux, […] cette inversion perpétuelle de la métaphore, ce système monotone d’antithèses. […] Cela n’empêche pas que la ligne de ses pièces est ravissante, une charmante arabesque de moralisme. » Pour Mauriac et Drieu, autres frères ennemis, catholiques différemment, les écrivains de « l’école sans Dieu » ne pouvaient accoucher que d’une littérature de distraction et d’évitement.
Stéphane Guégan

(1) Voir Jean Giraudoux, Electre, édition de Véronique Gély, Gallimard, Folio, 4,40€. Dans sa préface informée et enlevée, V. Gély, signe des temps, s’intéresse plus aux rapports mères-filles et hommes-femmes qu’au contexte idéologique et à ce qu’il faut bien appeler l’ambiguïté de la pièce, par diminution des conflits inhérents au genre de la tragédie antique. Le dilemme d’Electre (la vérité ou la collectivité) reste prisonnier de sa névrose et de sa méconnaissance des faits. Giraudoux, du reste, n’en fait pas l’héroïne qu’attend le spectateur, surprise qui s’ajoute aux autres : Clytemnestre et Egisthe sortent grandis du drame, aux dépens de la princesse frigide, d’Oreste, le frère aveuglé, et de leur père, lui aussi déchu de son statut de victime exemplaire. Comme il l’avoue à Ce soir, le quotidien fielleux d’Aragon, Giraudoux prend de grandes « libertés avec la tradition antique ». Plus encore, c’est la structure civique, métaphysique et accessoirement guerrière, évidente chez Sophocle et Euripide ou Corneille et Racine, qui se détraque… Puisqu’on parle des gens de Moscou, on notera enfin que Claude Roy, ex-maurrassien dur des années 30, et passé d’un extrême l’autre durant l’Occupation, n’annonce aucunement, en avril 1944, l’excommunication actuelle de Giraudoux. Sa nécrologie des Lettres françaises encense, au contraire, le dramaturge, symbole disponible d’un patriotisme en voie de triompher à nouveau. Il ne peut s’empêcher, naturellement, de s’approprier la dernière réplique d’Electre, largement galvaudée depuis : « Cela a un très beau nom, femme Narsès, cela s’appelle l’aurore. » /// (2) Voir Philip Nord, Le New Deal français, Perrin, 2019, 25€. Connu pour ses excellents travaux sur la consolidation du régime républicain en France, et la contribution des peintres (Manet, Monet, les impressionnistes) à ce processus, Nord se tourne ici vers une époque plus délicate à évaluer dans ses dynamiques, ses mentalités et surtout ses continuités continûment tues. Cette séquence de temps mal articulée, c’est celle qui va des dernières années de la IIIe République à la fin des années 1950. En manière de plaisanterie, Nord confie à ses lecteurs qu’il aurait pu intituler son livre Les origines vichystes de la IVe République. C’eût été beaucoup forcer sa thèse, qui veut que le renforcement de l’Etat soit resté une priorité et une obsession, de Daladier au retour de De Gaulle en 1958, Vichy compris. Sur différents plans, de la politique culturelle à la politique familiale, du registre urbain au volontariat industriel, bien des idées, réformes et structures administratives se sont transmises du Front populaire à Pétain et de Pétain à la IVe République. Histoire politique et histoire culturelle s’épaulant ici, le lecteur y croisera aussi bien Jean Zay, Léon Blum, Mendès-France, Laval, Michel Debré, Jouvet, Giraudoux que Bergery ou Le Corbusier, assez occupés de révolution nationale après la défaite. SG