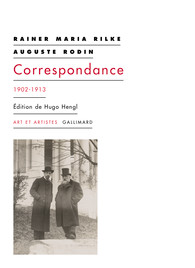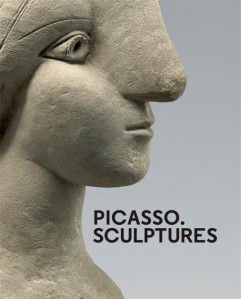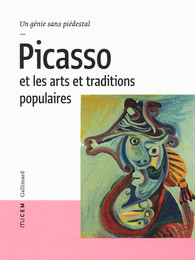Publié chez Skira en octobre 1971, et seizième opus des Sentiers de la création, La Chute d’Icare, aurait pu, aurait dû en constituer le premier, comme Gaëtan Picon, son auteur et le directeur de cette éminente collection depuis deux ans, le suggérait lui-même : du processus de génération formelle que visaient ces ouvrages, Picasso avait été très tôt « l’instigateur », écrit Picon, avant de rappeler une anecdote qui remontait au début des années 1930 : « Comme Albert Skira aime à le raconter, l’idée de la collection a pris naissance ce jour où, marchant à côté de Picasso dans le parc de Boisgeloup, il vit son compagnon ramasser un fil de fer et un morceau de branche morte et les enfouir dans la poche de son imperméable. Quelques jours plus tard, il devait les retrouver dans l’atelier – devenus sculptures. » Je ne peux pas m’empêcher d’associer à ce récit des origines une teinte de nostalgie, parce qu’il ramène Picon et ses lecteurs à une période antérieure à la seconde guerre mondiale, parce qu’il désigne un moment du parcours picassien étranger à l’engagement communiste. Ne croyons pas pour autant que La Chute d’Icare, décor (ill. 1) et livre, soit coupé de l’histoire politique du XXe siècle : c’est même tout le contraire, j’y reviens plus loin. Inauguré deux fois, en mars 1958, à Vallauris et en présence de Maurice Thorez, puis en septembre de la même année, à l’UNESCO qui en était le commanditaire, le vaste décor, dans sa phase primitive, avait précédé le retour de Charles de Gaulle au pouvoir.

Entre le 6 décembre 1957 et le 29 janvier 1958 s’étaient ainsi échelonnés une vaste série de dessins à la mine de plomb, au crayon gras, ou à l’encre de Chine. De la gouache initiale à la maquette finale, Picasso n’a pas chômé. Il est vrai que l’UNESCO lui confirme, le 24 octobre 1957, par courrier de Jean Thomas, son Directeur général, l’attribution de la somme considérable de quatre millions deux cent mille francs en paiement de ce qui doit constituer le principal attrait de ses nouveaux bâtiments parisiens (130 m2 de peinture à l’acrylique). Georges Salles, l’ancien directeur des musées de France, avait encouragé l’artiste à accepter cette commande et à la réaliser vite. A défaut d’un programme iconographique précis, le titre fut apparemment, et en toute logique, du ressort de l’UNESCO : Les Forces de la vie et de l’esprit triomphant du Mal relèvent d’une rhétorique analogue au Delacroix de la Galerie d’Apollon (Louvre), Apollon tuant le serpent Python (ill. 2), peinture de 1850-51 que Picasso connaissait bien. Sa première pensée, durant l’hiver 1957-1958, n’en fut pas moins une scène d’atelier très éloignée des classiques ou baroques allégories. On songe plutôt à la fameuse « allégorie réelle » de Courbet qu’est L’Atelier d’Orsay (ill. 3). Sa proximité avec la gouache initiale du 6 décembre 1957 (ill. 4) a été signalée par Pierre Daix. Mais, à la différence de son ainé, au centre de la composition de 1855, Picasso, en ombre chinoise, s’est déporté sur la droite de la feuille, le regard et la palette tournés vers les deux présences qui occupent le champ de l’image, un tableau représentant des baigneurs et des plongeurs, un modèle féminin, allongée et nue à gauche. Une toile sur un châssis retourné, comme chez Courbet, complète la donne. Pour être étrange, la proposition iconographique de départ n’en était pas moins compatible, par son optimisme relatif, avec les attentes de l’UNESCO, vouée à soutenir et célébrer les bienfaits de l’éducation, de la science et de la culture.

L’image initiale allait toutefois beaucoup évoluer au gré de brusques changements, d’inattendus écarts, qui fascinaient Picon et le confortèrent dans sa conviction que la création poétique ou plastique s’identifiait à une manière de plongeon ininterrompu, tant que l’artiste en avait ainsi décidé. Son livre nous y plonge à notre tour, et déroule, du décor de l’UNESCO, le film de ses péripéties, à partir des carnets et feuilles préparatoires. Priorité est même donnée au visuel sur le verbal, inversion des habitudes de la collection selon Picon lui-même : « Jusqu’à présent, écrit-il, la réponse avait été celle des mots. L’image-document, aujourd’hui, remplace la parole-hypothèse. Regardons. Et si ce que montre le regard n’est pas tout à fait conforme à ce que les mots se préparaient à dire, alors, que l’esprit rentre ses mots. Et qu’il tente d’en trouver d’autres, plus proches de ce qui lui est donné à voir. » Pour Picon, l’acte créateur est premier, l’explication seconde, voire menacée d’échec. Le tout intelligible est un leurre. De plus, à l’œuvre en devenir ou en recherche d’elle-même, on peut assigner une fin, non un début absolu ; la déjà citée gouache du 6 décembre 1957, note Picon, est riche d’antécédents : si elle « met en scène un espace réel, qui est celui de l’atelier même du peintre [,] cet espace réel, qu’elle convertit en image, contient déjà une image – celle d’un tableau, Le Tremplin, avec l’artiste se profilant dans l’ombre : image qui se réfère elle-même à une image plus ancienne, le tableau qui se trouve ici à l’intérieur du tableau étant fait à partir d’une sculpture. Ainsi, chaque élément appartient à la fois comme cause et comme effet à un jeu d’autoréférences qui possède en lui-même son principe de génération. Nous sommes ici dans le règne d’une nature autonome (celle des images, non des choses), et d’une nature continue, fonctionnant comme un système d’ensemble, chaque élément relevant du tissu tout entier plutôt que de l’unité qu’il est possible d’y découper. » Tout le passage est révélateur du primat donné au fait plastique, tel que Picon et Malraux s’en sont fait les champions depuis l’après-guerre. L’art moderne ne saurait être d’imitation ou d’observation au sens du XIXe siècle, il est de conception, et s’accomplit dans la cohérence de la configuration visuelle qu’il oppose au néant d’un monde sans Dieu, et propose à notre lecture. On ne parlera pas de strict formalisme cependant, puisque les formes se veulent l’expression obscure d’une nécessité d’ordre métaphysique, et que toute relation avec le monde sensible n’y est pas congédiée.

Le thème principal des premiers dessins de Picasso sert au mieux le propos de l’exégète. « Le tableau, le tremplin : c’est entre ces deux éléments que tout se joue. […] Le plongeur ne serait-il pas, comme le peintre, devant le risque et le vide de son élément ? » Si les plongeurs ont préexisté à la gouache de décembre 1957, ils ne vont pas tous survivre à ses différentes mutations. « Entre celle-ci et le résultat final, souligne Picon, aucune ressemblance n’est immédiatement perceptible. » Se succèdent alors une vingtaine de pages où les mots se contentent d’identifier les dessins, sans commentaire donc, en toute souveraineté. Si succession il y a bien, elle ne saurait être d’induction parfaite ; impossible donc, selon Picon, de déduire l’œuvre finale « des éléments complètement rassemblés comme leur conséquence nécessaire. Et, à aucun moment, le dessin du jour ne peut être considéré comme la conséquence du dessin de la veille. Il y a, à chaque instant, un saut, un coup de dés, une ouverture imprévue, l’instant terminal étant non point l’aboutissement de ces sauts, la réduction ou la compensation de ces écarts, mais le saut auquel le peintre choisit d’arrêter son bondissement. » Sous couvert du coup de dés mallarméen, on retrouve l’idée de l’acte créateur comme plongeon et plongée. S’ouvre alors une nouvelle séquence graphique, aussi longue que la précédente, aussi ondoyante surtout, elle met en lumière les infimes reprises que subissent chaque élément thématique de l’atelier originel. Puis vient le « saut décisif », écrit Picon, opéré entre le 8 janvier 1958 et le 18 du mois, quand s’ouvre la phase qui mène au dernier état de la composition (ill. 1 et 5). Aucun des éléments initiaux n’y entre. Tous ceux du décor terminal les ont remplacés, Picasso y rassemble « la baigneuse de gauche […] – la figure verticale dressée comme la pièce d’un jeu d’échecs, qui ne rappelle que de très loin les sculptures et les silhouettes du Tremplin – la baigneuse couchée sur le dos – le profil d’homme accoudé et surtout la forme plongeante autour de laquelle tout va se stabiliser : la pieuvre à tête d’anneau, aux doigts et au corps de squelette […]. » En somme, l’œuvre dite finale n’est que l’avatar tardif d’une série de métamorphoses dont une partie des modalités nous échapperait. Si, précise Picon, Picasso « semble marcher dans une clarté grandissante », cette clarté reste trompeuse : « La création ne cesse d’ouvrir, accidentellement, sa propre route. A chaque moment se produit quelque chose d’imprévisible – que l’esprit seul, et celui-là même du créateur, n’a pu accomplir, qu’a pu seule accomplir sa main, devançant l’esprit, lequel, ensuite, s’arrange comme il peut. L’ensemble des opérations ne se réduit à aucune raison que l’on en dégagerait pour les déduire ensuite. En ce sens, elles sont inexplicables. » A cet égard, La Chute d’Icare lui semble plus exemplaire que Guernica dont le dessin du 11 mai 1937, précise Picon, « contient déjà tous les éléments de la toile du 15 juin ». Au cours de l’élaboration de l’œuvre commandée par les Républicains espagnols, « l’image bouge, mais faiblement : elle est sauvée du ressac. […] La Chute d’Icare rend sensible [quant à elle] cette continuité si frappante chez Picasso du discontinu créateur. »

Quand d’autres auraient glosé le grand décor en le contextualisant sans tarder, le directeur des Sentiers de la création s’offre le luxe de n’y venir qu’en fin d’analyse, inversant les usages de l’histoire de l’art au profit du caractère irréductible, imprescriptible, de l’aventure des formes. Soudain, en effet, Picon change de registre : ce n’est plus l’œuvre qui à soi seule fait l’auteur, mais l’auteur qui reprend la main, l’auteur et le contexte de ses actes. En 1957, rappelle Picon, Picasso vient « de s’installer à Cannes. Il prend ses distances à l’égard de la politique, de l’engagement. Il laisse derrière lui la tentation des grands sujets de la vie historique et collective. Il se retrouve seul dans l’atelier qu’il peint, et où il peint avec le souvenir de quelques grands rivaux, de Velázquez à Matisse, et en présence d’un nouveau visage de femme, qui vient d’entrer dans sa vie. Cette succession d’actes distincts d’invention, ces sauts, ces coups de dés, ces « sorties » imprévues, possèdent ainsi une unité de fait. Y-a-t-il aussi une unité de sens – même si c’est au dernier moment qu’elle surgit ? » La Chute d’Icare, note-t-il, n’a reçu son titre qu’a posteriori. Il ne s’agit plus d’une idée à laquelle il faut donner une image : Guernica, Massacre en Corée de 1951, La Guerre et la Paix, peints aux murs de la chapelle de Vallauris en 1952-1953, autrement dit l’art de propagande. « Cette fois, poursuit Picon, Picasso a fait un tableau à partir duquel le titre reste à trouver, n’importe quel tableau – à cela près qu’il doit convenir à un mur de l’UNESCO. Et ce tableau, dont il ne savait pas ce qu’il serait […], voici qu’on peut l’appeler aussi bien La Chute d’Icare que : Les Forces de la vie et de l’esprit triomphant du Mal. – Après tout, l’atelier dont il est parti ne contenait-il pas, avec le profil de l’artiste, l’un de ses tableaux et le modèle nu, ce qui eût pu convenir à une institution au service de la culture et de la vie ? » Le livre de Picon fait alors un écart, qui lui permet discrètement de dépasser les limites de sa propre analyse, et de corriger l’affirmation selon laquelle La Chute d’Icare tiendrait à distance les turbulences politiques du moment où elle fut conçue, peinte et inaugurée. Contrepoint ténébreux de cette image plus matissienne que picassienne, le squelette du plongeur, comme irradié en sa mandorle noire, appelle une explication : « Car si le personnage vertical […] se dresse vigilant comme l’esprit, […] la forme immergée, elle, est ambiguë – et l’on a le droit d’hésiter entre le symbole du héros vaincu dans le combat spirituel […] et celui – plus proche des batailles d’hommes d’une histoire plus récente, dont l’UNESCO, justement, veut empêcher le retour – de la pieuvre du Mal dont les tentacules viennent de lâcher prise, selon la promesse faite aux « vainqueurs de Guernica ». Sitôt convoquée, l’explication politique est suspendue : « Mais devons-nous choisir ? Une œuvre n’a pas un sens si elle n’est pas pour cela privée de sens. » Picon semble, de fait, plus soucieux de dissiper les ambiguïtés qu’une lecture hâtive de son livre pourrait susciter, car l’autonomie plastique à laquelle tendraient les grandes créations ne signifie pas fermeture au réel. Si toute œuvre digne de ce nom « fonctionne comme un système autonome », écrit-il, « la création est aussi une aptitude à faire du monde sa pâture. »

Du reste, les toutes dernières lignes de l’essai de 1971 font écho à Admirable tremblement du temps et à sa critique d’une peinture qui, oublieuse de l’appel du monde, insoucieuse de dire le réel, ne ferait entendre que le son, privé de sens, de ses seules formes : « Après tout, si Icare est tombé, n’est-ce pas pour avoir oublié l’autre élément ? interroge Picon. […] La figure énigmatique de l’art contemporain est celle-ci, peut-être : d’avoir découvert la vérité de son essence – à savoir que la création est une sorte de parthénogénèse, une autogénération à partir de ses moyens -, il risque de perdre son existence. » En d’autres termes, à rompre son attention au réel, à créer en vase clos, à confondre autonomie et autarcie, l’art perd toute pertinence et donc toute légitimité. La plupart des experts de Picasso, ignorant l’ambiguïté du livre de Picon sur ce point, dissocient La Chute d’Icare de sa peinture politique. Pierre Daix, qui publie une recension très enthousiaste du livre de Picon (Lettres françaises, 12 janvier 1972), voit dans le décor de l’UNESCO « une étape de la reconquête de soi […]. Ce plongeur sans filet n’est-ce pas lui [Picasso], plus que cet Icare que les autres y voient ? » Il qualifie d’« idiot » le titre qui aurait été « donné » à cette peinture qui lui semble plutôt tutoyer Matisse qu’avouer la mauvaise conscience de l’artiste. Or, il me semble que cet « Icare des ténèbres », selon la belle formule que Georges Salles prononce en mars 1958 et que Picasso accepte alors, dévoile le sous-texte oublié de ce décor, nié même par ceux qui en avaient les clefs d’interprétation, ses compagnons de route du PCF comme Daix… Depuis les peintures de la chapelle de Vallauris (1952-1953), criantes de manichéisme et de pauvreté d’inspiration, l’histoire avait mis le peintre devant ses responsabilités. On sait que lors de l’écrasement de Budapest, fin 1956, qui fut aussi l’écrasement de la conscience européenne, il ne rompt pas avec le PCF, quand ses proches l’encouragent à le faire, de James Lord à Michel Leiris, sans parler des insurgés hongrois eux-mêmes. « Le crime russe en Hongrie est d’un ordre qui rend le silence complice », note alors le Journal de Cocteau. Picasso, on le sait, se contente de cosigner une lettre adressée au Comité central où il se borne à manifester une inquiétude quant à la désinformation dont ferait preuve L’Humanité au sujet de l’actualité, actualité qui est aussi celle du rapport Khrouchtchev. Stupeur de Thorez et Laurent Casanova ! La défiance s’installe, comme Cocteau est presque seul à nous le faire mesurer, soulignant aussi bien le désenchantement de Picasso que son incapacité à l’avouer ou à le peindre en toute transparence. Il faut donc ici revenir à la pieuvre noire à tête d’anneau. Si l’on se souvient que Picasso approuva la formule de Salles, cet « Icare des ténèbres » n’est-il pas, plutôt qu’une énième allusion au grand Sam, la terrible métaphore de la fin des illusions, de la fin de l’illusion, l’allégorie d’une hubris, cette fois communiste, secrètement désavouée, mais publiquement tue ? La chapelle de Vallauris dénonçait les méthodes américaines en Corée, bombardements massif et guerre bactériologique, le décor de l’UNESCO s’ouvre peut-être à une tout autre lecture de la Pax sovietica. Stéphane Guégan
*Picasso 1957-1971, portrait de l’artiste en plongeur, colloque Gaëtan Picon et la pensée de l’art, organisé par l’association Les Amis de Gaëtan Picon, 3 et 4 juin 2022.
PICASSO, C’EST AUSSI…

Le premier panthéon de Picasso, où siègent Velázquez et Cervantès dès 1894-95, se montre moins généreux envers Greco, dont la résurrection était pourtant bien avancée. Les Français en furent les intercesseurs les plus décisifs, les écrivains, de Théophile Gautier à Montesquiou, comme les peintres, de Degas à Lautrec et Emile Bernard. Mais l’enfant de Malaga et le génie de Tolède, un Crétois devenu l’incarnation de l’Espagne post-tridentine, ne mettront pas longtemps à se trouver. Quand Picasso, à 16 ans, rend compte de sa visite du Prado, découvert en 1897, Greco s’est hissé parmi ses dieux, aux côtés de Titien, Rubens et Van Dyck. On notera qu’il parle plus alors de peinture religieuse que de sujets profanes, ce qui fait mentir une bonne part de l’historiographie picassienne, aveugle au sacré par cécité marxiste ou moderniste. Kahnweiler aura contribué à installer cette erreur de lecture en rapportant certains propos de Picasso, ou supposés tels, au milieu des années 1950, et en accréditant, à tort, une hostilité de race à l’égard des tableaux de dévotion du Greco. Ils ressortiraient à la rhétorique italienne, et seuls ses portraits, si humains, si brusques, feraient éclater sa leçon de vérité. L’exposition de Bâle ne croit pas à ce partage des eaux et rétablit enfin les termes du dialogue que Picasso, à trois siècles de distance, et malgré la fameuse « mort de Dieu », a noué avec son aîné. En moins de 80 œuvres, démonstration est ainsi faite que l’essentiel du grecquisme picassien déborde les attributs qu’on lui associe habituellement, visages en lame, barbes en pointe, regards de feu, lèvres de fer, libre anatomie et formidable résonance intérieure. Cela n’est pas faux, c’est simplement insuffisant. Une toute autre parenté, plus spirituelle et plus secrète, se dégage des rapprochements qu’a voulus Carmen Giménez et qu’elle illustre par des prêts prestigieux. Depuis le livre de Coquiot, la période bleue passe pour la plus poreuse au magnétisme du Greco. La palette mariale du vieux maître, ses lumières brisées, le sillon de céleste souffrance qu’il imprimait à ses images de saints et de saintes, Picasso en est bien l’héritier conscient. Mais ces hommes et ces femmes qu’il poursuit au café, dans les rues pouilleuses et les bordels à peine plus reluisants, ne sont-ils, ne sont-elles que les victimes du mal social qui frappe de plein fouet l’Europe 1900 ? Devant l’insistance que Picasso met à importer le mysticisme du Greco au sein de ses misérables ou de ses acolytes au verre facile, on finit par se demander si leur détresse, qu’il aura traduite comme personne, n’est pas davantage métaphysique. Aussi l’aspect le plus stimulant de l’exposition bâloise est-il lié à la forte présence des tableaux cubistes et à ce qui s’y devine de références à la grande imagerie catholique. Aux apôtres décharnés, à Madeleine repentante, à la Vierge de douleurs, se sont peut-être substitués des musiciens, des poètes ou des femmes aux yeux profonds, le mystère lui demeure : une manière de transcendance perdue hante la peinture à facettes et nous oblige, à force d’attention, à en ressusciter au sens fort les figures. A la fin des années 1960, ce seront les mousquetaires baroques qui combleront de truculence le « défaut de divin » propre à notre monde de plus en plus étroit. SG // Picasso – El Greco, Kunstmuseum Basel, 11 juin-25 septembre 2022. Catalogue sous la direction de Carmen Giménez, 44 €.

L’enfant va paraître, quelques heures à attendre, pas plus. Picasso attrape son carnet et note : « Si c’est une fille, La Faucille, si c’est un garçon, Le Marteau. » Nous sommes le 5 septembre 1935, et ce sera une fille, et elle ne s’appellera pas Joséphine, en l’honneur de Staline. María de la Concepción convient mieux à ses parents, à leur conception de la vie, inséparable d’une sacralité que la 1re communion de l’enfant, Maya pour les intimes, devait ritualiser en mai 1946. Par la grâce d’un prénom revit l’une des deux sœurs de Pablo, foudroyée par la diphtérie à 7 ans, alors qu’il en avait 14 et que ses prières n’avaient pu écarter la mort. Nommer, c’est créer, dit la Bible. La nouvelle Marie n’entre pas seule dans une existence promise à ne ressembler à nulle autre, avec son lot de bonheurs, de difficultés et de déchirures à venir. Des ombres, en septembre 1935, il n’en manque pas. La mère de Maya, la blonde Marie-Thérèse Walter, 26 ans, est née de père inconnu, et Pablo, toujours marié à Olga, ne peut, ni l’épouser, ni reconnaître pleinement le fruit de leurs amours clandestines. L’arrivée de Dora Maar, proche des surréalistes et des cocos (la faucille !), complique bientôt les choses, puis Françoise Gilot surgit. On le pressent, la toile de fond sur laquelle se déploie la très importante exposition du musée Picasso était de nature à bousculer quelques lignes, elle le fait et le fait bien, en sortant justement Maya et Marie-Thérèse du flou, dramatisé ou platement sentimental, des raccourcis biographiques ou diaboliques. Elle nous vaut, d’abord, une série inouïe de portraits de Maya, du joli nourrisson croqué dans les tendresses de l’estompe aux tableaux de 1938-1940, le regard ému du père change alors de ton : graphisme dur et couleurs acides, refus de toute infantilisation de son sujet et écho aux guerres présentes et futures. Si le dessin d’enfant, gage d’une sorte de « pensée sauvage » fascine les artistes depuis la fin du XVIIIe siècle, si Picasso collectionne ceux de sa fille et en occupe les marges, dessiner ou peindre l’enfance le pousse en terre freudienne, lui qui trouvait la psychanalyse volontiers trop explicative. Reste l’ambivalence de nos chères têtes blondes, il s’en saisit, y descend, pour le dire comme Proust. Il lui arrive même, mettant en lumière et à distance les affres domestiques où le jette sa polygamie tantôt heureuse, tantôt cruelle, d’user du mythe, grec ou plus archaïque encore, à l’instar de Sigmund… L’aveu que concèdent les sublimes feuilles de l’été 1936 s’affuble de néo-classicisme et du masque antique. Non moins que les présences souvent chiffrées de Marie-Thérèse, parfois accrues d’une épée chevaleresque et inquiétante, le visage de Maya traverse l’art picassien jusqu’aux années 1950. A Royan, dès octobre-novembre 1939, les déformations loufoques ou lugubres semblent soudainement moins ludiques que prophylactiques. Puis, la guerre finie, qui l’a beaucoup rapproché de son père, l’adolescente s’épanouit, s’assombrit, devient une femme à son tour, survit aux outrances médiatiques de l’époque, assiste son père auprès de Clouzot, soutient sa mère et décide d’avoir une vie à elle. Sous le regard, peut-être, de l’autre Marie. SG // Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo, Musée Picasso de Paris, jusqu’au 16 avril 2022, catalogue illustré de toutes le pièces exposées (grande vertu), sous la direction des commissaires, Diana Widmaier-Ruiz-Picasso et Emilia Philippot, Skira / Musée Picasso, 45€, avec la collaboration de Rafael Inglada, Olivia Speer, Olivier Widmaier-Picasso et Johan Popelard. On notera, comme ce dernier, la teneur chrétienne des poèmes de Picasso en 1935-1936, le religieux alternant avec le cru, la peur, l’humour et les multiples projections du moi sur le mystère de Maya, poèmes qui ne sauraient être lus comme le direct reflet du biographique, mais sa mise en forme complète.

Grâce aux enfants et petits-enfants de Picasso, à la faveur de dons ou de règlements de succession, les œuvres auprès desquelles il vécut ont rejoint, pour une large part, les collections nationales, à commencer par le musée parisien qu’abrite l’hôtel Salé. Il n’a jamais autant mérité sa réputation d’être le réceptacle essentiel de l’œuvre et de son archive, deux façons complémentaires de documenter le mystère de sa création. Picasso aimait à y reconnaître le fruit de la fantaisie et le ressac de l’instant. Or, le dialogue en fut l’autre moteur, dialogue avec les maîtres ou ses contemporains, dialogue avec les arts autres, dialogue avec soi. La dation Maya Ruiz-Picasso enrichit notre compréhension de cette triple exigence et réduit, d’abord, une lacune. Les tout débuts de l’artiste, que montre si bien le musée de Barcelone, se comprennent moins bien à Paris. D’où l’importance du portrait de José Ruiz Blasco, le père et le maître de l’adolescent (14 ans) quand il signa et data la chose. Celui qui devait déclarer sa flamme envers Courbet et Les Nain s’annonce ; le choix du profil et l’expression ferme disent eux la force d’un attachement que la freudienne histoire de l’art continue à ignorer. Si le Tiki, lui aussi entré dans les collections, renvoie au Gauguin des Marquises par son millésime et l’indécision de sa nature (objet de culte, avatar touristique), il était gage aussi d’une force d’affirmation que Picasso associa à la personnalité et au soutien d’Apollinaire dans une photographie célèbre. C’est aussi un peu un ready-made : en pénétrant l’atelier, il légitime sa valeur d’art, et non plus seulement sa portée sacrée. La Vénus du gaz, simple brûleur de cuisinière redressé, et soudainement humanisé et divinisé à la fois, se rapprocherait davantage des métamorphoses infra-minces de Duchamp si elle ne se souvenait pas des petites baigneuses de 1931-32. Malgré sa date, janvier 1945, j’aurais tendance à la détacher du contexte de la Libération, de la révélation des camps, ce serait une réponse indécente à l’abject. Sa charge d’Eros et d’humour, proche de Joan Miró, autorise plutôt à s’interroger sur la production de l’Occupation, que les experts noircissent à plaisir, et à tort. Que la sensualité grinçante ait été aussi la réponse picassienne à l’angoisse ou au remords, deux autres œuvres de la dation le rappellent à point nommé, L’Enfant à la sucette (juillet 1938) et le charivarique portrait de la mère de Marie-Thérèse Walter (octobre 1939), « gueule cassée » pleine de douceur et d’outrance à la fois. A cet égard, Jeune garçon à la langouste (juin 1941), – dont on a pu comparer le sexe à un canon, mais qu’il faudrait aussi rapprocher de certaines représentations de Jésus enfant -, est cousin d’El Bobo (1959), et d’une truculence baroque où le vin, les œufs et le pénis font signe aux Barrachos de Velázquez, chers à Manet. Deux autres acquisitions insignes oscillent aussi entre le profane et le religieux, le pur et l’impur, le carnet de variations sur Le Déjeuner sur l’herbe et La Tête d’homme de 1971, d’un chromatisme strident et d’un catholicisme réparateur. Le Palais des Papes en recevrait le message après sa mort. SG // Nouveaux chefs-d’œuvre. La dation Maya-Ruiz-Picasso, jusqu’au 31 décembre 2022. Catalogue sous la direction d’Emilia Philippot avec la collaboration de Virginie Perdrisot-Cassan, Johan Popelard, Juliette Pozzo et Joanne Snrech, Skira/Musée Picasso, 25€.

Pour Giorgio Vasari, qui ne se payait pas de mots, Raphaël était unique, « ottimo universale », d’un génie étendu à tout et tous, maître et rénovateur de chaque art, capable d’électriser l’âme du savant et de l’ignorant, riche de ce qu’il prit et donna aux autres, sans relâche. En 2004, on ne l’a pas oublié, la National Gallery de Londres réunissait une centaine d’œuvres, insignes ou injustement méconnues, qui offraient du prodige un portrait situé, au contact donc d’œuvres de son père (très marqué par la peinture des Flandres), de Perugino, Vinci et Michel-Ange, ses trois mentors essentiels. Dix-huit ans plus tard, sur les mêmes cimaises et à partir d’un nombre équivalent de tableaux, dessins, gravures, projets d’architecture, tapisseries et estampages de stuc, Raphaël se présente seul au public, mais multiple, polyvalent et actif sur les fronts les plus divers et, conformément au génie du christianisme, secondant les appels de l’Eros et le travail du Salut avec la fermeté qui guida sa carrière stupéfiante. Lui reprocher le magnétisme de ses Madone, la grâce juvénile de ses saints ou de ses apôtres aux cheveux longs, c’est se fermer l’accès à la métaphysique incarnée, commune à l’art et au sacré, où s’inscrit le sens du beau que Raphaël partage, d’ailleurs, avec une grande partie de son époque. Une sorte de frémissement d’éternelle jeunesse, de vie concrète, parcourt la sélection londonienne. Du reste, au-delà de leur volonté à suivre l’ensemble des voies qu’emprunta Raphaël, les commissaires britanniques, David Ekserdjian et Tom Henry, ont rendu particulièrement tangible le souci du réel, du particulier, dont la bottega est le théâtre collectif, derrière les privilèges ultimes de l’idea, mot que Raphaël utilise dans une lettre célèbre. A plusieurs reprises, chose savoureuse, l’atelier s’ouvre à notre indiscrète présence. Comme Rubens et David bientôt, Raphaël faisait poser ses élèves et collaborateurs, en tenue moderne et en fonction des exigences de tel retable d’église (Le Couronnement de saint Nicolas de Tolentino) ou de telle estampe furieuse (Le Massacre des innocents que Delacroix et Picasso n’oublieraient pas). L’alliance de la prose et de la fiction sacrée, cinq siècles après les faits, continue à nous soulever. Chaque emprunt, Mona Lisa de Léonard ou ignudi de Michel-Ange, Raphaël le testait, le vérifiait sur le motif. Eût-il été le portraitiste que l’on sait, entre Rogier van der Weyden (« La Muta ») et Vinci, si son adhérence au réel l’avait l’abandonné ou trompé. Son chef-d’œuvre du genre, à égalité du Jules II à longue barbe de Londres, se trouve au Louvre, et il a fait le voyage. On y voit Raphaël poser la main gauche sur l’épaule du cher Giulio (Romano) et leurs mains droites presque se confondre en signe de continuité par-delà la mort qui va frapper le maître et propulser le disciple, de fort tempérament, au-devant de la scène. L’oeuvre a inspiré au jeune Manet une autre effigie double, mais on pense aussi à Picasso ici et là, à Maya et Marie-Thérèse face à la fusionnelle Madonna Tempi, à Guernica devant L’Incendie du Borgo et le carton de la Conversion de saint Paul, frise explosive où l’œil est précipité de droite à gauche, tragique fiat lux. SG // Raphaël, Londres, The National Gallery, jusqu’au 31 juillet 2022, catalogue sous la direction de David Ekserdjian et Tom Henry, Yale University Press / National Gallery Global LImited, 60€. Signalons, avant d’y revenir, l’exposition Picasso Ingres : Face To Face, visible dans les mêmes lieux jusqu’au 9 octobre, occasion d’une rencontre, au sommet, entre le Portrait de Madame Moitessier et Jeune femme au livre, réponse de Picasso à Ingres, où l’on reconnaît Marie-Thérèse Walter. Datant de 1932, il précédait de quatre ans l’entrée fracassante de sa principale source dans les collections londoniennes. Le directeur de la National Gallery, Kenneth Clark (32 ans), n’écoutant que son cœur, avait déboursé une somme folle pour un tableau fou, foi de Picasso !