
Accueillie au sein de la vaste édition des œuvres complètes de Théophile Gautier (1811-1871) que mène Honoré Champion, sa critique d’art ne pouvait trouver meilleure consécration, ses vertus intactes de témoignage et d’analyse meilleur abri (1). C’est déjà donner deux raisons de la lire ou de la relire, comme s’y emploient Marie-Hélène Girard et Wolfgang Drost, éditeurs respectifs des Salons de 1857 et 1859 (2). La corrélation est désormais bien connue entre « l’exposition des artistes vivants », née sous Louis XIV, régulière à partir de Louis XV, et la naissance de la presse d’art. En se donnant une vitrine, la création contemporaine se donna des voix. Certains écrivains, le Baudelaire de 1845, sont entrés en littérature par cette porte qui était tout sauf étroite (3). Vite aguerri au genre, qui exigeait une langue imageante et une prompte évaluation, le poète des Fleurs du mal a ramassé le Salon de 1859 en une formule célèbre : « Nulle explosion ; pas de génies inconnus. » Sa recension cinglante décrit ensuite un mouroir, entre faste officiel et entassement indigeste, où s’étalaient le « discrédit de l’imagination » et « le mépris du grand ». Peu d’élus, par conséquent, hors Delacroix, Corot et Paul Huet, les aigles de 1830… Quant à l’art de 1859, quant à ce réalisme où il n’est pas loin certains jours de diagnostiquer une myopie étrangère à la poésie visuelle, Baudelaire réagit en romantique libéral et presque en ancien de 1848, disposé donc à tolérer certaines expressions de la nouvelle objectivité, si préférable aux résiliences néo-classiques et surtout à la banalisation accrue du tout-venant des Salons. Legros, un proche de Whistler, et Amand Gautier, un disciple de Courbet, bénéficient immédiatement de l’extension des préférences baudelairiennes, non moins que le lumineux Fromentin et sa moisson algérienne.
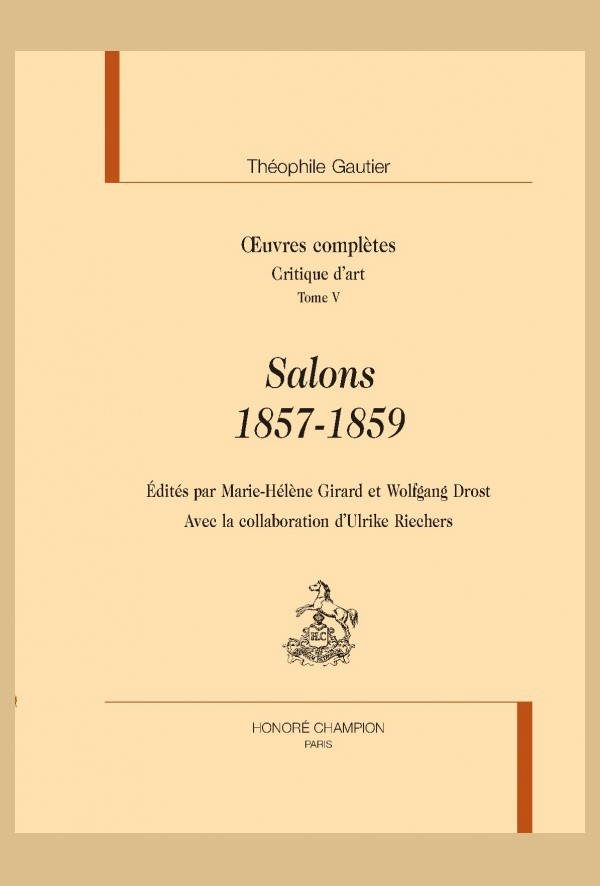
Impossible, à l’inverse, de ne pas écraser la peinture bâtarde d’un Gérôme sous son mépris des faiseurs : « L’esprit français épigrammatique, combiné avec un élément de pédanterie, destiné à relever d’un peu de sérieux sa légèreté naturelle, devait engendrer une école que Théophile Gautier, dans sa bénignité, appelle poliment néo-grecque. » On ne mesure peut-être plus le tort qu’aura fait cette pointe décochée à un confrère, plus illustre alors que lui, tort qui n’a cessé de grandir au XXe siècle. Gautier est-il même blanchi aujourd’hui de cette trop grande bienveillance envers les célébrités du Second empire, plus ou moins indigentes, et réhabilitées au titre de la curiosité historique ? Le plus drôle est que Baudelaire, sujet aussi à la camaraderie, était le premier à priser, chez Gérôme même, une indéniable « recherche du nouveau et […] des grands sujets », mais le peintre du Roi Candaule, courte gaudriole inspirée de Gautier, restait prisonnier de son pinceau maigre et de ses formules incertaines, plus scolaires que neuves, pointues… Théophile, certes, fut moins dur, en 1859, à l’égard de Gérôme, son dessin net, sa noblesse tempérée, un Gérôme qu’il dit « en progrès ; seulement, à force de finesse, sa peinture s’atténue, s’évapore et disparaît. » Sa bénignité, on le voit, savait se contenir. En vérité, Baudelaire posait mal le problème en ignorant ses conditions. Plume du Moniteur universel, le journal de l’Empire, Gautier est interdit d’éreintage, lui qui l’avait pratiqué avec fureur dans les années 1830, bien qu’il lui préférât toujours l’exercice d’admiration. On parle des meilleurs, on oublie les médiocres. Or, en cette fin des années 1850, exception faite des gloires vieillissantes (Delacroix, Ingres) et du problématique Courbet, le niveau baisse, le niveau d’inspiration et d’invention, pas le niveau technique ; au contraire, celui-ci triomphe et, substitutif, lasse, agace.

Se montant un peu la tête en 1859, Gautier appuie ceux qui conservent une faible étincelle de « beauté », Hébert et son spleen italien, Baudry et ses femmes presque incarnées, Puvis de Chavannes qu’il compare à Mantegna, Jules Breton et ses paysannes proprettes, voire les Glaneuses moins lisses et plus cadencées de Millet, qui « sont d’un maître ». Ce ne sont que caresses et demi-bonheurs arrachés au vide dont il faut bien faire le constat. Et, quoi qu’on en dise, Gautier, dès 1857, enregistre la panne. Cette année-là, il signe dans L’Artiste qu’il dirige les vingt articles consacrés au Salon. Si l’exposition, logée au cœur du palais de l’Industrie, – un vestige de 1855 -, a gagné au change, Gautier suggère avec tact la nécessité de modifier la composition du jury, entièrement abandonnée aux membres de l’Institut. Il ne s’agit pas d’une réaction de vieux chevelu, anti-académique par essence, mais d’une mesure de bon sens, que le régime devait suivre après 1863. En somme, la diversité accrue du champ esthétique appelle un élargissement proportionnel des sensibilités que le jury doit refléter. Timide, du reste, est la fronde de Gautier en 1857, car il ne perd pas de vue la masse inouïe des œuvres rituellement soumises à l’examen de l’administration : « Malgré des éliminations sévères, le nombre des statues et des tableaux est encore très considérable. » Pourtant nul chef-d’œuvre, nulle audace ne se dégage de cette enfilade de salles à grands murs et lumière zénithale ! Tant d’améliorations, à condition d’être bien accroché, pour un résultat si faible… Ni couleur, ni touche, le gris partout, notamment du côté des élèves de Delaroche, Gérôme compris. Gautier leur préfère ouvertement les disciples de Thomas Couture : ce point, trop négligé, est capital, d’autant plus que le critique réitère en 1857 son intérêt envers le maître décisif de Manet : outre leur franchise, « un certain faire empâté trahit ceux qui ont traversé l’atelier de Couture ». Et Gautier de retenir quatre des vingt-trois disciples d’un artiste qui boude le Salon. On ne souligne pas assez non plus, à la différence de Marie-Hélène Girard, l’attention que le poète d’Emaux et camées porte aux « peintres de la vie moderne », à ces Gavarni du pinceau qui sont encore l’exception et qui, tel Alfred Stevens, n’ont pas l’audace de ceux qui viendront : « L’époque moderne semble effrayer les peintres ; ils reculent devant notre costume, dont il serait possible de tirer parti après tout, et travestissent leurs sujets dans un carnaval perpétuel. » Relire le Gautier de 1857-59, c’est ainsi sentir monter des cornues effervescentes du Salon « les révolutions [qui] se préparent » (Drost).

Le privilège de connaître les ruptures proches, de savoir que Manet et Degas sont prêts alors à s’élancer, fausse évidemment notre rapport à l’histoire : elle n’était pas encore écrite vers 1860… L’autre erreur de perspective touche au rôle exact du Salon, qui n’est pas le réceptacle neutre des oppositions esthétiques et des blocages institutionnels du moment, il en est le brasseur et l’incubateur, de même que les grandes voix de la presse enregistrent moins le présent qu’elles ne précipitent le futur. Jugées ainsi, elles n’ont plus à être soumises aux hiérarchies de l’avant-gardisme rétrospectif du XXe siècle, idolâtrant Baudelaire aux dépens de tout le reste. Pour ressaisir le jeune Manet, qui renonce à exposer en 1859 après s’y être attelé, mieux vaut tenir compte de ce que Gautier écrit en 1857 de « l’école Couture » et d’Alfred Stevens, peintre des petits drames de la vie moderne (4) ; mieux vaut s’intéresser aussi au néo-rocaille de Charles Chaplin, qu’il mêlait aussi bien à sa relecture de la fable qu’à l’Éros de plus en plus libre des Parisiennes. Stevens et Chaplin ne sont pas absents du passionnant dossier que la National Gallery de Londres vient de consacrer au Portrait d’E[va] G[onzalès] (5). Ce fut l’un des deux tableaux, aujourd’hui sous-évalués, que Manet exposa au Salon de 1870. Fille d’un polygraphe huppé et d’une musicienne, riche aussi d’une éducation soignée, Eva Gonzalès (1847-1883) impressionna assez tôt un Théodore de Banville, qui devait encourager la famille à lui faire pratiquer la peinture sérieusement. Chaplin sera son premier maître avant que Stevens ne convainque Manet de la prendre sous son aile. En 1870, débutant au Salon, elle se présente comme l’élève du premier et le modèle du dernier. Stratégie qui, sans trop froisser la vérité, ne manquait pas d’habileté. Cela n’empêcha guère les critiques d’étriller le tableau (une horrible caricature de l’art de peindre et de la séduction naturelle d’Eva !), à l’exception de Duranty, avec lequel Manet s’était battu en duel peu avant, et de Duret, le plus éloquent de ses partisans, parlant du rare « inventeur », de l’unique peintre « vivant » qu’offrait l’exposition. Si le point de vue de Londres se voulait féministe, il se distinguait des contre-sens de Tamar Garb, qui reprochait au portrait de Manet, en 2007, d’avoir réduit son modèle au statut infamant d’aimable amateur, et choisi d’en faire quelque praticienne mondaine de la peinture de fleur (6). Sarah Herring et Emma Capron lui opposent la positivité des références aux précédents de Vigée Le Brun (notamment l’autoportrait des Offices de Florence). Nous savons aussi que le tableau qu’Eva est en train de peindre, dans la fiction de son portrait, dérive de Jean-Baptiste Monnoyer, autre écho flatteur. Mais Manet, erreur courante des commentateurs, ne la montre pas copiant l’image dont lui-même s’est inspiré, Eva scrute hors champ un vrai bouquet dont le portraitiste pose à terre un indice qui lui est cher, une branche de pivoine, elle frôle amoureusement la robe opulente et jouxte une étude roulée sur laquelle se lit la signature de l’auteur. Mis bout à bout, ces décisions plastiques rappellent que sa peinture, pour être poétiquement réfléchie, restait écriture du réel.

Il y a un peu de whistlerisme dans le portrait d’Eva Gonzalès, de la robe somptueuse jusqu’au tapis étrange, et, par conséquent, un peu de japonisme. En 1857, devant La Curée du chevreuil (Boston), Gautier créditait le chef-d’œuvre de Courbet d’une « perspective à la chinoise », mais aussi d’une vie triviale et puissante… C’est la meilleure réponse que l’on puisse adresser à ceux qui logent plus tard dans le siècle le dialogue des Français avec le Japon, ou qui confondent cet échange de première importance avec un banal phénomène migratoire, pour ne pas dire une passive transmission formelle. Résistons donc, avec Sophie Basch, à la vulgate, très répandue aux États-Unis, du jeu d’influences « salutaire » (7). Son livre, sans craindre la polémique, récuse la vision mécaniste du transfert et s’intéresse, au contraire, à la « nécessité [intérieure et] antérieure » qui contribua à transformer les arts de France. Ce nouveau bilan, à partir d’une information très enrichie, qui puise autant au monde des images qu’à la littérature, se garde et de la philologie binaire, et des conclusions maximalistes, du type de celles de William Rubin, décrétant que le japonisme, avant le primitivisme picassien, avait fait passer les arts visuels occidentaux du perceptif au conceptuel. La chronologie s’est également étoffée et rééquilibrée. Bien avant que Huysmans ne chante les affiches de Chéret pour leur orientalisme bien digéré, ou que Montesquiou ne se désole des excès d’une mode propice à la pacotille exotique et ne parle du « 93 des bambous » consécutif à l’Exposition universelle de 1878, la passion se sera répandue des « Japonneries ». Le mot appartient à Baudelaire, qui agit en prosélyte, au début des années 1860, avec Zacharie Astruc, Arsène Houssaye et beaucoup d’autres, probablement Manet. Si l’on en croit Bracquemond, Champfleury et Philippe Burty, que Sophie Basch réinterroge sur nouveaux frais, la rencontre du Japon est déjà très avancée au milieu des années 1850, on y revient… Autant que la datation du phénomène, l’argumentation d’époque doit nous arrêter. Car ses premiers thuriféraires, au lieu de se prosterner devant les semences de l’Orient, comparent les nouvelles images à Watteau, Goya, Daumier, Gavarni, Constantin Guys et même, sous la plume de Duret, aux frères Le Nain. Degas, on le sait, se range derrière ces derniers lorsqu’il tente d’encourager James Tissot, un fanatique du Japon comme lui, à rejoindre le « salon réaliste » qui se prépare. L’histoire l’a platement retenu comme la première exposition « impressionniste ». Le Salon avait cessé de sourire à Degas, qui conservait un souvenir très cuisant de celui de 1867. Un texte oublié d’Ernest Chesneau, déniché par Sophie Basch, établit définitivement qu’il y montra La Famille Bellelli, perdue dans les hauteurs, et Les Deux sœurs (Los Angeles, notre ill.), œuvre où la griffe du Japon était sensible selon ce critique proche des frères Goncourt et de Manet. Le Japonisme d’Édouard va lui de la citation directe (Portrait de Zola) à l’immixtion latente, et à l’humour des chats noirs, familiers des toits parisiens. Restons avec eux un moment.

Les souvenirs, quand ils résistent à l’aveu, se prêtent aux détours de la métaphore et donnent à leur exploration un goût d’aventure… Cette vérité, bien connue des psychanalystes, se vérifie avec le dernier livre de Frédéric Vitoux, bref et félin comme on les aime, et étanche, bien sûr, au jargon du corps médical (8). On sait l’auteur aussi féru de Stendhal, Manet et Céline que passionné des chats, zélateur de leur cause, admirateur de leur façon double d’être au monde, là et ailleurs en permanence, fou de leur beauté et du mystère qu’ils emportent en mourant… Or Vitoux traite la mémoire affective et fouille son passé familial de la même manière qu’il caresse ses amis de toujours, lentement, religieusement et, si nécessaire, à rebrousse-poil, par goût des étincelles. Car L’Assiette du chat ne ronronne pas, ni ne paresse, c’est une subtile et vive descente en soi, à la rencontre de l’inconnu ou de l’inconnue : les femmes, deux générations de femmes, dominent, en effet, le récit et l’entrainent par ricochet. En dire plus serait diminuer le plaisir que procure un livre qui hésite, on comprendra pourquoi, puis se décide à dérouler les lacis d’une enquête périlleuse. Plus, poignante. Qui était cette Clarisse, de père juif et polonais, amie de la grand-mère de l’auteur, et que cachait la dévotion de la première pour la seconde ? Et que penser de cette petite fille, Odette, « sœur de lait » du père de l’écrivain, et dont la mère avait été la domestique des grands-parents de Vitoux ? On sent ce dernier très ému à réveiller ces fantômes, ces êtres qu’il croisa enfant, aima hors de tout questionnement, ces présences intimes que la vie écarta bientôt de l’île Saint-Louis où l’action se concentre. La géographie des livres de Vitoux est toujours soigneusement cadrée, reste ou pas d’une cinéphilie précoce qui a peut-être laissé d’autres traces, au-delà de l’humour doux-amer à la Frank Capra. Je veux parler de l’art de varier le temps et le tempo du fil narratif, ou de donner à l’objet inanimé le statut d’un talisman frappé d’oubli, et soudain ramené à la lumière. Hitchcock et Chabrol furent aussi des as de ces emboîtages inattendus. Un dernier mot, qu’on empruntera à Vitoux, puisqu’il dévoile une des couleurs, mais une des couleurs seulement, de sa palette : « Le passé est un trou noir à la formidable puissance d’attraction. » Stéphane Guégan
(1) Deux volumes ont déjà vu le jour, l’un couvre les années 1833-1842, l’autre embrasse le vaste bilan de 1855.
(2)Voir Stéphane Guégan, Baudelaire. L’Art contre L’Ennui, Flammarion, 2021.
(3)Théophile Gautier, Œuvres complètes, section VII / Critique d’art, Salons de 1857-1859, édition de Marie-Hélène Girard et Wolfgang Drost. Avec la collaboration d’Ulrike Riechers, 130€.
(4)Partagé au sujet d’Arthur Stevens, trop minutieux, trop anecdotique, Baudelaire n’en était pas moins sensible à deux traits du peintre belge, le « prodigieux parfum de femme » et « l’harmonie distinguée et bizarre des tons ». Si son Salon de 1859 est muet à son égard, c’est que le Bruxellois n’expose pas à Paris cette année-là, il est plus curieux que le poète n’ait rien dit alors des tableaux de Joseph Stevens, le frère d’Arthur, remarqué par Gautier et Nadar. Mais on sait la place que lui feront Pauvre Belgique ! et Le Spleen de Paris.
(5)Voir Sarah Herring et Emma Capron (dir.), Discover Manet & Eva Gonzales, Yale University Press, 2022, 20£, avec les contributions d’Hannah Baker, Catherine Higgitt and Hayley Tomlinson. La publication livre une moisson de renseignements techniques sur le tableau et établit qu’il était de bords arrondis, très XVIIIe siècle, originellement.
(6)Tamar Garb, The Painted Face. Portraits of Women in France, 1814-1914, Yale University Press, 2007. Le catalogue de Londres (voir note précédente) y renvoie quant à la réception critique du Portrait d’Eva Gonzalès. Il est préférable de revenir au Manet de Tabarant (1947) et consulter les travaux d’Eric Darragon. Concernant un autre peintre désormais victime des gender studies et de leur éventuel sexisme, j’ai discuté les thèses de Tamar Garb dans l’un des chapitres de mon Caillebotte. Peintre des extrêmes (Hazan, 2021).
(7)Sophie Basch, Le Japonisme, un art français, Les Presses du Réel, 32€.
(8)Frédéric Vitoux, de l’Académie française, L’Assiette du chat, Grasset, 2023, 18€.

A voir, à lire :
*Une exposition : Manet / Degas, musée d’Orsay, du 28 mars au 23 juillet 2023
*Du théâtre : Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat, Manet, Degas. Une femme peut en cacher une autre, Editions SAMSA, 8€.
















