 Avant de les pousser au défi esthétique, la guerre accule les écrivains à leur part d’inconnu. Se montreront-ils à la hauteur ? Face au danger, face à la mort, ces êtres de cabinet et de salon, maîtres des mots, seront-ils maîtres d’eux ? Seront-ils, dirait Drieu, des hommes ? En 1914, la fierté de servir son pays et de braver l’agresseur embellit, au mieux, la résignation générale à l’inévitable. On part rarement se battre la fleur aux lèvres. En 14, les écrivains se montèrent la tête, comme les autres, quelle qu’ait été la flamme de leur patriotisme. Du conflit qui s’engageait et s’embourberait vite dans ses millions de cadavres, les plus jeunes attendaient la fin du vieux monde. Des vieillards les envoyaient au feu, le feu les débarrasserait de la gérontocratie qui dominait le pouvoir et le haut commandement. Le champ de bataille souriait au sang vif, aux horizons neufs, ce serait un laboratoire plus qu’un mouroir. Quand bien même ces combattants, à peine sortis de l’adolescence, allaient rapidement douter du destin collectif qui les appelait, la littérature ne perdrait rien en chemin. Délire d’enthousiasme et déluge de violence, effroi et fascination devant l’indescriptible, elle ferait son miel de tout. Les mots, rempart à l’horreur ou à l’absurde, ont épousé l’épreuve dans sa fièvre et sa folie destructrices, ils ont aussi fait résonner le dépassement de soi, la fraternité des armes et le merveilleux insolite d’un chaos que certains crurent régénérateur au-delà de la paix.
Avant de les pousser au défi esthétique, la guerre accule les écrivains à leur part d’inconnu. Se montreront-ils à la hauteur ? Face au danger, face à la mort, ces êtres de cabinet et de salon, maîtres des mots, seront-ils maîtres d’eux ? Seront-ils, dirait Drieu, des hommes ? En 1914, la fierté de servir son pays et de braver l’agresseur embellit, au mieux, la résignation générale à l’inévitable. On part rarement se battre la fleur aux lèvres. En 14, les écrivains se montèrent la tête, comme les autres, quelle qu’ait été la flamme de leur patriotisme. Du conflit qui s’engageait et s’embourberait vite dans ses millions de cadavres, les plus jeunes attendaient la fin du vieux monde. Des vieillards les envoyaient au feu, le feu les débarrasserait de la gérontocratie qui dominait le pouvoir et le haut commandement. Le champ de bataille souriait au sang vif, aux horizons neufs, ce serait un laboratoire plus qu’un mouroir. Quand bien même ces combattants, à peine sortis de l’adolescence, allaient rapidement douter du destin collectif qui les appelait, la littérature ne perdrait rien en chemin. Délire d’enthousiasme et déluge de violence, effroi et fascination devant l’indescriptible, elle ferait son miel de tout. Les mots, rempart à l’horreur ou à l’absurde, ont épousé l’épreuve dans sa fièvre et sa folie destructrices, ils ont aussi fait résonner le dépassement de soi, la fraternité des armes et le merveilleux insolite d’un chaos que certains crurent régénérateur au-delà de la paix.
 En ce centenaire de la bataille de la Somme, où tombèrent tant de britanniques (voir la série Peaky blinders quant au durable trauma outre-Manche), l’Historial de la Grande Guerre rend hommage à une quinzaine de poètes et romanciers, français, allemands et anglais. Neuf d’entre eux, en effet, vécurent l’offensive de juillet-novembre 1916, celle des Orages d’acier de Jünger, heureux de chanter l’avènement d’une virilité aussi trempée que les canons qui déchirèrent le ciel d’été. Faisant vite oublier ses modestes espaces par son lacis de boyaux sombres, l’exposition de Péronne est surtout riche d’un matériel rarement vu et confronté, du casque transpercé de Jünger à la pipe d’opium de Joë Bousquet, du portrait de Péguy par Egon Schiele aux dessins expressionnistes du grand poète Wilhelm Klemm (publiés aussi dans Die Aktion), du carnet militaire d’Apollinaire aux loufoqueries « explosives » de Jacques Vaché (photo, plus haut), du Feu d’Henri Barbusse (qui impressionna Otto Dix, Céline et Hemingway) au génial J’ai tué de Blaise Cendrars. Le « British side » du parcours est très brillant, des stances noires d’Ivor Gurney (qui pensait soigner sa neurasthénie en prenant les armes) au fameux Counter Attack de Siegfried Sassoon, qui rendit public son dégoût de l’inefficacité inhumaine de l’état-major en juillet 1917. A tout cela, qui est beaucoup et justifie une visite, s’ajoute le Cahier bleu de Georges Bataille, cahier d’un jeune guerrier de 18 ans, qui pleure la cathédrale de Reims, celle de son enfance, celle d’une France souillée, et dédie son poème rageur à Léon Bloy.
En ce centenaire de la bataille de la Somme, où tombèrent tant de britanniques (voir la série Peaky blinders quant au durable trauma outre-Manche), l’Historial de la Grande Guerre rend hommage à une quinzaine de poètes et romanciers, français, allemands et anglais. Neuf d’entre eux, en effet, vécurent l’offensive de juillet-novembre 1916, celle des Orages d’acier de Jünger, heureux de chanter l’avènement d’une virilité aussi trempée que les canons qui déchirèrent le ciel d’été. Faisant vite oublier ses modestes espaces par son lacis de boyaux sombres, l’exposition de Péronne est surtout riche d’un matériel rarement vu et confronté, du casque transpercé de Jünger à la pipe d’opium de Joë Bousquet, du portrait de Péguy par Egon Schiele aux dessins expressionnistes du grand poète Wilhelm Klemm (publiés aussi dans Die Aktion), du carnet militaire d’Apollinaire aux loufoqueries « explosives » de Jacques Vaché (photo, plus haut), du Feu d’Henri Barbusse (qui impressionna Otto Dix, Céline et Hemingway) au génial J’ai tué de Blaise Cendrars. Le « British side » du parcours est très brillant, des stances noires d’Ivor Gurney (qui pensait soigner sa neurasthénie en prenant les armes) au fameux Counter Attack de Siegfried Sassoon, qui rendit public son dégoût de l’inefficacité inhumaine de l’état-major en juillet 1917. A tout cela, qui est beaucoup et justifie une visite, s’ajoute le Cahier bleu de Georges Bataille, cahier d’un jeune guerrier de 18 ans, qui pleure la cathédrale de Reims, celle de son enfance, celle d’une France souillée, et dédie son poème rageur à Léon Bloy.
 Ce lyrisme doloriste, dont la cathédrale « vitriolée » (Cocteau) serait encore longtemps le motif exemplaire, le Drieu La Rochelle d’Interrogation (Gallimard, août 1917) n’en a cure. La Part du feu, l’un des poèmes du recueil les plus tributaires du futurisme italien, dénonce ceux qui pleurent la destruction des vieux temples : «Laissons ces eaux aux vieillards, qui ne sentent pas dans leurs têtes débiles la force de concevoir des chefs-d’œuvre. » Drieu est absent des cimaises de Péronne. Début 1916, le rescapé de Charleroi et des Dardanelles se blesse grièvement à Verdun, un éclat d’obus dans le bras. Sa main gauche se raidit, à jamais. La bataille de la Somme ne fut donc pas pour lui. En août, il publie Usine = Usine dans Sic : la revue de Pierre Albert-Birot tient Marinetti pour l’un de ses mentors. De nos jours, la phalange futuriste de l’intelligentsia parisienne, Apollinaire compris, n’a plus très bonne presse. Bellicisme nietzschéen, jeunisme radical, horreur de la muséification du passé, ça ne cadre pas avec notre époque. On ne s’explique pas autrement le fait que la majorité des manifestations liées au centenaire de la guerre de 14-18 aient mis nos sulfureux futuristes hors champ. Drieu traine lui une telle réputation qu’il est devenu inutile d’invoquer son tropisme italien pour l’exclure des fêtes du souvenir. Il reste l’homme couvert de haines, bien que cette haine, toujours ambiguë, voire secrètement amoureuse, fasse la joie des éditeurs, comme on verra plus loin.
Ce lyrisme doloriste, dont la cathédrale « vitriolée » (Cocteau) serait encore longtemps le motif exemplaire, le Drieu La Rochelle d’Interrogation (Gallimard, août 1917) n’en a cure. La Part du feu, l’un des poèmes du recueil les plus tributaires du futurisme italien, dénonce ceux qui pleurent la destruction des vieux temples : «Laissons ces eaux aux vieillards, qui ne sentent pas dans leurs têtes débiles la force de concevoir des chefs-d’œuvre. » Drieu est absent des cimaises de Péronne. Début 1916, le rescapé de Charleroi et des Dardanelles se blesse grièvement à Verdun, un éclat d’obus dans le bras. Sa main gauche se raidit, à jamais. La bataille de la Somme ne fut donc pas pour lui. En août, il publie Usine = Usine dans Sic : la revue de Pierre Albert-Birot tient Marinetti pour l’un de ses mentors. De nos jours, la phalange futuriste de l’intelligentsia parisienne, Apollinaire compris, n’a plus très bonne presse. Bellicisme nietzschéen, jeunisme radical, horreur de la muséification du passé, ça ne cadre pas avec notre époque. On ne s’explique pas autrement le fait que la majorité des manifestations liées au centenaire de la guerre de 14-18 aient mis nos sulfureux futuristes hors champ. Drieu traine lui une telle réputation qu’il est devenu inutile d’invoquer son tropisme italien pour l’exclure des fêtes du souvenir. Il reste l’homme couvert de haines, bien que cette haine, toujours ambiguë, voire secrètement amoureuse, fasse la joie des éditeurs, comme on verra plus loin.
Julien Hervier n’est pas soupçonnable de pareils calculs. Le meilleur connaisseur de Drieu n’exploite pas un filon. Il sert une cause où se reconnaissent quelques-uns aujourd’hui. En février dernier, Bartillat publiait son édition des Ecrits de jeunesse, le volume que Drieu prépara durant la « drôle de guerre », dès 1939 probablement, et ne fit imprimer qu’en 1941. Date tardive, elle s’explique par la raclée de juin 1940, mais elle fit croire à quelque manœuvre collaborationniste ! Or, entre 1917 et 1927, où s’encadre la « jeunesse » de l’auteur, celui-ci tenta plutôt de concilier capitalisme, socialisme et briandisme. Aider l’Allemagne des années 1920 à surmonter le coût de sa défaite lui semble de meilleure politique, dans la perspective d’une Europe coincée entre la Russie et l’Amérique, que l’acharnement cocardier de courte portée. Il est d’autres manières d’écarter le risque d’une nouvelle guerre que l’angélisme pacifiste et l’esthétisme post-dadaïste… Mais accorde-t-on encore un reste de crédit à la pensée politique de Drieu ? Le fascisme n’en est-il pas le dernier mot? L’attention qu’il a portée très tôt à Mussolini, comme beaucoup d’hommes qui se disent encore de gauche alors, n’amorçait-elle pas sa conversion à Hitler ? Qu’il ait été un ardent antimunichois en 1937, en vomissant le soulagement qu’éprouvèrent une pléiade d’écrivains supposés plus respectables, n’effleure plus la bonne conscience de tous ceux, et ils sont nombreux à peser sur l’opinion publique, qui ont définitivement révoqué en doute le « service de la France » dont Drieu n’a jamais démordu.
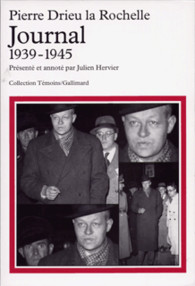 Comme Pierre Andreu et Frédéric Grover avant lui, Hervier prend au sérieux le poète iconoclaste de 1917, le réformiste socialisant des années 1920, l’électrochoc de février 34 et les déchirements du Journal 1939-1945 dont il fut l’éditeur courageux, voilà près de vingt-cinq ans, malgré la tempête qu’il savait soulever et souleva. C’est qu’Hervier s’était refusé à transformer cette ultime autobiographie en pièce à conviction du grand procès auquel, noblesse oblige, Drieu se sera soustrait. L’auteur du Feu follet s’était expliqué avant de se tuer, il n’avait plus rien à ajouter en 1945, encore moins à des tribunaux d’épuration où ne siégèrent, il est vrai, que des amis de la France et d’exemplaires résistants. Des explications sur sa conduite et son parcours politique, de la nouvelle gauche à la jeune droite, puis du socialisme fasciste au fascisme socialiste, le nombre impressionne, de même que sa répugnance inlassable envers tout nationalisme étroit. La patrie est affaire de valeurs partagées, plus que d’origine : un passage peu relevé d’Etat civil (1921) prend appui sur l’intégration réussie des Juifs français pour illustrer son idée, dirions-nous, du vivre-ensemble. Vraie crise morale, la guerre de 14 a enterré le patriotisme hérité de 1814 et de 1870 en démasquant les illusions qu’il avait trop longtemps camouflées. Comment nommer autrement, dit Drieu, la folie suicidaire des autorités, la bourgeoisie embusquée, l’ivresse technologique retournée contre l’infanterie et la propagande anti-boche ?
Comme Pierre Andreu et Frédéric Grover avant lui, Hervier prend au sérieux le poète iconoclaste de 1917, le réformiste socialisant des années 1920, l’électrochoc de février 34 et les déchirements du Journal 1939-1945 dont il fut l’éditeur courageux, voilà près de vingt-cinq ans, malgré la tempête qu’il savait soulever et souleva. C’est qu’Hervier s’était refusé à transformer cette ultime autobiographie en pièce à conviction du grand procès auquel, noblesse oblige, Drieu se sera soustrait. L’auteur du Feu follet s’était expliqué avant de se tuer, il n’avait plus rien à ajouter en 1945, encore moins à des tribunaux d’épuration où ne siégèrent, il est vrai, que des amis de la France et d’exemplaires résistants. Des explications sur sa conduite et son parcours politique, de la nouvelle gauche à la jeune droite, puis du socialisme fasciste au fascisme socialiste, le nombre impressionne, de même que sa répugnance inlassable envers tout nationalisme étroit. La patrie est affaire de valeurs partagées, plus que d’origine : un passage peu relevé d’Etat civil (1921) prend appui sur l’intégration réussie des Juifs français pour illustrer son idée, dirions-nous, du vivre-ensemble. Vraie crise morale, la guerre de 14 a enterré le patriotisme hérité de 1814 et de 1870 en démasquant les illusions qu’il avait trop longtemps camouflées. Comment nommer autrement, dit Drieu, la folie suicidaire des autorités, la bourgeoisie embusquée, l’ivresse technologique retournée contre l’infanterie et la propagande anti-boche ?
 Il faut que la IIIème République, déchue, cède la place à une nouvelle organisation politique, économique et sociale, et se dote de nouvelles élites. La boucherie de 14-18 a révélé toute une jeunesse à elle-même, elle a réveillé son sens de l’action après lui avoir fait presque perdre celui de l’obéissance, elle a vérifié ce que Drieu a retenu de Nietzsche, Barrès et Rimbaud : l’histoire se recrée dans la violence, comme l’art dans le mal. Chance de l’individu moderne, que tout condamne à l’apathie, la guerre sonne l’appel au sursaut collectif. Tel est, du moins, le credo d’Interrogation et, avec moins de confiance prophétique, de Fond de cantine, second opus poétique de Drieu, paru en 1920, alors qu’il est devenu un solide compagnon des futurs surréalistes et que sa foi en un avenir neuf s’étiole un peu. Alimenté par l’argent d’une épouse qu’il délaisse, son libertinage ne connaît aucune borne : sexe et alcool, adultères et bordel, remplissent sa vie et ses romans d’un aristocratisme à part. Drieu n’en conserve pas moins une «tête politique ». Ce Don Juan insatiable ne peut abandonner le soldat de Charleroi au stupre des années folles. Rétif finalement à Mussolini, trop nationaliste, lucide quant à Moscou, refusant de suivre Aragon sur la pente du léninisme, il va publier coup sur coup, en 1927, deux essais, La Suite dans les idées et Le Jeune Européen, dédié au Breton de Légitime défense. Avec Interrogation et Fond de cantine, ils formeront plus tard les Ecrits de jeunesse, qui pivotent ainsi sur l’expérience de la guerre et les attentes de la paix.
Il faut que la IIIème République, déchue, cède la place à une nouvelle organisation politique, économique et sociale, et se dote de nouvelles élites. La boucherie de 14-18 a révélé toute une jeunesse à elle-même, elle a réveillé son sens de l’action après lui avoir fait presque perdre celui de l’obéissance, elle a vérifié ce que Drieu a retenu de Nietzsche, Barrès et Rimbaud : l’histoire se recrée dans la violence, comme l’art dans le mal. Chance de l’individu moderne, que tout condamne à l’apathie, la guerre sonne l’appel au sursaut collectif. Tel est, du moins, le credo d’Interrogation et, avec moins de confiance prophétique, de Fond de cantine, second opus poétique de Drieu, paru en 1920, alors qu’il est devenu un solide compagnon des futurs surréalistes et que sa foi en un avenir neuf s’étiole un peu. Alimenté par l’argent d’une épouse qu’il délaisse, son libertinage ne connaît aucune borne : sexe et alcool, adultères et bordel, remplissent sa vie et ses romans d’un aristocratisme à part. Drieu n’en conserve pas moins une «tête politique ». Ce Don Juan insatiable ne peut abandonner le soldat de Charleroi au stupre des années folles. Rétif finalement à Mussolini, trop nationaliste, lucide quant à Moscou, refusant de suivre Aragon sur la pente du léninisme, il va publier coup sur coup, en 1927, deux essais, La Suite dans les idées et Le Jeune Européen, dédié au Breton de Légitime défense. Avec Interrogation et Fond de cantine, ils formeront plus tard les Ecrits de jeunesse, qui pivotent ainsi sur l’expérience de la guerre et les attentes de la paix.
Balançant de la confession intime à la réflexion globale, La Suite dans les idées appartient à ces objets indéfinissables chers à Drieu. Fait de bribes échouées, poèmes et récits courts, le premier volume n’a pas convaincu Gallimard, auquel Drieu avait tenté de le vendre dès 1925. Ce décousu ne doit pas abuser et Hervier donne la clef de l’étrange bouquet en rapprochant son Préambule de l’adresse liminaire des Fleurs du Mal. Drieu ne s’est jamais complu dans la lecture décadente de Baudelaire, celle de la fin du XIXème siècle, et ses complaisances obscures. Le Baudelaire de Drieu annonce plutôt celui de Valéry et Matisse, tout de résolution et de clarté roboratives. La recherche du plaisir ne saurait dédouaner les jouisseurs d’agir sur le monde environnant et d’interroger le sens de leur vie de débauches. La Suite dans les idées peint en tons crus et drôles, cruellement drôles, la difficulté de s’arracher aux délices de Capoue pour la jeunesse des cafés et des dancings, où les jeunes surréalistes ne sont pas les derniers à briller. A cet étourdissement généralisé, à ces femmes affranchies et qui éclatent de « toute leur fureur sexuelle » à la terrasse des bistrots, Drieu ne jette pas la pierre, il en fut, il en est encore un peu… Son besoin d’autre chose n’en est que plus impérieux et se fait entendre des lecteurs du Jeune Européen.
 « Rêveries lyriques sur l’état de notre civilisation », et les tourments de sa jeunesse turbulente, faudrait-il ajouter pour rester dans la ligne des Fleurs du Mal, ce grand livre passablement occulté attrape la décomposition contemporaine au filet de son étrange alliage. Dédié à André Breton, il cite Le Paysan de Paris d’Aragon en tête de sa seconde partie, où le music-hall et les divers attraits du merveilleux populaire illustrent « le tragique moderne » des surréalistes avec lesquels Drieu vient de rompre. Rupture de principe et non d’écriture, et rupture ambiguë dont il faudra un jour avouer tous les ressorts. Admettons, pour l’heure, qu’ils sont d’abord politiques ! En 1927, Aragon a rejoint le PCF et d’autres se tâtent parmi les fêtards du Cyrano. Drieu, par contre, redit « l’affreuse déconvenue » que la Russie soviétique lui a causée, il le redit en admirateur ancien et trompé de la Révolution de 17. Il lui semble, d’ailleurs, que l’actualité voit triompher les fausses valeurs, les engagements bidons, l’imposture des mots dévoyés… De même que la victoire du prolétariat masque celle du machinisme et de la servitude d’Etat, l’époque entière glisse vers le règne de la duperie, la France surtout. Où trouver la force d’un changement authentique ? Comment réveiller les appétits du fantassin devant lequel l’Europe déroulait un rêvé de fraternité par-dessus les clivages, les classes et les frontières ? Ce fut l’interrogation de 1927 ! Au-delà du toilettage que Drieu leur fera subir en 1939-1940 sous le feu d’une autre guerre, et que Julien Hervier passe savamment en revue, les Ecrits de jeunesse, livre de combat, étaient porteurs d’un projet auquel la Collaboration, jeu de dupes, allait administrer un coup fatal. Stéphane Guégan
« Rêveries lyriques sur l’état de notre civilisation », et les tourments de sa jeunesse turbulente, faudrait-il ajouter pour rester dans la ligne des Fleurs du Mal, ce grand livre passablement occulté attrape la décomposition contemporaine au filet de son étrange alliage. Dédié à André Breton, il cite Le Paysan de Paris d’Aragon en tête de sa seconde partie, où le music-hall et les divers attraits du merveilleux populaire illustrent « le tragique moderne » des surréalistes avec lesquels Drieu vient de rompre. Rupture de principe et non d’écriture, et rupture ambiguë dont il faudra un jour avouer tous les ressorts. Admettons, pour l’heure, qu’ils sont d’abord politiques ! En 1927, Aragon a rejoint le PCF et d’autres se tâtent parmi les fêtards du Cyrano. Drieu, par contre, redit « l’affreuse déconvenue » que la Russie soviétique lui a causée, il le redit en admirateur ancien et trompé de la Révolution de 17. Il lui semble, d’ailleurs, que l’actualité voit triompher les fausses valeurs, les engagements bidons, l’imposture des mots dévoyés… De même que la victoire du prolétariat masque celle du machinisme et de la servitude d’Etat, l’époque entière glisse vers le règne de la duperie, la France surtout. Où trouver la force d’un changement authentique ? Comment réveiller les appétits du fantassin devant lequel l’Europe déroulait un rêvé de fraternité par-dessus les clivages, les classes et les frontières ? Ce fut l’interrogation de 1927 ! Au-delà du toilettage que Drieu leur fera subir en 1939-1940 sous le feu d’une autre guerre, et que Julien Hervier passe savamment en revue, les Ecrits de jeunesse, livre de combat, étaient porteurs d’un projet auquel la Collaboration, jeu de dupes, allait administrer un coup fatal. Stéphane Guégan
*Ecrivains en guerre. Nous sommes des machines à oublier, Historial de la Grande Guerre, Péronne, jusqu’au 16 novembre, catalogue sous la direction des commissaires, Laurence Campa et Philippe Pigeard, Gallimard, 24€
**Drieu La Rochelle, Le Jeune Européen et autres écrits de jeunesse 1917-1927, édition, avant-propos et annexes par Julien Hervier, Bartillat, 23€.
***Les excellentes Editions de Paris nous rappellent quel journaliste inspiré fut Drieu. Ne cherchons pas ailleurs l’un des ressorts de ses nouvelles et romans, où il a su faire passer le ton et le punch de la presse. Ce que Drieu écrivit de l’activité théâtrale en 1923-1924, pour la NRF, enchanta Zweig (il recommande sa lecture à Romain Rolland). Julien Hervier note justement combien Le Jeune Européen y a puisé une partie de son matériau et de sa verve. Vers 1930, pour revenir à notre précieux florilège, Drieu adore s’écarter des sujets nobles, il radiographie le présent, passion dévorante, vagabonde et rimbaldise de Lindbergh à Violette Nozière, de Stendhal à Borges et de Saint-Denis au Louvre. Journaux ou revues, gauche ou droite, peu importe. Au-dessus des partis et des patries, il caresse le rêve d’une France qui éviterait l’étau des fascismes et des communismes, une France qui soignerait son corps (vive le sport, le camping, les voyages) et sa santé spirituelle en lisant D. H. Lawrence. Drieu a beaucoup pratiqué le nudisme solitaire avec ses plus belles maîtresses. Du reste, les femmes qui refusent de vieillir et d’épaissir l’attendrissent plus que la veulerie des tribunaux face au mystère, ou des gouvernements face au danger. La peinture, autre marotte, se cogne ici et là à sa plume, la meilleure peinture, Manet, Picasso, Derain, le dernier Renoir et même Soutine, qui fait « souffrir la toile » et crier le désordre de l’atelier. La politique, rarement directe, peut l’être aussi. On relira les courtes notes qu’il donna à Paulhan sur l’épiphanie de février 34 et la guerre d’Espagne. SG (Pierre Drieu La Rochelle, Chroniques des années 30, présentation de Christian Dedet, Les Editions de Paris, 15€).
 ****La fable a tous les droits, sauf celui de torturer l’histoire. Dans le récit qu’il imagine d’un procès qui n’eut jamais lieu, ou qui n’eut pour assises intimes que le seul Drieu, Gérard Guégan ne blesse pas la vérité. Tout au plus se glisse-t-il dans ses silences avec tact. Il aime trop Drieu pour dramatiser banalement la confrontation finale du traqué avec lui-même… De jeunes communistes, qui n’ont pas digéré le pacte Ribbentrop-Molotov, lui ont mis la main dessus fin 44, c’est l’hypothèse de départ. Drieu a pactisé avec l’ennemi, il doit assumer les crimes de l’Allemagne, qui deviennent les siens, pense la plus énervée du groupe. Mais ses camarades la calment, la situation se complique, les esprits se troublent, à l’image des années d’Occupation et du rôle qu’y joua Drieu. S’enclenche la polarité des contraires, issue de la vulgate sartrienne, haine de soi et volonté de puissance. Plus hardie est la troisième voix, celle de Guégan lui-même, qui ne confond pas Drieu et les vulgaires collabos enrichis, renvoie son antisémitisme à ses singulières éclipses et amoureuses exceptions, n’oublie pas que son fascisme fut un « combat », au service de la France, et sa mort le sceau des âmes fortes. Ni création littéraire, ni document historique, le livre d’Aude Terray se saisit du dernier Drieu, quant à lui, de façon trop attendue. La finesse psychologique qu’annonce la 4ème de couverture consiste à remailler les poncifs usuels : Drieu a tout raté, il se déteste, bande un coup sur deux, tient sa «revanche » sous la botte et, évidemment, s’abandonne à sa fascination pour la mort et la force, ces maîtresses insatiables… Les raccourcis journalistiques abondent : Abel Bonnard et Jouhandeau se résument à leur passion homosexuelle pour l’Occupant, le « voyage » des écrivains français ne peut être qu’une « grotesque équipée », le choix que Drieu fait de « revenir » à Doriot, en 1942, « un spasme suicidaire ». On apprend, avec stupeur, que Gilles a été « ignoré » à sa sortie. L’assertion surprendra Jean-Baptiste Bruneau qui a consacré une livre décisif à la réception critique de Drieu. Il eût mieux valu se demander pourquoi, en 1939, la presse, gauche et droite confondues, « ignore » l’antisémitisme (toujours déchiré) de l’auteur et ne s’émeut que du vitriol jeté, à profusion, sur la classe politique et la cléricature surréaliste. Le livre refermé, une question surgit : la mode des précipités biographiques convient-elle à un sujet aussi « grave » (Paulhan, mars 1945) que la « fin » de Drieu ? SG (Gérard Guégan, Tout a une fin, Drieu, Gallimard, 10€ ; Aude Terray, Les Derniers jours de Drieu La Rochelle, Grasset, 18€)
****La fable a tous les droits, sauf celui de torturer l’histoire. Dans le récit qu’il imagine d’un procès qui n’eut jamais lieu, ou qui n’eut pour assises intimes que le seul Drieu, Gérard Guégan ne blesse pas la vérité. Tout au plus se glisse-t-il dans ses silences avec tact. Il aime trop Drieu pour dramatiser banalement la confrontation finale du traqué avec lui-même… De jeunes communistes, qui n’ont pas digéré le pacte Ribbentrop-Molotov, lui ont mis la main dessus fin 44, c’est l’hypothèse de départ. Drieu a pactisé avec l’ennemi, il doit assumer les crimes de l’Allemagne, qui deviennent les siens, pense la plus énervée du groupe. Mais ses camarades la calment, la situation se complique, les esprits se troublent, à l’image des années d’Occupation et du rôle qu’y joua Drieu. S’enclenche la polarité des contraires, issue de la vulgate sartrienne, haine de soi et volonté de puissance. Plus hardie est la troisième voix, celle de Guégan lui-même, qui ne confond pas Drieu et les vulgaires collabos enrichis, renvoie son antisémitisme à ses singulières éclipses et amoureuses exceptions, n’oublie pas que son fascisme fut un « combat », au service de la France, et sa mort le sceau des âmes fortes. Ni création littéraire, ni document historique, le livre d’Aude Terray se saisit du dernier Drieu, quant à lui, de façon trop attendue. La finesse psychologique qu’annonce la 4ème de couverture consiste à remailler les poncifs usuels : Drieu a tout raté, il se déteste, bande un coup sur deux, tient sa «revanche » sous la botte et, évidemment, s’abandonne à sa fascination pour la mort et la force, ces maîtresses insatiables… Les raccourcis journalistiques abondent : Abel Bonnard et Jouhandeau se résument à leur passion homosexuelle pour l’Occupant, le « voyage » des écrivains français ne peut être qu’une « grotesque équipée », le choix que Drieu fait de « revenir » à Doriot, en 1942, « un spasme suicidaire ». On apprend, avec stupeur, que Gilles a été « ignoré » à sa sortie. L’assertion surprendra Jean-Baptiste Bruneau qui a consacré une livre décisif à la réception critique de Drieu. Il eût mieux valu se demander pourquoi, en 1939, la presse, gauche et droite confondues, « ignore » l’antisémitisme (toujours déchiré) de l’auteur et ne s’émeut que du vitriol jeté, à profusion, sur la classe politique et la cléricature surréaliste. Le livre refermé, une question surgit : la mode des précipités biographiques convient-elle à un sujet aussi « grave » (Paulhan, mars 1945) que la « fin » de Drieu ? SG (Gérard Guégan, Tout a une fin, Drieu, Gallimard, 10€ ; Aude Terray, Les Derniers jours de Drieu La Rochelle, Grasset, 18€)
*****Sur Drieu lecteur de Bernanos, voir Stéphane Guégan, « Sous le soleil de Bernanos », La Revue des deux mondes, septembre 2016, 15 €
 ******Sur Matisse lecteur de Baudelaire (et de Valéry), voir ma présentation de Matisse, Les Fleurs du mal, reprint de l’édition de 1947, avec un livret d’accompagnement, Hazan, septembre 2016, 25€.
******Sur Matisse lecteur de Baudelaire (et de Valéry), voir ma présentation de Matisse, Les Fleurs du mal, reprint de l’édition de 1947, avec un livret d’accompagnement, Hazan, septembre 2016, 25€.
SAVE THE DATE / Stéphane Guégan, Drieu, l’homme aux valises pleines, Conférence de l’Observatoire de la modernité. Dix phares de la pensée moderne, 2ème partie. Sous la direction de Chantal Delsol et Laetitia Strauch-Bonart. Collège des Bernardins, mercredi 5 octobre 2016, 20 h00.









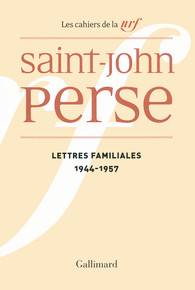




 La conduite des Bordelais lors des Cent-Jours n’en est pas la seule raison. Louis XVIII lui-même répandit ses largesses sur la «cité du douze mars» et fit expédier à son tour quelques tableaux de poids, dans tous les sens du terme. L’un d’entre eux, Le Christ en croix de
La conduite des Bordelais lors des Cent-Jours n’en est pas la seule raison. Louis XVIII lui-même répandit ses largesses sur la «cité du douze mars» et fit expédier à son tour quelques tableaux de poids, dans tous les sens du terme. L’un d’entre eux, Le Christ en croix de  Parvenu au seuil de la galerie moderne, un grand portrait équestre de Charles X lui indique le départ d’un parcours qui le conduira jusqu’à la France de De Gaulle puisque un
Parvenu au seuil de la galerie moderne, un grand portrait équestre de Charles X lui indique le départ d’un parcours qui le conduira jusqu’à la France de De Gaulle puisque un  *Matisse-Rouault. Correspondance 1906-1953, lettres rassemblées et annotées par Jacqueline Munck, La Bibliothèque des arts, 19€.
*Matisse-Rouault. Correspondance 1906-1953, lettres rassemblées et annotées par Jacqueline Munck, La Bibliothèque des arts, 19€.