
On fait souvent naître l’art moderne du divorce entre l’image et la littérature, à laquelle elle aurait été trop longtemps subordonnée. Depuis la Renaissance et son Ut pictura poesis, la peinture d’histoire s’était efforcée de s’assimiler les règles et les finalités de la poésie et du théâtre antiques. Sous la force de la conception humaniste des arts, la peinture devient parole muette et se veut la « sœur » de la rhétorique, autant que de la tragédie. Aussi le tableau sacré ou profane prend-il souvent l’apparence d’une scène ouverte au jeu des passions humaines, des plus douces aux plus terribles, en vue de la traditionnelle catharsis. Nourri d’Aristote et d’Horace, tout un courant théorique prétend fonder l’invention picturale sur les correspondances entre l’ordre des formes et l’ordre des mots. Dessin, couleur, composition et même imagination sont appelés à procéder de façon identique au royaume du visuel et au royaume du verbe. On attend d’une peinture à contenu littéraire qu’elle respecte scrupuleusement sa source textuelle, construise l’action et conduise ses protagonistes avec une efficacité entrainante, voire édifiante. « Lisez l’histoire et le tableau, écrit Nicolas Poussin à Chantelou en avril 1639, afin de connaître si chaque chose est appropriée au sujet. » En vérité, le lien entre peinture et rhétorique a toujours été de tension plus que d’harmonie, les peintres prenant vite conscience des particularités de leur médium et de la force supérieure du visible sur nous. Cette conscience d’une spécificité des arts visuels se creuse à la fin du XVIIIe siècle.

A mesure que le génie individuel entend rivaliser avec le cursus institutionnel, et l’image avec le texte, les peintres redéfinissent l’ancien dialogue des muses, n’empruntent plus nécessairement leurs sujets à la littérature ou se logent dans ses vides. Mais cette redéfinition n’équivaut pas, loin s’en faut, à la pleine autonomie qu’on associe souvent à l’évolution de la peinture française après David. Sans parler de la critique d’art de Baudelaire, Maurice Barrès ou du Claudel de L’Œil écoute, les exemples de Girodet, Ingres, Delacroix, Chassériau, Gustave Moreau, Manet, Picasso ou Matisse permettent de réévaluer la part de « l’ancien monde » dans l’art des modernes. Avant les travaux décisifs de Marc Fumaroli (L’Ecole du silence, Flammarion, 1991) et de Jacqueline Lichtenstein (La Couleur éloquente, Flammarion, 1989 et Les Raisons de l’art. Essai sur les théories de la peinture, Gallimard, 2014), le lecteur français disposait de peu d’ouvrages capables de l’initier à ce que Marc Fumaroli appelait « l’écoute symbolique ». La seule exception notable était l’ouvrage de Rensselaer W. Lee (1898-1984), ancien disciple de Panofsky, Ut pictura poesis. Humanisme et théorie de la peinture XVe-XVIIe siècles, dans la belle traduction de Maurice Brock. Parue en 1991 chez Macula, elle revient en librairie, sous la même enseigne (2024, 26€) : on ne saurait trop en encourager la lecture. En plus de saluer la nouveauté des travaux de Michael Baxandall, la préface de l’édition italienne de 1974, qu’on lira ici, donna à Lee l’occasion de corriger ce que son texte, en 1940, véhiculait de poncifs au sujet des Carrache ou de Charles Le Brun. Il n’eut pas le temps d’en faire de même au sujet de l’Académie royale, vengée plus tard par les publications cruciales de Jacqueline Lichtenstein et de Christian Michel. Stéphane Guégan
*Voir aussi, Stéphane Guégan, « Poussin ou la parole retrouvée », Le Débat, Gallimard, septembre-octobre 1994, p. 78-84, accessible en ligne sur Cairn.
De la scène au tableau

Sur les planches, faut-il peindre ou faut-il feindre ? Traduire un ressenti ou produire un savoir ? Eprouver les sentiments à représenter, en cherchant le contact brutal du public, ou dominer sa sensibilité, en vue d’un effet d’art supérieur ? Diderot, note Laurence Marie, donne l’impression, illusoire, d’être passé d’une théorie à l’autre. Son magnifique Paradoxe sur le comédien, l’un de ses derniers écrits, suggère une lecture moins binaire, et plaide plutôt l’unité de l’émotion et du sang-froid, de la vérité et de la science, du naturel et de l’idéal. Ce sont les mots de Diderot, assez génial pour ne pas les opposer. Du reste, insiste-il, le plus important, outre l’introduction au théâtre de ce que les bienséances proscrivaient ou nommaient sans le montrer, c’est l’illusion scénique, le quatrième mur, le saisissement du spectateur, corps et esprit. Loin de partager la haine des plaisirs dramatiques d’un Nicole et d’un Rousseau, il en défend l’utilité au nom du divertissement, de l’esthétique en soi, et des effets politiques du voir-ensemble. A ce public en communion, Voltaire, fort de ses séjours londoniens, promettait dès les années 1730 moins de conversations et plus d’événements, plus d’actions que de paroles. Diderot se lance dans une bataille qui a débuté avant lui, conspue la raideur déclamatoire et réclame, Eschyle en tête, un regain de vigueur corporel et verbal. Ce n’est pas à définir et contraindre l’acteur qu’aspire son Paradoxe, c’est à promouvoir un « spectacle rénové », étayé de « tableaux frappants », une morale en mouvement, non un catéchisme, résume Laurence Marie, qui assortit son édition serrée, brillante et surprenante, d’un florilège de textes pris aux Anciens comme aux comédiens et comédiennes d’aujourd’hui. Puisque Diderot associe nouveau théâtre et nouvelle peinture dans un même destin, et que le Paradoxe mentionne aussi bien Raphaël et Titien que Lagrenée, les annexes comprennent quelques extraits des célèbres Salons du maître. La sensation qu’à produite sur lui le Bélisaire de David en 1781 est bien connue, Diderot citant Racine à l’appui du tableau volontiers théâtral, au sens où le peintre, un ami de Sedaine et des Chénier, un mordu de la Comédie-Française sous Louis XVI, entendait le mot. David Alston et Mark Ledubury ont définitivement éclairé cette passion de la tragédie propre à électriser ses pinceaux, eux aussi de feu et de glace. SG / Diderot, Paradoxe sur le comédien, édition présentée, établie et annotée par Laurence Marie, Gallimard, Folio classique, 7,80 €. Quant aux lectures du texte par les acteurs actuels, voir Laurence Marie, Les Paradoxes du comédien, Gallimard, 22,50 €.

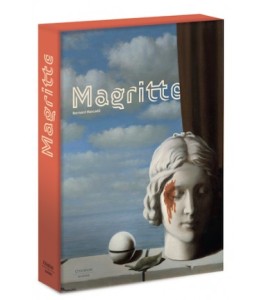



 La thématique mariale, Richter le sait, se prête idéalement à cette méditation sur ce qu’il importe de transmettre : chacune des cinq toiles, allégorique en soi, joue avec sa propre disparition, et communique à son faire, larges coups de brosse et matière somptueuse, une manière de suspens vénitien. Jamais inerte, la matière pense et les titres, souvent à double entente, confirment cette intelligence des apparences, qui n’est jamais plus évidente qu’à travers les thèmes issus du vieux fonds romantique. Face à son Iceberg dans le brouillard, dont la touche fondante épouse son sujet, face à ses innombrables évocations de la forêt ou de la terre mère, le souvenir remonte des tableaux de Friedrich, Carus, Courbet et
La thématique mariale, Richter le sait, se prête idéalement à cette méditation sur ce qu’il importe de transmettre : chacune des cinq toiles, allégorique en soi, joue avec sa propre disparition, et communique à son faire, larges coups de brosse et matière somptueuse, une manière de suspens vénitien. Jamais inerte, la matière pense et les titres, souvent à double entente, confirment cette intelligence des apparences, qui n’est jamais plus évidente qu’à travers les thèmes issus du vieux fonds romantique. Face à son Iceberg dans le brouillard, dont la touche fondante épouse son sujet, face à ses innombrables évocations de la forêt ou de la terre mère, le souvenir remonte des tableaux de Friedrich, Carus, Courbet et  *
*