 L’été s’en est allé et j’ai lu tous les livres… Mais le temps, en sa course folle, et l’écriture, deux livres à paraître en octobre, ont semé mille embuches sur l’humble chemin du blogueur. Je sors tardivement du silence pour vider, comme dirait le cher Drieu, mon fond de cantine. La rentrée des expositions et des éditeurs pressant le pas, il faut agir, et faire court plutôt que de ne rien faire. C’est la lecture de l’excellent Rien de trop d’Antoine Arsan qui m’a mis sur la voie de la solution, ou de l’illumination… Tout lecteur de Jack Kerouac, et je le suis de longue date, entretient un moi bouddhique, rêvant d’une réconciliation pacifique avec ce monde que la toute-puissance technique, dirait Heidegger, continue à joyeusement saccager. Malgré cela, l’intelligence du zen, le vagabondage physique et mental du sublime Bashô continue à animer les maîtres du haïku et à faire vibrer, dans la déliaison de leur peu de mots, un monde absolu, comme étranger à toute perception humaine. Le tout de l’univers surgit, sans se livrer, ni se figer, à partir d’instants anodins et de notations concrètes dont le sens doit rester inachevé, suspendu entre être et non-être. L’énonciation et l’énoncé ne s’emboîtent qu’imparfaitement. Mais il y a sens, quoique fuyant. Aussi la belle définition d’Yves Bonnefoy, « l’épiphanie du rien », me semble-t-elle moins heureuse que la définition de Barthes, dans L’Empire des signes, le livre qu’il écrivit pour Gaëtan Picon en 1970 : « Le haïku n’est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d’un coup sa forme juste. » Entre le banal et l’éternité, la grâce doit ressembler au hasard d’une musique qui aurait pu ne pas se lever. Conclusion parfaite d’Arsan : le haïku dit et ne dit rien, ou plutôt veut ne rien dire.
L’été s’en est allé et j’ai lu tous les livres… Mais le temps, en sa course folle, et l’écriture, deux livres à paraître en octobre, ont semé mille embuches sur l’humble chemin du blogueur. Je sors tardivement du silence pour vider, comme dirait le cher Drieu, mon fond de cantine. La rentrée des expositions et des éditeurs pressant le pas, il faut agir, et faire court plutôt que de ne rien faire. C’est la lecture de l’excellent Rien de trop d’Antoine Arsan qui m’a mis sur la voie de la solution, ou de l’illumination… Tout lecteur de Jack Kerouac, et je le suis de longue date, entretient un moi bouddhique, rêvant d’une réconciliation pacifique avec ce monde que la toute-puissance technique, dirait Heidegger, continue à joyeusement saccager. Malgré cela, l’intelligence du zen, le vagabondage physique et mental du sublime Bashô continue à animer les maîtres du haïku et à faire vibrer, dans la déliaison de leur peu de mots, un monde absolu, comme étranger à toute perception humaine. Le tout de l’univers surgit, sans se livrer, ni se figer, à partir d’instants anodins et de notations concrètes dont le sens doit rester inachevé, suspendu entre être et non-être. L’énonciation et l’énoncé ne s’emboîtent qu’imparfaitement. Mais il y a sens, quoique fuyant. Aussi la belle définition d’Yves Bonnefoy, « l’épiphanie du rien », me semble-t-elle moins heureuse que la définition de Barthes, dans L’Empire des signes, le livre qu’il écrivit pour Gaëtan Picon en 1970 : « Le haïku n’est pas une pensée riche réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d’un coup sa forme juste. » Entre le banal et l’éternité, la grâce doit ressembler au hasard d’une musique qui aurait pu ne pas se lever. Conclusion parfaite d’Arsan : le haïku dit et ne dit rien, ou plutôt veut ne rien dire.
 Kerouac en a laissé plusieurs milliers et il n’est pas facile de les faire passer dans notre langue. Difficulté où s’inverse le rapport de l’écrivain à la langue américaine, qui n’était pas son idiome natif. L’attachement passionné à Céline et Proust fut, on le sait, l’autre moteur de cette tension dialectale. Le Livre des haïkus, en sa version française, est disponible aux éditions de La Table Ronde, de même que le premier coup d’éclat de Kerouac, The Town and the City, et désormais son dernier roman. Pic paraît en octobre 1969, quelques jours avant la mort de son auteur. Perfect timing ! Cela n’a pas suffi à le préserver d’un effacement tenace et injuste. Une partie du matériau, semble-t-il, provient des chutes d’On the Road. Kerouac, bien qu’à bout de souffle, reste obsédé par l’oralité et le jazz des mots. Il veut écrire, à son tour, un Huckleberry Finn… Si le résultat reste plus modeste que l’antécédent mythique de toute la modernité américaine, il lui ressemble par le choix singulier de mettre le récit dans la bouche et les yeux d’un gamin noir de Caroline du Nord. Aucun risque de verser avec Kerouac dans l’exercice de style. Les inflexions qu’il fait entendre du sabir de son héros, c’est sa façon de révéler une situation sociale et raciale dont l’enfant n’a pas encore conscience. Du monde, il ne connaît que l’étroit périmètre d’une vie sordide. Elle le devient surtout à la mort du grand-père, dont Pic apprend alors le passé d’ancien esclave… A partir de là, il ira de surprise en surprise, elles ne sont pas toutes mauvaises. Son frère, jadis happé par la route, resurgit un soir et les voilà filant vers New York, la rue, l’usine, les boîtes… L’école du désir, le salut par la route, la disponibilité au présent, Kerouac tisse ses thèmes majeurs, sans oublier de nous faire rire dans l’Amérique de la ségrégation. A la veille du grand saut, le talent est intact.
Kerouac en a laissé plusieurs milliers et il n’est pas facile de les faire passer dans notre langue. Difficulté où s’inverse le rapport de l’écrivain à la langue américaine, qui n’était pas son idiome natif. L’attachement passionné à Céline et Proust fut, on le sait, l’autre moteur de cette tension dialectale. Le Livre des haïkus, en sa version française, est disponible aux éditions de La Table Ronde, de même que le premier coup d’éclat de Kerouac, The Town and the City, et désormais son dernier roman. Pic paraît en octobre 1969, quelques jours avant la mort de son auteur. Perfect timing ! Cela n’a pas suffi à le préserver d’un effacement tenace et injuste. Une partie du matériau, semble-t-il, provient des chutes d’On the Road. Kerouac, bien qu’à bout de souffle, reste obsédé par l’oralité et le jazz des mots. Il veut écrire, à son tour, un Huckleberry Finn… Si le résultat reste plus modeste que l’antécédent mythique de toute la modernité américaine, il lui ressemble par le choix singulier de mettre le récit dans la bouche et les yeux d’un gamin noir de Caroline du Nord. Aucun risque de verser avec Kerouac dans l’exercice de style. Les inflexions qu’il fait entendre du sabir de son héros, c’est sa façon de révéler une situation sociale et raciale dont l’enfant n’a pas encore conscience. Du monde, il ne connaît que l’étroit périmètre d’une vie sordide. Elle le devient surtout à la mort du grand-père, dont Pic apprend alors le passé d’ancien esclave… A partir de là, il ira de surprise en surprise, elles ne sont pas toutes mauvaises. Son frère, jadis happé par la route, resurgit un soir et les voilà filant vers New York, la rue, l’usine, les boîtes… L’école du désir, le salut par la route, la disponibilité au présent, Kerouac tisse ses thèmes majeurs, sans oublier de nous faire rire dans l’Amérique de la ségrégation. A la veille du grand saut, le talent est intact.
 Entre Pic et Les Larrons, l’ultime chef-d’œuvre de Faulkner, que de parallèles troublants ! Le Sud leur tient lieu d’espace de départ commun. Le Sud, et donc la confrontation des épidermes. « Vous pouvez pas savoir, vous êtes pas de la bonne couleur. » Sur les rives du Mississippi, chacun écorche l’anglais, Blancs et Noirs. Mais la peau reste une barrière presque infranchissable, sauf à s’appeler Faulkner et obliger chaque communauté à se voir dans l’œil de l’autre…. Se sentant presque déserté par l’inspiration et la force d’écrire, l’auteur de Sartoris décide lui aussi d’affronter, avec un « roman d’apprentissage », la mort qui vient… Comme Kerouac, il pense à Huck Finn et ne résiste pas au bonheur de remonter l’horloge du temps jusqu’au début du XXe siècle, à l’heure où l’Amérique des derniers aventuriers bascule dans l’ère de l’automobile. On aura compris que la route interdite se charge du potentiel épique de l’ancien western. Trois personnages, deux Blancs, un Noir, deviennent des hommes en cavale. Au plus jeune, onze ans, Faulkner a donné un nom de légende : Lucius Priest pourrait sortir de La Divine Comédie… Mais son destin fera quelques embardées avant le Paradis des souvenirs. Car, le grand âge venu, c’est lui qui raconte, transmet et agit en double de l’auteur. « Grandfather said ». L’incipit des Larrons est plus célèbre que le roman qu’il amorce, roman mal aimé depuis sa sortie, au motif que le tragique tendu des grandes créations faulknériennes y ferait défaut. Son ton de comédie grinçante a dérangé, il indiquait pourtant, note François Pitavy, une réorientation shakespearienne qu’on pourrait comparer au dernier Verdi ou au dernier John Ford (ils ont beaucoup travaillé ensemble). A la mort de son ami Camus, la route et la vitesse toujours, Faulkner dira que la littérature n’a pas à expliquer l’absurde de la vie et le mystère des choix qu’elle nous fait faire. La Pléiade, avec le dernier des cinq volumes des Œuvres romanesques, hisse définitivement Faulkner parmi ses pairs.
Entre Pic et Les Larrons, l’ultime chef-d’œuvre de Faulkner, que de parallèles troublants ! Le Sud leur tient lieu d’espace de départ commun. Le Sud, et donc la confrontation des épidermes. « Vous pouvez pas savoir, vous êtes pas de la bonne couleur. » Sur les rives du Mississippi, chacun écorche l’anglais, Blancs et Noirs. Mais la peau reste une barrière presque infranchissable, sauf à s’appeler Faulkner et obliger chaque communauté à se voir dans l’œil de l’autre…. Se sentant presque déserté par l’inspiration et la force d’écrire, l’auteur de Sartoris décide lui aussi d’affronter, avec un « roman d’apprentissage », la mort qui vient… Comme Kerouac, il pense à Huck Finn et ne résiste pas au bonheur de remonter l’horloge du temps jusqu’au début du XXe siècle, à l’heure où l’Amérique des derniers aventuriers bascule dans l’ère de l’automobile. On aura compris que la route interdite se charge du potentiel épique de l’ancien western. Trois personnages, deux Blancs, un Noir, deviennent des hommes en cavale. Au plus jeune, onze ans, Faulkner a donné un nom de légende : Lucius Priest pourrait sortir de La Divine Comédie… Mais son destin fera quelques embardées avant le Paradis des souvenirs. Car, le grand âge venu, c’est lui qui raconte, transmet et agit en double de l’auteur. « Grandfather said ». L’incipit des Larrons est plus célèbre que le roman qu’il amorce, roman mal aimé depuis sa sortie, au motif que le tragique tendu des grandes créations faulknériennes y ferait défaut. Son ton de comédie grinçante a dérangé, il indiquait pourtant, note François Pitavy, une réorientation shakespearienne qu’on pourrait comparer au dernier Verdi ou au dernier John Ford (ils ont beaucoup travaillé ensemble). A la mort de son ami Camus, la route et la vitesse toujours, Faulkner dira que la littérature n’a pas à expliquer l’absurde de la vie et le mystère des choix qu’elle nous fait faire. La Pléiade, avec le dernier des cinq volumes des Œuvres romanesques, hisse définitivement Faulkner parmi ses pairs.
 Michelet n’y a pas volé sa place, encore qu’elle se réduise à son chef-d’œuvre. Précédée par le scandale et l’arrêt des cours où elle s’était élaborée, L’histoire de la Révolution française accède au rang de bréviaire national dès le Second Empire et ne cessera d’étendre le nombre de ses adeptes, depuis l’époque de Couture et Manet à celle de Péguy et Drieu. Cette Bible du peuple de France rejoint La Pléiade en juillet 1939, comme si le gouvernement d’alors était encore capable de s’en montrer digne. On aimerait tant que la collection prestigieuse s’enrichît bientôt du Journal de Michelet, dont la résurrection a marqué les années 1950-1960. En attendant, saluons l’entreprise de Perrine Simon-Nahum qui en a tiré un volume d’extraits remarquable de vie et de cohérence. Lui convient la couverture véhémente et tricolore de Léopold Massard, le portraitiste de Couture, portraitiste lui-même de Michelet ! Le travail de l’historien, comme il fut le premier à le dire fortement, ne se détache pas plus de la traque des archives que de l’interrogation du présent, de la collecte des traces menacées que de la passion du vivant. Tout lui est sujet d’enquête, des structures de la France prérévolutionnaire à l’intimité féminine. Grand écrivain, grand amoureux, ardent démocrate, que l’histoire contemporaine déçoit et la haine sociale inquiète (« La fraternité ne saurait être radicale »), l’amant de Marianne jette ses forces dans l’avenir en pragmatique (son rôle et son attitude constructive sous Louis-Philippe l’attestent). Il n’a rien du doux rêveur, du lyrique de salon, dont le Baudelaire de 1848 s’est moqué. Le Journal, en tous cas, nous le montre en pleine maîtrise du terrain, qu’il fouille les chefs-d’œuvre de Florence ou bûche douloureusement les annales de la Terreur. Une langue qui ne se paie jamais de mots, proche parfois des courts-circuits du haïku, nul narcissisme, un monument de papier, nourricier de l’œuvre.
Michelet n’y a pas volé sa place, encore qu’elle se réduise à son chef-d’œuvre. Précédée par le scandale et l’arrêt des cours où elle s’était élaborée, L’histoire de la Révolution française accède au rang de bréviaire national dès le Second Empire et ne cessera d’étendre le nombre de ses adeptes, depuis l’époque de Couture et Manet à celle de Péguy et Drieu. Cette Bible du peuple de France rejoint La Pléiade en juillet 1939, comme si le gouvernement d’alors était encore capable de s’en montrer digne. On aimerait tant que la collection prestigieuse s’enrichît bientôt du Journal de Michelet, dont la résurrection a marqué les années 1950-1960. En attendant, saluons l’entreprise de Perrine Simon-Nahum qui en a tiré un volume d’extraits remarquable de vie et de cohérence. Lui convient la couverture véhémente et tricolore de Léopold Massard, le portraitiste de Couture, portraitiste lui-même de Michelet ! Le travail de l’historien, comme il fut le premier à le dire fortement, ne se détache pas plus de la traque des archives que de l’interrogation du présent, de la collecte des traces menacées que de la passion du vivant. Tout lui est sujet d’enquête, des structures de la France prérévolutionnaire à l’intimité féminine. Grand écrivain, grand amoureux, ardent démocrate, que l’histoire contemporaine déçoit et la haine sociale inquiète (« La fraternité ne saurait être radicale »), l’amant de Marianne jette ses forces dans l’avenir en pragmatique (son rôle et son attitude constructive sous Louis-Philippe l’attestent). Il n’a rien du doux rêveur, du lyrique de salon, dont le Baudelaire de 1848 s’est moqué. Le Journal, en tous cas, nous le montre en pleine maîtrise du terrain, qu’il fouille les chefs-d’œuvre de Florence ou bûche douloureusement les annales de la Terreur. Une langue qui ne se paie jamais de mots, proche parfois des courts-circuits du haïku, nul narcissisme, un monument de papier, nourricier de l’œuvre.
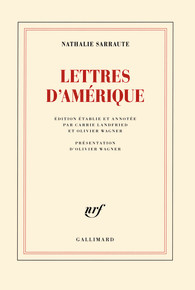 Restons dans la langue de l’instant, la note ciselée, mais repartons en Amérique avec Nathalie Sarraute et les lettres qu’elle adressa à son mari lors de sa tournée triomphale de 1964. Parce qu’il se pique d’être neuf en tout, le nouveau monde s’est rapidement entiché du nouveau roman. On acclame les fossoyeurs du récit traditionnel, ils ont, en outre, la bonne idée de ne pas soutenir ce grand général à particule, vieille France, qui horripile Washington… Pinget et Robbe-Grillet abordent avant Sarraute l’eldorado des campus, les hôtels cossus, les grosses limousines et les conférences ritualisées. L’auteur de Tropismes aurait pu, à dire vrai, y précéder l’auteur des Gommes si elle n’avait pas, en 1960, signé le Manifeste des 121. Devant son soutien au F.L.N., les services culturels du ministère des Affaires étrangères refusèrent leur aide à l’envoi de la réfractaire outre-Atlantique. Quatre ans passèrent… À 63 ans, Sarraute mesure enfin sa popularité de théoricienne post-flaubertienne et de romancière post-proustienne. On voit en elle une sorte de Virginia Woolf traversée par l’expérience de la guerre et la cordée de l’existentialisme. Mais sa rupture avec Sartre et Beauvoir n’est pas pour déplaire, tout comme l’humour rosse des Fruits d’or, qui font un tabac alors qu’ils dénoncent joyeusement le snobisme du milieu littéraire. Dans son excellente présentation, Olivier Wagner fait entendre quelques voix de cette Amérique conquise. Plus que celle d’Hannah Arendt, ralliée par avance, celle du New York Times, en la personne du délicieux Orville Prescott, prouve que Sarraute séduit jusqu’aux adversaires du roman à l’os, dépouillé de tout. C’est qu’Orville avait senti ce que Claude Mauriac écrivait en 1958 : « la prétendue négation de la psychologie » relevait de la farce publicitaire. Une chose est sûre, ces lettres inédites débordent de drôlerie dans leur analyse de soi et des autres. D’Harlem à San Francisco, elles peignent la terre des libertés et l’envers du décor. Un vrai roman.
Restons dans la langue de l’instant, la note ciselée, mais repartons en Amérique avec Nathalie Sarraute et les lettres qu’elle adressa à son mari lors de sa tournée triomphale de 1964. Parce qu’il se pique d’être neuf en tout, le nouveau monde s’est rapidement entiché du nouveau roman. On acclame les fossoyeurs du récit traditionnel, ils ont, en outre, la bonne idée de ne pas soutenir ce grand général à particule, vieille France, qui horripile Washington… Pinget et Robbe-Grillet abordent avant Sarraute l’eldorado des campus, les hôtels cossus, les grosses limousines et les conférences ritualisées. L’auteur de Tropismes aurait pu, à dire vrai, y précéder l’auteur des Gommes si elle n’avait pas, en 1960, signé le Manifeste des 121. Devant son soutien au F.L.N., les services culturels du ministère des Affaires étrangères refusèrent leur aide à l’envoi de la réfractaire outre-Atlantique. Quatre ans passèrent… À 63 ans, Sarraute mesure enfin sa popularité de théoricienne post-flaubertienne et de romancière post-proustienne. On voit en elle une sorte de Virginia Woolf traversée par l’expérience de la guerre et la cordée de l’existentialisme. Mais sa rupture avec Sartre et Beauvoir n’est pas pour déplaire, tout comme l’humour rosse des Fruits d’or, qui font un tabac alors qu’ils dénoncent joyeusement le snobisme du milieu littéraire. Dans son excellente présentation, Olivier Wagner fait entendre quelques voix de cette Amérique conquise. Plus que celle d’Hannah Arendt, ralliée par avance, celle du New York Times, en la personne du délicieux Orville Prescott, prouve que Sarraute séduit jusqu’aux adversaires du roman à l’os, dépouillé de tout. C’est qu’Orville avait senti ce que Claude Mauriac écrivait en 1958 : « la prétendue négation de la psychologie » relevait de la farce publicitaire. Une chose est sûre, ces lettres inédites débordent de drôlerie dans leur analyse de soi et des autres. D’Harlem à San Francisco, elles peignent la terre des libertés et l’envers du décor. Un vrai roman.
Stéphane Guégan
 *Antoine Arsan, Rien de trop. Éloge du haïku, Gallimard, 11€ // Si l’admirable Pierre Loti n’a pas pratiqué le genre, lui qui connaissait si bien le Japon pour s’y être rendu cinq fois, il intègre manifestement à ses impressions de voyageur la concision de l’ukiyo-e, la miniature poétique et le heurt des « couleurs fraîches » qu’elles partagent. Ses Japoneries d’automne (Bartillat/Omnia poche, 12€), sont un régal d’altérité sensuelle et de choses vues. En dédiant leur première partie à Edmond de Goncourt, il entendait lui prouver que la vapeur et le chemin de fer, en rétrécissant la planète, ne l’avaient pas banalisée.
*Antoine Arsan, Rien de trop. Éloge du haïku, Gallimard, 11€ // Si l’admirable Pierre Loti n’a pas pratiqué le genre, lui qui connaissait si bien le Japon pour s’y être rendu cinq fois, il intègre manifestement à ses impressions de voyageur la concision de l’ukiyo-e, la miniature poétique et le heurt des « couleurs fraîches » qu’elles partagent. Ses Japoneries d’automne (Bartillat/Omnia poche, 12€), sont un régal d’altérité sensuelle et de choses vues. En dédiant leur première partie à Edmond de Goncourt, il entendait lui prouver que la vapeur et le chemin de fer, en rétrécissant la planète, ne l’avaient pas banalisée.
 *Jack Kerouac, Pic, nouvelle traduction de l’américain et postface de Christophe Mercier, La Table ronde / La petite vermillon, 5,90€. // Duchamp illuminé ? Certes, mais de quelle sorte ? La scandaleuse Fountain de 1917, selon l’œil avec laquelle on la scrute, a pu être interprétée comme un Bouddha en oraison ou un sexe féminin en pâmoison. Il est malheureux, par conséquent, qu’elle ait perdu son premier titre et, devenue banal urinoir, ait été dépouillée de son ambivalence originelle. Car, ainsi que le démontre Philippe Comar, vrai Panofsky des icônes impures, le ready-made de Duchamp vient après beaucoup d’autres images et évocations du liquide excrémentiel. Il était respecté religieusement par les Anciens, médecins du corps, de l’âme ou du Ciel. Duchamp, par son obsession du sexuel, est proche aussi des peintres néerlandais du XVIIe, sur lesquels s’attarde la glose amusée de Comar. Les jolies malades d’amour y sont légion et les preuves de leurs turpitudes prennent souvent la couleur de l’or et de l’extase. La fontaine des modernes lui préfère « la culture du déchet » et de la mort (Philippe Comar, Des urinoirs dans l’art… avant Marcel Duchamp, Beaux-Arts de Paris éditions, 9€).
*Jack Kerouac, Pic, nouvelle traduction de l’américain et postface de Christophe Mercier, La Table ronde / La petite vermillon, 5,90€. // Duchamp illuminé ? Certes, mais de quelle sorte ? La scandaleuse Fountain de 1917, selon l’œil avec laquelle on la scrute, a pu être interprétée comme un Bouddha en oraison ou un sexe féminin en pâmoison. Il est malheureux, par conséquent, qu’elle ait perdu son premier titre et, devenue banal urinoir, ait été dépouillée de son ambivalence originelle. Car, ainsi que le démontre Philippe Comar, vrai Panofsky des icônes impures, le ready-made de Duchamp vient après beaucoup d’autres images et évocations du liquide excrémentiel. Il était respecté religieusement par les Anciens, médecins du corps, de l’âme ou du Ciel. Duchamp, par son obsession du sexuel, est proche aussi des peintres néerlandais du XVIIe, sur lesquels s’attarde la glose amusée de Comar. Les jolies malades d’amour y sont légion et les preuves de leurs turpitudes prennent souvent la couleur de l’or et de l’extase. La fontaine des modernes lui préfère « la culture du déchet » et de la mort (Philippe Comar, Des urinoirs dans l’art… avant Marcel Duchamp, Beaux-Arts de Paris éditions, 9€).
*William Faulkner, Œuvres romanesques, tome V, édition établie par François Pitavy et Jacques Pothier, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 70€. Outre Les Larrons, il comprend les deux romans, La Ville et La Demeure, avec lesquels se clôt l’admirable trilogie des Snopes.
*Jules Michelet, Journal, choix et édition de Perrine Simon-Nahum, Gallimard, Folio classique, 7,70€.
*Nathalie Sarraute, Lettres d’Amérique, présentation et édition d’Olivier Wagner, en collaboration avec Carrie Landfried, Gallimard, 14,50€




