 Dans La Généalogie de la morale, Nietzsche avance l’hypothèse que les premiers hommes ont utilisé la souffrance, à travers les sacrifices, comme levier de la mémoire. Cette idée de la peur active, positive, instauratrice, et ancrée de toute éternité en nous, a beaucoup retenu le Breton de L’Art magique (1957). Nos morts, à l’ère moderne, jouent peut-être un rôle semblable aux meurtres ritualisés d’hier… Qu’aurait été ainsi la carrière d’Albert Bartholomé (1848-1928), le superbe sculpteur que l’on sait, si le deuil, deuils intimes et deuils collectifs, n’avait pas entraîné l’artiste hors de sa sagesse initiale, et hors de la peinture, où il manque de flamme, pour les trois dimensions et l’espace réel ? C’est la question que l’on se pose en lisant l’ouvrage très complet et chaleureux que lui consacre Thérèse Burollet, fruit de cinquante ans de recherche et de combat en faveur de celui que la France moderne a si mal traité. Comment passe-t-on d’une telle gloire à une telle indifférence? En 1903, le photographe Steichen (notre photo) croyait pouvoir résumer la sculpture française du moment en immortalisant Rodin et Bartholomé, le Puget et le Canova du mouvement moderne. Un siècle plus tard, que reste-il du « seul et véritable rival de Rodin », selon la juste formule de Jacques de Caso, préfacier de cet ouvrage à contre-courant ? Bartholomé attendait son sursaut, le voici. Nous nous étions habitués à le réduire au portrait de sa première épouse, au Monument aux morts du Père-Lachaise et à l’amitié de Degas, lien dont les mauvaises langues nous avaient presque persuadé qu’il était de vassalité.
Dans La Généalogie de la morale, Nietzsche avance l’hypothèse que les premiers hommes ont utilisé la souffrance, à travers les sacrifices, comme levier de la mémoire. Cette idée de la peur active, positive, instauratrice, et ancrée de toute éternité en nous, a beaucoup retenu le Breton de L’Art magique (1957). Nos morts, à l’ère moderne, jouent peut-être un rôle semblable aux meurtres ritualisés d’hier… Qu’aurait été ainsi la carrière d’Albert Bartholomé (1848-1928), le superbe sculpteur que l’on sait, si le deuil, deuils intimes et deuils collectifs, n’avait pas entraîné l’artiste hors de sa sagesse initiale, et hors de la peinture, où il manque de flamme, pour les trois dimensions et l’espace réel ? C’est la question que l’on se pose en lisant l’ouvrage très complet et chaleureux que lui consacre Thérèse Burollet, fruit de cinquante ans de recherche et de combat en faveur de celui que la France moderne a si mal traité. Comment passe-t-on d’une telle gloire à une telle indifférence? En 1903, le photographe Steichen (notre photo) croyait pouvoir résumer la sculpture française du moment en immortalisant Rodin et Bartholomé, le Puget et le Canova du mouvement moderne. Un siècle plus tard, que reste-il du « seul et véritable rival de Rodin », selon la juste formule de Jacques de Caso, préfacier de cet ouvrage à contre-courant ? Bartholomé attendait son sursaut, le voici. Nous nous étions habitués à le réduire au portrait de sa première épouse, au Monument aux morts du Père-Lachaise et à l’amitié de Degas, lien dont les mauvaises langues nous avaient presque persuadé qu’il était de vassalité.
 De belle façon, Thérèse Burollet fait donc œuvre utile. Elle commence par nous rappeler que, fils de rentier et orphelin précoce de père, Bartholomé entreprend de devenir peintre en Suisse, où la guerre de 1870 devait l’expédier. Au mépris de son statut de chef de famille, qui l’exemptait, il s’était engagé comme volontaire. Bartholomé, 22 ans, se trouva ainsi mêlé au destin malheureux de l’armée de l’Est, l’armée de Bourbaki, supposée contenir l’avancée prussienne en Alsace. Il vécut surtout l’espèce de « retraite de Russie » qui le conduisit à Genève. Là l’attendent un maître, Barthélémy Menn, et un beau mariage, avec Prospérie de Fleury, en février 1874. Le couple se transporte à Paris, où Bartholomé devient un des éphémères élèves de Gérôme. La vague du naturalisme, portée par Jules Breton et Bastien-Lepage, le secoue dès 1879. Huysmans remarque aussitôt cet « artiste franc », ce « peintre énergique, épris de la réalité et la reproduisant avec un accent très particulier ». Il attire aussi l’attention de Degas, qui derechef l’intègre à son cercle, Bracquemond, De Nittis, Zandomeneghi, Berthe Morisot. Du coup, sa peinture se réchauffe, sans faire fondre une certaine retenue. En 1882, son portrait de Prospérie (notre photo), revêtue d’une « robe à la polonaise blanche et noire, sur une jupe plissée violette », la montre dans le contre-jour d’une serre aussi chic que la jeune fleur, mais promise à se faner sous peu. On pense au Balcon de Manet et à sa propre Serre, sans la morsure du génie, typique du beau-frère de Morisot. Cinq ans plus tard, la tuberculose finit de consumer la jeune femme. Son mari est brisé. Mais le travail du deuil fera naître un sculpteur.
De belle façon, Thérèse Burollet fait donc œuvre utile. Elle commence par nous rappeler que, fils de rentier et orphelin précoce de père, Bartholomé entreprend de devenir peintre en Suisse, où la guerre de 1870 devait l’expédier. Au mépris de son statut de chef de famille, qui l’exemptait, il s’était engagé comme volontaire. Bartholomé, 22 ans, se trouva ainsi mêlé au destin malheureux de l’armée de l’Est, l’armée de Bourbaki, supposée contenir l’avancée prussienne en Alsace. Il vécut surtout l’espèce de « retraite de Russie » qui le conduisit à Genève. Là l’attendent un maître, Barthélémy Menn, et un beau mariage, avec Prospérie de Fleury, en février 1874. Le couple se transporte à Paris, où Bartholomé devient un des éphémères élèves de Gérôme. La vague du naturalisme, portée par Jules Breton et Bastien-Lepage, le secoue dès 1879. Huysmans remarque aussitôt cet « artiste franc », ce « peintre énergique, épris de la réalité et la reproduisant avec un accent très particulier ». Il attire aussi l’attention de Degas, qui derechef l’intègre à son cercle, Bracquemond, De Nittis, Zandomeneghi, Berthe Morisot. Du coup, sa peinture se réchauffe, sans faire fondre une certaine retenue. En 1882, son portrait de Prospérie (notre photo), revêtue d’une « robe à la polonaise blanche et noire, sur une jupe plissée violette », la montre dans le contre-jour d’une serre aussi chic que la jeune fleur, mais promise à se faner sous peu. On pense au Balcon de Manet et à sa propre Serre, sans la morsure du génie, typique du beau-frère de Morisot. Cinq ans plus tard, la tuberculose finit de consumer la jeune femme. Son mari est brisé. Mais le travail du deuil fera naître un sculpteur.
 Pour l’arracher à son désespoir, et peut-être le détourner du suicide, ajoute Jacques-Émile Blanche, Degas lui suggère de sculpter le monument funéraire de son épouse, lui qui n’a jamais usé d’autre chose que de pinceaux… Saisissant monument, presque italien dans son vérisme pathétique. Bartholomé s’y représente, le front posé sur celui de la défunte, une main appuyée sur le corps amaigri, comme s’il cherchait à recueillir et conserver son dernier souffle. Deux photos, peu connues, de Degas montrent que Bartholomé s’en est aidé pour parvenir à se voir regardant Prospérie. la mise en abîme est passée par la chambre noire. Un grand Christ, expirant sur la croix, manière d’autoportrait, surplombait la scène terrible, en costumes modernes. Le souvenir de Préault et celui de l’Henri II de Germain Pillon y sont indiscernables. Dans la solitude de l’atelier, sous l’œil presque ému de Degas, c’est une sorte de miracle qui s’est produit. La suite, on la connaît mieux. Car il s’agit du gigantesque Monument aux morts du Père-Lachaise qu’il ébauche hors de toute commande. En est-il besoin, du reste, quand, à la manière des Contemplations d’Hugo, Bartholomé entend tutoyer l’au-delà, accueillir les morts inconnus et répandre sur eux la lumière que l’Église réserve aux seuls baptisés ? Si le dispositif d’ensemble renvoie aux schémas égyptiens de Canova, l’idée échappe à tout pastiche. Deux figures, un homme et une femme aux formes pleines, mais vues de dos, se dirigent vers une porte qui n’a rien de sépulcral. Soutenu par Peladan, au nom du « symbolisme chrétien », et Verhaeren, au nom de sa belle simplicité, Bartholomé finit pas obtenir commande du monument, et la Légion d’honneur en sus. Son ami Mallarmé l’en félicite. Il est vrai que le symbolisme de l’œuvre rejoint le Requiem de Fauré dans sa délicatesse d’intention et son refus du morbide.
Pour l’arracher à son désespoir, et peut-être le détourner du suicide, ajoute Jacques-Émile Blanche, Degas lui suggère de sculpter le monument funéraire de son épouse, lui qui n’a jamais usé d’autre chose que de pinceaux… Saisissant monument, presque italien dans son vérisme pathétique. Bartholomé s’y représente, le front posé sur celui de la défunte, une main appuyée sur le corps amaigri, comme s’il cherchait à recueillir et conserver son dernier souffle. Deux photos, peu connues, de Degas montrent que Bartholomé s’en est aidé pour parvenir à se voir regardant Prospérie. la mise en abîme est passée par la chambre noire. Un grand Christ, expirant sur la croix, manière d’autoportrait, surplombait la scène terrible, en costumes modernes. Le souvenir de Préault et celui de l’Henri II de Germain Pillon y sont indiscernables. Dans la solitude de l’atelier, sous l’œil presque ému de Degas, c’est une sorte de miracle qui s’est produit. La suite, on la connaît mieux. Car il s’agit du gigantesque Monument aux morts du Père-Lachaise qu’il ébauche hors de toute commande. En est-il besoin, du reste, quand, à la manière des Contemplations d’Hugo, Bartholomé entend tutoyer l’au-delà, accueillir les morts inconnus et répandre sur eux la lumière que l’Église réserve aux seuls baptisés ? Si le dispositif d’ensemble renvoie aux schémas égyptiens de Canova, l’idée échappe à tout pastiche. Deux figures, un homme et une femme aux formes pleines, mais vues de dos, se dirigent vers une porte qui n’a rien de sépulcral. Soutenu par Peladan, au nom du « symbolisme chrétien », et Verhaeren, au nom de sa belle simplicité, Bartholomé finit pas obtenir commande du monument, et la Légion d’honneur en sus. Son ami Mallarmé l’en félicite. Il est vrai que le symbolisme de l’œuvre rejoint le Requiem de Fauré dans sa délicatesse d’intention et son refus du morbide.
 Les demandes vont dès lors pleuvoir, et pousser le sculpteur aux limites de l’allégorie, ce privilège piégé de la statuomanie du XIXe siècle. Il conçoit notamment le Monument Jean-Jacques Rousseau (1909-10), pour le Panthéon, où la Gloire et la Musique rivalisent de grâce vraie. Vérité oblige, il recourt à Houdon pour ressusciter le philosophe. Durant la guerre de 14, après surtout, c’est le plein emploi. Très patriote, Bartholomé ne s’en cache pas. Il dessine la Croix de guerre, organise la fraternité artistique et parvient à y faire participer Rodin, qui offre un exemplaire de sa Défense… Lui, entre autres, cède généreusement une Tête de son Christ… Les morts en avalanche de la guerre le requièrent, évidemment. Thérèse Burollet analyse chaque réalisation de la mémoire blessée, de cette philosophie consolante en acte. On retiendra surtout deux chefs-d’œuvre, le gisant du baron Jacques Benoist de Laumont et le buste de l’aviateur Gabriel Guérin, le premier dort dans l’éternité, l’autre fend l’air, à jamais. Leur jeunesse semble indestructible. Le marbre guerrier de Paris 1914-1918, longtemps visible place du Carrousel, plaît moins aujourd’hui, après avoir intrigué les surréalistes et irrité les Allemands sous l’Occupation. Lamentable incurie, il achève son agonie au Dépôt de Vincennes ! Nous rappeler tout cela suffirait à justifier amplement ce livre dont la richesse iconographique force aussi l’admiration. Mais on y découvre aussi un autre Bartholomé, plus que sensible aux femmes et musardant à loisir sur les terres de notre XVIIIe siècle. Voilà un homme qui, note Degas, a « le diable dans le cœur », donne à ses Vénus pudiques la chevelure qui les déshabille et sait attendrir la pierre jusqu’à la bonne température du bain, où il plonge son Éros radieux. Stéphane Guégan
Les demandes vont dès lors pleuvoir, et pousser le sculpteur aux limites de l’allégorie, ce privilège piégé de la statuomanie du XIXe siècle. Il conçoit notamment le Monument Jean-Jacques Rousseau (1909-10), pour le Panthéon, où la Gloire et la Musique rivalisent de grâce vraie. Vérité oblige, il recourt à Houdon pour ressusciter le philosophe. Durant la guerre de 14, après surtout, c’est le plein emploi. Très patriote, Bartholomé ne s’en cache pas. Il dessine la Croix de guerre, organise la fraternité artistique et parvient à y faire participer Rodin, qui offre un exemplaire de sa Défense… Lui, entre autres, cède généreusement une Tête de son Christ… Les morts en avalanche de la guerre le requièrent, évidemment. Thérèse Burollet analyse chaque réalisation de la mémoire blessée, de cette philosophie consolante en acte. On retiendra surtout deux chefs-d’œuvre, le gisant du baron Jacques Benoist de Laumont et le buste de l’aviateur Gabriel Guérin, le premier dort dans l’éternité, l’autre fend l’air, à jamais. Leur jeunesse semble indestructible. Le marbre guerrier de Paris 1914-1918, longtemps visible place du Carrousel, plaît moins aujourd’hui, après avoir intrigué les surréalistes et irrité les Allemands sous l’Occupation. Lamentable incurie, il achève son agonie au Dépôt de Vincennes ! Nous rappeler tout cela suffirait à justifier amplement ce livre dont la richesse iconographique force aussi l’admiration. Mais on y découvre aussi un autre Bartholomé, plus que sensible aux femmes et musardant à loisir sur les terres de notre XVIIIe siècle. Voilà un homme qui, note Degas, a « le diable dans le cœur », donne à ses Vénus pudiques la chevelure qui les déshabille et sait attendrir la pierre jusqu’à la bonne température du bain, où il plonge son Éros radieux. Stéphane Guégan
Thérèse Burollet, Albert Bartholomé, Arthena, avec le concours du CNL, 110€.
Et aussi…
 A ceux qui n’auraient pas encore compris la portée fondatrice, l’impact national et européen de la guerre de 1870 et de la Commune (en sa dimension patriotique), la remarquable exposition du Musée de l’Armée apporte toute l’information souhaitable dans une mise en scène nerveuse, riche en effets de miroir. Documents et œuvres d’art, de Manet à Menzel, de Meissonier à Gustave Doré, tissent un double récit, celui des faits et celui de la mémoire, et nous obligent à toujours tenir compte du double regard, celui des Français et celui des Prussiens, que les opposants à Napoléon III eurent le tort de croire plus « progressistes et pacifistes » que les Autrichiens ! Quant à ceux qui estiment connaître le sujet, je leur promets quelques surprises de taille. Preuve est faite que le débat sur l’enseignement de notre histoire, socle indispensable d’une République soucieuse de sa pérennité, doit se doubler d’une approche ouverte sur le reste du monde. SG// France-Allemagne (s) 1870-1871. La guerre, la Commune, les Mémoires, Musée de l’Armée / Invalides, jusqu’au 30 juillet 2017. Catalogue sous la direction de David Guillet et alii, Gallimard/Musée de l’Armée, 35 €.
A ceux qui n’auraient pas encore compris la portée fondatrice, l’impact national et européen de la guerre de 1870 et de la Commune (en sa dimension patriotique), la remarquable exposition du Musée de l’Armée apporte toute l’information souhaitable dans une mise en scène nerveuse, riche en effets de miroir. Documents et œuvres d’art, de Manet à Menzel, de Meissonier à Gustave Doré, tissent un double récit, celui des faits et celui de la mémoire, et nous obligent à toujours tenir compte du double regard, celui des Français et celui des Prussiens, que les opposants à Napoléon III eurent le tort de croire plus « progressistes et pacifistes » que les Autrichiens ! Quant à ceux qui estiment connaître le sujet, je leur promets quelques surprises de taille. Preuve est faite que le débat sur l’enseignement de notre histoire, socle indispensable d’une République soucieuse de sa pérennité, doit se doubler d’une approche ouverte sur le reste du monde. SG// France-Allemagne (s) 1870-1871. La guerre, la Commune, les Mémoires, Musée de l’Armée / Invalides, jusqu’au 30 juillet 2017. Catalogue sous la direction de David Guillet et alii, Gallimard/Musée de l’Armée, 35 €.
 Livre après livre, Claire Maingon peaufine le sujet qu’elle affectionne entre tous, l’art en guerre, et notamment la guerre de 14 et ses retombées. Après son analyse du Salon des années 1914-1925, après L’Art face à la guerre (Presses universitaires de Vincennes, 2015), où elle observait le destin de la peinture histoire, depuis qu’elle a cessé de glorifier son sujet ou de pouvoir le saisir, elle signe l’indispensable Musée invisible. Le Louvre et la grand guerre (1914-1921) (Louvre éditeurs / PURH, 19€). On se souvient de l’évacuation du Louvre avant septembre 39. Mais se souvient-on que le grand musée, symbole de la Nation s’il en fut, se vida partiellement en 1870 et en 1914, alors que la capitale entrait dans le champ des canons allemands ? André Michel, conservateur des sculptures, et aficionado de Bartholomé, seconde alors de ses articles fervents ce déménagement symbolique. L’est tout autant la réouverture du Louvre, par étapes, de 1919 à 1921. Succédant au trauma des destructions, réelles et possibles, cette nouvelle naissance hisse les couleurs victorieuses d’un accrochage repensé de la peinture française. Le « génie national », expression qui n’inquiétait pas encore, avait pour noms Fouquet, Poussin, les Le Nain, Ingres, Delacroix (achat du Sardanapale), Manet, Courbet et Degas (ces deux derniers, en gloire, malgré l’envoi provisoire du second au Luxembourg). Camille Mauclair, en 1930, sous le choc du « nouveau Louvre » pourra écrire : « Manet nous a aidés à comprendre Ingres. » SG
Livre après livre, Claire Maingon peaufine le sujet qu’elle affectionne entre tous, l’art en guerre, et notamment la guerre de 14 et ses retombées. Après son analyse du Salon des années 1914-1925, après L’Art face à la guerre (Presses universitaires de Vincennes, 2015), où elle observait le destin de la peinture histoire, depuis qu’elle a cessé de glorifier son sujet ou de pouvoir le saisir, elle signe l’indispensable Musée invisible. Le Louvre et la grand guerre (1914-1921) (Louvre éditeurs / PURH, 19€). On se souvient de l’évacuation du Louvre avant septembre 39. Mais se souvient-on que le grand musée, symbole de la Nation s’il en fut, se vida partiellement en 1870 et en 1914, alors que la capitale entrait dans le champ des canons allemands ? André Michel, conservateur des sculptures, et aficionado de Bartholomé, seconde alors de ses articles fervents ce déménagement symbolique. L’est tout autant la réouverture du Louvre, par étapes, de 1919 à 1921. Succédant au trauma des destructions, réelles et possibles, cette nouvelle naissance hisse les couleurs victorieuses d’un accrochage repensé de la peinture française. Le « génie national », expression qui n’inquiétait pas encore, avait pour noms Fouquet, Poussin, les Le Nain, Ingres, Delacroix (achat du Sardanapale), Manet, Courbet et Degas (ces deux derniers, en gloire, malgré l’envoi provisoire du second au Luxembourg). Camille Mauclair, en 1930, sous le choc du « nouveau Louvre » pourra écrire : « Manet nous a aidés à comprendre Ingres. » SG
 Il y a 80 ans, tout juste, disparaissait Élie Faure, cher aux éditions Bartillat, modèle des Voix du silence de Malraux et grande lecture de Céline ! A lire le catalogue qui accompagnait le récent hommage de la Mairie du VIe arrondissement, on reprend conscience qu’il posa aussi pour Van Dongen, en 1912, et Picasso, en pleine époque ingresque. D’une modernité, l’autre. L’étendue de ses goûts, sa curiosité exotique, souffle sur la collection d’un historien de l’art sans frontière, voyageur intrépide, dont ce livre, emporté par la verve et le savoir de Juliette Hoffenberg, dévoile maintes facettes ignorées. Refusant de rejoindre le parti des embusqués en 14, il aura, plus tard, cette phrase immortelle : « La laideur des monuments aux morts serait à nous dégoûter de la guerre. » A l’évidence, il ne pensait pas à Bartholomé. SG // Juliette Hoffenberg, Élie Faure. Une collection particulière, Somogy, 12 €).
Il y a 80 ans, tout juste, disparaissait Élie Faure, cher aux éditions Bartillat, modèle des Voix du silence de Malraux et grande lecture de Céline ! A lire le catalogue qui accompagnait le récent hommage de la Mairie du VIe arrondissement, on reprend conscience qu’il posa aussi pour Van Dongen, en 1912, et Picasso, en pleine époque ingresque. D’une modernité, l’autre. L’étendue de ses goûts, sa curiosité exotique, souffle sur la collection d’un historien de l’art sans frontière, voyageur intrépide, dont ce livre, emporté par la verve et le savoir de Juliette Hoffenberg, dévoile maintes facettes ignorées. Refusant de rejoindre le parti des embusqués en 14, il aura, plus tard, cette phrase immortelle : « La laideur des monuments aux morts serait à nous dégoûter de la guerre. » A l’évidence, il ne pensait pas à Bartholomé. SG // Juliette Hoffenberg, Élie Faure. Une collection particulière, Somogy, 12 €).
Des nouvelles du front
 Colloque international // Breton après Breton (1966-2016). Philosophies du surréalisme, 26 et 27 avril 2017 (INHA / BNF, site Mitterrand)
Colloque international // Breton après Breton (1966-2016). Philosophies du surréalisme, 26 et 27 avril 2017 (INHA / BNF, site Mitterrand)
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/auditoriums/f.coll_breton.html?seance=1223926781448
 Stéphane Guégan, Faut-il brûler Céline ?, Revue des deux mondes, mai 2017.
Stéphane Guégan, Faut-il brûler Céline ?, Revue des deux mondes, mai 2017.

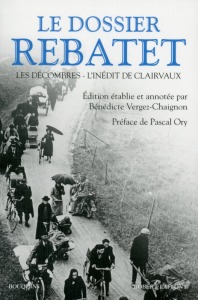
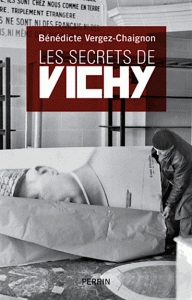

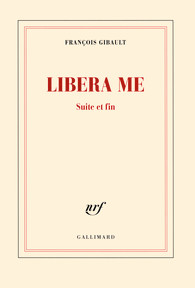
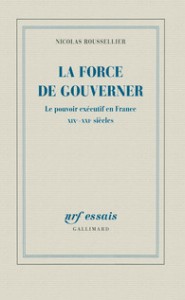

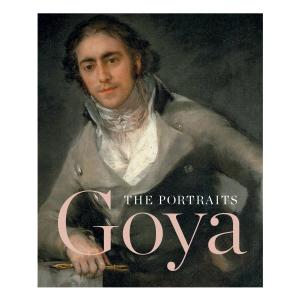




 Certains noms contiennent tout un destin. Carrier-Belleuse, qui enchanta le
Certains noms contiennent tout un destin. Carrier-Belleuse, qui enchanta le  Au Salon de 1865, celui d’Olympia, ses bustes de l’empereur et de Delacroix furent très remarqués. Le grand peintre était mort depuis deux ans plus et, tels
Au Salon de 1865, celui d’Olympia, ses bustes de l’empereur et de Delacroix furent très remarqués. Le grand peintre était mort depuis deux ans plus et, tels  – Dominique Viéville, Rodin. Les métaphores du génie 1900-1917, Musée Rodin / Flammarion, 35€. L’ancien directeur du musée Rodin (2005-2012) se penche sur l’ultime phase créatrice de l’artiste, qu’ouvrent l’affaire Dreyfus (dont il n’est pas un partisan) et le pavillon de l’Alma, rétrospective de l’œuvre en marge de l’Exposition Universelle. La période se referme avec la guerre, les cathédrales mutilées et une poussée d’anti-germanisme sans précédent. Devenu un homme public, auquel l’Académie fait les yeux doux, Rodin se voit en
– Dominique Viéville, Rodin. Les métaphores du génie 1900-1917, Musée Rodin / Flammarion, 35€. L’ancien directeur du musée Rodin (2005-2012) se penche sur l’ultime phase créatrice de l’artiste, qu’ouvrent l’affaire Dreyfus (dont il n’est pas un partisan) et le pavillon de l’Alma, rétrospective de l’œuvre en marge de l’Exposition Universelle. La période se referme avec la guerre, les cathédrales mutilées et une poussée d’anti-germanisme sans précédent. Devenu un homme public, auquel l’Académie fait les yeux doux, Rodin se voit en 

