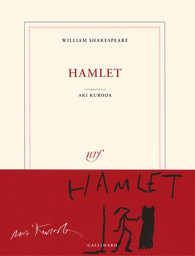L’émotion qu’a soulevée l’incendie de Notre-Dame de Paris ne pouvait être qu’impure. Elle le fut. Devant les flammes, inséparables pourtant de l’Enfer, peu se sentirent saisis du message qu’elles adressaient à la part chrétienne, subsistante, mais diminuante, de notre identité européenne. On pleura un joyau médiéval, un vestige du vieux Paris, voire un haut lieu du bas tourisme, quand il eût fallu prendre appui sur le désastre pour en relever la vraie signification. Discours, polémiques et arguties ne quittèrent pas le champ des responsabilités et des choix de restauration. Il est vrai que le feu, emportant charpentes, toitures et une partie de la voûte, a épargné ou presque les œuvres qu’elles abritaient. C’eût pu être pire… On pense aux rosaces et à la sublime Pietà de Coustou que les photographies, dès le lendemain du drame, ont montrées en léger retrait des débris qui les auraient, autrement, foudroyées (ill. 1). Les Mays du XVIIe siècle, ces immenses tableaux peints en hommage à la Vierge, « embellissaient » jadis les colonnes du vaisseau central, pour le dire comme leurs commanditaires, les riches maîtres orfèvres de la confrérie Sainte-Anne-et-Saint-Marcel. Depuis la Révolution, qui ne les ménagea guère, leur sort est resté problématique, leur déplacement constant. Ceux qui retrouvèrent le chemin de la cathédrale aux XIXe et XXe siècles ont rejoint les chapelles latérales où ils étaient peu visibles. On peut aujourd’hui s’en féliciter. Mais ce que le feu n’a pas détruit devrait davantage aujourd’hui nous préoccuper. L’heure n’est-elle pas venue de statuer convenablement sur ce qui subsiste, série unique, des 76 tableaux qui furent exécutés entre 1630 et 1707, et que les amateurs du siècle suivant regardaient comme formant le premier musée de l’école française ? En tête du formidable livre que Delphine Bastet leur a consacré, Pierre Rosenberg forme le vœu qu’on agisse enfin et que, pour une fois, on agisse vite : « Notre-Dame est sauvée, sauvons les Mays », écrit-il en suggérant qu’on les réunisse à nouveau et qu’on les expose, en bonne lumière, dans un « grand musée de l’œuvre Notre-Dame ».

Dans la mesure où il est impensable qu’ils retrouvent leur place originelle, le regroupement s’impose, d’autant plus qu’une vingtaine d’entre eux manquent à l’appel et qu’un bon nombre, roulés dans les réserves du Louvre et du musée d’Arras, ne sont pas en état d’être ramenés à la vue du public, on n’ose dire des fidèles que le tout-gothique seul semble émouvoir. Or, si hétérogènes de qualité soient-ils, c’est la vision d’ensemble qu’ils offrent qui importe. Il ne faut surtout pas renouveler le geste des révolutionnaires qui retinrent ce qu’ils tenaient pour les chefs-d’œuvre du groupe, les toiles de Le Sueur et Le Brun notamment, et reléguèrent ou vendirent le reste. Une toile, non des moindres, bien qu’elle dérive d’Annibal Carrache, le Jésus et la Samaritaine de Louis Boullogne le jeune, n’a rien moins qu’atterri en pleine campagne anglaise ! D’autres, par on ne sait quels détours, pendent aux murs d’églises modestes, loin de Paris. Dispersion et dépréciation ont rompu la chaîne. Elle avait pourtant fière allure, se dira tout lecteur de la somme de Delphine Bastet qui fait souffler sur le corpus qu’elle a doctement reconstitué les vents de la spiritualité tridentine, de la rhétorique picturale et de la politique pré ou post-gallicane. Préférant parfois donner leur chance à de jeunes peintres par économie, les orfèvres ont contribué à les lancer, ils ont aussi fait résonner, durant plus de soixante-dix ans, toutes les nouveautés, notamment le souffle romain de Simon Vouet, dont l’absence étonne, ou le style plus viril du jeune Le Brun, porté qu’il était par le mécénat du chancelier Séguier et les discussions théologiques qui prospéraient dans ce cercle, autour du degré de réalisme, entre autres exemples, qu’il était licite d’observer par respect du verbe incarné et souci d’efficience. Dès le second May de Laurent La Hyre, le choc visuel prévaut. Pour un Le Sueur qui peint la force des mots, ses contemporains, le siècle avançant, ne reculent devant aucune audace, aucune violence, lorsque le sujet le commande. Tirées des Actes des Apôtres, puis des Évangiles sous Louis XIV, quand l’anti-protestantisme du roi anime tout un programme christologique, les scènes à peindre, note Delphine Bastet, valorisent l’autorité, le martyre, le sacrifice, la figure paulienne (Pierre, c’est Rome), l’héritage de l’église primitive dans le catholicisme français et, contre le jansénisme cette fois, la vérité de l’eucharistie et des sacrements.

L’«injonction faite à l’homme de participer à son Salut », excellent principe, s’observe partout, et elle n’est jamais plus nette qu’à travers l’explication et le sonnet qui, chaque année, accompagnaient la présentation d’un nouveau tableau. Il en va ainsi, en 1678, du May de Bon Boullogne, Le Christ guérissant le paralytique au bord de la piscine, dont le sous-texte tranche sur le mode de l’impératif : « La confiance du paralytique doit animer, pêcheur, ta foi ; / Espère ; ton salut ne dépend que de toi, / Et si tu veux guérir, la Grâce est toujours preste. » Nous ne pouvons donner plus qu’un faible aperçu de l’information et des analyses dont Delphine Bastet gratifie son lecteur. Elle s’intéresse aussi à la postérité de ces toiles redevenues visibles, en grand nombre, entre 1802 et 1862. C’est le cas de La Vision de saint Étienne avant la lapidation de Houasse dont Schnetz et Ingres n’ont pas oublié la figure du martyre, marche contrariée et bras ouverts embrassant déjà le ciel… Pour ma part, je verrais volontiers un lien de filiation entre La Décollation de saint Paul à Rome de Louis Boullogne le père, gravé vers 1750, et L’Exécution sans jugement chez les rois maures de Henri Regnault (1870, Orsay, ill. 3). Le tableau de 1657 fait partie des six Mays que Nicolas Milovanovic reproduit et commente dans son Catalogue des peintures françaises du XVIIe siècle du musée du Louvre, dont la plupart des notices apportent leur lot d’informations et de suggestions précieuses, voire de réattribution plausible. Une seule toile en provenance de Notre-Dame garnit les vastes salles du deuxième étage depuis leur ouverture en 1993, La Prédication de saint Paul à Ephèse dont nous avons déjà parlé. Les autres sont roulées et appellent des restaurations profondes. Pierre Rosenberg a bien raison de s’inquiéter de leur avenir. On aimerait voir bientôt entre des mains réparatrices la lugubre Décollation de saint Jean Baptiste de Claude II Audran, dont le climat carcéral n’est pas sans faire penser au chef-d’œuvre du Caravage peint pour la cathédrale Saint Jean de La Valette. Le musée du Louvre, en plus de deux cents ans, s’est progressivement ouvert à d’autres peintres du Grand Siècle que le club des cinq déjà fêté par le musée révolutionnaire, Poussin, Le Sueur, Champaigne, Le Brun et Claude Gellée…

En introduction, Milovanovic éclaire le destin de ces plus de cinq cents tableaux, leur accrochage ayant aussi varié que leur place dans le cœur des conservateurs et des directeurs du Louvre. On rappellera ici que Pierre Rosenberg a magistralement catalogué les 40 Poussin du Louvre, dont le sensuel Mars et Vénus Mazarin qu’il a réhabilité. Tous les régimes politiques de la France postrévolutionnaire ont tenu à exalter la richesse et l’excellence du « siècle de Louis XIV », et la IIe République, centralisatrice et patriote, plus que tout autre. Villot, l’ami de Delacroix, et Jeanron, peintre réaliste, sont aux commandes, comme on dit, ils poussent alors Le Brun, Jouvenet et Valentin parmi les dieux de la peinture du Salon carré, vraie tribune de la peinture européenne où Vinci, Raphaël et Véronèse ont leur fauteuil, en plus de Poussin, Le Sueur, Lorrain et du Christ mort de Champaigne comme du Bossuet de Rigaud (préféré à Louis XIV, évidemment). Étrangement, les grands chefs-d’œuvre de Louis le Nain sont acquis plus tard, Le Repas de paysans entre sous Napoléon III, Famille de paysans (le sommet de l’œuvre) en 1915 et La Tabagie, quoique plébiscité par Paul de Saint-Victor en 1850 et par Champfleury en 1860, en 1969. À cette époque, Michel Laclotte, disparu cet été, dirige le département des peintures et vient d’inaugurer un nouvel accrochage, aux antipodes de celui de Germain Bazin, dont Milovanovic nous apprend qu’il s’était attiré les foudres de L’Humanité en 1953. La réaction très violente des communistes devant la moindre visibilité des peintres du Grand siècle reconduisait, de fait, la philosophie du Louvre de 1848. Sachant dominer son amour de la peinture italienne, Laclotte mit en œuvre un vaste redéploiement de l’école française, prélude au bouleversement du Grand Louvre en 1993. Les espaces d’accrochage, dilatés et remodelés, furent soudain compatibles avec la grandeur, comme Baudelaire le disait de Le Brun, que cette peinture mettait surtout dans tous les esprits. On vit revenir les immenses cartons de tapisserie de Le Sueur et de Champaigne, Les Batailles d’Alexandre redéroulèrent leur fièvre épique et les Jouvenet purent s’étirer à volonté… En dehors du Saint Paul de Le Sueur, décidément iconique, les Mays ne participèrent pas à cette fête nationale. Leur résurrection n’avait pas sonné alors que la présentation du musée d’Arras montrait ses limites… Notre-Dame est sauvée, sauvons les Mays. La France actuelle a plus que besoin de ces signes-là. Stéphane Guégan
*Delphine Bastet, Les Mays de Notre-Dame de Paris, avant-propos de Pierre Rosenberg, de l’Académie française, et préface de Stéphane Loire, Arthena, 125€ // Nicolas Milovanovic, Peintures françaises du XVIIe siècle du Musée du Louvre, Gallimard / Musée du Louvre, 65 €.
Peinture (dite) ancienne, toujours !

« Un livre toujours à lire ou à relire », disait Philippe Lançon du Vermeer de Daniel Arasse en 2017. C’est, sans doute, en effet, son meilleur ouvrage, moins célèbre que Le Détail et On n’y voit rien, mais de méthode plus serrée et de portée plus large. La raison en est, d’abord, l’esthétique propre au XVIIe siècle néerlandais dont le réalisme semble légitimer la sociologie banale ou le formalisme aveugle. Après avoir cité les célèbres et beaux articles de Jean-Louis Vaudoyer qui émurent tant Marcel Proust en mai 1921, mais dont le lyrisme ignore l’importance du sujet chez ce peintre dont l’univers domestique lui semblait dénué d’au-delà symbolique, politique, religieux et théorique, Arasse annonce son propos, qui est contraire en tout à la vision fin-de-siècle de son prédécesseur. Plus encore que l’iconographie de Vermeer, commune à la plupart de ses contemporains, il vise « l’ambition » du peintre, sa façon d’être singulier à l’intérieur d’une culture visuelle qui le déborde et qu’il détourne. D’étranger à toute glose, le « mystère de Vermeer », – ce sphinx, disait déjà Théophile Thoré en 1866 -, regagne le cœur de l’analyse, à partir des conditions historiques de sa possibilité même. Le chapitre qu’il consacre à L’Art de la peinture, l’un des plus grands formats de l’artiste, constitue le moment le plus décisif du livre. Elle n’a cure évidemment des oppositions scolaires entre les pôles Nord et Sud de la peinture moderne : Vermeer, pour Arasse, n’identifie pas moins sa pratique à la « cosa mentale » qu’un Léonard. Ce que son réalisme a de construit, de fictif, de latent, L’Art de la peinture le proclame avec une pointe d’humour. On y voit une jeune femme déguisée en Clio dont la tête ornée se perd dans une immense carte des Pays-Bas ; un peintre de dos y ébauche la tête de la Muse dans un style du tableau qui les englobe. Familier du tableau dans le tableau, Vermeer réitère le geste en s’incorporant à la scène par l’artiste qu’il y montre aussi solidement assis qu’actif. Or, L’Histoire que figure Clio et la cartographie sont des sciences connexes : les apparenter à la peinture elle-même équivaut à rattacher celle-ci au domaine de « la connaissance démontrée ». Cette peinture pourtant ne conduit pas à l’idée en toute transparence ; au contraire, comme Manet plus tard, Vermeer voile le contenu de ses toiles sous l’effet d’une présence vivante, qui semble à première vue sans arrière-plan d’aucune sorte. Citant Vasari, qui prêtait à Léonard l’art de balancer entre « le vu et le non-vu », Arasse en réattribue la stratégie à son héritier de Delft. Cette capacité de l’image à faire sourdre une signification en partie occultée (et non occulte) pousse finalement l’auteur à examiner ce qu’elle doit au catholicisme de ce papiste de Vermeer. Poétique et religion sont inséparables. SG / Daniel Arasse, L’Ambition de Vermeer, Flammarion, Champs, 12€.

De tous les martyrs hérités de l’agonie de l’Empire romain, il est le plus représenté et peut-être le plus cher aux peintres, l’Italie de la Renaissance voyant en lui, tout à la fois, le signe électif d’une reconquête de l’idéal grec et le dualisme même de la vision chrétienne de l’homme. Saint Sébastien et son ambivalence principielle ne pouvaient espérer meilleur exégète que Patrick Wald Lasowski, cet éminent expert de la littérature et de l’imagerie libertines connaît aussi bien les cheminements du désir que leurs accointances avec la spiritualité la plus efficace, voire la plus haute. Ce petit livre, aussi érudit et bien écrit que du Marcel Schwob, nous procure un ravissement assez similaire à celui que les représentations de Sébastien étaient censées éveiller ou réveiller chez le fidèle. Cet enfant de Narbonne, centurion à Milan et favori de Dioclétien, meurt dans les plus atroces douleurs, par ordre de son ancien protecteur, après avoir subi l’outrage des flèches et été soigné par Irène (inoubliables tableaux de La Tour et de Delacroix). La littérature de l’Église apparente ces flèches aux traits de la parole qui convertit. Du reste, l’imagerie immense de Sébastien, plus ou moins habile à dire la douleur qui ne doit plaire qu’à Dieu, a vocation à nous fait sentir qu’il mourut par là où il avait fauté, en criblant l’antichristianisme d’Etat de sa fureur. Si la souffrance du preux ne vise que le Ciel, sa beauté remue les Eros d’en-bas. Où débute, se demandera-t-on avec Patrick Wald Lasowski, l’affranchissement homosexuel du personnage issu de la Légende dorée ? Sodoma, auquel le jeune Tennessee Williams consacra un poème en 1948, n’est sans doute pas le premier peintre à libérer quelque chose de lui dans l’icône du sacrifice. Wackenroder, en 1797, théorise en poète romantique la confusion des affects profane et sacré à l’intérieur de « l’expression flottante du désir ». Robert de Montesquiou éprouve une égale exaltation à la vue des tableaux et à la lecture de D’Annunzio. Puis, d’Alfred Courmes à Jean-Paul Gaultier (auquel la Cinémathèque dédie une exposition), maints artistes, plus proches de nous, lui ont déclaré leur flamme. Merci, une fois de plus, à Patrick Wald Lasowski d’avoir donné d’autres ailes à la milice du Ciel et à l’explication des images. SG / Patrick Wald Lasowski, Saint Sébastien martyr, suivi de Des roses sous la Terreur, Stilus, 13€.
En librairie, mercredi 13 octobre 2021…
Stéphane Guégan, Caillebotte. Peintre des extrêmes, Hazan, 99€.
Europe 1, Historiquement vôtre / Lundi 11 octobre 2021, 16h00.
Édouard Manet, Léon, Berthe Morisot, Le Balcon (et donc Caillebotte) : Stéphane Bern, Matthieu Noël et Stéphane Guégan
https://www.europe1.fr/emissions/lequipee-sauvage/ils-sont-sacrement-secrets-4070967.