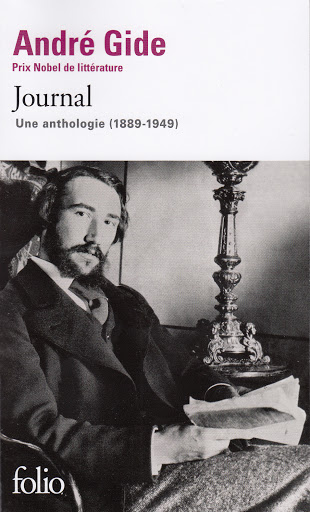Cher Jean Clair, Je viens de relire votre grand pamphlet de 2003, Du surréalisme considéré dans ses rapports au totalitarisme et aux tables tournantes, et je ne peux résister au désir de vous témoigner ma pleine reconnaissance. S’attaquer à un tel mythe de la mémoire collective, un an après l’exposition si brillante, si bienveillante aussi de Werner Spies au Centre Pompidou, il en fallait du toupet et de la constance ! De la témérité, même. Le milieu ne vous avait pas encore pardonné d’avoir remis à l’honneur Bonnard, Balthus et la Vienne 1900, d’avoir exhumé les Réalismes du XXe siècle (cette « hérésie »), et d’avoir fait de Marcel Duchamp, intouchable idole, l’héritier direct de Léonard et de Jules Laforgue plus que des iconoclastes immatures… Eh bien, vous vous êtes jeté dans l’arène comme si de rien n’était. Au moment de vous écrire, je me suis demandé qui, en dehors de vous, au début des années 2000, quand s’ouvre l’ère post-11 septembre, malmenait tant la vulgate du surréalisme et ceux qui avaient, et ont toujours, intérêt à la perpétrer, journalistes mystifiés, libertaires de salon ou universitaires en mal de frissons à bon compte. J’ai donc cherché d’autres réfractaires, aucun. D’autres insubordinations, aucune. C’est à peine si certains, moins aveugles à l’imposture stalinienne que les fidèles du culte, s’étaient permis de condamner le ralliement de nos rêveurs à la faucille et au marteau. Au fond, votre essai ne fraternise qu’avec la dissidence des premiers temps et, d’abord, avec la voix, chère entre toutes, de Brice Parain.

Celui qui fut l’un de vos mentors, et l’un de vos introducteurs à la NRF des années 1960, avait fait du chemin. Vous avez souvent dit votre dette envers ce fils de paysan, brûlé par l’expérience du front en 1916-18, et qui trouva dans la philosophie et, pensait-il, dans le communisme, une réponse au désarroi de la génération perdue. A la sienne et à la vôtre, il apportait une connaissance intime de la Russie soviétique, résultat d’un séjour officiel en 1925-26 et de sa foi en l’éveil d’« un nouvel Homme ». Parain, en effet, s’est convaincu des bienfaits du stalinisme et le clame, en novembre 1929, par l’entremise de la NRF. Alors que « l’affaire Roussakov » ébranle le mythe de l’URSS, mais laisse froid un René Crevel, lui réplique durement à ses adversaires politiques. Le rouge idéal requérait discipline et cécité volontaire, n’est-ce pas ? En 1933, la coupe déborde. Le brillant agrégé avait cru que le communisme « détruirait le mensonge », établirait « une vérité humaine ». Force fut de constater, à l’inverse, que la Terreur s’était installée en Russie. La plupart des surréalistes n’ont pas, eux, rompu si tôt, sans parler d’Aragon, prêt à toutes les apostasies. En 1936, Parain applaudit au Retour de l’U.R.S.S. de Gide, attaqué de toutes parts pour « trahison ». On peut comprendre votre attachement indéfectible à ce Parain-là, d’autant qu’il n’a pas attendu 1939 pour débusquer derrière le nazisme et son racisme « une révolution contre la raison ».

N’est-ce pas ce grief que vous étendez, en 2003, à Breton et ses séides, à leur esthétique et leur politique ? Tout votre essai, me semble-t-il, tend à démonter la phraséologie surréaliste, tenue généralement pour innocente de sa propre inconséquence, de son mysticisme vague, et ainsi à démontrer un large consentement à l’insensé, à la magie, à une vision ésotérique de l’humain et de l’art. En bref, le surréalisme, dites-vous, n’est autre que le produit d’une alliance monstrueuse entre socialisme et occultisme. Comme Raymond Queneau ou Julien Gracq en témoignent, Breton ne fut pas le dernier à régler sa vie, ses amours parfois rocambolesques et ses multiples activités, littéraires comme marchandes, en fonction des astres, des médiums ou des aveux du hasard. Il n’admettait pas plus la contradiction dans les rangs que le divorce entre l’expression artistique et le Grand Tout. Le retour à l’Unité primordiale, fût-ce au moyen du chaos politique ou de la violence aveugle, constitue l’obsession de l’œuvre et de l’homme, au point de muer son appartement en musée maniaque et en chaudron à ondes positives. Musée, ou plutôt cabinet de curiosités, dois-je dire avec vous. La forêt des signes y dévore l’ordre honni des temples du beau. A force de nier que l’œuvre d’art puisse trouver en elle-même sa fin et sa transcendance, Breton l’aura vidée de son être. Simple médiatrice de l’inconscient et de l’Esprit du monde, la représentation refuse les contradictions du réel et la dualité de l’être.
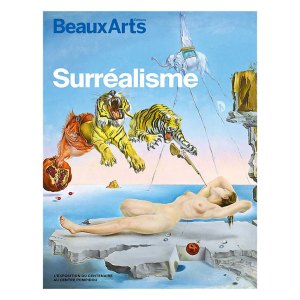
Au moins Breton n’aura-t-il pas démonétisé la figuration en art, selon l’attitude avant-gardiste la plus courante après 1920, au prétexte qu’il fallait en finir avec « la peinture littéraire » et lui préférer l’insignifiance du sujet ou l’autonomie des formes. Vous notez à plusieurs reprises les liens multiples qui rattachent les surréalistes au romantisme et au symbolisme, des petits larcins de Max Ernst aux fantasmagories érotiques de Gustave Moreau, pour ne pas parler du primitivisme de Gauguin, mieux informé, du reste, des réalités ethnographiques que les surréalistes et leur sens réducteur de l’altérité. La primauté du merveilleux n’a jamais quitté Breton, tantôt chiffonnier du marché aux puces, tantôt poète des épiphanies ordinaires. Par chance, les œuvres échappent aux théories, comme vous le rappelez aussi. S’il fallait se borner au programme surréaliste et à sa morale vacillante, nous aurions fermé la porte à ces chevaliers d’un onirisme assez daté. Même leur anti-modernité, malgré la destruction en cours du vivant, n’est plus la nôtre. Mais laissons à Brice Parain le soin de conclure puisque vous citez ce passage de son autobiographie. Après avoir lu Les Pas perdus (1924), il avait demandé audience à Breton et, poussé par sa droiture, lui avait signifié son refus de tricher avec le langage, instrument de vérité et non de révélation. « J’étais dans la direction contraire, la vie ». Belle formule balzacienne, et sur laquelle je vous quitterai, cher Jean Clair. Que Dieu nous garde des boules de cristal.
Stéphane Guégan
*Texte extrait du Hors-série Surréalisme de Beaux-Arts, septembre 2024, 13€ // Exposition Surréalisme, commissaires : Didier Ottinger et Marie Sarré, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, jusqu’au 13 janvier 2025 , catalogue 49,90€. En mars 2002, Werner Spies estimait avoir assez de recul pour évaluer à sa juste valeur, esthétique et historique, ce qu’il appelait « la révolution surréaliste », vaste secousse aux retombées multiples. La publicité et les situationnistes, en un demi-siècle, s’étaient emparé des mots d’ordre roboratifs du groupe ; et le jeu vidéo avait tourné au convulsif et au monstrueux dès avant la fin du XXe siècle. Nul n’a oublié les 600 œuvres réunies au Centre Pompidou et leur articulation au gré d’un parcours voulu avant tout thématique. On sait le double danger d’un tel choix, l’effacement du cadre de production et le nivellement des talents. Spies n’était pas homme à abolir les hiérarchies. Devant les affres du merveilleux ou les spasmes de l’actualité, il ne pensait pas que tous les pinceaux se valaient. C’eût été trahir la mémoire de son cher Max Ernst en qui les deux pôles du surréalisme, le collage et l’écriture automatique, s’étaient, selon lui, définis et accomplis. Eu égard à leur rang éminent, Chirico, Masson, Miró, Magritte et Dali avaient bénéficié d’une faveur identique. La présente exposition, au titre plus sobre, manière d’enregistrer à bas bruit l’échec révolutionnaire, a préféré élargir l’horizon et mêler aux ténors des figures souvent inconnues de la diaspora. Les thèmes chers au mouvement dictent encore la partition d’ensemble, des médiums au cosmos, des chimères aux larmes d’Eros (les surréalistes sont abonnés à la chair triste). A l’heure du désastre, bel optimisme, les commissaires restent fidèles aux deux grandes prophéties de Breton, « Changer la vie » et « Transformer le monde », sous-texte de l’enfilade de salles qui s’enroulent autour du manifeste de 24, comme autant d’effluves de la messe noire initiale. Pourquoi pas ? Le public, à présent, n’a peut-être plus besoin d’être déniaisé quant au côté farce et attrapes de l’ésotérisme surréaliste. Il accepte tout bonnement qu’un certain fantastique, une certaine extension du rationnel, disait Roger Caillois, ouvrent d’acceptables accès à la connaissance de l’humain, du sacré, du désir ou des pulsions de mort. Et puis, comme le rappelait Courbet, les œuvres seraient inutiles si elles se bornaient à remplir une feuille de route imposée. Concernant les œuvres justement, on dira d’un mot que le meilleur, voire les incunables, n’hésitent pas à voisiner ici avec de plus modestes pièces, voire de simples curiosités. Est-ce snobisme de rester froid aux alchimies de Remedios Varo et aux fantasmagories d’autres illuminés, que rassemble, par exemple, la salle de la pierre philosophale ? Il faut croire qu’il n’est pas donné à tous et toutes de la trouver. Du reste, il est mille façons de faire son chemin parmi ce dédale qui se plaît à nous charmer et nous dérouter.
Surréalisme et NRF

Puisque l’exposition du centre Pompidou s’enroule autour du Manifeste du surréalisme de 1924, et fait son profit des autres textes programmatiques de Breton au fil de son parcours, il est de bon sens, ou de bonne guerre, de retourner au « texte », à l’invitation de La Pléiade et de Philippe Forest. Aucun mouvement artistique n’aura autant claironné son avènement salutaire, et bientôt insurrectionnel, martelé sa doxa et sa morale, aucun ne se sera autant auto-épuré et bardé de messianisme, aucune église n’aura buriné, sur fond d’anticléricalisme laïcard, les tables de sa Loi. Le texte de 1924 et les suivants accumulent les paradoxes, le premier consistant à appuyer sur des cautions scientifiques (Freud, voire Taine) un flux argumentatif très brumeux. Breton pourtant n’hésite pas à allumer de vieilles lanternes, son rejet du réalisme, supposé tributaire du positivisme, rappelle les diatribes du symbolisme 1880, et le clivage entre art prosaïque et art noble, matière et pensée, vie et rêve. Cité à dessein, le nom de Paul Valéry, ennemi du roman et du naturalisme, vient garantir l’énième et trompeuse dénonciation de ceux qui se contentent de dire platement le réel au lieu d’exprimer leur psyché en toute indépendance à la mimésis occidentale, que Breton jugeait trop latine. Un Albert Aurier ou un Joséphin Péladan, en médicalisant le point de vue, n’auraient pas eu de mal à agréer le texte de 24. Il ne leur aurait pas déplu, s’ils n’étaient morts si tôt, de saluer ces cadets, un peu carabins (jusqu’à l’humour), qui s’adonnaient en complet veston aux pratiques occultes. Notons que Les Pas perdus, de Breton et de 1924 toujours, mais à l’enseigne de la NRF, rectifient la fameuse définition du surréalisme en limitant son fonctionnement à « un certain automatisme psychique ». On suivra donc les recommandations de Forest : la relecture du corpus, soit près de 30 ans de théorie rageuse, doit faire sa part aux doutes et apories de son auteur. SG // André Breton, Manifestes du surréalisme, préface de Philippe Forest, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 65€.

« La terre est bleue comme une orange / Jamais une erreur les mots ne mentent pas » : chacun connaît, par cœur, le distique célèbre de L’Amour La Poésie, que Paul Eluard fait paraître en 1929 aux Editions de la Nouvelle revue française. Le premier vers affirme les droits imprescriptibles de la subjectivité propres à toute création souveraine, le second dégage un autre parfum, celui du terrorisme avant-gardiste, qui aime à doter le langage d’une vérité inflexible, et oraculaire. C’est passer des chevaux roses de Baudelaire au Que faire ? de Lénine. Libre à Eluard, bien entendu, d’emprunter aux peintres la vieille recette des complémentaires : Delacroix, Van Gogh et Bonnard ont avant lui demandé au bleu et à l’orange de jeter sur leurs toiles l’éclat que l’on sait en s’aimantant. Le contraste qui en résulte pour l’œil et l’imagination pouvait très bien, du reste, servir le projet d’une poésie « surréaliste », faite de condensation extrême des moyens et d’ouverture du sens à leur richesse évocatoire. L’alliance du centripète et du centrifuge n’était pas neuve en 1929, on peut même y reconnaître un trait natif de la modernité française, que le gage de l’inconscient, souvent affiché par la bande de Breton, ne saurait masquer. De tous les poètes du cercle ardent, Eluard est le plus lyrique au sens presque lamartinien du terme. Dédié à Gala, L’Amour La Poésie chante moins en écrivain automatique qu’en héritier inspiré. Les douleurs capitales l’ont construit. La femme qu’on ne saurait retenir, la douleur de « survivre à l’absence », « Ton existence sans moi », la jeunesse vivifiante et irritante des nuages, la nuit protectrice et angoissante, ces thèmes sont éternels, jusqu’à un certain masochisme érotique, ici et là. Il n’y a pas à s’étonner que les anthologies de la poésie amoureuse à venir y trouveraient grain à moudre. De son côté, Pierre Emmanuel a signalé l’unanimisme, la pente d’Eluard à transformer l’amour en communion universelle, à convertir le dépit en élargissement de soi. Kiki Smith a traduit cette dynamique avec une délicatesse qui rend aussi bien justice à l’atmosphère diaprée du recueil qu’à son régime métaphorique, volontiers tourné vers l’oiseau, l’animal et l’organique quand l’ordre humain se désagrège. SG / Paul Eluard, L’Amour La Poésie, œuvres de Kiki Smith, Gallimard, 45 €.

Le désintéressement des surréalistes, nous dit la vulgate, ne saurait être remis en cause. Ce sont des purs, des dynamiteurs, en révolte contre le veau d’or et l’aliénation sociale. Aussi cette même vulgate, forte d’un consensus hallucinant, veut-elle ignorer leurs liens originels avec le marché de l’art et le mécénat, lui aussi lourd de sens, des élites parisiennes. Nos révolutionnaires, à défaut d’en venir, sont du peuple, et travaillent à son bonheur, mettez-vous ça dans la tête. Mais qu’en fut-il du milieu littéraire ? Breton et les siens ne se seraient pas abaissés, tout de même, au banal entrisme des débutants aux dents longues ? L’exposition de la Galerie Gallimard scrute, avec un luxe de documents irréfutables, la double stratégie du groupe envers la NRF et Gaston lui-même. Paul Valéry, à qui le jeune Breton fait une cour assidue et adresse ses premiers poèmes mallarméens, ne résiste pas à renforcer son ascendant sur le jeune admirateur de Marie Laurencin. Nous sommes en 1914. Très vite, Paulhan, puis Gide et Rivière, sont soumis au même numéro de charme. La campagne s’avère efficace puisque Breton accède au sommaire de la NRF dès juin 1920. L’année est déterminante, Gide et Rivière, en effet, affichent une certaine sympathie envers l’irrévérence dadaïste, n’eût-elle surtout produit, en fait de renouveau, que sa promesse. En attendant que les œuvres répondent aux provocations, et cessent de se noyer dans le solipsisme ou le spiritisme, mieux vaut les mettre sous contrat, pense Gaston. Gide, dans la maison de Proust, pousse l’Anicet d’Aragon en 1921. L’année suivante, la relance de Littérature, que Breton dirige en vue de liquider Dada, le rapproche de Gallimard, le nouvel éditeur de la revue fractionnelle. Drieu en sera avant de porter le fer lui aussi au cœur de la mêlée. Il fut un des premiers à dénoncer le piège où les surréalistes s’enferment par politique, en tous sens. On ne quittera cette exposition exemplaire sans lire la lettre de Drieu à Gaston (10 septembre 1925) et le rapport de lecture de Camus sur Seuls demeurent de René Char (5 octobre 1943). Quand celui-ci flatte la philosophie du surréalisme, sa « course à l’impossible », celui-là fustige son ami Aragon, traître à la cause de la poésie, par opportunisme personnel et idéologique. Un duel de lettres ouvertes, heureux temps, s’ensuivrait. SG // Des surréalistes à la NRF. Des livres, des rêves et des querelles 1919-1928, Galerie Gallimard, jusqu’au 12 octobre 2024. Catalogue, 9,90€.
Post-scriptum
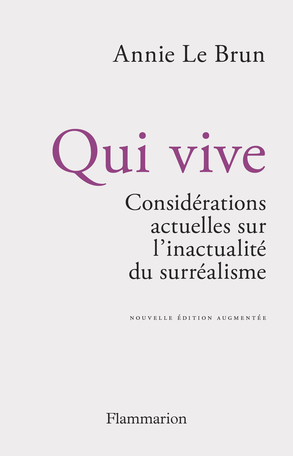
Avant de s’éteindre cet été, Annie Le Brun eut le bonheur de voir reparaître son Qui vive en une édition augmentée (Flammarion, 21€). Parues en 1991, alors que le Centre Pompidou célébrait André Breton, ces « considérations actuelles sur l’inactualité du surréalisme » sont suivies d’ajouts (au sujet de René Crevel ou de Leonora Carrington) et précédées d’une préface datée de février. On y lit, contre « la spectaculaire transmutation du surréalisme en valeur marchande » et « la neutralisation universitaire », ces lignes qui appellent un regain de résistance, mais aussi un droit d’inventaire : « Une des lignes de force de mon propos de 1991 avait été de représenter l’analogie qui s’était alors imposée à mes yeux entre la dévastation des forêts dans le monde entier et celle qui, de toutes parts, menaçait notre forêt mentale. La plupart n’y virent qu’une métaphore, qui malheureusement n’en est plus une depuis l’avènement de l’ère numérique, dont l’impact corrobore et dépasse les pires appréhensions. »

Conférence à venir, Saint-Exupéry, illustre méconnu, mardi 15 octobre 2024, 19:30/21:00, Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75 005 Paris, en partenariat avec la Revue des deux mondes et en présence d’Aurélie Julia, Jean-Claude Perrier (auteur de Saint-Exupéry. Un Petit Prince en exil, Plon, 2024) et Stéphane Guégan // contact@collegedesbernardins.fr //



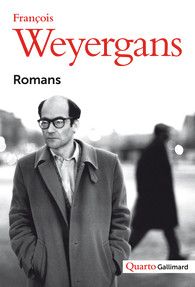






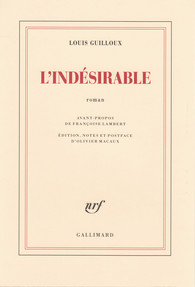




 Si l’on plaisantait comme lui, on dirait que le père d’Ubu périt trop tôt pour humer la gloire posthume que lui assura le premier XXe siècle. Dans son Anthologie de l’humour noir,
Si l’on plaisantait comme lui, on dirait que le père d’Ubu périt trop tôt pour humer la gloire posthume que lui assura le premier XXe siècle. Dans son Anthologie de l’humour noir,  Pas sûr ! Derrière la farce surgit une double vérité, métaphysique, on l’a dit, esthétique et presque stratégique, on le voit avec le livre de Julien Schuh, véritable tourbillon de savoir et d’intelligence. Son mérite est si grand qu’on lui pardonne ses multiples références, dictées par l’impératif universitaire, à Bourdieu et ses émules. Les fanatiques du champ littéraire, à l’opposé des tenants de la lecture interne, nous ont appris qu’aucun écrivain, promût-il l’obscurité et la polysémie comme l’expression d’un moi unique, n’échappait à l’espace de production et de réception où il s’engage. Fort de sa connaissance exemplaire des années 1890, littérature et peinture, Julien Schuh renvoie Jarry au milieu où il voulut se faire un nom avant d’y perdre pied. Cette configuration, faite de mentors et de revues, induit un type d’écriture, thèmes et rhétorique, dont nous comprenons enfin le fonctionnement. Jarry obéit moins au délire potache des fils de famille qu’au désir d’une prompte reconnaissance auprès de
Pas sûr ! Derrière la farce surgit une double vérité, métaphysique, on l’a dit, esthétique et presque stratégique, on le voit avec le livre de Julien Schuh, véritable tourbillon de savoir et d’intelligence. Son mérite est si grand qu’on lui pardonne ses multiples références, dictées par l’impératif universitaire, à Bourdieu et ses émules. Les fanatiques du champ littéraire, à l’opposé des tenants de la lecture interne, nous ont appris qu’aucun écrivain, promût-il l’obscurité et la polysémie comme l’expression d’un moi unique, n’échappait à l’espace de production et de réception où il s’engage. Fort de sa connaissance exemplaire des années 1890, littérature et peinture, Julien Schuh renvoie Jarry au milieu où il voulut se faire un nom avant d’y perdre pied. Cette configuration, faite de mentors et de revues, induit un type d’écriture, thèmes et rhétorique, dont nous comprenons enfin le fonctionnement. Jarry obéit moins au délire potache des fils de famille qu’au désir d’une prompte reconnaissance auprès de