
Il y a l’ombre de l’oubli, l’ombre du mépris, l’ombre du déni… Elles nous ont diversement écarté du roman sandien, maintenant réduit à quelques titres, souvent les plus champêtres. On ne peut se dissimuler, ainsi qu’en jugeait son ami Delacroix, les conséquences malheureuses d’une plume soumise aux rythmes de « la littérature industrielle ». La reine du feuilleton que fut George Sand (1804-1876) a trop écrit, comme d’autres ont trop peint ou trop gravé sous l’insatiable monarchie de Juillet. Les longueurs inutiles, les contretemps à répétition, les retards de la cristallisation amoureuse, l’action sacrifiée parfois au commentaire, c’est le prix fréquent à payer pour le lecteur de ses œuvres. Mais n’oublions pas ceux qui nous y ont précédés, de Chateaubriand à l’abbé Mugnier, de Sainte-Beuve, qui lança Indiana, à Proust, qui trouvait « extraordinaire » François le Champi. Si le Hugo des Misérables et le Flaubert de L’Éducation sentimentale ont oublié de nous dire ce qu’ils devaient à Horace (1841), rare portrait des étudiants rouges de 1832-35, Gautier reconnaissait à Mauprat maintes vertus, de celles dont est sorti son merveilleux Fracasse. Les réorientations de l’histoire littéraire, à moins que la glose bienpensante ne triomphe, devraient profiter à Sand en nous ramenant au texte, toujours préférable à la rumeur publique, et surtout aux textes les moins fréquentés. L’enfer des bibliothèques n’a peut-être pas encore avalé Mauprat, maintenu en vie par d’excellentes éditions, telle celle de Jean-Pierre Lacassagne (Folio, 1981). Or le roman de 1837 n’avait pas tout dit ; cela se vérifie à la lumière des généreuses introduction et annotation que François Kerlouégan a attachées à son gros volume, nouvelle pierre des indispensables Œuvres complètes de Sand.

Écrit entre les années Musset et les années Chopin, Mauprat porte la marque d’autres rencontres et d’autres alliances, il inaugure ainsi la veine républicaine et socialiste de son auteure, désormais en lutte aux côtés de Félicité de La Mennais, papiste libéral en froid avec Rome, et de Pierre Leroux, saint-simonien précoce, converti à Marianne. Indiana et Simon avaient eu la Restauration pour cadre et pour levier dramatique, Mauprat mêle ses multiples rebondissements, dignes des débuts du roman policier, au long crépuscule de l’Ancien Régime. Choix judicieux : Sand, comme d’autres déçus de juillet 1830, préconise de réinventer 1789, non de ressusciter 1793. Les excès du camp montagnard, en plein réveil sous Louis-Philippe, lui sont étrangers. Pas de sans-culottisme bobo chez elle, pas même de rousseauisme radical. Sand n’adhère pas plus à l’angélisme moral et social de Jean-Jacques qu’aux attendrissements de l’amour courtois. Le bon ne précède pas le mal, l’âge d’or du clan primitif l’âge de fer des monarchies liberticides. Bernard et Edmée, les deux héros d’un roman implanté aux confins du Berry, appartiennent, de naissance, à la vieille aristocratie : le premier grandit parmi une bande de soudards, la seconde, sa tante de même âge, superbe évidemment, a reçu une éducation « éclairée ». D’autres personnages, un ermite un peu savoyard, un curé défroqué, prospèrent autour d’eux et agissent à tour de rôle. Le canevas amoureux, noué dans cette extrême violence, anglaise et gothique, qu’affectionne la romancière, a besoin d’intercesseurs. Pour conquérir Edmée, Bernard devra se métamorphoser en homme des Lumières, rompre avec la barbarie clanique, partir se battre en Amérique pour une cause juste, et apprendre à aimer sans laisser refroidir ses ardeurs. Cette nuance, de taille, est finement glosée par Kerlouégan, sensible aux lecteurs féministes, plus sensible encore à la complexité, genre et fantasme, de la libido sandienne. La fabrique de nouveaux pactes, essentiels à Mauprat, intéresse les deux France et les deux sexes, déplace à sa guise les frontières, jamais aux dépens toutefois de la démocratie bien entendue, et du plaisir bien partagé.
Stéphane Guégan
« L’homme ne naît pas méchant ; il ne naît pas bon, non plus, comme l’entend Jean-Jacques Rousseau […]. L’homme naît avec plus ou moins de passions, avec plus ou moins de vigueur pour les satisfaire, avec plus ou moins d’aptitude pour en tirer un bon ou un mauvais parti dans la société. » (George Sand, Mauprat, ajout de 1852)
LUS… ET APPROUVÉS

Mauprat résulte d’un court récit de 1835, mais son sujet, « trop fort pour une nouvelle », dit-elle à François Buloz, accule Sand au roman, qui avale, au passage, l’embryon abandonné. Au même moment, elle fait connaissance de Lamennais, Leroux et de Marie d’Agoult. L’amitié des deux femmes, fulgurante, se transformera en rivalité et en haine, avant l’indifférence ou la nostalgie, résumerait Charles Dupêchez, l’impeccable éditeur de leur correspondance (Bartillat, 2001). Il mène aussi, et nous savons avec quelle diligence, l’entreprise de la correspondance générale, et croisée. Le mot convient à la comtesse rouge que le tome XV nous permet d’accompagner en ce virage climatérique qu’est 1870-72. Une seule observation servira à dire les déchirements de l’écrivaine politique. Quand Émile Ollivier, son gendre, précipite la France vers une défaite annoncée, sorte de juin 40 avant l’heure, Cosima, l’une des filles qu’elle donna à Liszt, se félicite des effets de la blitzkrieg. Wagner lui ira comme un gant : ils se marient le 26 août 1870 ! Autant que sa nature dépressive le permet, la belle-mère du sinistre Richard assure la France, depuis le Jura, du soutien de sa plume. Les prétentions prussiennes, le sort de l’Alsace notamment, la font réagir et rugir. Thiers, qu’elle n’aimait pas, lui paraît providentiel au sortir de la Commune, non par le massacre des communards, mais par le sauvetage de la République. SG / Marie de Flavigny, comtesse d’Agoult, Correspondance générale, tome XV, 1870-1872, édition établie et annotée par Charles F. Dupêchez, Honoré Champion, 2023, 140€.

Mauprat, ses capes, ses épées, ses cavalcades, sa peinture de l’ancienne France, l’agonie de la féodalité, conduit aussi au Vicomte de Bragelonne, sublime « plaidoyer pour l’aventure », comme la plupart des fresques historiques de Dumas. Jean-Yves Tadié, qui vient d’étoffer de manière significative l’édition qu’il avait donnée en 1997 (Folio classique), tient le dernier volet du triptyque des mousquetaires pour le meilleur, le plus puissant d’émotion, d’affect filial, de regrets, de deuils, de temps enfui. En contrepoint à la jeunesse de Louis XIV, à sa soif de pouvoir ou de revanche, à ses premières amours (qui enchantaient Paul Morand), deux mélancolies se superposent, celle de D’Artagnan et celle de Dumas, qui ont vieilli ensemble. Comme tout républicain conséquent, le lutteur de 1830, bientôt de 1848, croit à l’État moderne, qui n’est pas né en 1789. Le genre que Dumas pratique en maître de la péripétie et du dialogue, à égale distance de la chronique et de la fiction, lui offrait la possibilité d’inscrire la naissance de la monarchie absolue dans la perspective de son renversement. C’eût été se priver de la saveur du passé, irréductible à ce dont il est supposé avoir accouché. Dumas se contente de suggérer l’événement révolutionnaire à venir, et ne multiplie pas les allusions à la France de Louis-Philippe, phase terminale, selon lui, d’une perte inexorable de l’habitus chevaleresque. Le thème de la fin des gentilshommes, il le partage avec George Sand, et le traite avec une ardeur et une drôlerie qui ne sont qu’à lui. « La liberté partout, la vie partout » : Jean-Yves Tadié emprunte à Bragelonne les formules qui en résument l’éthique, la politique probablement, l’esthétique assurément. SG / Alexandre Dumas, Le Vicomte de Bragelonne, édition de Jean-Yves Tadié, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 69€.
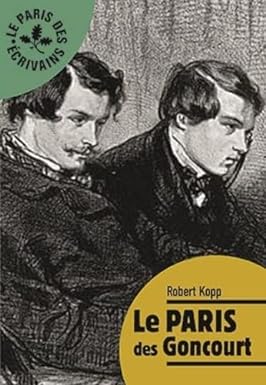
En dehors des « dîners Magny », où elle était la seule femme admise, à raison de l’hermaphrodisme de pensée, d’aspect, voire de morphologie, que ce cénacle masculin lui reconnaissait, Sand eut peu d’occasions de croiser les frères Goncourt. On se lisait, on s’estimait, plus qu’il n’est autorisé de le dire aujourd’hui. Mais la dame de Nohant, sous le Second Empire, bat la campagne plus que le pavé parisien, quand ses éditeurs ou les scènes théâtrales ne l’y appellent pas. Edmond et Jules souffrent eux d’une addiction contraire. La nature les éloigne de ses charmes quand la peinture de Daubigny ou de Corot ne la prend pas en charge, ils n’ont pas l’âme, ni le temps, d’explorer autre chose que la capitale, ses transformations plus ou moins heureuses, ses mœurs, des lorettes à la princesse Mathilde, ses journalistes prompts aussi à se vendre, ses cafés et ses restaurants bondés, autant de matériaux bruts nécessaires à leurs romans, mixtes d’exploration humaine sans précédent et d’écriture réaliste. Mais de quel réalisme procédaient-ils, eux qui préféraient Diderot à Rousseau, mais condamnaient Baudelaire ? « Poétiser » et « disséquer » la vie ne leur semblaient pas aussi antinomiques que ne le pensait Sand. Car Paris, nous rappelle Robert Kopp, au cours d’une passionnante promenade littéraire, fascine et horrifie nos compilateurs de « documents » et de papiers intimes. Ils étaient bien armés pour enregistrer l’évolution qu’ils déploraient. A mesure que se remplit le chaudron des impiétés du siècle, en tous sens, la ville tant aimée de Restif de La Bretonne et de Balzac faisait place au pandémonium des laideurs, morales et physiques, de l’âge moderne. Mais on ne quitte pas un bateau qui coule. SG / Robert Kopp, Le Paris des Goncourt, Éditions Alexandrines, 11€.

« Je le surpris en extase de ravissement devant un lis jaune dont il venait de comprendre la belle architecture. C’est le terme heureux dont il se servit. Il se hâtait de le peindre, voyant qu’à chaque instant son modèle accomplissant dans l’eau l’ensemble de sa floraison changeait de tons et d’attitudes. » Celle qui parle, c’est George Sand, celui qui peint, c’est Delacroix, qui séjourna trois fois à Nohant, lieu propice à l’examen poussé d’une nature inconsciemment artiste, ou œuvre de « l’éternel architecte ». Il manquait un livre à notre compréhension de cet observateur passionné des plantes et des arbres, des rochers et des eaux, sorte de Léonard de Vinci du romantisme, Vinci qu’il a vu et lu… Le très baudelairien Julien Zanetta, en cent pages lumineuses, tire du Journal et de l’œuvre de Delacroix (tel tigre fluvial, telle anamorphose de pierre et de chair), les indices convergents d’une pensée du monde accordée à son exploration physique, et aux lois qui ordonnent le réel sous ses accidents. Le passage que l’auteur glose, nul hasard justement, n’avait pas échappé à Lévi-Strauss (voir son magnifique Regarder Écouter Voir de 1993). Il se prête ici à une relecture d’ensemble du corpus delacrucien, analysé de l’intérieur, depuis les notions que le peintre aura explorées constamment, les analogies entre le monde que l’on porte en soi et le monde au contact duquel s’élabore l’œuvre, soit la création comme traduction clarifiante du réel, et l’imagination comme instrument de connaissance. Le livre refermé, on comprend mieux que Delacroix et Baudelaire, malgré leurs réserves respectives, aient été amenés à se rencontrer. SG / Julien Zanetta, A proportion. Eugène Delacroix et la mesure de l’homme, Éditions Le Bord de l’eau, 2023, 10€. Sur le sujet, voir aussi Stéphane Guégan, « Sur trois phares de Baudelaire », catalogue d’exposition Flower Power, RMN-Grand Palais / Musée des impressionnismes de Giverny, 2023, 39€.

Les peintres n’ont pas tous été tendres avec George Sand, reproche auquel Delacroix sut se soustraire en triant : Consuelo, Lélia ou Elle et Lui sont ainsi admirés, tandis que la pièce tirée de Mauprat, en 1853, se traîne et l’ennuie… La génération suivante se montre moins généreuse envers l’écrivaine qui traitait de barbouilleurs, certes, Courbet et Manet. On connait la lettre de Caillebotte, adressée à Monet en juillet 1884, terrible quant aux « niaiseries paysannesques » de la dame de Nohant. La bibliothèque de Monet lui-même, si elle réserve un bout de rayonnage à Sand, croule sous Balzac, les Goncourt et surtout Zola, objet d’une « admiration fanatique », note Anne Martin-Fugier. Les embaumeurs lui en voudront d’avoir redressé l’hagiographie courante, héritière de la doxa rewaldienne. Monet, grand peintre, eut ses faiblesses ou ses dérobades. Sans parler de son escapade londonienne de 1870, quand d’autres enfilent l’uniforme de la garde nationale ou celui des zouaves, il fut, sa vie entière, l’homme des « petits comptes », tapant son cercle jusqu’à son décollage, geignant ou pire, dès que ses finances s’asséchaient. Pas question toutefois de renoncer à son confort de petit bourgeois, aux domestiques, aux hôtels, avec vue sur la mer… Le jeu de massacre s’arrête là (on aurait pu le pousser plus loin, et souligner son double jeu avec Manet, autrement plus génial et noble que ce presque homonyme). Anne Martin-Fugier, femme de style et de savoir, n’a pas voulu caricaturer le peintre, qui avait pourtant débuté dans la charge railleuse. Monet, manieur d’argent, eut de l’or dans les pinceaux, et montra pugnacité et courage lors de la souscription visant à maintenir en France Olympia, puis à l’heure de l’Affaire Dreyfus, occasion aussi de se réconcilier avec Zola, lamentablement absent des souscripteurs. SG / Anne Martin-Fugier, Claude Monet, Folio biographies, Gallimard, 10,90€.
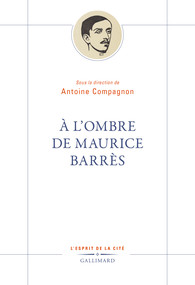
Oliver Bara le mentionnait récemment, Jean Jaurès et Maurice Barrès partageaient une identique passion pour les romans de George Sand. Était-ce pour de semblables raisons ? Barrès voyait-il avant tout en elle une sœur de terroir, eût-elle le sien, comme on dit un frère d’armes ? Ce qui est sûr, c’est l’assourdissante discrétion qui a caractérisé le centenaire de la mort de l’écrivain « lorrain ». Il est peu probable, en effet, que la république des lettres, l’université, inféodée au surréalisme, et la presse, souvent muselée par l’ignorance ou le sectarisme, s’agitent beaucoup en décembre prochain. Or « le cadavre », lui, bouge encore, et il se trouve des lecteurs, des historiens, des écrivains capables de fronder le mur du silence. Antoine Compagnon en a rassemblé une poignée, très experte, investie de la rude mission d’expliquer l’effacement de l’ex-prince de la jeunesse par-delà ses raisons les plus évidentes, son anti-dreyfusisme, son nationalisme racialiste, la lyre ultra-cocardière de 14-18. L’affaire se complique dès que le bilan tient compte des titres à mettre à son crédit. La postérité, de Blum à Drieu et Aragon ; la composante baudelairienne d’un Homme libre, comme le note Alexandre de Vitry ; la beauté sidérante de ses écrits sur l’art, de Delacroix à Greco ; et enfin l’espèce de byronisme oriental, cher à Malraux, que recrée en 1922 Un jardin sur l’Oronte, livré aux amours d’un croisé du Moyen Âge et d’une beauté musulmane. D’ailleurs, l’idéologie, si tant est que le mot s’applique à un écrivain peu doctrinaire, rappelle Grégoire Kauffmann (après Raoul Girardet), n’a jamais suffi à classer un écrivain. Que ferait-on du style ? Du culte des mots ? Compagnon, en tête d’ouvrage, se demande si l’on peut, si l’on doit, « oublier Barrès » et l’exclure des librairies. Il n’a pas oublié, à l’évidence, ce que ses années 1960 durent à la découverte, merci Bernard de Fallois, d’un écrivain alors en sursis, mais encore en rayon, qui avait tout pour le bouleverser. SG / Antoine Compagnon (sous la direction de), A l’ombre de Maurice Barrès, avec les contributions de Jessica Desclaux, Grégoire Kauffmann, Alexandre de Vitry, Michel Winock et trois textes d’Albert Thibaudet, Gallimard, 18€. Notons que Barrès, voix de Tolède et de la chapelle des Saint-Anges, hantait La Vie derrière soi (2021), le beau livre d’Antoine Compagnon déjà glosé ici, et qui reparaît en Folio essais, 9,70€.






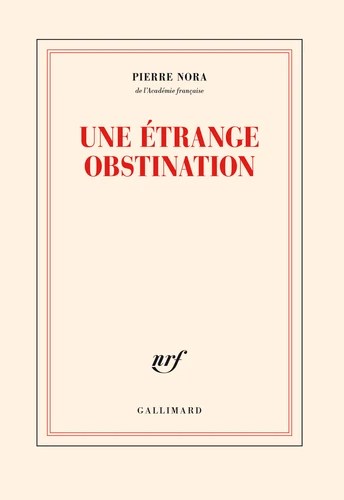





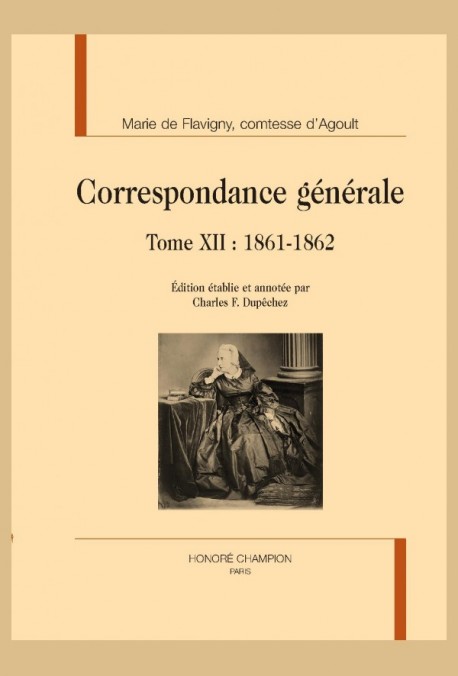
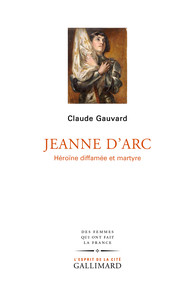








 Pour fertiles qu’elles puissent être, comme l’est celle de Dolan, les interprétations trop exclusives conviennent mal à Manet, l’artiste le moins démonstratif qui soit. Il préfère jouir de ses pensées sans les fixer… Peut-on écarter, par exemple, l’hypothèse très plausible que le tableau de Londres soit postérieur à la mort du père de Manet, décédé en septembre 1862, et qu’il se construise autour de la présence endeuillée de la mère du peintre (préparée par un dessin célèbre, coll. part.). Excellente musicienne, mais fidèle au bel canto de sa jeunesse, elle jette une note de noir au milieu de cette réunion mondaine, qui peut se lire comme l’extension de l’artiste, devenu chef de famille, d’une famille élargie, avec ses critiques influents, son réseau d’amitiés, son militaire, ses femmes en crinoline et peut-être son musicien… L’homme à bésicles, en effet, à droite, pourrait bien être Offenbach, autre virtuose en cour et peu
Pour fertiles qu’elles puissent être, comme l’est celle de Dolan, les interprétations trop exclusives conviennent mal à Manet, l’artiste le moins démonstratif qui soit. Il préfère jouir de ses pensées sans les fixer… Peut-on écarter, par exemple, l’hypothèse très plausible que le tableau de Londres soit postérieur à la mort du père de Manet, décédé en septembre 1862, et qu’il se construise autour de la présence endeuillée de la mère du peintre (préparée par un dessin célèbre, coll. part.). Excellente musicienne, mais fidèle au bel canto de sa jeunesse, elle jette une note de noir au milieu de cette réunion mondaine, qui peut se lire comme l’extension de l’artiste, devenu chef de famille, d’une famille élargie, avec ses critiques influents, son réseau d’amitiés, son militaire, ses femmes en crinoline et peut-être son musicien… L’homme à bésicles, en effet, à droite, pourrait bien être Offenbach, autre virtuose en cour et peu  Le «décrochage» date bien du Second Empire, et s’aggrave sous
Le «décrochage» date bien du Second Empire, et s’aggrave sous