
Le musée des Beaux-Arts de Bordeaux a perdu son directeur mais retrouvé l’usage de son aile nord, qu’occupent superbement les XIXe et XXe siècles. Quatre ans de travaux et de réflexion scénographique ont été nécessaires à cette réouverture très attendue. Et pour cause! Les deux perles de la galerie moderne, La Grèce sur les ruines de Missolonghi et La Chasse aux lions de Delacroix, s’impatientaient autant que leur public. Mais le résultat en valait la peine. Ce long chantier (il y a pire) a permis à l’aile sud de faire sa toilette et de modifier son offre. Les points forts de l’accrochage restent la peinture nordique et la séquence britannique, une rareté dans le panorama des musées de France, qui s’explique naturellement par la forte communauté anglaise qu’attira le port de Bordeaux au XVIIIe siècle. L’heureux réaménagement s’organise cependant autour des trésors du lieu, le Tarquin et Lucrèce du Titien (cadeau de Mazarin à Louis XIV en 1661), La Vierge à l’Enfant de Pierre de Cortone, Le Martyre de saint Georges de Rubens (saisi à Anvers par les soldats de l’an II) et la grande Présentation au Temple de Restout. Loin de nous l’intention de réduire la galerie de peintures anciennes à ce quarté gagnant, principaux envois de l’État de 1803 et 1805. Mais il faut reconnaître que Napoléon, avant et après son Sacre, n’a pas négligé cette ville qui passe aujourd’hui pour le symbole de la fidélité monarchiste.
 La conduite des Bordelais lors des Cent-Jours n’en est pas la seule raison. Louis XVIII lui-même répandit ses largesses sur la «cité du douze mars» et fit expédier à son tour quelques tableaux de poids, dans tous les sens du terme. L’un d’entre eux, Le Christ en croix de Jordaens, dépassait largement les possibilités spatiales de l’embryon de musée, problème chronique à Bordeaux. Ce retable, emporté de Lierre en 1794, reliquat donc de la France révolutionnaire, fait toujours pénitence à la cathédrale. L’autre cadeau de Louis XVIII, L’Embarquement de la duchesse d’Angoulême de Gros, correspondait parfaitement à sa propagande éclairée. Si le sujet flattait l’ancrage populaire de la Restauration, son auteur, rallié, personnifiait l’épopée napoléonienne. À travers Gros, le monarque miraculé faisait allégeance à cette Révolution que les ultras avaient en horreur. On sait ce qu’il advint du pays après la mort de l’intelligent Louis XVIII. Lorsqu’il rejoint l’aile nord, en traversant le beau jardin de la mairie de Bordeaux, le visiteur ne peut pas ne pas penser à ces deux France que ses propres pas relient à défaut de les réconcilier.
La conduite des Bordelais lors des Cent-Jours n’en est pas la seule raison. Louis XVIII lui-même répandit ses largesses sur la «cité du douze mars» et fit expédier à son tour quelques tableaux de poids, dans tous les sens du terme. L’un d’entre eux, Le Christ en croix de Jordaens, dépassait largement les possibilités spatiales de l’embryon de musée, problème chronique à Bordeaux. Ce retable, emporté de Lierre en 1794, reliquat donc de la France révolutionnaire, fait toujours pénitence à la cathédrale. L’autre cadeau de Louis XVIII, L’Embarquement de la duchesse d’Angoulême de Gros, correspondait parfaitement à sa propagande éclairée. Si le sujet flattait l’ancrage populaire de la Restauration, son auteur, rallié, personnifiait l’épopée napoléonienne. À travers Gros, le monarque miraculé faisait allégeance à cette Révolution que les ultras avaient en horreur. On sait ce qu’il advint du pays après la mort de l’intelligent Louis XVIII. Lorsqu’il rejoint l’aile nord, en traversant le beau jardin de la mairie de Bordeaux, le visiteur ne peut pas ne pas penser à ces deux France que ses propres pas relient à défaut de les réconcilier.
 Parvenu au seuil de la galerie moderne, un grand portrait équestre de Charles X lui indique le départ d’un parcours qui le conduira jusqu’à la France de De Gaulle puisque un Masson de 1968, donné par Michel Leiris, marque une sorte de terminus ante quem. La réputation du musée s’est faite sur les fonds Redon, Marquet et Lhote. Ils sont bien en place et produisent leur effet. Du portrait peu connu du jeune Matisse par son ami Marquet surgit le souvenir de leurs années communes chez Gustave Moreau. Et un Picasso néoclassique, à proximité de Lhote, fait moins l’effet d’un intrus que d’une alternative nécessaire au cubisme trop sûr de lui. Entretemps, c’est tout le XIXe siècle qui aura déroulé ses héros d’hier et d’aujourd’hui. La place manque cruellement pour montrer le fonds Roll ou le fond Smith, ce Bordelais au nom anglais qui aura été le De Nittis du cru. Les adeptes locaux de Courbet et d’Auguin réclament aussi des salles, comme on réclamait du pain sous les fenêtres de Versailles en d’autres temps. Compte tenu de l’espace, l’ensemble à belle allure et offre un panorama nerveux et dense de la peinture française du XIXe siècle. Ma préférence, tout bien pesé, ira à la salle où Gros et Delacroix se jettent un défi éternel. Ce n’est pas une vaine formule de journaliste. Delacroix, lié à la ville depuis son enfance, lui vendit sa Grèce sur les ruines de Missolonghi en 1852 pour une somme modique. La confrontation que le musée lui offrait, il l’a voulue. Quatre ans plus tard, sa Chasse aux lions, ce «chaos de griffes» selon Théophile Gautier, cette «explosion de couleurs» selon Baudelaire, viendra y confirmer son rang, royal ou impérial, c’est selon.
Parvenu au seuil de la galerie moderne, un grand portrait équestre de Charles X lui indique le départ d’un parcours qui le conduira jusqu’à la France de De Gaulle puisque un Masson de 1968, donné par Michel Leiris, marque une sorte de terminus ante quem. La réputation du musée s’est faite sur les fonds Redon, Marquet et Lhote. Ils sont bien en place et produisent leur effet. Du portrait peu connu du jeune Matisse par son ami Marquet surgit le souvenir de leurs années communes chez Gustave Moreau. Et un Picasso néoclassique, à proximité de Lhote, fait moins l’effet d’un intrus que d’une alternative nécessaire au cubisme trop sûr de lui. Entretemps, c’est tout le XIXe siècle qui aura déroulé ses héros d’hier et d’aujourd’hui. La place manque cruellement pour montrer le fonds Roll ou le fond Smith, ce Bordelais au nom anglais qui aura été le De Nittis du cru. Les adeptes locaux de Courbet et d’Auguin réclament aussi des salles, comme on réclamait du pain sous les fenêtres de Versailles en d’autres temps. Compte tenu de l’espace, l’ensemble à belle allure et offre un panorama nerveux et dense de la peinture française du XIXe siècle. Ma préférence, tout bien pesé, ira à la salle où Gros et Delacroix se jettent un défi éternel. Ce n’est pas une vaine formule de journaliste. Delacroix, lié à la ville depuis son enfance, lui vendit sa Grèce sur les ruines de Missolonghi en 1852 pour une somme modique. La confrontation que le musée lui offrait, il l’a voulue. Quatre ans plus tard, sa Chasse aux lions, ce «chaos de griffes» selon Théophile Gautier, cette «explosion de couleurs» selon Baudelaire, viendra y confirmer son rang, royal ou impérial, c’est selon.
Stéphane Guégan
Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 20 cours d’Albret. Catalogue des peintures, sous la direction de Guillaume Ambroise, Le Festin, 2010
 *Matisse-Rouault. Correspondance 1906-1953, lettres rassemblées et annotées par Jacqueline Munck, La Bibliothèque des arts, 19€.
*Matisse-Rouault. Correspondance 1906-1953, lettres rassemblées et annotées par Jacqueline Munck, La Bibliothèque des arts, 19€.
Chez Gustave Moreau, qui fut au fauvisme ce que Guérin fut au romantisme, un accoucheur involontaire plus qu’un libérateur, Matisse n’a pas seulement croisé Marquet. Il s’est également lié d’amitié avec Georges Rouault. La parution de leur correspondance, rendue possible par la découverte des lettres de Matisse en 2006, montre que les fauves ont vite calmé le jeu. Rappellera-t-on le mot cruel de Cocteau? On les sent plus préoccupés par leur carrière que des questions d’esthétique ou de politique. Seuls les échanges datant de l’Occupation et de l’après-guerre, marqué par l’ascendant des communistes, pour ne pas dire leur dictature dans le milieu intellectuel, dérogent à la règle. Santé et négoce l’emportent sur les autres considérations bien qu’on puisse glaner ici et là d’intéressantes informations ayant trait aux voyages de Matisse en Afrique du Nord et à leur passage chez Moreau. Cette relation, du reste, est triangulaire: Pierre Matisse, fils du peintre et marchand à New York, prend vite une place prépondérante dans cette correspondance qui révèle des liens plus profonds que ne le laissaient penser les années pauvres en lettres. SG
 Jordaens est entré dans le cœur des Français dès la fin du XVIIe siècle pour ne jamais plus en sortir. On s’étonne donc qu’il ait fallu attendre plus de 300 ans la sublime rétrospective du Petit Palais. Dans l’intervalle, évidemment, la perception de l’artiste s’est transformée du tout au tout. En 1699, alors que la «querelle du coloris» fait rage, Roger de Piles reconnaît à Jordaens une «manière» de son invention, une manière qu’il qualifie de «forte, de vraie et de suave» et qui appelle le souffle des «grands tableaux». Cette puissance de pinceau et d’effet, érotique et dramatique selon les sujets qu’elle fait vibrer sur la toile, résulterait de deux sources d’inspiration fondues par le génie flamand, la Venise de Véronèse dialoguant vigoureusement avec le réalisme du
Jordaens est entré dans le cœur des Français dès la fin du XVIIe siècle pour ne jamais plus en sortir. On s’étonne donc qu’il ait fallu attendre plus de 300 ans la sublime rétrospective du Petit Palais. Dans l’intervalle, évidemment, la perception de l’artiste s’est transformée du tout au tout. En 1699, alors que la «querelle du coloris» fait rage, Roger de Piles reconnaît à Jordaens une «manière» de son invention, une manière qu’il qualifie de «forte, de vraie et de suave» et qui appelle le souffle des «grands tableaux». Cette puissance de pinceau et d’effet, érotique et dramatique selon les sujets qu’elle fait vibrer sur la toile, résulterait de deux sources d’inspiration fondues par le génie flamand, la Venise de Véronèse dialoguant vigoureusement avec le réalisme du  Difficile de quitter les rives de
Difficile de quitter les rives de  Que la part du lion y revienne à Masson ne fait que souligner une vérité bonne à redire : des peintres qui eurent à se féliciter et à souffrir tour à tour du magistère de Breton, il est sans doute le peintre lettré par excellence. C’est en février 1924 que se rencontrent les deux hommes. La carrière commerciale de
Que la part du lion y revienne à Masson ne fait que souligner une vérité bonne à redire : des peintres qui eurent à se féliciter et à souffrir tour à tour du magistère de Breton, il est sans doute le peintre lettré par excellence. C’est en février 1924 que se rencontrent les deux hommes. La carrière commerciale de  Autre Juif allemand au destin incroyable, Erwin Blumenfeld, dont le Jeu de Paume évoque chaque métamorphose, pour la première fois, sur un pied d’égalité. N’y voyons pas facile provocation. Dès les années 1920, dans l’effervescence et les nouvelles menaces de l’après-guerre, le jeune Blumenfeld, exilé à Amsterdam puis à Paris, laisse ses dessins volontairement enfantins faire émerger les thèmes qu’il ne quitterait plus, l’Eros bestial, l’antisémitisme, la pratique du collage sans filet et une certaine fascination pour l’humour dévastateur de Chaplin. Qu’un dadaïste de la première heure ait pu se révéler un photographe de mode dès la fin des années 1930, qu’un fanatique du noir et blanc arty ait autant utilisé la couleur dans les années 1950-1960, voilà au moins deux raisons de se pencher sur son cas. À mi-distance de l’iconoclasme
Autre Juif allemand au destin incroyable, Erwin Blumenfeld, dont le Jeu de Paume évoque chaque métamorphose, pour la première fois, sur un pied d’égalité. N’y voyons pas facile provocation. Dès les années 1920, dans l’effervescence et les nouvelles menaces de l’après-guerre, le jeune Blumenfeld, exilé à Amsterdam puis à Paris, laisse ses dessins volontairement enfantins faire émerger les thèmes qu’il ne quitterait plus, l’Eros bestial, l’antisémitisme, la pratique du collage sans filet et une certaine fascination pour l’humour dévastateur de Chaplin. Qu’un dadaïste de la première heure ait pu se révéler un photographe de mode dès la fin des années 1930, qu’un fanatique du noir et blanc arty ait autant utilisé la couleur dans les années 1950-1960, voilà au moins deux raisons de se pencher sur son cas. À mi-distance de l’iconoclasme  On ne fait plus grand cas des Parnassiens et l’épithète évoque moins désormais les cimes de l’inspiration poétique que son désolant assèchement. Apollon et ses Muses s’étaient trompés d’adresse. À quoi bon parler des stériles héritiers de
On ne fait plus grand cas des Parnassiens et l’épithète évoque moins désormais les cimes de l’inspiration poétique que son désolant assèchement. Apollon et ses Muses s’étaient trompés d’adresse. À quoi bon parler des stériles héritiers de 
 Les liens sont nombreux qui unissent
Les liens sont nombreux qui unissent  Nous abordons, évidemment, le cas Gérôme dans nos Cent tableaux qui font débat (Hazan, 39€), livre qui a fait l’objet de deux émissions :
Nous abordons, évidemment, le cas Gérôme dans nos Cent tableaux qui font débat (Hazan, 39€), livre qui a fait l’objet de deux émissions : «Ne pas rater le dernier acte de sa vie.» Cocteau, en 1962, n’a plus le choix. Ou plutôt, à 73 ans, il fait celui de la virilité, encore et toujours. La mort vient mais il refuse de lui ouvrir sa porte. Habitué à contrôler sa «difficulté d’être», il repousse tout ce qui pourrait l’augmenter. Il nous a prévenus dès 1945: «la vie d’un poète est chose atroce». Inutile d’y ajouter. Le dernier volume du Passé défini s’interrompt le 11 octobre 1963, deux jours avant que Cocteau ne rende l’âme. Son indispensable journal le montre malade, aux prises avec les vertiges et les médecins, il ne le montre jamais désemparé, abattu, face à l’inéluctable. La mort n’est rien, dit Cocteau, c’est mourir, l’ennuyeux. La mort des amis seule l’atteint, celle de Francis Poulenc, qui emporte avec lui les chaudes années 1920, ou celle de
«Ne pas rater le dernier acte de sa vie.» Cocteau, en 1962, n’a plus le choix. Ou plutôt, à 73 ans, il fait celui de la virilité, encore et toujours. La mort vient mais il refuse de lui ouvrir sa porte. Habitué à contrôler sa «difficulté d’être», il repousse tout ce qui pourrait l’augmenter. Il nous a prévenus dès 1945: «la vie d’un poète est chose atroce». Inutile d’y ajouter. Le dernier volume du Passé défini s’interrompt le 11 octobre 1963, deux jours avant que Cocteau ne rende l’âme. Son indispensable journal le montre malade, aux prises avec les vertiges et les médecins, il ne le montre jamais désemparé, abattu, face à l’inéluctable. La mort n’est rien, dit Cocteau, c’est mourir, l’ennuyeux. La mort des amis seule l’atteint, celle de Francis Poulenc, qui emporte avec lui les chaudes années 1920, ou celle de  Ce que traduisent les ultimes pages du Passé défini, c’est une terreur bien ancrée de la solitude. Cocteau peut s’étourdir au milieu des têtes couronnées et de la jet set, il a besoin des preuves d’amour du dernier carré. En fait de fidélité, Édouard Dermit l’emporte haut la main sur Jean Marais, dévoré par sa carrière de star. On sait que la désertion de Francine Weisweiller fut vécue comme une trahison autrement traumatisante. Certains jours, la conscience de sa supériorité et le rôle qu’il joue quai Conti, lors notamment de l’élection de
Ce que traduisent les ultimes pages du Passé défini, c’est une terreur bien ancrée de la solitude. Cocteau peut s’étourdir au milieu des têtes couronnées et de la jet set, il a besoin des preuves d’amour du dernier carré. En fait de fidélité, Édouard Dermit l’emporte haut la main sur Jean Marais, dévoré par sa carrière de star. On sait que la désertion de Francine Weisweiller fut vécue comme une trahison autrement traumatisante. Certains jours, la conscience de sa supériorité et le rôle qu’il joue quai Conti, lors notamment de l’élection de  – Pascal Fulacher et Dominique Marny, Jean Cocteau le magnifique. Les miroirs d’un poète, Gallimard/Musée des lettres et manuscrits, 29€.
– Pascal Fulacher et Dominique Marny, Jean Cocteau le magnifique. Les miroirs d’un poète, Gallimard/Musée des lettres et manuscrits, 29€.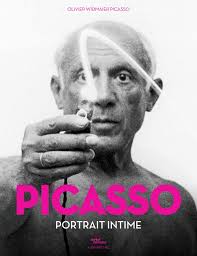
 Le livre de Germain Latour, Guernica. Histoire secrète d’un tableau (Seuil, 21€), est loin d’apporter à son lecteur la moisson d’informations inédites que son titre promet. C’est que le destin du tableau, après la mort de Picasso et de Franco, l’intéresse plus que l’œuvre lui-même. Choix recevable, du reste. Germain Latour n’est pas le premier à noter que le peintre, si favorable fût-il aux Républicains espagnols, n’apporta pas à leur cause l’engagement total qu’ils en attendaient. C’est Zervos qui part en Espagne fin 1936, pas lui, alors qu’on l’a bombardé directeur en titre du Prado! Picasso, on le sait, n’avait pas l’âme d’un Hemingway ni même d’un
Le livre de Germain Latour, Guernica. Histoire secrète d’un tableau (Seuil, 21€), est loin d’apporter à son lecteur la moisson d’informations inédites que son titre promet. C’est que le destin du tableau, après la mort de Picasso et de Franco, l’intéresse plus que l’œuvre lui-même. Choix recevable, du reste. Germain Latour n’est pas le premier à noter que le peintre, si favorable fût-il aux Républicains espagnols, n’apporta pas à leur cause l’engagement total qu’ils en attendaient. C’est Zervos qui part en Espagne fin 1936, pas lui, alors qu’on l’a bombardé directeur en titre du Prado! Picasso, on le sait, n’avait pas l’âme d’un Hemingway ni même d’un  La puissance de fascination de Madame Bovary, fausse relique, se moque merveilleusement du temps. Flaubert n’aura pas bûché pour rien durant cinq ans son livre le plus sadique, plus cruel et génial que
La puissance de fascination de Madame Bovary, fausse relique, se moque merveilleusement du temps. Flaubert n’aura pas bûché pour rien durant cinq ans son livre le plus sadique, plus cruel et génial que  Flaubert sature la forme pour mieux affranchir le sens. Sa peinture furieuse et acide des passions comprimées est d’autant plus dérangeante que la fausse neutralité du style, l’étonnante trouvaille du discours indirect, suspend tout jugement moral univoque. Il n’y avait plus d’explication rassurante, mais autant de vérités que de personnages, et un seul être supérieur dans la veulerie généralisée de la vie sociale, cette fille de ferme dévorée de lectures. Un refus et une découverte, disais-je. Celle-ci apparaît très clairement dans le couplage que proposent les volumes II et III des
Flaubert sature la forme pour mieux affranchir le sens. Sa peinture furieuse et acide des passions comprimées est d’autant plus dérangeante que la fausse neutralité du style, l’étonnante trouvaille du discours indirect, suspend tout jugement moral univoque. Il n’y avait plus d’explication rassurante, mais autant de vérités que de personnages, et un seul être supérieur dans la veulerie généralisée de la vie sociale, cette fille de ferme dévorée de lectures. Un refus et une découverte, disais-je. Celle-ci apparaît très clairement dans le couplage que proposent les volumes II et III des  À l’évidence, l’un de nos prix littéraires devrait être réservé à l’écrivain le plus infréquentable du moment. Revenu avec trois livres sur le devant de la scène,
À l’évidence, l’un de nos prix littéraires devrait être réservé à l’écrivain le plus infréquentable du moment. Revenu avec trois livres sur le devant de la scène,  Ce dernier se nomme Bugeaud et sonne perpétuellement la charge contre les bassesses de l’époque. N’y avait-il pas lieu d’intenter un procès au nostalgique des colonies perdues? Il est vrai que le livre ne donne pas prise à ce genre d’attaque. Bugeaud, c’est Millet se moquant un peu de lui-même ou du rôle qu’on aime à lui faire jouer. Amusant dédoublement, il apporte au roman une cocasserie inattendue, comme si on passait de Blanchot et ses vides angoissés à Queneau et ses satires littéraires. Plutôt que dévoiler la fin, ce qui serait un vrai crime pour le coup, disons qu’elle rejoint l’esprit de L’Être-Bœuf, véritable cri d’amour adressé à la viande bovine, à son Limousin natal et aux plaisirs qu’on dit de bouche. Les textes brefs que publie
Ce dernier se nomme Bugeaud et sonne perpétuellement la charge contre les bassesses de l’époque. N’y avait-il pas lieu d’intenter un procès au nostalgique des colonies perdues? Il est vrai que le livre ne donne pas prise à ce genre d’attaque. Bugeaud, c’est Millet se moquant un peu de lui-même ou du rôle qu’on aime à lui faire jouer. Amusant dédoublement, il apporte au roman une cocasserie inattendue, comme si on passait de Blanchot et ses vides angoissés à Queneau et ses satires littéraires. Plutôt que dévoiler la fin, ce qui serait un vrai crime pour le coup, disons qu’elle rejoint l’esprit de L’Être-Bœuf, véritable cri d’amour adressé à la viande bovine, à son Limousin natal et aux plaisirs qu’on dit de bouche. Les textes brefs que publie  Mélomane averti, Millet aura aussi associé son nom, en 2013, au bicentenaire de la naissance de Wagner, en préfaçant ses Écrits sur la musique, principalement ceux que l’autre Richard consacra au dieu Beethoven et à l’explication ou à la promotion de son propre génie. Ils sont loin de former l’ensemble des essais et articles de Wagner, graphomane par nécessité matérielle et vocation poétique. Millet était donc en droit de le présenter comme le plus «écrivain» des grands musiciens allemands. Le plus écrivain et le plus aimé de ses confrères de la plume, notamment en France. Seul Chopin l’égale dans l’estime et l’admiration de Nerval, Gautier et
Mélomane averti, Millet aura aussi associé son nom, en 2013, au bicentenaire de la naissance de Wagner, en préfaçant ses Écrits sur la musique, principalement ceux que l’autre Richard consacra au dieu Beethoven et à l’explication ou à la promotion de son propre génie. Ils sont loin de former l’ensemble des essais et articles de Wagner, graphomane par nécessité matérielle et vocation poétique. Millet était donc en droit de le présenter comme le plus «écrivain» des grands musiciens allemands. Le plus écrivain et le plus aimé de ses confrères de la plume, notamment en France. Seul Chopin l’égale dans l’estime et l’admiration de Nerval, Gautier et  Ses lettres mettent surtout en évidence sa volonté de puissance et de reconnaissance, qui trouvèrent en Liszt plus qu’une oreille attentive, un agent d’autant plus efficace qu’il s’estimait moins capable de partitions «sublimes». Après avoir conquis le pianiste virtuose et le tombeur byronien des flamboyantes années 1830, Wagner abuse de «la nature essentiellement aimable et aimante» de cet homme à peine plus âgé que lui, mais lié, vers 1848, à toute
Ses lettres mettent surtout en évidence sa volonté de puissance et de reconnaissance, qui trouvèrent en Liszt plus qu’une oreille attentive, un agent d’autant plus efficace qu’il s’estimait moins capable de partitions «sublimes». Après avoir conquis le pianiste virtuose et le tombeur byronien des flamboyantes années 1830, Wagner abuse de «la nature essentiellement aimable et aimante» de cet homme à peine plus âgé que lui, mais lié, vers 1848, à toute  «Votre père était le plus intelligent d’entre nous tous.» Qui parle ainsi? Qui désigne en Bernard un des aigles du XXe siècle? Rien moins que Picasso vers 1950. Le vieux peintre n’avait pas oublié. Il n’avait pas oublié le bel et fier Émile, alors qu’il traitait la plupart de ses contemporains par le plus violent mépris. Il n’avait pas oublié ses saltimbanques maigres et altiers, sa tension fiévreuse, son retour à
«Votre père était le plus intelligent d’entre nous tous.» Qui parle ainsi? Qui désigne en Bernard un des aigles du XXe siècle? Rien moins que Picasso vers 1950. Le vieux peintre n’avait pas oublié. Il n’avait pas oublié le bel et fier Émile, alors qu’il traitait la plupart de ses contemporains par le plus violent mépris. Il n’avait pas oublié ses saltimbanques maigres et altiers, sa tension fiévreuse, son retour à 
 Signe intempestif, l’appel de la viande fait mauvais effet. Il rappelle la saignée de la Belgique et la
Signe intempestif, l’appel de la viande fait mauvais effet. Il rappelle la saignée de la Belgique et la  Concernant l’offensive d’août 1916, Keegan se met à la place des soldats, croise les documents et varie les focales. On sent se prolonger chez lui la fraternité des fameux bataillons de Kitchener, ces volontaires issus de l’Angleterre des prolos et des campagnes, arrachés à la terre mère par un mélange de patriotisme victorien et de désespoir social. Ces Pals’Battalions, forts de leur sentiment d’appartenance communautaire, allaient subir les plus lourdes pertes de l’histoire anglaise. Car c’est l’été des Orages d’acier de Jünger. L’été de «la bataille du matériel […] avec son déploiement de moyens titanesques». Cette offensive, Joffre en rêve depuis décembre 1915. Relever l’honneur flétri l’obsède, relancer la guerre enkystée. Et les 200 000 premiers morts de Verdun, entre février et juin 1916, ajoutent à son impatience. Regonflés à bloc, suréquipés, prêts à arroser les Boches de millions d’obus, Français et Anglais reprennent l’initiative le 1er juillet. L’artillerie conquiert, l’infanterie occupe. À l’abri, en somme, du feu roulant des canons, les vagues successives de fantassins s’élanceront sur le no man’s land qui sépare les belligérants. Voilà pour la théorie, la réalité sera tristement différente. Fin septembre, au terme de plusieurs attaques, 400 000 jeunes Anglais auront touché la poussière. Après le premier échec, il faudra plus que du rhum pour enjamber le parapet et affronter les mitrailleuses allemandes… Keegan, sans naïveté, rend hommage à ces soldats de l’impossible, pris au piège de la double mâchoire des tranchées.
Concernant l’offensive d’août 1916, Keegan se met à la place des soldats, croise les documents et varie les focales. On sent se prolonger chez lui la fraternité des fameux bataillons de Kitchener, ces volontaires issus de l’Angleterre des prolos et des campagnes, arrachés à la terre mère par un mélange de patriotisme victorien et de désespoir social. Ces Pals’Battalions, forts de leur sentiment d’appartenance communautaire, allaient subir les plus lourdes pertes de l’histoire anglaise. Car c’est l’été des Orages d’acier de Jünger. L’été de «la bataille du matériel […] avec son déploiement de moyens titanesques». Cette offensive, Joffre en rêve depuis décembre 1915. Relever l’honneur flétri l’obsède, relancer la guerre enkystée. Et les 200 000 premiers morts de Verdun, entre février et juin 1916, ajoutent à son impatience. Regonflés à bloc, suréquipés, prêts à arroser les Boches de millions d’obus, Français et Anglais reprennent l’initiative le 1er juillet. L’artillerie conquiert, l’infanterie occupe. À l’abri, en somme, du feu roulant des canons, les vagues successives de fantassins s’élanceront sur le no man’s land qui sépare les belligérants. Voilà pour la théorie, la réalité sera tristement différente. Fin septembre, au terme de plusieurs attaques, 400 000 jeunes Anglais auront touché la poussière. Après le premier échec, il faudra plus que du rhum pour enjamber le parapet et affronter les mitrailleuses allemandes… Keegan, sans naïveté, rend hommage à ces soldats de l’impossible, pris au piège de la double mâchoire des tranchées. A-t-il jamais lu le grand
A-t-il jamais lu le grand  – Raphaël Confiant, Le Bataillon créole, Mercure de France, 19,80€
– Raphaël Confiant, Le Bataillon créole, Mercure de France, 19,80€ – George Desvallières, Correspondance 1914-1918. Une famille d’artistes pendant la guerre, édition établie par Catherine Ambroselli de Bayser, Somogy, 49€
– George Desvallières, Correspondance 1914-1918. Une famille d’artistes pendant la guerre, édition établie par Catherine Ambroselli de Bayser, Somogy, 49€