A moins d’être hantée, une collection d’art reste imparfaite. Amasser les chefs-d’œuvre ne suffit pas, encore faut-il les faire vivre ensemble, les frotter à plus modestes qu’eux et doter le tout d’une présence toujours surprenante : le vrai collectionneur assume son âme de sorcier avec une sorte de ferveur inquiète, s’entoure de fantômes familiers et varie leur emplacement dès que revient le besoin d’en réveiller le mystère. Il y a de l’alchimiste qui ne s’ignore pas chez les amants de la beauté. Doucet et Yves Saint Laurent furent de tels magiciens. Une exposition unique les réunit et nous le confirme.
 Jérôme Neutres est ici dans son élément. De Marcel Proust et Jacques-Emile Blanche, passions du commissaire, à Jacques Doucet (1853-1929), le chemin mène tout droit, les lecteurs de La Recherche le savent. Nous voici confrontés au destin romanesque d’un couturier de la Belle Epoque, féru de littérature et de Chine, qui commença par collectionner comme son grand-père, selon son mot, avant d’inventer le goût des petits-enfants qu’il n’eut pas. Quelles sont les intimes motivations et les secrètes divinations qui poussent un même homme à vendre en 1912 ses trésors du XVIIIe siècle et à s’enticher de Brancusi, Modigliani, Matisse, Picabia, Duchamp et Masson, jusqu’à acheter, douze ans plus tard, Les Demoiselles d’Avignon et en faire la pièce maîtresse du fameux pavillon de la rue Saint-James, à Neuilly, meublé de tout ce que l’Art déco compte alors de gloires futures? Doucet, amusé et intrigué par l’audace des « jeunes », précède toujours le mouvement, au point que son Picasso insigne, boudé par l’administration française, rejoindra le MoMA en 1929. No comment… Ce n’était pas faute d’avoir souhaité qu’il en fût autrement. André Breton, l’un de ses conseillers au sortir de la guerre de 14, lui avait fait acheter les Demoiselles parce qu’il fallait maintenir, à tout prix, sur le sol français, l’étendard du mouvement moderne et la toile qui résumait leur besoin commun d’altérité radicale. Pour Doucet, Breton et Picasso, la peinture doit avoir de l’esprit, elle doit même convoquer les esprits, parler de haut et de loin. Il en découlait aussi l’impératif d’une présentation habitée, animée, finement tressée, l’inverse de celle des musées.
Jérôme Neutres est ici dans son élément. De Marcel Proust et Jacques-Emile Blanche, passions du commissaire, à Jacques Doucet (1853-1929), le chemin mène tout droit, les lecteurs de La Recherche le savent. Nous voici confrontés au destin romanesque d’un couturier de la Belle Epoque, féru de littérature et de Chine, qui commença par collectionner comme son grand-père, selon son mot, avant d’inventer le goût des petits-enfants qu’il n’eut pas. Quelles sont les intimes motivations et les secrètes divinations qui poussent un même homme à vendre en 1912 ses trésors du XVIIIe siècle et à s’enticher de Brancusi, Modigliani, Matisse, Picabia, Duchamp et Masson, jusqu’à acheter, douze ans plus tard, Les Demoiselles d’Avignon et en faire la pièce maîtresse du fameux pavillon de la rue Saint-James, à Neuilly, meublé de tout ce que l’Art déco compte alors de gloires futures? Doucet, amusé et intrigué par l’audace des « jeunes », précède toujours le mouvement, au point que son Picasso insigne, boudé par l’administration française, rejoindra le MoMA en 1929. No comment… Ce n’était pas faute d’avoir souhaité qu’il en fût autrement. André Breton, l’un de ses conseillers au sortir de la guerre de 14, lui avait fait acheter les Demoiselles parce qu’il fallait maintenir, à tout prix, sur le sol français, l’étendard du mouvement moderne et la toile qui résumait leur besoin commun d’altérité radicale. Pour Doucet, Breton et Picasso, la peinture doit avoir de l’esprit, elle doit même convoquer les esprits, parler de haut et de loin. Il en découlait aussi l’impératif d’une présentation habitée, animée, finement tressée, l’inverse de celle des musées.
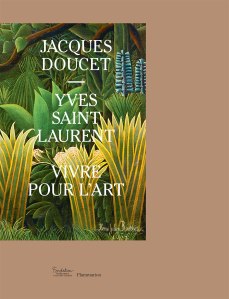 Saisissant, à chaque pas, est le parcours de la fondation Bergé, qui débute sous l’œil du grand Bouddha de Doucet et d’un mur entier de Picasso : Rêverie et Couple, tous deux de 1904, ont conservé les cadres du collectionneur, note de luxe jetée sur l’ambiguïté bleue et brune de ces confessions de jeunesse fortement sexuées. Au centre, L’Homme à la guitare, l’un des chefs-d’œuvre de 1912, frétille d’harmonieuses brisures visuelles. Avant l’achat un peu fou des Demoiselles, Doucet fit sagement l’acquisition de Table, rareté suisse et comble de la synecdoque cubiste ou nègre. A Neuilly, du reste, le cabinet oriental faisait écho à tous les exotismes de l’entre-deux-guerres. Ces liens invisibles ont été retissés, et la Charmeuse de serpent du douanier Rousseau a retrouvé sa place au-dessus du Sofa africain de Marcel Coard, prêt insigne du Virginia Museum of Fine arts. Vitrine de l’Art Déco, meubles et encadrements d’Eileen Gray ou de Pierre Legrain, tapis de Ruhlmann et reliures de Rose Adler, le studio Saint-James se laisse rapidement envoûter par le surréalisme, du précurseur Chirico au catalan Miro. Après 1917, on vit aussi Doucet financer les revues d’avant-garde, de Nord/Sud à Littérature, et faire entrer dans sa fameuse bibliothèque aussi bien Apollinaire, Reverdy, Max Jacob que les nouveaux agités du freudisme à la mode, Breton et Aragon. Ce dernier, la duplicité même, ne ménage pas son protecteur dans sa correspondance intime. La chose vint aux oreilles de Doucet. Il fallut toute la diplomatie de Drieu pour recoller les morceaux. Ne devait-on pas pardonner aux « enfants sublimes » de vivre dans l’absolu, puisque les maîtres du relatif n’y accédaient que sur leurs ailes ? « Les rois sages ont toujours nourri les moines fous. »
Saisissant, à chaque pas, est le parcours de la fondation Bergé, qui débute sous l’œil du grand Bouddha de Doucet et d’un mur entier de Picasso : Rêverie et Couple, tous deux de 1904, ont conservé les cadres du collectionneur, note de luxe jetée sur l’ambiguïté bleue et brune de ces confessions de jeunesse fortement sexuées. Au centre, L’Homme à la guitare, l’un des chefs-d’œuvre de 1912, frétille d’harmonieuses brisures visuelles. Avant l’achat un peu fou des Demoiselles, Doucet fit sagement l’acquisition de Table, rareté suisse et comble de la synecdoque cubiste ou nègre. A Neuilly, du reste, le cabinet oriental faisait écho à tous les exotismes de l’entre-deux-guerres. Ces liens invisibles ont été retissés, et la Charmeuse de serpent du douanier Rousseau a retrouvé sa place au-dessus du Sofa africain de Marcel Coard, prêt insigne du Virginia Museum of Fine arts. Vitrine de l’Art Déco, meubles et encadrements d’Eileen Gray ou de Pierre Legrain, tapis de Ruhlmann et reliures de Rose Adler, le studio Saint-James se laisse rapidement envoûter par le surréalisme, du précurseur Chirico au catalan Miro. Après 1917, on vit aussi Doucet financer les revues d’avant-garde, de Nord/Sud à Littérature, et faire entrer dans sa fameuse bibliothèque aussi bien Apollinaire, Reverdy, Max Jacob que les nouveaux agités du freudisme à la mode, Breton et Aragon. Ce dernier, la duplicité même, ne ménage pas son protecteur dans sa correspondance intime. La chose vint aux oreilles de Doucet. Il fallut toute la diplomatie de Drieu pour recoller les morceaux. Ne devait-on pas pardonner aux « enfants sublimes » de vivre dans l’absolu, puisque les maîtres du relatif n’y accédaient que sur leurs ailes ? « Les rois sages ont toujours nourri les moines fous. »
 On pense à cette fusée de Drieu devant la grande tenture de Burne-Jones, qui montre Melchior, Balthazar et Gaspard venus s’agenouiller aux pieds du Sauveur. Avant de rejoindre Orsay, grâce au don de Pierre Bergé, elle avait longtemps orné la sobre bibliothèque d’Yves Saint Laurent, rue de Babylone. D’une tout autre munificence brillait naturellement le grand salon du grand couturier, qu’évoque le second moment de l’exposition dans l’éclat rocaille des miroirs de Claude Lalanne. Jérôme Neutres y a regroupé quelques-uns des trésors qui furent dispersés en 2009, certains provenant de la collection Doucet, tels le Tabouret curule de Legrain, propriété désormais du Louvre Abu Dhabi, et le Revenant de Chirico, aujourd’hui au Centre Pompidou. Cette toile possède un superbe pedigree, nous apprend Edouard Sebline, puisque Yves Saint Laurent et Pierre Bergé l’acquirent en 1985 auprès des héritiers de Pierre Colle. Avant d’ouvrir boutique, l’ami de Max Jacob avait été un temps le collaborateur de Dior, maître de qui l’ont sait… L’histoire du goût ressemble souvent à une histoire de famille. On est ainsi heureux de revoir, vieilles connaissances, le portrait des enfants Dedreux, l’un des plus beaux Géricault revenus en mains privées, et les quatre Warhol explosifs de 1972, conservés par Pierre Bergé, où s’affirme la modernité que partageaient le peintre Pop et son modèle, saisi ici entre l’action et le songe, le relatif et l’absolu. Stéphane Guégan
On pense à cette fusée de Drieu devant la grande tenture de Burne-Jones, qui montre Melchior, Balthazar et Gaspard venus s’agenouiller aux pieds du Sauveur. Avant de rejoindre Orsay, grâce au don de Pierre Bergé, elle avait longtemps orné la sobre bibliothèque d’Yves Saint Laurent, rue de Babylone. D’une tout autre munificence brillait naturellement le grand salon du grand couturier, qu’évoque le second moment de l’exposition dans l’éclat rocaille des miroirs de Claude Lalanne. Jérôme Neutres y a regroupé quelques-uns des trésors qui furent dispersés en 2009, certains provenant de la collection Doucet, tels le Tabouret curule de Legrain, propriété désormais du Louvre Abu Dhabi, et le Revenant de Chirico, aujourd’hui au Centre Pompidou. Cette toile possède un superbe pedigree, nous apprend Edouard Sebline, puisque Yves Saint Laurent et Pierre Bergé l’acquirent en 1985 auprès des héritiers de Pierre Colle. Avant d’ouvrir boutique, l’ami de Max Jacob avait été un temps le collaborateur de Dior, maître de qui l’ont sait… L’histoire du goût ressemble souvent à une histoire de famille. On est ainsi heureux de revoir, vieilles connaissances, le portrait des enfants Dedreux, l’un des plus beaux Géricault revenus en mains privées, et les quatre Warhol explosifs de 1972, conservés par Pierre Bergé, où s’affirme la modernité que partageaient le peintre Pop et son modèle, saisi ici entre l’action et le songe, le relatif et l’absolu. Stéphane Guégan
Jacques Doucet / Yves Saint Laurent, Vivre pour l’art, Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, jusqu’au 14 février 2016. Catalogue sous la direction de Jérôme Neutres, Flammarion, 39€.
 Pierre Bergé est le plus libéral des collectionneurs et des prêteurs. La propriété exclusive, jalouse, mesquine, le laisse froid. Sitôt achetés, tableaux, livres et manuscrits sont à partager ou montrer au plus grand nombre. Ce qui est figé n’est jamais complet : « J’ai toujours considéré que les livres n’entraient dans ma bibliothèque que d’une manière temporaire, en transit en quelque sorte, et qu’un jour ils partiraient. » Avant de tout vendre, de tout éparpiller aux quatre vents de l’éternelle bibliophilie, il fait circuler. Une de ses dernières trouvailles (2003) tient du miracle : les carnets du jeune Guillaume Apollinaire ne courent pas les rues, ni même les documents de première main sur ce moment d’éclosion du poète français, le plus grand entre Rimbaud et Breton. À quoi rêvent les génies en herbe? Qu’attend-on des aveux opaques d’un adolescent jeté dans une vie nomade, ballottée entre un père absent et une mère très présente, belle et intelligente, mais dépendante des hommes qu’elle charme et qui l’entretiennent avant de disparaître? Là où nous voyons des annonces, il ne percevait aucun signe. C’est même la beauté de ce carnet, une beauté de nuit étoilée, que de tout maintenir en suspension, de résister aux lectures trop intrusives, malgré l’éclairante postface de Pierre Caizergues. Dans la perfection d’un reprint qui conserve jusqu’aux maculatures et aux transferts du crayon gras, une trentaine de dessins nous est révélée, qu’a généralement signés celui qui se nomme encore Wilhelm de Kostrovitzky. Ils s’étalent de sa 12ème à sa 15ème année, de la fin de la 5ème à la fin de la 3ème, alors que le collégien du lycée Saint-Charles, où enseignent des Pères marianistes (Société de Marie) montre sérieux et piété. Mais le passionnel l’habite déjà en ces années 1893-1895. Son besoin extrême de lecture et de religion, son goût précoce des uniformes et des actions d’éclat, son attirance pour la mode féminine et même sa pente à voyager en esprit nous parlent déjà du futur écrivain fantasque et superstitieux, moderne et antimoderne, le seul lyrique qui ait complètement conquis et compris Picasso. Avec Pierre Caizergues, notons aussi la veine noire qui colore d’énigme les pièces chrétiennes et les pages profanes : Noël se construit autour du dialogue angoissé que le narrateur noue avec l’Enfant Jésus qu’il tutoie ; Minuit inscrit le sommeil d’une dormeuse, peut-être chinoise, parmi les figures et écritures d’un calligramme involontaire; Macbeth porte une citation de Shakespeare en anglais (« I’gin to be aweary of the sun ») et réunit en mosaïque les éléments d’un obscur roman familial. Apollinaire, on le sait, se voudra un poète du soleil et de l’amour, son double nervalien, alors naissant, le suivra tout au long de sa courte vie. SG / Guillaume Apollinaire, Un album de jeunesse, préface de Pierre Bergé, postface de Pierre Caizergues, 17,50€
Pierre Bergé est le plus libéral des collectionneurs et des prêteurs. La propriété exclusive, jalouse, mesquine, le laisse froid. Sitôt achetés, tableaux, livres et manuscrits sont à partager ou montrer au plus grand nombre. Ce qui est figé n’est jamais complet : « J’ai toujours considéré que les livres n’entraient dans ma bibliothèque que d’une manière temporaire, en transit en quelque sorte, et qu’un jour ils partiraient. » Avant de tout vendre, de tout éparpiller aux quatre vents de l’éternelle bibliophilie, il fait circuler. Une de ses dernières trouvailles (2003) tient du miracle : les carnets du jeune Guillaume Apollinaire ne courent pas les rues, ni même les documents de première main sur ce moment d’éclosion du poète français, le plus grand entre Rimbaud et Breton. À quoi rêvent les génies en herbe? Qu’attend-on des aveux opaques d’un adolescent jeté dans une vie nomade, ballottée entre un père absent et une mère très présente, belle et intelligente, mais dépendante des hommes qu’elle charme et qui l’entretiennent avant de disparaître? Là où nous voyons des annonces, il ne percevait aucun signe. C’est même la beauté de ce carnet, une beauté de nuit étoilée, que de tout maintenir en suspension, de résister aux lectures trop intrusives, malgré l’éclairante postface de Pierre Caizergues. Dans la perfection d’un reprint qui conserve jusqu’aux maculatures et aux transferts du crayon gras, une trentaine de dessins nous est révélée, qu’a généralement signés celui qui se nomme encore Wilhelm de Kostrovitzky. Ils s’étalent de sa 12ème à sa 15ème année, de la fin de la 5ème à la fin de la 3ème, alors que le collégien du lycée Saint-Charles, où enseignent des Pères marianistes (Société de Marie) montre sérieux et piété. Mais le passionnel l’habite déjà en ces années 1893-1895. Son besoin extrême de lecture et de religion, son goût précoce des uniformes et des actions d’éclat, son attirance pour la mode féminine et même sa pente à voyager en esprit nous parlent déjà du futur écrivain fantasque et superstitieux, moderne et antimoderne, le seul lyrique qui ait complètement conquis et compris Picasso. Avec Pierre Caizergues, notons aussi la veine noire qui colore d’énigme les pièces chrétiennes et les pages profanes : Noël se construit autour du dialogue angoissé que le narrateur noue avec l’Enfant Jésus qu’il tutoie ; Minuit inscrit le sommeil d’une dormeuse, peut-être chinoise, parmi les figures et écritures d’un calligramme involontaire; Macbeth porte une citation de Shakespeare en anglais (« I’gin to be aweary of the sun ») et réunit en mosaïque les éléments d’un obscur roman familial. Apollinaire, on le sait, se voudra un poète du soleil et de l’amour, son double nervalien, alors naissant, le suivra tout au long de sa courte vie. SG / Guillaume Apollinaire, Un album de jeunesse, préface de Pierre Bergé, postface de Pierre Caizergues, 17,50€




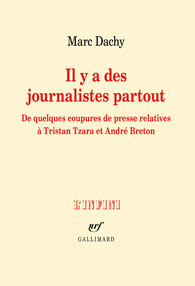

 Une lettre d’écrivain n’est pas un acte d’écriture comme les autres. Et quand le destinataire se trouve être aussi un homme ou une femme de plume, l’affaire se complique terriblement. Quatre livres indispensables en apportent la preuve, traversés qu’ils sont par la même fascination du pouvoir des mots et ce qu’on peut leur fait jouer. De Gide à Kerouac, en passant par Paulhan et Beckett, ces correspondances se construisent sur la fiction qu’elles fondent. Puis, un beau jour, les faux-semblants se délitent et le verbe, en sa vérité foncière, reprend alors ses droits. Gide, donc, le grand Gide, grand surtout par son
Une lettre d’écrivain n’est pas un acte d’écriture comme les autres. Et quand le destinataire se trouve être aussi un homme ou une femme de plume, l’affaire se complique terriblement. Quatre livres indispensables en apportent la preuve, traversés qu’ils sont par la même fascination du pouvoir des mots et ce qu’on peut leur fait jouer. De Gide à Kerouac, en passant par Paulhan et Beckett, ces correspondances se construisent sur la fiction qu’elles fondent. Puis, un beau jour, les faux-semblants se délitent et le verbe, en sa vérité foncière, reprend alors ses droits. Gide, donc, le grand Gide, grand surtout par son  Si curieux qu’il soit aussi, l’attelage que formèrent Bloch et Paulhan ressemble au précédent par les différences et les dissensions qu’il eut à constamment vaincre. De même âge, ayant fait ainsi l’expérience de la guerre de 14-18 à trente ans, le second avec plus de vaillance et moins de scrupule idéologique que le premier, ils se croisent, à l’été 1920, dans les bureaux de la N.R.F, dont Paulhan vient d’être nommé secrétaire général. Il en prendra la direction, comme on sait, en février 1925, à la mort de
Si curieux qu’il soit aussi, l’attelage que formèrent Bloch et Paulhan ressemble au précédent par les différences et les dissensions qu’il eut à constamment vaincre. De même âge, ayant fait ainsi l’expérience de la guerre de 14-18 à trente ans, le second avec plus de vaillance et moins de scrupule idéologique que le premier, ils se croisent, à l’été 1920, dans les bureaux de la N.R.F, dont Paulhan vient d’être nommé secrétaire général. Il en prendra la direction, comme on sait, en février 1925, à la mort de Indiscutable, inaliénable fut la fibre française du jeune Beckett, qui endura les «années noires» sur le sol élu et se mêla à la nébuleuse de la résistance intellectuelle. Sa correspondance confirme, s’il était besoin, son attachement au pays de Baudelaire, Rimbaud, Gide et Proust, quatre de ses auteurs de prédilection. Mais il en est beaucoup d’autres. Rien, à dire vrai, ne lui échappe au cours des années 1920-1930, d’Éluard et Breton qu’il traduit, à
Indiscutable, inaliénable fut la fibre française du jeune Beckett, qui endura les «années noires» sur le sol élu et se mêla à la nébuleuse de la résistance intellectuelle. Sa correspondance confirme, s’il était besoin, son attachement au pays de Baudelaire, Rimbaud, Gide et Proust, quatre de ses auteurs de prédilection. Mais il en est beaucoup d’autres. Rien, à dire vrai, ne lui échappe au cours des années 1920-1930, d’Éluard et Breton qu’il traduit, à 
 *Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, Gallimard, Folio, 8,40€.
*Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, Gallimard, Folio, 8,40€. *Paul Valéry, Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945, Gallimard, 35€.
*Paul Valéry, Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945, Gallimard, 35€.


 – Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),
– Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),  *Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’
*Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’ *Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de
*Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de  C’était la thèse de La Chambre claire de Barthes: la photographie sème la mort sur son passage, surtout quand elle prétend capter la vie. Lettre de faire-part anticipée offerte aux hommes, elle les vampirise. De son narcissisme originel au photojournalisme douteux, le médium sera vite rattrapé par les écueils de sa magie. Peu de photographes en ont réchappé. Et Cartier-Bresson forcerait-il autant l’admiration s’il n’y avait touché? Succès du moment, l’exposition du Centre Pompidou ne l’a pas volé. Elle est d’une maîtrise parfaite et d’une réelle originalité au regard des hommages dont «l’œil du siècle» a maintes fois bénéficié. La formule, trompeuse comme tout slogan, prouve enfin sa légitimité, hors des complaisances formalistes ou de l’hagiographie qui l’avaient justifiée. Sa vérité, nous dit
C’était la thèse de La Chambre claire de Barthes: la photographie sème la mort sur son passage, surtout quand elle prétend capter la vie. Lettre de faire-part anticipée offerte aux hommes, elle les vampirise. De son narcissisme originel au photojournalisme douteux, le médium sera vite rattrapé par les écueils de sa magie. Peu de photographes en ont réchappé. Et Cartier-Bresson forcerait-il autant l’admiration s’il n’y avait touché? Succès du moment, l’exposition du Centre Pompidou ne l’a pas volé. Elle est d’une maîtrise parfaite et d’une réelle originalité au regard des hommages dont «l’œil du siècle» a maintes fois bénéficié. La formule, trompeuse comme tout slogan, prouve enfin sa légitimité, hors des complaisances formalistes ou de l’hagiographie qui l’avaient justifiée. Sa vérité, nous dit  Dans le catalogue de l’exposition Paparazzi, qu’a dirigée Clément Chéroux pour le Centre Pompidou-Metz,
Dans le catalogue de l’exposition Paparazzi, qu’a dirigée Clément Chéroux pour le Centre Pompidou-Metz,  Si l’on plaisantait comme lui, on dirait que le père d’Ubu périt trop tôt pour humer la gloire posthume que lui assura le premier XXe siècle. Dans son Anthologie de l’humour noir,
Si l’on plaisantait comme lui, on dirait que le père d’Ubu périt trop tôt pour humer la gloire posthume que lui assura le premier XXe siècle. Dans son Anthologie de l’humour noir,  Pas sûr ! Derrière la farce surgit une double vérité, métaphysique, on l’a dit, esthétique et presque stratégique, on le voit avec le livre de Julien Schuh, véritable tourbillon de savoir et d’intelligence. Son mérite est si grand qu’on lui pardonne ses multiples références, dictées par l’impératif universitaire, à Bourdieu et ses émules. Les fanatiques du champ littéraire, à l’opposé des tenants de la lecture interne, nous ont appris qu’aucun écrivain, promût-il l’obscurité et la polysémie comme l’expression d’un moi unique, n’échappait à l’espace de production et de réception où il s’engage. Fort de sa connaissance exemplaire des années 1890, littérature et peinture, Julien Schuh renvoie Jarry au milieu où il voulut se faire un nom avant d’y perdre pied. Cette configuration, faite de mentors et de revues, induit un type d’écriture, thèmes et rhétorique, dont nous comprenons enfin le fonctionnement. Jarry obéit moins au délire potache des fils de famille qu’au désir d’une prompte reconnaissance auprès de
Pas sûr ! Derrière la farce surgit une double vérité, métaphysique, on l’a dit, esthétique et presque stratégique, on le voit avec le livre de Julien Schuh, véritable tourbillon de savoir et d’intelligence. Son mérite est si grand qu’on lui pardonne ses multiples références, dictées par l’impératif universitaire, à Bourdieu et ses émules. Les fanatiques du champ littéraire, à l’opposé des tenants de la lecture interne, nous ont appris qu’aucun écrivain, promût-il l’obscurité et la polysémie comme l’expression d’un moi unique, n’échappait à l’espace de production et de réception où il s’engage. Fort de sa connaissance exemplaire des années 1890, littérature et peinture, Julien Schuh renvoie Jarry au milieu où il voulut se faire un nom avant d’y perdre pied. Cette configuration, faite de mentors et de revues, induit un type d’écriture, thèmes et rhétorique, dont nous comprenons enfin le fonctionnement. Jarry obéit moins au délire potache des fils de famille qu’au désir d’une prompte reconnaissance auprès de  Vous le pensiez froid comme la mort ou l’ennui, glacé comme ses pinceaux, agaçant comme une énigme sans fin, Magritte est tout le contraire. Le portrait qu’en brosse Michel Draguet inverse la donne. Plus son objet fuit et se refuse à la lecture, à l’instar des tableaux à tiroirs infinis dont le peintre partageait le goût avec Dalí, plus Draguet le poursuit dans ses retranchements, ses non-dits, ses mensonges et les recoins d’une vie qui, parce que pleine et pas toujours très nette, veut d’emblée rester secrète. On ne saurait trouver meilleure justification à la biographie, enquête policière sans jugement dernier. «Magritte est un maître du paraître. Un Œdipe qui, pour berner le Sphinx, aurait échafaudé une incroyable fiction: celle d’un peintre sans vie et sans passion, se partageant entre sa femme Georgette, les échecs et quelques menues distractions et qui, derrière la façade de son conformisme bourgeois, aurait alimenté un imaginaire poétique méthodiquement mis en scène dans des tableaux propres et des gouaches précises.» Il refusait de parler de son passé, du suicide de sa mère, jetait un voile de pudeur et d’oubli sur son père, un affairiste libertaire, et sa jeunesse hautement dissolue.
Vous le pensiez froid comme la mort ou l’ennui, glacé comme ses pinceaux, agaçant comme une énigme sans fin, Magritte est tout le contraire. Le portrait qu’en brosse Michel Draguet inverse la donne. Plus son objet fuit et se refuse à la lecture, à l’instar des tableaux à tiroirs infinis dont le peintre partageait le goût avec Dalí, plus Draguet le poursuit dans ses retranchements, ses non-dits, ses mensonges et les recoins d’une vie qui, parce que pleine et pas toujours très nette, veut d’emblée rester secrète. On ne saurait trouver meilleure justification à la biographie, enquête policière sans jugement dernier. «Magritte est un maître du paraître. Un Œdipe qui, pour berner le Sphinx, aurait échafaudé une incroyable fiction: celle d’un peintre sans vie et sans passion, se partageant entre sa femme Georgette, les échecs et quelques menues distractions et qui, derrière la façade de son conformisme bourgeois, aurait alimenté un imaginaire poétique méthodiquement mis en scène dans des tableaux propres et des gouaches précises.» Il refusait de parler de son passé, du suicide de sa mère, jetait un voile de pudeur et d’oubli sur son père, un affairiste libertaire, et sa jeunesse hautement dissolue.  Surmontant son horreur sans cesse réaffirmée du littéral, du transparent, de l’évidence (sauf quand elle est éternelle), Magritte a pratiqué le portrait. Son entourage direct, de l’intraitable Nougé à la famille Spaak, lui a fourni quelques modèles et l’occasion, chaque fois, de détourner les lois du genre. La face éludée, flambée de l’excentrique
Surmontant son horreur sans cesse réaffirmée du littéral, du transparent, de l’évidence (sauf quand elle est éternelle), Magritte a pratiqué le portrait. Son entourage direct, de l’intraitable Nougé à la famille Spaak, lui a fourni quelques modèles et l’occasion, chaque fois, de détourner les lois du genre. La face éludée, flambée de l’excentrique 
 Sans qu’ils le sachent encore, Bernard et
Sans qu’ils le sachent encore, Bernard et  La vie de Bernard bascule dès sa démobilisation. Le 25 juillet 1940, il épouse Else Reichman, une superbe Juive autrichienne qu’il a abordée au Louvre alors qu’elle tournait autour de la Vénus de Milo (il s’était mis lui-même à tourner autour des deux beautés avant d’aborder la seule qui pût partager son existence précaire). Le 26, il expédie à Paulhan sa profession de foi collaborationniste. Cette concomitance surprend moins quand on réalise que Bernard ne confond pas la
La vie de Bernard bascule dès sa démobilisation. Le 25 juillet 1940, il épouse Else Reichman, une superbe Juive autrichienne qu’il a abordée au Louvre alors qu’elle tournait autour de la Vénus de Milo (il s’était mis lui-même à tourner autour des deux beautés avant d’aborder la seule qui pût partager son existence précaire). Le 26, il expédie à Paulhan sa profession de foi collaborationniste. Cette concomitance surprend moins quand on réalise que Bernard ne confond pas la  Puisque Ulysse revient en Folio Classique (Gallimard, 12,80€) dans l’édition que Jacques Aubert avait dirigée pour La Pléiade, rappelons l’impact de cette grandiose satire homérique sur la génération de Marc Bernard. La traduction de
Puisque Ulysse revient en Folio Classique (Gallimard, 12,80€) dans l’édition que Jacques Aubert avait dirigée pour La Pléiade, rappelons l’impact de cette grandiose satire homérique sur la génération de Marc Bernard. La traduction de