
Il y a un romantisme des années 1860 et il n’est pas seulement le fait des anciens combattants puisque Baudelaire consacre à sa défense une grande partie de son Salon de 1859. On pense, bien sûr, au savoureux passage où déborde sa nostalgie pour les paysagistes d’avant la conversion générale à la peinture herbivore. Un double échec s’y consomme : le recul des sites imaginaires conjugue ses effets négatifs avec l’empirisme sans originalité. Baudelaire, frustré de ces compositions à « caractère amoureusement poétique » que seul Paul Huet maintient en vie, se rabat sur Meryon, les ciels opiacés de Boudin, les encres d’Hugo et « la beauté surnaturelle des paysages de Delacroix ». Où est passée l’esthétique du vertige qu’illustrait, en 1830, la vogue des châteaux forts, des lacs suspendus, des abbayes en ruine, des ponts gigantesques ? Baudelaire fera même mieux au début des années 1860 et appuiera d’une égale ferveur la naissante modernité et ce qu’elle ne démodait pas à ses yeux. Une semblable libéralité se dégage de la critique théâtrale de Théophile Gautier, l’homme du très officiel Moniteur, dont Patrick Berthier continue à éditer pieusement le précieux trésor journalistique. Son efficacité est telle que nous atteignons les années 1865-1867, qui voient s’affirmer, on le sait, une nouvelle vague de peintres sous l’impulsion de Manet. Et Gautier ne se prive pas des parallèles qui s’imposent ou qu’il impose.

Cette double saison fut maigre en vrais événements, Berthier les identifie parfaitement, le scandale d’Henriette Maréchal et le miracle de Fantasio. Il se trouve que Gautier fut mêlé au coup de maître des frères Goncourt à plusieurs degrés, comme à l’exhumation du chef-d’œuvre, inédit à la scène, d’Alfred de Musset. Sa recension du drame des Goncourt a toutes les habiletés, elle suggère la cabale qui fit chuter Henriette Maréchal après six représentations et visait la princesse Mathilde, dont Théophile était proche, à travers le drame des deux frères. Mais c’est aussi le réalisme, la vie présente, qui semblait indigne de la Comédie française pour beaucoup. Le bal de l’opéra qui ouvre l’acte I a des chances d’avoir inspiré à Manet, assez attentif aux Goncourt, le tableau refusé de 1874 (Washington, NGA, ill. 1). Gautier applaudit aussi à cette invasion, jusqu’au turf, du monde moderne. Les intrigues, les décolletés et la joyeuse cohue qu’abrite le foyer, en ouverture d’Henriette Maréchal, l’enchantent, autant que le coup de révolver final. C’est 1830 recommencé sous de nouveaux oripeaux : « MM. de Goncourt, comme disent les peintres, font nature ; mais cette fidélité au modèle n’exclut pas chez eux les recherches d’art les plus raffinées. » Il rapproche aussi d’une pièce de son cher Auguste Maquet, ancien du Petit Cénacle, « ces peintres qui réduisent leur palette aux couleurs primordiales ». Suivez le regard. D’autres insistances de Gautier disent sa conscience des évolutions en cours, notamment ses nombreuses références à la Vie parisienne, l’hebdomadaire illustré né en 1863, et vrai vivier de la modernité naissante. Il verse des larmes sincères sur Gavarni et Gozlan, décédés l’un et l’autre en 1866, liens vifs entre le romantisme et la modernité telle que Baudelaire et Gautier l’entendent. Quant à renoncer aux plaisirs périmés, il n’en est pas question… En juin 1866, le Gringoire de Théodore de Banville, troisième événement théâtral de l’époque, est ainsi salué : « Au lever de la toile, notre vieux romantisme s’est réjoui de voir un décor Moyen Âge ! Bonne fortune assez rare aujourd’hui. » Tout est dit. Stéphane Guégan
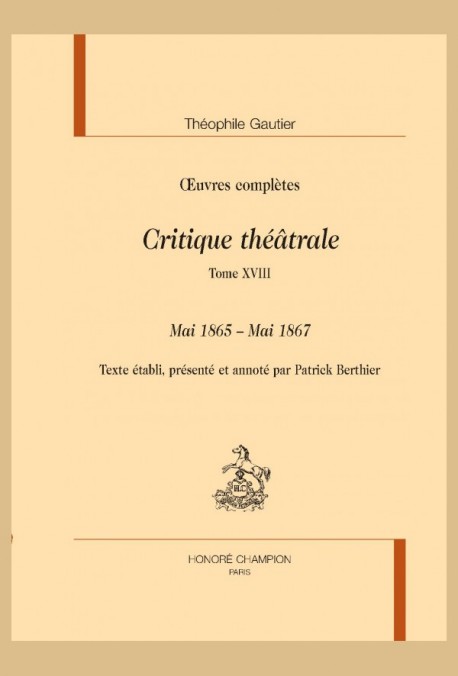
Théophile Gautier, Œuvres complètes. Critique théâtrale, tome XVIII, mai 1865- mai 1867, texte établi, présenté et annoté par Patrick Berthier, Honoré Champion, 2023, 98€.
Voir mes recensions des tomes XVII, XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV.
ANNÉES SOIXANTES…

La surdouée Fanny Kemble (1809-1893) aurait pu jouir de la plus délicieuse des existences entre les scènes théâtrales de Londres où elle brillait et le milieu artistique qui l’avait adoubée. Ce cercle comptait des écrivains, des poètes et des peintres de choix, Walter Scott, Tennyson, Thackeray ou encore le grand Thomas Lawrence. L’impéritie de son père scella différemment son destin et, à la suite d’une tournée américaine, Fanny, vingt-quatre ans, dut renoncer à son indépendance et se marier à un planteur peu dégrossi, maître chez lui et propriétaire de nombreux esclaves d’origine africaine. L’union ne fut pas heureuse, on s’en doute, et confirme ce que Tocqueville dit de la servilité des épouses américaines. Avant leur séparation, la jeune femme obtint toutefois de ce mari imposé l’autorisation de visiter les champs de coton et de riz d’où il tirait sa fortune. Le témoignage de Fanny Kemble, celui d’une abolitionniste qu’aucun argument économique ou racial ne saurait fléchir, est digne de la situation révoltante à laquelle elle est exposée dès l’hiver 1838-39. Son livre paraîtra en 1863, la traduction n’en avait jamais été entreprise. Merci donc au Mercure de France. Pour avoir participé à la guerre de sécession aux côtés des troupes nordistes, Philippe d’Orléans, comte de Paris (fils aîné de Ferdinand), ne s’était pas trompé en désignant le Journal de Fanny à l’attention de ceux qui voulaient se confronter enfin à la réalité des Noirs enchaînés. SG / Fanny Kemble, Journal 1838-1839, traduit de l’anglais par Caroline Valeau, édition de Françoise Lapeyre, Le Temps retrouvé / Mercure de France, 12€.

Toutes les raisons sont bonnes de relire Atala et même René, ces courts romans inscrits sur les tables du premier romantisme (1801 et 1802) pour avoir donné de nouvelles couleurs, une luxuriance inédite, à la peinture de la nature et des passions humaines les moins avouables, ou les moins compatibles avec les exigences du Ciel. La puissance d’évocation et de sensualité du texte mit immédiatement le monde de l’image en émoi. On ne compte pas les peintres, que Girodet domine, et les illustrateurs qui crurent possible de rivaliser avec les mots de l’Enchanteur, de son vivant et, plus curieux, longtemps après sa mort. La nouvelle édition de Folio classique s’enrichit de planches de Gustave Doré. Cet exact contemporain de Manet, observateur à ses heures des turpitudes modernes, leur préféra le plus souvent l’émulation des aigles de la littérature. Le dessinateur vertigineux de L’Enfer de Dante (1861) donne à Chactas et aux siens, deux ans plus tard, l’écrin et l’écran d’une végétation anthropomorphique, sexuée, bonne et mauvaise. La « selva oscura » d’Atala baigne ses pieds dans le Mississippi. Baudelaire, en 1859, a parlé à Nadar des « enfantillages » de Doré, dont Gautier était l’ami et le complice en tout. Lui le qualifiait d’anormal, excessif et « prodigieux crayon ». Les illustrations d’Atala, qu’on retrouve avec bonheur, ont fait travailler plusieurs générations d’imaginations, de part et d’autre de l’Atlantique : on en perçoit l’écho lointain chez le Masson de Martinique charmeuse de serpents ou, de façon plus catholique, dans La Ligne rouge de Terrence Malick. SG / Chateaubriand, Atala suivi de René, édition de Sébastien Baudouin, préface d’Aurélien Bellanger, Gallimard / Folio classique, 5,50€.

Au rythme où se maintient sa correspondance, deux ou trois lettres reçues et expédiés quotidiennement, Marie d’Agoult pouvait se sentir encore, à 60 ans, aussi entourée d’intelligences flatteuses qu’utile à la marche de l’histoire. Le lecteur toutefois est vite en droit de se demander de quelle histoire il s’agit en ces années 1866-1869, le naufrage proche du Second Empire ou, après l’année terrible et l’épisode Mac Mahon, la relance républicaine ? Contrairement à son gendre Émile Ollivier, qui sous-estime largement le danger prussien et ne se lancera dans la guerre qu’au moment le plus inopportun, la comtesse, bien qu’Allemande à moitié, se méfie davantage des appétits de Bismarck ; elle se montre toujours très préoccupée par les avantages à saisir du « tournant libéral » où Napoléon III persévère et où le prince Napoléon, l’un de ses proches, croit pousser ses pions. Elle mise aussi, prescience certaine, sur l’avenir politique de Jules Grévy à la lumière de ses premiers succès électoraux. Le rouge raisonnable de ses opinions, que confirme alors la réédition de sa belle Histoire de la révolution de 1848, a du sang bleu, comme elle aime à en sourire avec la presse de l’époque. Elle se voit ainsi mettre « dans les écrivains de la caste qui ont été libéraux et républicains : Chateaubriand, Lamennais, Tocqueville, Vigny ». Être centre gauche ou centre droit, cela se conçoit très bien en politique au terme d’un presque siècle de violences continues. Mais en art ? Wagner mis à part, Marie est devenue étrangère à son temps et conserve au tiède Ponsard toute son estime admirative. Ses filles des deux lits ne montrent pas plus d’appétence pour la création du moment, et leur correspondance si passionnante le trahit à maints endroits. Comme si la richesse de ce tome XIV, aussi soignée que les précédents, ne suffisait pas, Charles Dupêchez le complète, en effet, des lettres qu’échangèrent Cosima von Bülow et Claire de Charnacé. La première, fille de Liszt et bientôt Mme Wagner, avoue ainsi n’avoir rien compris à Henriette Maréchal, à la protection de la princesse Mathilde, au fiasco et à « la pièce elle-même ». Ailleurs, au sujet du mariage de Catulle Mendès et de Judith Gautier un certain antisémitisme se donne carrière sous l’ironie de salon. De l’électrochoc (insuffisant) de Sadowa à l’internement (partiel) de Marie chez le fameux docteur Blanche, ces mille pages documentent un moment de notre histoire politique et culturelle qui demande encore à être mieux saisi. SG / Marie de Flavigny, comtesse d’Agoult, Correspondance générale, tome XIV, 1866-1869, édition établie et annotée par Charles F. Dupêchez, 145€. Remarquons au passage combien George Sand reste présente à l’esprit de Marie d’Agoult et à ses échanges avec Hortense Allart. Quoi qu’elles en aient, les deux amies ne parviennent pas nier le lustre littéraire de celle qu’elles nomment jalousement la Reine. A ce sujet, il faut s’intéresser à l’un des romans les plus oubliés de la dame de Nohant, écrit au bord du volcan (1869-1870) et publié en quatre livraisons dans la Revue des deux mondes, de part et d’autre de Sedan… La donnée de départ y est aussi savoureuse (une aristocrate au service de bourgeois, dont une adolescente tyrannique) que les résonances dynastiques et sociales annoncées dès le titre. Voir George Sand, Œuvres complètes sous la direction de Béatrice Didier, Césarine Dietrich, édition critique par Alex Lascar, Honoré Champion, 2022, 59€.





