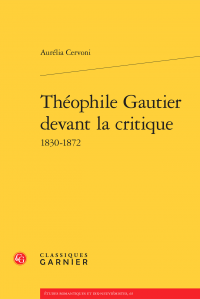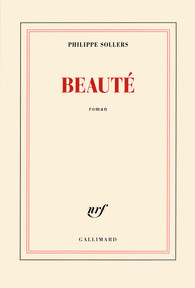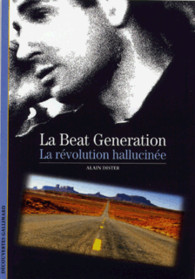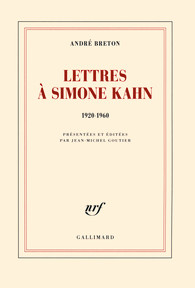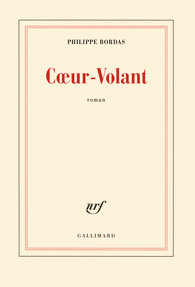Au cours des années noires, sous les feux croisés de la politique ségrégationniste de Vichy et des exigences allemandes, le sort terrible des Juifs de France fut tout sauf homogène. Le pire s’abattit sur ceux et celles qui ne possédaient pas la nationalité française ou se l’étaient vu retirer après juin 1940. Venus en grand nombre de Pologne, de Russie ou d’Allemagne dans l’entre-deux-guerres, ils avaient suscité quelques réactions de xénophobie, et même de l’inquiétude chez certains « Français israélites », tel Berl. Ce sont ces « étrangers » qu’on déporta prioritairement à partir de 1941, et plus massivement entre mars et décembre 1942, à la demande des forces d’Occupation. Des 80000 juifs de France qui ont été tués par les nazis durant l’Occupation, près de deux-tiers ne furent pas tenus pour nos concitoyens. « Nous livrons nos hôtes », résumait à chaud Maurice Garçon, pourtant hypersensible au problème de l’assimilation : les rafles l’ont horrifié plus que le statut des juifs, qu’il jugea néanmoins excessif, voire inutile, et animé surtout d’une jalousie qu’il avait pu observer chez ses confrères du barreau de Paris. Avocate comme lui, Anne Wachsmann le cite souvent à travers le récit où elle restitue, en mariant l’empathie à la distance, le destin de son père et de ses grands-parents, Juifs originaires d’Allemagne et de Pologne dont la ville de Strasbourg permit la rencontre. Après avoir connu les tensions consécutives au retour de l’Alsace dans le giron français, au lendemain de la première guerre mondiale, les familles Frank et Wachsmann quittèrent leur ville dès avant l’exode des populations que menaçait, en septembre 1939, la proximité de la ligne Siegfried. Depuis le Sud-Ouest où ils avaient été envoyés, certains des Alsaciens déplacés rentrèrent dés l’été 40, appâtés par les nouveaux maîtres de la France. Pas les aïeuls de l’auteure, évidemment… Indésirables, selon la terminologie nazie, étaient devenus les Juifs en pays rhénan. Sa famille resta donc en zone libre où régnait ce que Jacques Semelin a appelé une « schizophrénie administrative », entre persécutions et aides sociales, à l’égard de ceux qui, en zone occupée, portaient l’étoile jaune. Les grands-parents et l’arrière-grand-père d’Anne Wachsmann se plièrent aux réglementations induites par le statut des juifs et même aux recensements, formalité qui les exposerait, fin 1943 – début 1944, aux pires dangers : les Allemands, désormais répandus sur l’ensemble du territoire, ne faisaient plus de distinction. Pour ces hommes et ces femmes, français au regard de Vichy, mais obligés le plus souvent à se reconvertir professionnellement, la situation variait largement selon leur fortune personnelle, leurs réseaux et protections. Peu, on le sait, échappèrent aux contingentements drastiques imposés à la plupart des activités du secteur privé. Et beaucoup eurent recours aux faux papiers d’identité pour parer à une éventuelle arrestation, travailler ou simplement survivre. « Mon histoire n’a rien à voir avec la Shoah », écrit Anne Wachsmann. Elle n’en est pas moins édifiante, fascinante, et confirme ce qu’Annie Kriegel a pu écrire de la nécessité, pour comprendre l’Occupation, de multiplier les points de vue particuliers.
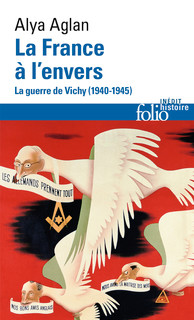
Le drame propre aux Juifs, malgré ses spécificités, doit aussi se comprendre à l’intérieur du drame des autres Français, ils furent loin, du reste, de s’être tous montrés indifférents aux premiers. Une saisie globale des années noires, par-delà ce qu’Alya Aglan nomme la « rivalité mimétique » (René Girard) de Pétain et De Gaulle, par-delà la légitimité de ce que nous croyons être aujourd’hui la seule attitude à adopter alors, met « en lumière le désarroi et la désorientation générale auxquels ont été confrontés ceux qui ont vécu cette période, propulsés dans les affres des choix qui ne sont pas toujours guidés par la cohérence d’une idéologie. » Tandis que le régime du Maréchal se donne les moyens d’une reconfiguration nationale bien hypothétique, après le traumatisme de juin 40, les forces dissolvantes de cette unité en reconstruction agissent partout, des ultras de la collaboration à la duplicité permanente des forces d’Occupation et aux exigences de plus en plus monstrueuses, en termes humains, financiers et matériels, de Berlin. En outre, en devenant mondiale à une échelle inusitée, comme y insiste l’appel du 18 juin, la guerre attise les déchirements internes, individuels et collectifs. « La France à l’envers » des années noires, ce n’est donc pas l’éradication simple et nette de l’héritage de 1789, vision simpliste, ce fut souvent la France des traverses, des voisinages dangereux ou équivoques, la France des ambiguïtés de guerre. Alya Aglan se sert même adroitement de Drieu et de Récit secret pour illustrer sa thèse d’une reconnaissance de l’affrontement fratricide qui tissait le quotidien et révélait, à son insu souvent, « une forme de connivence intime ». On pense aux premières pages du beau livre de Julian Jackson (La France sous l’Occupation, Flammarion, 2004) qui confronte cinq citations d’époque, révélatrices de certaines proximités de valeur entre des hommes aux choix différents : un résistant pétainiste, un pétainiste pro-britannique et anti-allemand, un pétainiste pro-juif et deux résistants antisémites… En somme, plus d’un demi-siècle a été nécessaire pour que l’analyse de l’Occupation allemande révise ses critères et sans doute son matériel de référence.

La France de l’après-guerre n’a pas recouvert d’oubli l’action de Vichy et de l’occupant envers les Juifs de France, quelle que soit leur nationalité. Bien que les déportés, dans leur cas, aient été malencontreusement qualifiés de « politiques » et distingués des résistants envoyés en camp, comme pour séparer les héros des victimes de l’Occupation allemande, il y eut bien place pour eux aussi dans la mémoire nationale, sujet qui obsède, à juste titre, François Azouvi, petit-fils de martyrs d’Auschwitz, neveu d’un combattant des maquis de Corrèze. Son ardeur n’en est que plus admirable à déconstruire le mythe du résistancialisme, narcotique que De Gaulle et d’autres voix de la libération auraient administré aux Français pour qu’ils oublient leur attitude sous la botte, et ignorent la réalité exacte des atrocités perpétrées alors. J’ai dit, en 2012, avec quelle force et quelle précision historique son précédent ouvrage, Le Mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire (Fayard) avait rétabli le mouvement d’indignation et de compassion que la découverte de la réalité concentrationnaire et des usines de l’extermination nazie suscita, en France, fin 1944-début 1945. Le nouveau volet de son diptyque a toujours pour objet le mythe du « mensonge consolateur » qu’ont colporté aussi bien les campus américains que nos intellectuels de salon, toujours prêts à salir « la France moisie ». C’était les belles années 1970, dans le ressac des idéologies et du maoïsme mondain, quand il fallut chercher d’autres responsables et d’autres crimes à dénoncer, Vichy n’était plus qu’une succursale de Berlin, la Shoah une invention française… De Gaulle, proclamait-on des deux côtés de l’Atlantique, continuait à mystifier les consciences et interdire une saisie des faits accablants. Français si vous saviez… titraient leur documentaire André Harris et Alain de Sédouy, dénaturant au passage une formule de Bernanos. En vérité, le moment Vichy fut moins occulté que sa complexité. Quant à l’héroïsation de la Résistance, très sensible dans l’après-guerre, elle ne servit pas à taire la multiplicité des comportements, leur ambiguïté fondamentale ou leur indignité. Azouvi s’intéresse à la mystique que les membres de « l’armée de l’ombre » ont souvent confessée en souvenir de leurs actes, mystique qui ne pouvait que peser sur les récits nationaux de l’après-guerre. « Mais quand on déplore que la France victorieuse ait préféré célébrer ses héros plutôt que de pleurer ses victimes, il y a l’idée implicite que les résistants ont contribué à l’effacement de la mémoire des Juifs. » Les preuves qu’accumule l’auteur viennent du champ politique comme du cinéma et de la littérature. Elles ne permettent pas d’oublier une réalité du temps, étrangère à son prétendu résistancialisme : « ce n’est pas la déportation des Juifs qui était inaudible, mais la déportation tout court en ce qu’elle confrontait les autres, les non-déportés, à l’inhumanité de l’homme. » Enfin, comme l’avaient noté Paulhan, Brice Parain et Maurice Genevoix à la lumière de la guerre de 14, il y a le traumatisme du rescapé, de celui qui n’aurait pas payé le prix fort.

Trop jeune pour s’être battu en 1914-18, trop vieux pour rejoindre l’active en septembre 1939, Saint-Exupéry, qui est né avec le siècle, ne se résigne pas à laisser cette guerre se faire sans lui, voire à prolonger le laxisme des puissances européennes, face à Hitler, depuis 1933. On donne donc des ailes au grand pilote de l’aéropostale, et il s’en sert à partir de mars 1940. Cette incorporation du devoir et de l’honneur le place en première ligne lors de la débâcle de mai. La seule solution, estime-t-il, ce n’est pas l’Angleterre dont il a ses raisons de se méfier, c’est la flotte aérienne de Roosevelt, un mur d’acier venu des États-Unis. Mais le timoré Paul Reynaud éconduit la proposition de l’écrivain. On connaît la suite. Six jours après que les Allemands eurent paradé dans Paris, il décolle en direction d’Alger. L’Afrique, l’empire, non Londres. Puis ce sera New York. De Gaulle, dont il se méfie et ne comprend pas le départ, ne lui pardonnera pas… Aux États-Unis, l’écriture le reprend, il veut dire, il doit dire l’absurdité, l’héroïsme désabusé, de la dernière mission qu’il avait accomplie, accompagné d’un mitrailleur et d’un observateur, au-dessus d’Arras, en basse altitude, afin de ramener à ses supérieurs des photographies inutiles. Du ciel, le monde d’en-bas n’est pas beau à voir, villages incendiés par les Français pour freiner l’avance irrésistible des Allemands, débâcle massive des futurs vaincus, routes engorgées de voitures alors que les panzers fondent sur leur proie. La langue est sèche, d’un atticisme ému. Saint-Ex ne s’est jamais tant dépris de l’oratoire, la phrase cingle, l’adjectif et l’adverbe sont évacués, les mots, comme orphelins, claquent avec la vigueur du désespoir ou du dérisoire. Cette mission de reconnaissance, quand la France s’est déjà perdue, son commandant ne trouve rien à en dire. « C’est comme ça. » Du pur Céline. Le pilote sacrifié et ses camarades s’habillent « pour le service d’un Dieu mort », Saint-Ex se sent « tout semblable au chrétien que la grâce a abandonné. » Malgré le feu nourri des boches, un vrai festival de lumière et d’acier, l’équipage s’en sort, mais la lutte contre le nazisme ne fait que commencer. De Pilote de guerre, son chef-d’œuvre, on ne retint que le diagnostic du chapitre XVII : la France n’avait pas assez cru en elle pour gagner, mais elle s’était épargné la honte de se livrer sans combattre. L’armistice, il fallait l’accepter comme un mal nécessaire, en somme. L’édition américaine au titre hollywoodien, Flight to Arras, ouvre la marche en février 1942 et indispose les exilés du surréalisme et leur morale d’embusqués. Après avoir contribué à l’agonie de la IIIe République et fui le théâtre des opérations, la bande à André Breton vomissait » le défaitisme réactionnaire » de Saint-Ex, un comble ! Gageons que ces messieurs ont été également indisposés par l’illustration de Bernard Lamotte, un élève de Lucien Simon comme Tal-Coat et Georges Rohner, illustration qui rappelle un peu le graphisme de Dufresne et Segonzac, et que nous sommes heureux de retrouver, voire de découvrir. Car Gallimard, qui fait paraître le livre en décembre 1942 sans les images de l’édition américaine, ne les avait utilisées jusqu’à aujourd’hui. Citoyen new-yorkais depuis 1935, défendu par la Galerie Wildenstein, Lamotte ouvre de grands ciels au-dessus de l’agitation des hommes, et propulse les avions de chasse au-dessus des blés. Quelques tanks y surnagent, à l’affût. Ailleurs, la guerre impose ses grandes fumées noires, son bruit assourdissant, ses cadavres d’architecture ou de soldats inconnus. Le destin français du livre réservait d’autres pugilats. Le 24 septembre 1942, Paul Morand informe un Gaston Gallimard très impatient que Vichy autorise la parution du brûlot en zone occupée. Le nettoyage de ce qui touche à Hitler opéré, le livre passe sous les radars de la censure allemande. Comme on a accordé à Gaston du papier en quantité, le tirage sera énorme et presque écoulé, par chance, au moment où il est retiré des librairies sous la pression de la presse collaborationniste. Cette contre-épopée « belliciste et philosémite », en raison du beau personnage de Jean Israël, révolte les lecteurs incapables d’y lire la flamme du plus pur patriotisme. Bousculé aux États-Unis pour ne pas avoir dénoncé l’arrêt des combats, Pilote de guerre tombait, chez nous, pour avoir plaidé la résistance à l’armée allemande. Tout le drame de ce livre de la dignité blessée était pourtant là.

Saint-Ex s’était abîmé en mer depuis fort longtemps lorsque De Gaulle remit les gaz. Au printemps 58, René Coty ne tenait plus la maison, l’Algérie, fierté de la France, était devenue son cauchemar. L’homme du 18 juin, à 67 ans, rempile et se découvre une âme de décolonisateur, pilule qu’il fait avaler à Michel Debré, son premier Premier ministre au sortir du référendum de septembre et de l’écrasement des communistes qui appelaient au non. En théorie, l’exécutif désormais régalien, c’est eux ; en pratique, c’est lui. Hugo eût écrit « Lui ». L’affaire algérienne est typique du monde de l’après. L’empire, c’est fini. Reste à savoir comment en sortir sans casse pour les colons et les colonisés. On ne peut pas dire que De Gaulle y ait réussi parfaitement… C’est l’autre aspect de cet événement exemplaire des temps nouveaux. Après avoir fait croire qu’il conserverait les choses en l’état, puis changé du tout au tout, le Président décide, pour ainsi dire, d’abandonner l’Algérie à son destin propre, se préoccupe peu des pieds-noirs et encore moins des harkis. Les accords d’Evian, en mars 1962, embrasent différemment les cœurs. De Gaulle avait dressé dos à dos l’O.A.S. et le F.N.L. auparavant. Résultat, une vague de violence qui aurait pu lui coûter la vie, et que n’apaisera pas l’Indépendance. Comme le résume Raphaëlle Bacqué, De Gaulle aura toujours maintenu l’action de l’État, en mystique du verbe incarnée, au-dessus des individus et des conséquences de ses choix politiques, aussi douloureuses soient-elles. Que retient-on encore de la plongée, évidemment passionnante, qui nous est proposée par la journaliste du Monde dans les archives de ces dix ans de pouvoir « autoritaire », comme on dit ? Pour être comprise, la geste gaullienne, souvent nécessaire et peu dictatoriale, a toujours besoin d’être réintégrée au tissu national et international de cet entre-deux-chaos. 1958-1968 : ce livre, par l’image et le document, des notes de discours et des rapports officieux aux agendas du monarque, en déroule le film haletant, hallucinant parfois, servi par la maquette de Sarah Martinon, à la fois neuve et délicieusement surannée. Bref, on s’y croirait. Tout commence par un cliché. Par sa raideur d’épée, le portrait officiel de février 59, dû au photographe Jean-Marie Marcel, évoque plus le Napoléon III de Winterhalter que le Jules Grévy de Bonnat. Un détail y fait mouche, les livres qui tapissent l’arrière-plan. A l’instar du grand Bonaparte, celui de 1799, le Président lit, et met de la littérature, c’est-à-dire du panache, et de l’esbroufe occasionnellement, dans sa pratique du pouvoir et son usage des médias. On lui reprocha jusqu’en mai 68 de les avoir confisqués à son seul profit, à sa seule survie. C’est très excessif. Les jeunes gens du baby-boom qui eurent la quinzaine au début des années 60 n’abusaient pas de la nuance. Ils voulaient consommer à plein, s’envoyer en l’air librement, musique, drogue et « bagatelle », pour user du délicieux mot de De Gaulle. Que ce dernier ait tenu tête aux Russes, aux Américains, aux Chinois et aux Israéliens quand il lui sembla impératif de le faire, qu’il ait imaginé une Europe soudée autour du couple franco-allemand et respectueuse du souverainisme de chacun, qu’il ait cherché l’équilibre entre la modernisation accélérée de la France et rappelé que le nucléaire ou la contraception ne suffisaient pas à fonder une morale, ceci ne lui fut pas toujours compté, comme bien d’autres fruits de ses deux mandats. La jeunesse yé-yé était plus soucieuse d’elle-même que de nos campagnes souillées ou des 5 millions de Français qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Au fond, elle voyait en Lui un autocrate épuisé et l’ennemi de l’esprit de jouissance. Un nouveau Pétain, en somme… Embarquant De Gaulle et le Maréchal dans une équipée aussi folle que l’Histoire, et aussi vraie que toute œuvre d’imagination, le prochain roman de Jean-Marie Rouart, Ils voyagèrent vers des pays perdus (Albin Michel, en librairie le 7 janvier 2021) ramène ses lecteurs dans l’Algérie de 1942 et les énigmes de la guerre avec une drôlerie qui nous arrache à l’excessive grisaille de la littérature actuelle. Nous en reparlerons, évidemment. Stéphane Guégan

Anne Wachsmann, Ces excellents Français. Une famille juive sous l’Occupation, préface de Jean-Louis Debré, La Nuée bleue, 25€ // Alya Aglan, La France à l’envers. La guerre de Vichy (1940-1945), Gallimard, Folio-Histoire, 11,50€ // François Azouvi, Français, on ne vous a rien caché. La Résistance, Vichy, notre mémoire, Gallimard, NRF-Essais, 24€ // Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de chasse, illustré par Bernard Lamotte, New York, 1942, postface d’Alban Cerisier, Gallimard, 32€. De la même collection, on se procurera, les yeux fermés mais les antennes déployées, La Métamorphose illustrée par Miquel Barceló (Gallimard, 45€), c’est-à-dire la plus géniale des nouvelles transformistes conjuguée au coup de patte du plus grand des peintres espagnols vivants. Le texte le hante depuis l’enfance sans l’égarer, ni l’avoir jamais apeuré. Là où d’autres reculent d’horreur ou de dégoût, il y savoure une forme de comique absolu, au sens où l’entendait Baudelaire. Du Cervantès moderne. Comment y répondre, y glisser son rire propre, sinon par la fantasmagorie la plus débridée, où l’humain se pare des beautés inquiétantes de l’insecte, l’insecte des apparences de son contraire, la peinture des prestiges oubliés de la salissure ou de la coulure, aux confins du sublime et de l’abject ? De la très belle ouvrage. // Raphaëlle Bacqué, De Gaulle Président. Dix ans d’archives inédites de l’Élysée, Flammarion, 35€.