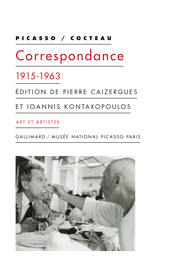Françoise Gilot avait prévenu son cher Jean Cocteau : « Il t’aime et te déteste. » Janusien, Picasso l’était jusqu’au bout des ongles, soignés par superstition, et acérés par plaisir. Sous l’Occupation, durant laquelle il fut le centre d’attentions diverses (et non de menaces, comme l’écrivent d’aucuns), le peintre soumit à un graphologue son écriture emportée et chaotique. « Aime intensément et tue ce qu’il aime ». Du Racine. Cocteau en fit vite les frais. Mais l’étrange amitié qu’il a entretenue désespérément, obstinément avec Picasso, et que Claude Arnaud examine sans littérature, dut peut-être au manque de feu initial son demi-siècle de joies et de souffrances. Rien de comparable aux coups de foudre suscités par Max Jacob et Apollinaire, si on s’en tient aux vrais poètes, aimés, délaissés, trahis avant lui… En 1915, Cocteau avait forcé la porte de Picasso, au risque d’en payer le prix fort un jour. Parade leur tint lieu de lune de miel, le mariage avec Olga, en 1918, de confirmation. Faut-il croire que Picasso ait été un peu jaloux ensuite de Radiguet, dont il a laissé un portrait rimbaldien ? Quoi qu’il en soit, au début des années 1920, estime Arnaud, ce n’est déjà plus ça. La première rupture approche, que précipitent ces dynamiteurs en chambre de surréalistes. Étriller Cocteau présente bien des avantages, on élimine un rival et on disculpe Picasso d’avoir trempé dans « le rappel à l’ordre » cher à l’excommunié. Or la réaction figurative du peintre, sa sortie du cubisme le plus étroit, fertile à son heure, était riche des développements futurs de l’œuvre. Nul autre que Cocteau ne pouvait autant se féliciter du virage qu’il avait favorisé. Quant à bénéficier de la gratitude de Picasso, il ne fallait pas y compter. Au cours des années 30, la correspondance est à voie et voix uniques. Cocteau, expert des soliloques amers, aime pour deux et, malheureux, rongé par l’opium, le fait savoir, aveu d’un besoin d’admiration, d’une attente lancinante, et peut-être d’un masochisme, dit Arnaud, qui ne demande qu’à se frotter au sadisme de Picasso, ajoute l’auteur. Le plus beau est qu’il y eut replâtrage. Entre juin 40 et la Libération, après une quinzaine d’années froides, le dégel débute ; les bonnes âmes, façon de parler, s’en étonnent ou s’en inquiètent. Comment Cocteau, le compromis, et Picasso, l’incorruptible, ont-ils pu frayer dans les mêmes eaux au cours de ces années qu’on dit « sombres » pour se débarrasser de leur ambiguïté ? Arnaud ne craint pas de dissiper de tenaces légendes. Pas plus que Cocteau, Picasso accepte de laisser la culture dépérir sous la botte allemande, et l’on sait depuis peu que don Pablo s’est enrichi à millions alors. Moins fortuné, quoique aussi actif, le poète subit davantage les attaques de la presse bienpensante. En rejoignant le P.C.F. fin 1944, Picasso confirme et conforte son souhait de rester dans la lumière. Cocteau, pour demeurer en cours, doit avaler la mue communiste de son « ami » (« son premier acte antirévolutionnaire »), les leurres de la Pax sovietica et les veuleries de 1956. Son Journal, en silence, étrille « le camarade Picasso », son mélange de lâcheté et de tyrannie. Mais l’amour l’emporte encore sur les moments de dégoût, la vénération sur la détestation. Stéphane Guégan
*Claude Arnaud, Picasso tout contre Cocteau, Grasset, 2023, 20,90€.
D’AUTRES ÉTOILES, D’AUTRES PICASSERIES…

Faisons un rêve ! Sarah Bernhardt, lasse d’être mitraillée par les portraitistes mondains de son temps, ou lapidée par la caricature quelquefois antisémite, se tourne vers Picasso, le nouveau siècle appelant de nouvelles images. La femme la plus maigre de son royaume, au dire de Zola, fait don de sa sveltesse et de ses yeux de braise aux cristallines sécheresses du cubisme. Devenu le Boldini de son temps, l’Andalou l’eût étirée, dilatée et presque fragmentée, au-delà de ce que Georges Clairin s’était autorisé dans le fameux tableau (notre ill.) du Salon de 1876… « Comme si l’exposition du Petit Palais n’était pas assez riche, fastueuse, merveilleusement diverse et théâtrale », me répondent ses commissaires ! On ne saurait le nier. Il fallait, du reste, que cet hommage ressemblât à la vie inhumaine, extraterrestre, de la divine, à cette mise en scène de soi, même loin des planches, aux métamorphoses que réclamaient le drame et le public, aux amours de toutes sortes qu’elle accumulait, à la présence démultipliée que lui assuraient les médias de son temps, jusqu’au cinéma, qui fit d’elle l’un de ses astres, l’une de ses stars plutôt, puisque l’adoubement de l’Amérique et des dollars était passé par là. « Quand même », était sa devise. Qu’on m’aime, disent l’écho et le visiteur d’un parcours qui combine la méthode et l’ivresse, à l’image d’une carrière menée avec l’opiniâtreté des femmes que le génie et le destin propulsent hors de leur sphère d’origine. Juive des Pays-Bas, la mère de Sarah, galante de la Monarchie de Juillet et du Second empire, l’a fait baptiser et élever au couvent. On croirait lire un livret d’opéra, d’autant plus que l’enfant semble s’être imaginée devenir nonne. Le duc de Morny, protecteur des jeunes filles à tempérament, met fin aux désirs de claustration. Elle a 15 ans, entre au Conservatoire, Nadar fixe un visage aux yeux d’amande, aux lèvres volontaires, sous la crinière sombre d’une lionne prometteuse. Les difficultés de sa carrière naissante ne résisteront pas à l’énergie évidente de l’adolescente, à son charme, qu’elle sait mettre à contribution, comme le registre des courtisanes de 1861-1876 nous l’apprend. La fiche d’identification est assortie d’une photographie, qui restera sa grande alliée. L’année terrible ne retarde que peu l’explosion, Ruy Blas, Phèdre, les pièces de Sardou et Rostand semblent avoir été écrites pour elle, certaines le furent. Mucha et ses affiches mobilisent un public, abattent les frontières. A sa mort, en 1923, un an après Proust qui en fit sa Berma, des milliers de fanatiques lui rendent un dernier hommage en se pressant chez elle. Son fils, prince de Ligne par son père (naturel), mais beaucoup moins dreyfusard que sa maman, donnera plus tard au Petit Palais le chef-d’œuvre de Clairin. C’est le roi de la fête. Il occupe le centre magnétique d’une scénographie à vagues successives. Zola, que l’affaire Dreyfus devait rapprocher de l’actrice, apprécia peu la toile en 1876, le corps de Sarah y disparaissait trop sous les sinuosités serpentines d’une robe sans corset, et la vérité du visage s’effaçait derrière un minois « régulier et vulgairement sensuel », digne de Cabanel. Avec son canapé rouge et ses coussins jaunes, Clairin rappelait, en outre, les tapages chromatiques de feu Regnault, son ami, mort en janvier 1871. Zola, l’ami de Manet, cherchait Victorine Meurent là où nous goûtons Gloria Swanson. SG /// Annick Lemoine, Stéphanie Cantarutti et Cécilie Champy-Vinas (dir.), Sarah Bernhardt. Et la femme créa la star, Paris-Musée, 39€. L’exposition est visible jusqu’au 27 août 2023.

Le 23 juin 1912, depuis Sorgues, Picasso annonce à Kahnweiler son intention d’aller « au théâtre voir Sarah Bernhardt dans La Dame aux camélias », non la pièce (comme on l’écrit parfois), mais le beau et nouveau film d’André Calmettes. La vamp de plus de 60 ans y incarne les fraiches courtisanes avec l’aplomb érotique d’une débutante. Imaginons une salle de cinéma, à Avignon peut-être, Picasso et Eva Gouel au premier rang, sous le choc de la double magie, Marguerite au grand cœur blessé et les ombres si vivantes de l’écran. La mort de l’héroïne remua-t-elle le peintre si friand, dit-on, des souffrances du deuxième sexe ? Le monstre connut-il alors un de ces émois répréhensibles, même en pensée, même en art ? L’ogre a presque cessé d’être un animal politique ou presque… Le célèbre pamphlet royaliste de Chateaubriand désignait ainsi, à sa chute, un certain général corse, devenu tyran et anthropophage. Grâce à Picasso, objet du lynchage médiatique que l’on sait, le mot a retrouvé des couleurs, plutôt vives. Lui, nous dit-on, se nourrissait exclusivement de femmes, de plus en plus jeunes avec le temps. Laurence Madeline consacre un livre, vif aussi, à huit d’entre elles. C’est une de plus que la légende n’en attribue à Barbe-Bleue, mais le XXe siècle, au théâtre, puis au cinéma (merveilleux film d’Ernst Lubitsch), ne s’est pas privé de modifier la comptabilité de Charles Perrault. On sait que l’écrivain du Grand siècle avait voulu croquer à touches sombres un modèle parfait de cruauté, un fétichiste morbide, plus qu’un érotomane insatiable, sens aujourd’hui privilégié. Il ne se déroule pas un jour sans que Picasso ne se voie attribuer le nom de l’égorgeur ou qu’une manifestation, une performance ne salue le terrible destin de ses victimes. Les hostilités ont, d’ailleurs, commencé bien avant l’ère Me too. « Les femmes du diable », titrait Elle en 1977, le magazine « féminin » confirmait son tournant « féministe ». La diabolisation n’aura fait qu’empirer, et le besoin de ne pas y céder bêtement aussi. Où situer le curseur, se demande Laurence Madeline, qui ne ménage pas le machisme picassien, ni ce que le polygame espagnol fit endurer aux huit compagnes et épouses ? On ne se débarrasse pas facilement des approximations, demi-vérités et autres mensonges en libre accès sur les réseaux de la doxa criminalisante. Au lieu de nous asséner péremptoirement ses conclusions, son livre tisse ensemble huit courtes enquêtes, aussi documentées que possible, aussi variées que le furent ces liaisons dangereuses, et différentes « les femmes de Picasso ». Remercions l’auteure de leur redonner vie, de renseigner leur existence, de cerner chaque liaison dans sa vérité propre, quand la victimisation actuelle les réduit au statut de martyres passives, interchangeables. Germaine, Fernande, Eva, Olga, Marie-Thérèse, Dora, Françoise et Jacqueline ne furent pas de simples prénoms, bonnes à baptiser les périodes stylistiques du maître. Malgré la priorité qu’il donna toujours au travail et à sa personne, choix nécessairement destructeur en terrain vulnérable, Picasso ne fit pas de la cruauté le seul moteur de sa biographie amoureuse. Et son art, reflet supposé des viols et violences qui auraient composé son ordinaire, exige d’être interprété en fonction de sa part fantasmatique et souvent auto-ironique. Lui tenir tête n’était pas chose aisée, d’autres que Françoise pourtant y parvinrent. Car il était capable de tout, de déloyauté, de lâcheté, de brutalité, comme d’attentions, de tendresse et de passion, un temps, entre deux tableaux. Fernande Olivier, en 1957, avouait lui devoir « mes plus belles années de jeunesse ». Sous l’idéalisation du souvenir, le cri du cœur. SG /// Laurence Madeline, Picasso. 8 femmes, Hazan, 25€. A réécouter : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/signes-des-temps/cinquantenaire-de-la-mort-de-picasso-peut-on-separer-l-homme-de-l-artiste-9830416 / A voir : https://www.arte.tv/fr/videos/108957-000-A/picasso-sans-legende/

Prise en tenaille par le rapport Khrouchtchev et l’écrasement de la Hongrie, 1956 fut une annus horribilis pour les communistes français et leurs compagnons de route. Si L’Humanité ne perd pas le sourire, rompue qu’elle est aux tueries et aux purges du grand frère russe, les intellectuels tirent en masse leur révérence. D’autres ménagent le choux et la chèvre. A rebours de Roger Vailland et Claude Roy, Picasso se borne à manifester sa perplexité avec tact, un modèle d’habileté, que Maurice Thorez ne digère pas toutefois. Le peintre n’en est pas moins intouchable… Quoi qu’il ait condamné la saignée de la Hongrie et dénoncé les agissements de « la bureaucratie soviétique », Sartre tape aussi fort, voire plus fort, sur oncle Sam, les atlantistes, le gaullisme et ses séides. Situations VIII couvre une période hautement troublée, elle débute aux lendemains des événements de Budapest, et court jusqu’aux bilans déçus de mai 68. Le Sartre de l’hiver 1956 n’est pas encore pleinement acquis à la critique ouverte du bolchevisme historique. Lénine, cet ami du peuple, lui inspire encore de mauvaises pensées, la certitude, par exemple, qu’il est des politiques, des violences, que telle situation historique, justement, rend « inévitables ». Invoquer la guerre froide, justifiât-elle l’impérialisme soviétique, permet à notre dialecticien d’adoucir sa prise de distance : le printemps de Prague, douze ans plus tard, met définitivement fin à cette mascarade en lui donnant l’occasion, autre audace, de dialoguer avec les romans de Kundera (et accessoirement le Rêveuse bourgeoisie de Drieu). Entretemps, Situations VIII, document capital, aura accroché à son tableau de chasse le Vietnam (et l’étonnante aventure du Tribunal Russell), la colère étudiante (et la contestation des cours magistraux qu’il fait sienne en bousculant à la manière des potaches Raymond Aron), les violences policières (qu’il aborde avec l’imperturbable duplicité de la gauche caviar vis-à-vis de « l’oppression bourgeoise »), l’utopie d’une recomposition du paysage politique, que rendraient nécessaires Mai 68 et l’effritement de l’appareil du PC. Le dernier Sartre se cherche, mais les futures dérives se pressentent à sa façon de penser et destituer l’autorité sous toutes ses formes. Quand le refus inconditionnel de l’ordre se mue en doctrine, en dogme, le danger de l’extrême-gauche pointe son nez. De la conscience et de ses libertés, Sartre paraît ne plus se soucier. Rares sont les exceptions où, au détour d’une des interviews dont il inonde la presse de son cœur, un semblant de remords nous surprend. Au micro de New Left, en janvier 1970, il s’oublie, le temps d’avouer qu’il aimerait se pencher sur « les raisons pour lesquelles j’ai écrit exactement le contraire de ce que je voulais dire ». Vivement Situations IX et X. SG /// Jean-Paul Sartre, Situations VIII, novembre 1966-janvier 1970, nouvelle édition revue et augmentée par Georges Barrère, Mauricette Berne, François Noudelmann et Annie Sornaga, Gallimard, 23€. Nos recensions précédentes : Situations II, Situations III, Situations IV, Situations V, Situations VI et Situations VII.

De même qu’on parle de la culture de Montmartre au sujet de Toulouse-Lautrec, la peinture de Basquiat gagne à être comprise parmi les sons, les contorsions et les convulsions du New York « dirty », « arty », de la fin des années 1970, ceux et celles qui rythment et désaccordent Downtown 81. Glenn O’Brien, auquel ce film doit d’exister et le peintre d’avoir décollé, aime à rappeler que son ami Jean-Michel connaissait Miles Davis, John Coltrane et Charlie Parker aussi bien que Picasso, Duchamp et Pollock. Parade, son dispositif scénique et la partition de Satie vivaient en lui à la manière de l’œuvre totale à réitérer, de sorte qu’il signa en 1988, l’année de son overdose mortelle, le rideau de Body and Soul. L’industrie du spectacle, la plus redoutable au monde, avait déjà figé la grâce des commencements et accouché de leur caricature inoffensive. Je suis de ceux qui préfèrent aux « tableaux à quatre mains » de Basquiat et Warhol, incapables de jouer la même partition et d’échapper au BCBG, les œuvres qui se voient à la Cité de la musique, et presque s’entendent. Dans le bas de Manhattan, où le Mudd Club fidélisait une faune internationale encore décalée, l’économie parallèle des petits malins opérait aux marges de la ville en faillite. New York ressemblait chaque jour un peu plus aux images du Vietnam que la télévision venait de déverser sur l’Amérique. Certaines toiles de Basquiat se tapissent de bombes, de mots, d’onomatopées, de signes en tout genre, le tout formant une musique qui n’appartient qu’à la peinture, celle qui produit le sonore au lieu de le traduire. C’était affaire de ponctuation visuelle, de syncope spatiale, d’invasion aérienne, de litanie mystérieuse. Malgré une tendance à la fusion, dont témoignent les milliers de vinyles où Basquiat réinventait l’orphisme des anciens, le jazz des années 1940-50 devient vite la référence majeure. Il imprime des façons d’être, de se vêtir ou de jouer. Avant de se réinventer en peintre des opprimés, en chantre d’une nouvelle négritude, Basquiat fut poète et musicien errant, sans autre prétention que de faire chanter son nom de code, le fameux Samo, et ses haïkus. Première exposition à se saisir du sujet et à en approfondir la connaissance, notamment par les nombreux entretiens qu’abrite le catalogue, Basquiat Soundtracks s’ouvre à la culture de Harlem, domaine de recherche très actif, et sujet d’une prochaine exposition du Met de New York. Au titre des rapprochements à creuser, peut-être ne serait-il pas inutile de se préoccuper davantage du graphisme des disques en provenance alors de Londres. Basquiat, quoique portoricain et haïtien, poussait le snobisme à se dire plus américain qu’européen. Rien, par chance, ne nous oblige à croire ce sampleur fait peintre. SG /// Vincent Bessières, Dieter Burchhart et Mary-Dailey Desmarais (dir.), Basquiat Soundtracks, Gallimard/Philharmonie de Paris/Musée des beaux-arts de Montréal, 39€. Visible jusqu’au 30 juillet.
Lecture théâtralisée · Manet, Degas – Une femme peut en cacher une autre
Manet, Degas – Une femme peut en cacher une autre de Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat
Musée d’Orsay, dimanche 11 juin 2023, 16h00 / Samsa éditions, 8€.

Guillaume Durand
© Marie Grée
L’exposition « Manet / Degas » incite le visiteur à se poser la question de la convergence, de la parenté et de la complémentarité entre deux figures données. Chaque commissaire de l’exposition invite deux personnalités de son choix pour dialoguer librement avec elles, à partir de leur champ de création. Écrivains ou artistes disent de quelle manière ils se confrontent à l’histoire de l’art qui les a précédés.
Guillaume Durand, journaliste et écrivain, est l’auteur de Déjeunons sur l’herbe publié en 2022 aux éditions Bouquins. Pour cet ouvrage, il a reçu la prix Renaudot essai. Lui et Stéphane Guégan, commissaire de l’exposition « Manet / Degas », dialogueront le temps d’une soirée.
Jeudi 4 mai 2023, à 19h00, Musée d’Orsay, auditorium.