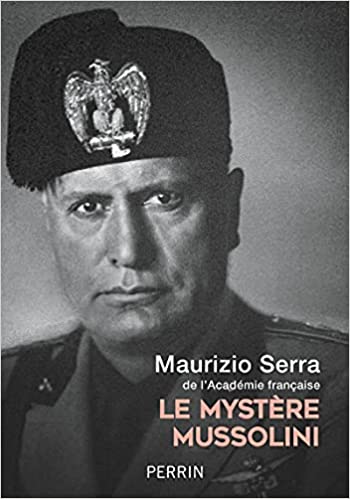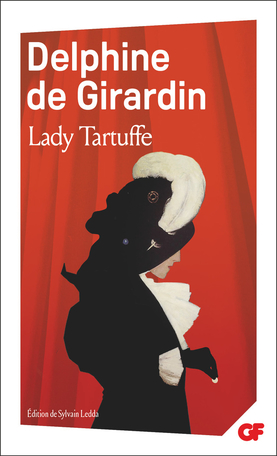
D comme… Féminisant et métamorphosant Tartuffe en 1853, Delphine de Girardin (1804-1855) n’annexe pas le chef-d’œuvre de Molière au sectarisme, souvent puritain, de certaines féministes de son temps, et du nôtre. La dénonciation du sexisme systémique eût insulté sa connaissance du monde et sa conception du théâtre. Elles se rejoignent précisément dans ce tableau des mœurs contemporaines où son pinceau superbe, coloré et drôle, moliéresque, s’abstient de « corriger la société ». Rire et faire rire de celles et ceux qui font profession de vertu suffit à sa tâche. Le mal et le bien, comme le soulignait déjà la Delphine de Germaine de Staël en 1802, ne sont pas de chimie pure, ils n’en gouvernement pas moins nos destinées, variant selon les individus, les circonstances, capables de renversements spectaculaires dès que le don de soi, c’est-à-dire la vraie charité, vous révèle à vous-même et dissout l’hypocrisie ambiante. En apparence, Madame de Blossac agit en fonction de ce que lui dicte un cœur sans limites ; en vérité, cette sainte, enlaidie et prude par ruse, cache une intrigante prête à tout pour conquérir une position que son sexe et son peu de fortune rendent moins accessible. Delphine de Girardin, pour se méfier des suffragettes, n’ignore pas les difficultés inhérentes à la condition féminine. Son coup de génie est de ne pas y enfermer les femmes de sa pièce, autrement énergiques que les hommes, et de ne pas excuser la faute de son héroïne par la force des entraves sociales. L’autre originalité de Lady Tartuffe, si irrésistible envers le cant trompeur des élites et des philanthropes d’occasion, tient à sa chute hugolienne, le contraire même des comédies à thèses. Du reste, la sienne s’élève au tragique, comme Rachel, pour qui le rôle fut écrit, l’a magnifiquement traduit sur les planches. L’amour vrai peut prendre tous les masques et « l’attrait de l’abîme » tenter les êtres les plus corsetés. Eminent connaisseur de la scène romantique, du texte aux acteurs, de la création à sa réception, Sylvain Ledda signe l’excellente édition d’un ouvrage que Gautier couvrit d’éloges et qui connut le succès. Digne d’être comparée à Dumas, Musset et même à Balzac, Lady Tartuffe, reprise aujourd’hui, désennuierait bien des salles parisiennes, agrippées au nouveau cant comme au graal.

E comme… L’Eros féminin n’est pas absent de la littérature masculine, qui reconnaît bien volontiers sa singularité et la difficulté de la percer. La passion, le désir, la jouissance et la frustration, avant d’ondoyer au flux des genres, ont une réalité biologique. Il est naturel que l’écriture en possède une également, et il est ainsi légitime de parler d’écriture féminine en matière amoureuse. Les 1500 pages de cette anthologie rose, doublement rose même, rayonnent de cette vérité aujourd’hui attaquée de toute part. Le paradoxe est qu’elle le soit souvent au nom de la libération des femmes. Romain Enriquez et Camille Koskas, d’un pas décidé, foulent donc un terrain dangereux. Ne les soupçonnons pas d’avoir plié devant la vulgate, et concédé à l’air du temps une partie de leur sommaire bien réglé, notamment son ultime moment, dévolu aux « regards militants sur l’Eros », autant dire à la guerre des sexes et aux violences masculines. Car nos ébats et nos débats sont bien lestés d’une indéniable continuité historique. Christine de Pizan, au début du XVe siècle, s’emporte contre les étreintes forcées et même ce que notre époque nomme « la culture du viol », généralisant à l’extrême et oubliant ce qui sépare les jeux de l’amour des crimes odieux. La brutalité masculine, objet de maintes gloses puisque sujette à variantes, n’est qu’un des nombreux thèmes du volume, ouvert à tous les sentiments et toutes les pratiques, soucieux des minutes heureuses et des transports douloureux, accueillant à la pudeur et à l’impudeur, à l’humour comme au silence des mots, conscient enfin de l’évolution des comportements. Aucune frontière n’a freiné nos deux compilateurs et fins analystes. Certaines, les géographiques, s’évanouissaient d’elles-mêmes, l’ailleurs et l’autre étant les meilleurs alliés de Cupidon ; d’autres craintes, d’autres liens, tel celui du charnel au sacré, traversent ce massif de textes souvent peu connus. C’est le dernier compliment qu’il faut lui adresser. George Sand, Marie d’Agoult, Judith Gautier, Rachilde, Renée Vivien et Colette l’unique y siègent de droit. On est surtout heureux de faire la connaissance des « oubliées dont l’œuvre est parfois rééditée ici pour la première fois », Félicité de Choiseul-Meuse, « autrice » peu rousseauiste de Julie ou J’ai sauvé ma rose (1807), ou Faty, SM anonyme, à laquelle on doit des Mémoires d’une fouetteuse restés sans lendemain. La préface nous apprend qu’Annie Ernaux n’a pas souhaité figurer dans cette anthologie où l’on regrette davantage l’absence de Marie Nimier, qui sait être crue et joueuse, joyeuse, chose rare.

L comme Longhi… Après avoir été son modèle dominant, la peinture est devenue la mauvaise conscience du cinéma au temps de sa majorité. Et l’invention du parlant n’aura fait qu’aggraver la dépendance coupable de la photographie animée et sonore aux poésies immobiles et muettes. Elève de Roberto Longhi au crépuscule du fascisme italien, un fascisme dont on préfère oublier aujourd’hui qu’il était loin de partager l’anti-modernisme des nazis, Pasolini n’a jamais coupé avec la peinture, ni accepté la séparation entre les anciens et les modernes. Elle n’avait, d’ailleurs, aucun sens pour Longhi, que Piero della Francesca a retenu autant que Courbet et Manet. Et les derniers films du disciple, à partir de Théorème (1968) et du tournant figuratif qu’il marque, se signalent par l’irruption de Francis Bacon et même, au cœur de Salo (1975), de Sironi et du futurisme. Dans l’une des innombrables scènes de cette allégorie pesante de l’ère mussolinienne, un tableau de Giacommo Balla appelle le regard du spectateur, Pessimismo e Ottimismo. La toile de 1923, contemporaine des tout débuts du Duce, dégage son sujet, éternel et circonstanciel, d’une simple opposition de couleurs (le noir et le bleu) et de formes (tranchantes ou caressantes). Pasolini montre, il ne démontre pas, importe la subtilité de la peinture au cœur d’un médium réputé plus assertif. Il était tentant d’arracher ses films aux salles obscures et d’en tirer le matériau d’une exposition riche des sources qu’il cite jusqu’à l’ivresse d’une saturation boccacienne. Guillaume de Sardes et Bartolomeo Pietromarchi, furieusement iconophiles, ne s’en sont pas privés. L’une des plus hautes séquences de l’art italien, qui s’étend de Giotto au Caravage, en passant par Masaccio, Vinci, Michel-Ange, Bronzino et Pontormo, a durablement hanté Pasolini et provoqué une folie citationnelle très picassienne. La composante érotique de ce mimétisme saute aux yeux tant elle fait vaciller l’écran et rappelle que le cinéaste, ex-marxiste repenti, a vécu son art et sa sexualité en catholique, heureux d’affronter symboliquement le mal dans sa chair et sur pellicule, afin d’en dénoncer les avatars historiques, l’existence sans Dieu, le technicisme éhonté, le retour inlassable des guerres.

P comme... La langue des Fleurs du Mal et une certaine pratique du sonnet remontent à Ronsard, dont le nom évoque désormais une manière de sentir (les émotions) et de sertir (les mots). Il est aussi devenu synonyme d’un moment poétique soumis aux aléas du temps. La renaissance de la Renaissance date du romantisme. En 1828, le fameux Tableau historique de Sainte-Beuve, citant A Vénus de Du Bellay, résume les causes de la résurrection dont il se fait l’agent et que la génération suivante allait rendre définitive : « On y est frappé, entre autres mérites, de la libre allure, et en quelque sorte de la fluidité courante de la phrase poétique, qui se déroule et serpente sans effort à travers les sinuosités de la rime. » Les poètes de La Pléiade, ce groupe à géométrie variable, sont-ils sortis des habitudes de lecture au cours des XVIIe et XVIIIe siècles ? Ils firent sur Hugo, Musset, Gautier ou Banville l’impression d’une source fraîche, trop longtemps écartée des salles de classe, en raison de leurs licences de forme et de fond. Même l’histoire de la censure confortait les cadets dans l’admiration des poètes d’Henri II. Le Livret de folastries de 1553, où sont impliqués Ronsard, Muret, Baïf et Jodelle, se pare d’une bien discrète feuille de vigne, deux lignes du grand Catulle : si le poète peut choisir d’être chaste, ses vers n’y sont en rien tenus, disaient-ils en substance. On brûla l’ouvrage délictueux, qui s’était déjà diffusé. En 1862, sa réédition subit le même sort pour ainsi dire, la condamnation des Fleurs du Mal était toute proche. L’inspiration de La Pléiade, si tant est que ce générique ait un sens, ne se réduit pas aux plaisirs vénusiens, loin s’en faut. Mais une nouvelle liberté de mœurs trouve là matière à mignardise et anacréontisme, exaltations et regrets, quand l’heure n’est plus à folâtrer. Le volume qu’a conçu Mireille Huchon, aubaine des lecteurs affranchis, florilège dont chaque notice rend plus savant, satisfait d’autres attentes : le règne d’Henri II (1547-1559), dont la salle de bal de Fontainebleau nous rappelle les magnificences, voit s’affirmer une politique de la langue qui vient de François Ier et aboutit à Richelieu. Tout un pan du présent recueil en découle, les poèmes de circonstance, bien sûr, et les traités de poétique, certes horaciens ou cicéroniens, qui plaident et servent, par leur beauté propre, un élargissement de l’idiome national. Cette embellie du lexique ne tient pas du mythe. Avant Baudelaire et ses vocables empruntés à la peinture ou aux chiffonniers, Ronsard et les siens agirent de même avec le grec, le latin, l’italien, l’espagnol et les termes techniques de leur temps. De vrais modernes.

H comme… Héliogabale est à l’imaginaire du premier XXe siècle ce que Néron fut aux représentations du précédent, le bouquet superlatif des crimes dont l’humanité se rend capable, un monstre à partir duquel penser le politique et l’homme vacille. Porté sur le trône à 14 ans, assassiné en 222, au terme d’un règne bref qu’on pensait aussi illégitime qu’indigne, il illustrait le concept pascalien de tyrannie, soit la force sans la justice. Le réexamen de ses méfaits est tout récent. Quand Jean Genet se saisit du sujet, l’historiographie dérive du passif accablant des sources anciennes. On sait aussi qu’il a été très impressionné par le livre qu’Artaud avait consacré à l’empereur dé(ver)gondé. Quoi de plus tentant pour un néophyte ? Au printemps 1942, Genet, 32 ans, se mue en écrivain sous les fers. C’est sa huitième incarcération et, en cas de récidive, le bagne l’engloutira, lui et ses amours masculines, lui et ses rêves de poésie. Car ce petit voleur, pas toujours adroit, pas toujours droit non plus, a des lettres et, tout de même, une conscience. Poésie, roman et théâtre, il les embrasse tous avec une fulgurance de style difficile à contrôler. En amoureux des classiques, il retient pourtant le lyrisme qui bouillonne en lui et que réclame l’époque de l’Occupation. « Boileau hystérique », disait-on de Baudelaire au soir de carrière. Au début de la sienne, Genet serait plutôt un « Racine dépravé ». Héliogabale, pièce que l’on pensait perdue et dont l’exhumation fait « événement », comme l’écrivent François Rouget et Jonathan Littell, c’est un peu Britannicus réécrit par Rimbaud, Verlaine, ou Léon Bloy. Sur l’empereur deux fois déchu, abandonné aux égouts après avoir été égorgé dans les latrines de son palais, Genet ne projette pas uniquement ses lectures et son désir d’écrire un drame antique (qu’il voulait confier à Jean Marais). Si la folie du pouvoir illimité y apparaît dans sa nudité tragicomique, le (faux) fils de Caracalla personnifie surtout une déviance sexuelle, un appétit de vie et une fascination de l’abject que la duplicité des mots permet d’exalter ou de transfigurer en feignant de les condamner. Si cette farce ubuesque avait eu droit aux planches sous la botte, elle eût effacé ses apparents semblables, de Sartre à Camus, en passant par Anouilh. Le boulevard se frotte à la toge, la verve populaire au grand verbe. La grâce à laquelle Héliogabale aspire entre deux turpitudes, deux boutades assassines, ou deux auto-humiliations, n’aura pas le temps de l’atteindre. Genet pourtant le fait mourir en romain (le glaive de son amant) et en chrétien : « Tu n’es plus qu’une couronne d’épines », lui dit Aéginus, avant de le frapper.

I comme Italie… Tempérament de feu et marchand proactif, Léonce Rosenberg n’a besoin que de quelques mois, entre mars 1928 et juin 1929, pour métamorphoser son nouvel appartement en vitrine de l’art moderne. Quelques noms, certes, manquent à l’appel, Bonnard et Matisse, qui appartiennent à Bernheim-Jeune, Braque, qui l’a molesté lors des ventes Kahnweiler, ou encore Picasso qui s’est éloigné et lui préfère son frère Paul, après l’avoir portraituré, vêtu de son uniforme, et lui avoir vendu L’Arlequin grinçant du MoMA, le tout en 1915. Deux ans plus tard, la figure sandwich du manager français de Parade, roi de la réclame, serait une charge de Léonce, à suivre la suggestion suggestive de Juliette Pozzo. Que voit-on, dès lors, sur les murs du 75 rue de Longchamp, immeuble des beaux quartiers, peu préparé à recevoir l’armada d’un galeriste œcuménique. En effet, sa passion du cubisme ne l’a pas détourné du surréalisme narratif, voire sucré, et des réinventeurs de la grande peinture, De Chirico et Picabia, las des culs-de-sac de l’avant-garde. A moins d’être aveugle, le visiteur du musée Picasso, où l’ensemble a été reconstitué et remis en espace avec soin et panache, plébiscite immédiatement nos deux renégats. A leur contact, Léger, Metzinger et Herbin semblent d’une terrible sagesse, Jean Viollier et Max Ernst d’un onirisme inoffensif. L’alternance de temps forts et de temps faibles, d’où l’exposition tire aussi sa nervosité, se conforme à la stratégie commerciale de Rosenberg et à son sens de la décoration intérieure, de même que le mobilier Restauration ou monarchie de Juillet. Le hall d’entrée remplit son besoin d’ostentation avec les gladiateurs mi-héroïques, mi-ironiques, de De Chirico ; la chambre de l’épouse de Léonce se remplit elle des transparences érotiques de Picabia, salées ici et là de détails insistants. Rosenberg a les idées larges et l’intérêt qu’il porte au régime mussolinien d’avant l’Axe, à l’instar de son ami Waldemar-George, juif comme lui, mériterait d’être plus finement analysé qu’il n’est d’usage aujourd’hui.

N comme… Les confidences, Marie Nimier ne se contente pas de les susciter, elle aime les provoquer, en manière de réparation. Il y a quelques années, en Tunisie déjà, lors d’une signature de librairie, une femme s’approche et l’invite à la revoir le lendemain, autour d’un couscous au fenouil. Elle veut lui parler de son frère, de « mon frère et moi ». Mais l’auteur de La Reine du silence, pressentant des aveux « trop lourds à porter », recule et monte, soulagée et coupable, dans l’avion du retour. Les années passent, les régimes politiques changent, le mouvement de libération des femmes s’intensifie dans l’ancien protectorat français, la question religieuse devient plus saillante… Les langues ne demanderaient-elles pas à se délier, de nouveau, à l’ombre de l’anonymat ? Le souvenir de la femme éconduite, du couscous manqué, a creusé entretemps son sillon. Que faire sinon retourner en Tunisie et recueillir les histoires des « gens sans histoires », au café, par internet ou par l’entremise, comme chez Marivaux, de « petits billets » ? Point de dialogues, juste des monologues. Marie Nimier se méfie des interrogatoires, dirigés en sous-main, les sondages de notre fallacieuse époque l’ont vaccinée. Le résultat est magique, simplicité des destins racontés en confiance, fermeté de la langue qui refuse aussi bien la neutralité clinique que la surchauffe sentimentale. Les propos recueillis, quand le rire du confident ne libère pas l’atmosphère, auraient pourtant de quoi ébranler la distance que s’impose Marie Nimier. Chaque confession forme un chapitre, en fixe la durée, le ton, le degré d’intimisme, le risque encouru. Le courage qu’il faut à ces femmes et ces hommes s’ajoute à leurs motivations de parler, et de parler de tout, l’emprise du social, le poids de la famille et des traditions, la sexualité dans ses formes diverses, conquérantes, clandestines, malheureuses, farfelues ou tristement mécaniques chez les plus jeunes, condamnées à réserver leurs fantasmes aux écrans d’ordinateur. Le lecteur referme le livre de Marie Nimier plus riche de couleurs, de senteurs, d’autres relations au corps, du sourire de cet enfant oublié dans un orphelinat, qui sait que pleurer est inutile, et de ce jeune homme, malade du sida, à qui l’on vient d’apprendre qu’il ne saurait contaminer sa famille, et qui se redresse à l’appel de la vie retrouvée.

E comme écriture… Gautier disait qu’on voyage pour voyager. Partant, on écrit pour écrire, pour mettre sa vie en récit et en musique. Le Chant des livres, titre rimbaldien du dernier Gérard Guégan, doit s’entendre dans les deux sens, l’écrivain et le lecteur sont liés par l’écoute, une sorte de pacte qui doit rester mystérieux, un dialogue que le texte appelle sans l’épuiser, une invitation frappée d’inconnu. Même quand on croit se parler, on parle aux autres, des autres. « En effet, on écrit pour écrire, me répond Guégan. Du moins, le croit-on. Car c’est moins certain qu’il n’y paraît. On voyage aussi dans l’espoir d’une nouvelle aventure. En tout cas, c’est ainsi que j’aurai vécu. » Guégan, de surcroît, aura fait beaucoup écrire, l’éditeur et le lecteur qu’il fut et reste l’exigent… Le Marseille des années 1950-1960 prête son décor canaille aux premiers chapitres du Chant des livres et aux souvenirs, les bons et les mauvais, qui toquent à la fenêtre : le PCF et ses oukases esthétiques, le cinéma américain et ses dissidences secrètes, les écrivains célèbres qui fascinent et bientôt aspirent le fils de la Bretagne soularde et de l’Arménie meurtrie. A Manosque, Giono roulait ses beaux yeux de pâtre libertin ; à Paris, vite rejointe, Paulhan paraît plus fréquentable qu’Aragon. Mai 68 décime, au moins, les menteurs « en bande organisée ». Puis le temps du Sagittaire, moins porté à l’idéologie, succède à Champ libre. Deux Jean-Pierre, Enard et Martinet, souffle court mais grand style, laissent la faucheuse les accrocher trop tôt à son tableau de chasse. Au lieu de les pleurer, Guégan les ressuscite fortement, c’est moins morbide, et plus utile aux nouvelles générations. Certaines rencontres se moquent du temps révolu avec un air de jeunesse délectable, Charles Bukowski auquel GG a converti Sollers, Michel Mohrt le magnifique, aussi breton que son cher Kerouac, ou Florence Delay, « la Jeanne d’Arc de Bresson » et l’écrivaine pétillante, autant de rencontres narrées sans rubato. Les détails qui disent l’essentiel sont serrés, et la nostalgie, qu’on lui pardonnerait, bridée. Les « années mortes » valent tous les « Fleuves impassibles ». Stéphane Guégan

*Delphine de Girardin, Lady Tartuffe, édition de Sylvain Ledda, GF Flammarion, 8,50€. Si ce n’est fait, les fous du théâtre à gilet rouge doivent absolument se procurer le grand livre de l’auteur, Des feux dans l’ombre. La représentation de la mort sur la scène romantique (1827-1835), Honoré Champion, 2009. Sachez aussi que Ledda prépare une biographie de Delphine de Girardin, heureuse perspective. / Romain Enriquez et Camille Koskas, Ecrits érotiques de femmes. Une nouvelle histoire du désir. De Marie de France à Virginie Despentes, Bouquins, 34€ / Guillaume de Sardes et Bartolomeo Pietromarchi, Pasolini en clair-obscur, MNMN / Flammarion, 39€. L’exposition se voit au musée national de Monaco jusqu’au 29 septembre 2024 / La Pléiade. Poésie, poétique, édition de Mireille Huchon, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 69€ / Jean Genet, Héliogabale, édition établie et présentée par François Rouget, Gallimard, 15€. Autre prose brûlante, brûlante de passions comprimées ou libérées, mais aussi d’incendies criminels et de xénophobie délirante, Mademoiselle, écrit pour le cinéma, reparaît. Effroi garanti et émois de toutes natures (Gallimard, L’Imaginaire, 7,50€). Ce scenario impossible, cet antiroman rustique, nous ramène à la question que Lady Tartuffe inspirait à Gautier. Peut-on faire d’un personnage (très largement) odieux le héros ou l’héroïne d’un drame ou d’un roman ? La réponse est oui, évidemment. C’est aussi celle que Balzac fit à George Sand. Et Genet à tous ses détracteurs. Mentionnons enfin la passionnante analyse que Jonathan Littell consacre à Héliogabale dans La Nouvelle Revue française, laquelle connaît une nouvelle renaissance (n°657, printemps 2024, 20€) et se donne une nouvelle ligne éditoriale sous le direction d’Olivia Gesbert. Le dossier voué à l’écriture de la guerre fait une place justifiée à Albert Thibaudet. Benjamin Crémieux, grande plume de la maison, aurait pu être appelé à la barre, lui qui sut si bien parler de Drieu et de La Comédie de Charleroi, qu’il faut ajouter à la petite bibliothèque idéale qui clôt cette livraison du renouveau/ Giovanni Casini et Juliette Pozzo (sous la dir.), Dans l’appartement de Léonce Rosenberg, Flammarion / Musée Picasso, 39,90€. L’exposition s’y voit jusqu’au 19 mai. Courez-y vite ! / Marie Nimier, Confidences tunisiennes, Gallimard, 20,50€. / Gérard Guégan, Le Chant des livres, Grasset, 16€.
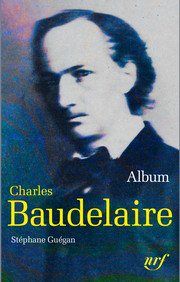
Parution,
le 16 mai 2024,
à l’occasion de la Quinzaine de la Pléiade.
Nous rendrons compte bientôt de la nouvelle édition des Œuvres compètes de Baudelaire, sous la direction d’André Guyaux et d’Andrea Schellino, à paraître ce même jour, dans la Bibliothèque de La Pléiade.