
Paths to Modernity vient d’ouvrir ses portes à Shanghai et le succès ne s’est pas fait attendre. Il promet d’être historique… Les vastes espaces du MAP (Museum of Art Pudong), dessinés par Jean Nouvel, ont déjà accueilli des milliers de visiteurs. Et comme le public chinois n’est pas blasé, ni bruyant, il manifeste en silence son enthousiasme à la vue de la centaine d’œuvres rassemblées et orchestrées autour d’insignes chefs-d’œuvre, des Glaneuses de Millet au Plaisir de Bonnard. Le titre et son pluriel disent bien que la modernité dont il s’agit ne se confond pas avec le modernisme du XXe siècle et ses détestables œillères. Saisir un moment, les années 1840-1910, et non un mouvement, l’impressionnisme par exemple, telle est l’offre. A Manet, Degas ou Monet aurait pu se borner le paysage parcouru. Mais une exposition d’art français loin de ses frontières ne saurait se plier aux dogmes d’un autre âge. Il leur a été préférée une approche globale, et apte à manifester les interférences et les rencontres oubliées entre les générations et les esthétiques apparemment contraires. Maîtres et élèves se retrouvent, les amis séparés se réconcilient, la mémoire des grandes œuvres se rend sensible au regard par les échos de l’accrochage, et Millet, pour ne prendre qu’un exemple, se devine derrière Bastien-Lepage, Monet, le Gauguin de Pont-Aven, le Van Gogh d’Arles, voire le Signac de Saint-Tropez. C’est peut-être la première fois, depuis les années de sa préfiguration, qu’Orsay se donne pour objet d’une exposition de pareille ampleur. Le partenariat du MAP l’a rendu possible et il faut s’en féliciter à l’heure où l’institution muséale, en son ensemble, est sujette à de nouvelles pressions. Sûre d’elle, l’opinion éclairée réclame un dépoussiérage de nos vieux musées « élitistes » et coupés du réel : le sociétal, panacée de tous nos maux, est érigé en remède de l’érudition clivante et du beau discriminatoire. Lieu d’admiration, de transmission, de connaissance, les temples du génie se voient intimer l’ordre de se muer en espaces de dialogue, de réconfort, d’empathie. Le premier Orsay, voilà près d’un demi-siècle, se voulait investi d’un autre message, et porteur d’une utopie plus raisonnable. L’un et l’autre revivent à Shanghai, où les œuvres sont situées et les contraires réinterrogés. D’un côté, le socio-politique comme cadre ; de l’autre, la croisée des parallèles comme horizon. Gérôme et Cabanel, comme on ne les a jamais vus, ouvrent le bal, les Nabis, en pleine mutation vers 1900, le referment après une série de chats goguenards. Des uns aux autres, l’Histoire a fait son chemin, jamais à sens unique. Le réalisme de 1848 en fut l’une des boussoles.
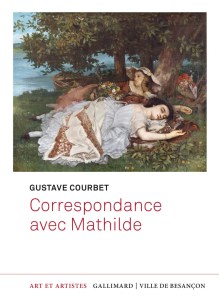
De Courbet, il faut tout attendre, pensait Proudhon. Qu’aurait-il pensé, le socialiste chaste, de cette correspondance « cochonne », plus que pornographique (les mots sont préférés à l’action), cochonne puisque ses auteurs la qualifient ainsi ? Jean-Jacques Fernier, en 1991, non content d’exposer pour la première fois L’Origine du monde et son merveilleux cache (bijou de Masson peint pour Lacan), livrait les premières bribes du « roman de Mathilde », du prénom d’une intrigante, « rouleuse d’hommes en vogue », qui échangea une centaine de missives érectiles, entre novembre 1872 et mai 1873, avec le maître d’Ornans. De cette romance salée et épistolaire, Courbet parle alors à Castagnary, peu porté sur la galanterie. Cette « correspondance frénétique », selon sa formule innocente, dormait en grande partie à la bibliothèque de Besançon. On l’y avait déposée autour de 1920, et condamnée à l’Enfer des écrits délictueux. Cas classique, des chercheurs remirent la main récemment dessus en traquant autre chose. Transcriptions et annotations composent un indispensable volume, refuge et chaudron des fantasmes les plus débridés, sorte de Sodome et Gomorrhe en version crue, voire campagnarde. Familière de ce genre d’escroqueries, et sans doute de chantage (il sera étouffé par l’entourage du peintre), Mathilde fait les premiers pas sur le mode victimaire : une femme malheureuse s’épanche sur l’épaule du communard génial, cassé par les conseils de guerre, la prison et la presse. Le gros Gustave mord à l’hameçon et Mathilde, objet de ses rêves, se transforme vite en objet de ses désirs. Tout y passe, franchement contés, des poils pubiens à la taille de leurs sexes, des « douces privautés », comme dit Molière, aux secrets trésors de l’intimité féminine. La gauloiserie appelant la gauloiserie, Courbet se remémore et narre les bonnes aventures de sa jeunesse. Ses biographes n’ont pas parlé de sa sexualité, nous voilà servis. Se pourrait-il que cette explosion scabreuse, teintée ici et là d’élans fleur bleue, dénotât une virilité mal assurée, se demande Petra Chu, l’éditrice de la correspondance générale, qu’avait épaulée en son temps le regretté Loïc Chotard ? Quoi qu’il en soit, ces lettres retrouvées n’ont pas fini d’agiter les experts. Elles fournissent maints éléments propres à analyser la sexualité inhérente aux tableaux, du virilisme au saphisme, du gracieux au brutal. Les lettres de Gustave sont celles d’un lecteur de Baudelaire, ce que la présente édition aurait pu gloser, de même que la référence à Poulet-Malassis sous la plume de Mathilde. Je ne partage pas non plus l’analyse de L’Origine du monde où Du Camp avait raison de sentir une sorte de mise en scène du fantasme fusionnel con amore, plus que l’intrusion voyeuriste des photographies vendues sous le manteau. Mathilde, du reste, parle très bien de l’imagination et du piment qu’elle donnera à leurs futurs ébats. Son impatience, en partie jouée, croît de lettre en lettre. A l’inverse, plus étonnantes, mais peu relevées, sont les raisons que Courbet allègue devant les appels de Mathilde à le rejoindre. Se dérobant à tout rendez-vous, il répète ainsi à sa « petite Vénus » que les préliminaires valent mieux que la « réalité ennemie ». On se pince. Est-ce le réaliste en chef qui parle ? Gautier n’avait-il pas raison de le taxer Courbet de « maniériste du laid », manière amusante de signaler ses folies libidineuses, mentales, et ses obsessions anatomiques, hors nature?

Comme Orsay, la Fondation des Treilles aime à penser la littérature et la peinture sous leur lumière commune, l’une à partir de l’autre, ce qui permet de respecter la spécificité des langages par-delà les parentés de forme et d’esprit. Sa riche archive, abondée par celle de la Fondation Catherine Gide, est essentielle à la compréhension du milieu de la N.R.F. et du choix de ses fondateurs en matière d’arts visuels. Malgré sa fidélité à Maurice Denis, nous savions André Gide très proche de Maria et Theo van Rysselberghe, le rôle de Madame auprès de l’écrivain dépassant assez vite celle de l’assistante. L’auteur des célèbres Cahiers fut un témoin et une confidente sans équivalent. A côté de la « Petite Dame » et ses écarts saphiques, il y eut donc son mari, le peintre néo-impressionniste, exigeant toujours plus de lui-même, auquel elle donna une fille, Elisabeth. Future épouse de Pierre Herbart, elle fut peut-être la seule passion féminine de Gide. Une autre fille devait naître de leur brève et si peu orthodoxe relation. A la naissance de Catherine, en avril 1923, la belle amitié qui liait Gide et Théo van Rysselberghe achève de se ternir. Tout avait commencé, vingt-cinq ans plus tôt, de la meilleure façon du monde. L’éclairage qu’apporte leur correspondance inédite change profondément ce qui se disait d’eux et de la place qu’occupa le pointillisme dans les cercles littéraires du tournant 1900. Il est très significatif que le poète mallarméen Francis Vielé-Griffin, dont Théo a portraituré la femme dès 1895, ait joué le rôle d’intercesseur. En effet, les émules de Seurat et Signac cultivent un mélange de rationalisme et de symbolisme qui les distinguent des autres acteurs de la fin-de-siècle. On y ajoutera une dose d’anarchisme qui, pour être de salon, plus que d’insurrection, n’en était pas moins sincère et de portée durable. Mariés en 1889, les Van Rysselberghe quittent Bruxelles en 1898. Paris leur est déjà, en partie, acquis ; la relance de L’Ermitage, une de ces revues libre-penseuses alors florissantes, fera le reste. Le couple, de surcroît, fréquente Verhaeren, très apprécié alors des deux côtés de la frontière. C’est l’époque où le poète aux longues moustaches fait les yeux doux à la peinture claire de Théo, « vie choisie qu’il montre sous ses aspects de santé et de beauté ». Henri Ghéon embraye, quelques mois plus tard, lors du fameux bilan qu’abrite Durand-Ruel au début de 1899 : « on comprend jusqu’à quelle solidité peut atteindre, bien employé, un procédé qui semble fait pour de fugaces notations. » Les 463 pages du présent volume fourmillent d’échos savoureux, et des habitués que réunissent rituellement Maria et Théo. Musique, lectures, peintures, voire lecture dans la peinture, ainsi que le célèbre tableau de Gand, en 1903, l’atteste. Verhaeren et Gide y occupent le centre, Fénéon brille en marge, le peintre Cross s’y trouve représenté aussi. L’auteur de La Porte étroite, grâce à ses amis belges, faisait table faste. A la mort de Théo, durant l’hiver 1926, Jean Paulhan confiera à Maria qu’il ne séparait pas son défunt mari « d’une sorte de légende ». Celle d’un âge d’or des lettres et des arts. Stéphane Guégan
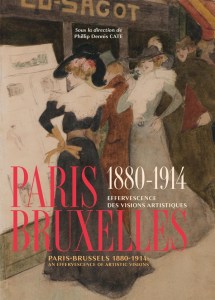
*Gustave Courbet, Correspondance avec Mathilde, Ludovic Carrez, Pierre-Emmanuel Guilleray, Bérénice Hartwig et Laurence Madeline (éd.), préface de Petra Chu, Gallimard, 22€ / Théo van Rysselberghe, Correspondance avec André Gide et les siens (1899-1926), Les inédits de la Fondation des Treilles, édition établie, présentée et annotée par Pierre Masson et Peter Schnyder, Les Cahiers de la NRF / Gallimard, 23€. Signalons aussi le catalogue d’exposition dirigé par Phillip Dennis Cate, grand connaisseur de l’art fin-de-siècle, Paris Bruxelles. 1880-1914. Effervescence des visions artistiques, Palais Lumière Evian / In Fine, 39€, avec ce cher Bottini en couverture. Outre la qualité des collaborations et la diversité des approches (du japonisme à la caricature), c’est le corpus même des œuvres qui retient, toutes issues d’une collection privée, avec ses limites naturelles et ses nombreuses surprises. Toute exposition doit surprendre.
DEUX GÉNIES DU TERRAIN

Ils ont la peau dure et le verbe célinien les damnés de Cayenne au début des années folles. C’est même la seule richesse possible là-bas, leur peau et leur poésie. Aussi s’ornent-ils de tatouages à fonctionnement codé. Certains se payent la tête des marchands de bonheur en trois coups : « Le Passé m’a trompé, / Le Présent me tourmente, / L’Avenir m’épouvante. » Un ancien curé, qui a sauvé sa tête, s’est marqué au cou : « Amen ». Albert Londres, ennemi juré de l’injustice, fut le Victor Hugo de ces misérables-là. Poète avorté, il s’est vengé de la muse en poussant la littérature au cœur du reportage. Au bagne résiste au temps, comme les vrais chefs-d’œuvre. Livre cruel envers la machine à broyer les hommes, il tire des sursitaires de Guyane le peu qui reste d’humanité en régime carcéral, quand s’efface l’horizon derrière les barreaux. La plupart des détenus, en effet, étaient assignés à résidence après avoir purgé des peines rarement proportionnées aux délits. C’est que les besoins de la colonisation priment depuis Napoléon III. Chaque tentative d’évasion vous fait plonger davantage. En 1923, pour le Petit parisien, moins centre gauche que son « reporteur », Londres ouvre les yeux à ses abonnés, qui se bercent de l’illusion d’une relégation trop laxiste des voyous et des détenus politiques. Londres découvre aussi que l’espace de la Loi y échappe, que l’immoralité et l’administration règnent sans contrôle. Le livre né de ses articles choquera sans mettre fin à l’Enfer. Il se referme sur une lettre terrible à Sarraut, alors ministre des colonies. Pour donner plus de poids aux mots, Londres rapporta des photographies, restées inédites. La nouvelle édition et son appareil critique les intègrent enfin. Le Papillon de Franklin James Schaffner n’est plus très loin. SG / Albert Londres, Au bagne, édition de Philippe Collin, postface de Bernard Cahier, Mercure de France / Le Temps retrouvé, 12€.

S’étant rendu aux îles du Salut, au large de Cayenne, archipel où s’entassaient les enterrés vivants, le Londres d’Au bagne se heurte à une cellule, celle de Dieudonné (cela ne s’invente pas), un sympathisant de « la bande à Bonnot » dont la justice, faute de grive, fit son merle à plumes bien noires. Le journaliste comprend vite qu’il y a erreur sur la marchandise, cet ébéniste, lecteur de Stirner et Nietzsche, ressemble peu à un tueur et encore moins à un lanceur de bombes. A la suite de cette rencontre qui l’a ému, Londres se multiplie en démarches. La révision du procès devient sa croix. C’est son « affaire Dreyfus », qui avait connu l’île du Diable… Cayenne, toujours. Mais Dieudonné ne sera pas entendu de la France qu’il s’obstine à vouloir ré-épouser. En attendant la grâce, il se fait la belle. Le Brésil est à deux pas… C’est à Rio que Londres, toujours missionnaire pour le compte du Petit Parisien, le localise en 1927. Quatre ans ont passé. Dieudonné en a 43. Il se livre au journaliste, raconte son évasion, du pur Jules Verne avec passeurs, rebondissements et belle Chinoise. Il faut lire L’Homme qui s’évada pour le croire. L’anarchie ne fut pas que tueries aveugles et extrémisme absurde. Elle donnait aussi des ailes à l’espoir déçu. En repartant, Londres emporte l’évadé après avoir emporté la grâce présidentielle. Conférence de presse à la gare de Lyon. Dieudonné avait pris cette fois le bon train. SG / Albert Londres, L’Homme qui s’évada, Arléa, 9€. Du même, lire impérativement aussi Dante n’avait rien vu : Biribi, Arléa, 10€. Autre monde, autres bagnes. Nous sommes en Afrique du Nord, mais la clientèle à collier de fer reste française. Maroc, Algérie, Tunisie, soit la sainte trinité des pénitenciers militaires, et le reflux des conseils de guerre que Drieu a vu fonctionner aux Dardanelles en 1915. De quoi enflammer Londres et sa haine des dénis de justice. Biribi, c’est le nom faussement riant de cet enfer… dantesque.

Peut-être son meilleur livre avec Les Cerfs-volants, car sa plus grande réussite dans le symbolisme involontaire et la polyphonie des consciences : en cela, Les Racines du ciel, Goncourt 1956, hissent Romain Gary, adepte de Conrad et de Dostoïevski, parmi les maîtres du premier XXe siècle, de Proust à Drieu. A la parution du livre sous sa couverture originale (une sorte de Rothko avec bande centrale d’éléphants), et surtout à l’annonce de sa victoire sur L’Emploi du temps de Butor, la double désapprobation des ténors du Nouveau roman (Nadeau) et du roman décolonial (la presse communiste) n’est guère surprenante. En 1980, à la faveur d’un de ces regards en arrière qu’il affectionnait, Gary s’épingla la médaille (il ne les détestait pas) du premier auteur à avoir écrit un roman écologiste, et écornait l’époque, les années 50 justement, où le mot et la chose n’éveillaient rien dans les dîners en ville. La « protection de la nature » ne devient une cause militante qu’à partir des années 60-70. Comme les éléphants qu’il aimait, et dont la vitesse de déplacement lui semblait une image adéquate d’un vitalisme venu de la nuit des temps, Gary arrive trop tôt, explique Igor Krtolica, en tête du bel essai, nourri de références littéraires, cinématographiques et philosophiques, que Les Racines du ciel lui ont inspiré. Erreur de montre, mais erreur tout aussi bien de mode. La cause de l’environnement s’appuie moins volontiers sur le littéraire que sur la parole scientifique. En outre, le refus de l’énonciation univoque se double d’une fascination de la vie sauvage qui sentirait son homme blanc. Tout faux, en somme. Où Nadeau est-il allé chercher, sinon dans sa duplicité militante ou le vide des romanciers du rien réifié, que Gary pratiquait le « sermon en images » ? Amochés par la guerre et ce qu’elle a tué de l’homme en l’homme, les contre-héros des Racines ont tendance, certes, à interroger un ciel devenu presque orphelin. Les curés que Gary avait vus se battre restaient dans sa mémoire intacte de tout anticléricalisme (autre passion des modernes). Nous aimons déconstruire, lui cherchait les voies capables de rebâtir après 39-45, après la shoah, après Hiroshima, après la Corée… Comme l’écrit avec drôlerie et justesse Krtolica, le travail du deuil n’est remplacé par le travail du rire qu’en raison de l’ironie dont Romain Gary sait les vertus. La dérision et le simple sourire à la vie habitent cet écrivain que la mythologie gaulliste a privé de son franciscanisme moins clivant qu’il se dit. Un dernier conseil, puisque Krtolica aime le cinéma et en parle bien : revoir le film de John Huston (1958), adapté du roman, que Gary traitait à tort de « navet » (ne serait-ce que pour la prestation d’Errol Flynn et de Juliette Greco) avant de lui comparer Hatari ! (1962), où le vieil Hawks, dès le long plan-séquence silencieux qui l’ouvre, produit un geste comparable à l’humanisme blessé de Gary, si typique de notre monde abîmé. SG / Igor Krtolica, Romain Gary. De l’humanisme à l’écologie, Gallimard, 19,50€. Du même Gary, lire aussi Johnnie Cœur, Gallimard, Folio Théâtre, 8,50€. Rions encore, puisque l’humour sert l’amour du vrai, avec cette pièce de 1961 qui met en scène une fausse grève de la faim et les dérives de l’humanitarisme dès que les moyens (les mass-médias, l’ivresse de la célébrité) dévoient ses causes. Après l’ère de la compassion, l’ère de la confusion débutait : certains chefs d’Etat en sont aujourd’hui les complices lamentables.
DEUX MAÎTRES RELEVÉS

Il y a un demi-siècle exactement, l’exposition de Frederick Cummings, Pierre Rosenberg et Robert Rosenblum, De David à Delacroix, offrait un panorama de la peinture française des années 1774-1830 qui n’a jamais été renouvelé. Ses apports mériteraient un livre, n’en mentionnons que deux. Les tableaux réunis au Grand Palais et à Detroit, en 1974, invalidaient enfin l’idée que la rupture davidienne suffisait à expliquer et épuiser ce tournant vertigineux, sur fond d’impermanence et de violences politiques. Il était soudain possible d’apprécier autour des grands tableaux d’histoire, des Horaces à la Liberté guidant le peuple, socle de la mémoire collective, une moisson de portraits, paysages, scènes de genres, transpositions littéraires et inventions inclassables, autant d’indices que la vieille hiérarchie des genres, en vacillant, ouvrait aux œuvres d’imagination une carrière aussi nouvelle que la société postrévolutionnaire, et aussi ouverte que le marché de l’art et la presse d’art redéfinis alors. Parmi les exhumations les plus curieuses que provoqua le désir de réécrire l’histoire de ce moment, deux tableaux mobilisèrent l’attention, la Mort d’Hyacinthe de Broc et le Dédale et Icare de Landon. L’un illustrait la quête primitive des Barbus, dissidents post-thermidoriens de l’atelier de David, épris d’une simplicité et d’une sentimentalité épurées, hors de toute rhétorique directe. Plus porcelainée, plus cinétique aussi, la petite toile de Landon aspirait au même type d’émotions insinuantes, et à une grâce androgyne que les critiques, lors du Salon de 1799, dirent racinienne. Landon, élève de Regnault comme Guérin, comme son ami Robert Lefebvre, aurait-il été le Barbu masqué de cet atelier rival, hostile aux davidiens, chercheur d’un idéal formel, et parfois politique, éloigné du peintre de Brutus et de Marat ? Landon, malgré les trouvailles et les études accumulées en cinquante ans, restait un mystère, sur lequel Katell Martineau lève enfin le voile, sans jamais nous faire peser la masse d’informations nouvelles que contient son étude. Ce n’était pas un mince sujet que le sien, car si Charles-Paul Landon (1760-1826) a peu peint, il a beaucoup écrit, il s’est même rendu digne de figurer au palmarès de la critique d’art française, telle qu’elle s’est développée et diversifiée au cours du premier quart du XIXe siècle. Force était donc de saisir cette personnalité intrigante, né au sein de la petite noblesse normande et appelé tôt à enseigner le dessin aux fils du comte d’Artois, entre le renouveau pictural qu’il incarne en son raphaélisme vaporeux, ses stratégies politiques et le Salon, où il met le pied dès 1791 et dont il se fit l’historien, aux côtés de maints collaborateurs, à partir de 1800. Le sous-titre de l’étude de Martineau, liée à l’aide précieuse de la Fondation Napoléon, ne saurait faire oublier que le meilleur de ses pinceaux, souvent léonardesques, s’est exposé au public entre la fin de la Constituante et la fin du Consulat, parenthèse magique dans l’histoire de notre peinture. Son Prix de Rome, en 1792, ne l’envoya pas à Rome où les Français, avant même la décapitation de Louis XVI, n’étaient plus désirés. Il n’en fut pas moins pensionné par le gouvernement révolutionnaire. Ce n’est pas le moindre paradoxe de son destin de royaliste modéré, qui se serait contenté d’une monarchie parlementaire, à l’anglaise, mais épargnée par le sang de la Régénération sociale. SG / Katell Martineau, Charles-Paul Landon. Peintre et critique d’art, Mare § Martin, 45€.
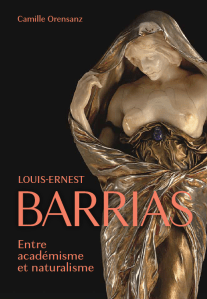
Prix de Rome de sculpture en 1865, Louis-Ernest Barrias (1841-1905) n’a dû sa survie qu’à l’éblouissant chef-d’œuvre d’Orsay, La Nature se dévoilant devant la science, point d’orgue de l’Exposition universelle de 1900, métaphore transparente et effeuillage polychrome qui transcende la froideur de ses matériaux. Laura Bossi, en tête du catalogue des Origines du monde, lui a donné sa pleine signification. Il faut y lire avec elle ce « temps de la science » dont Barrias fut l’exact contemporain, d’une science « vue comme la plus haute forme de vérité accessible à l’homme ». Un siècle après, même les partisans acharnés du progrès en sont revenus. Et les Barrias d’aujourd’hui donnent corps à des pensées plus sombres, hélas accordées à la destruction méthodique du vivant et à l’illusion que les gourous de la technique tentent d’entretenir quant à leur pouvoir de sauver la planète par les moyens qui la tuent. Le dernier cri d’alarme de Philippe Bihoux (L’Insoutenable abondance, Gallimard, Tracts, 3,90€) fait mal et rappelle le Baudelaire en guerre contre le satanisme des prophètes de l’utile. Barrias aurait offert au poète maints sujets de réflexion, ses allégories se colorant souvent d’un pessimisme prometteur (chimères victorieuses, enfants étouffés par le fatum). Camille Orensanz a soigneusement reconstitué la carrière inouïe de cet infatigable défenseur du beau, et analysé, dans un second temps, ses principes esthétiques. Que ce qu’on nomme l’académisme par peur de ses « vérités » doive être aujourd’hui réexaminé se confirme de page en page. Son récit bien mené ressuscite l’ami d’Henri Regnault, foudroyé à Buzenval, l’auteur du Siège de Paris (dont Mantz vanta « l’accent moderne »), le créateur du michelangelesque Spartacus de 1872 (Barbey s’en dit atteint au cœur) et le père de tant de monuments à destins variables. C’est là un des points cruciaux. « Ce que c’est que la gloire ! », a-t-on envie d’écrire en paraphrasant Mirbeau, bête noire de Barrias… Le défenseur de Rodin était de ceux qui voulaient abattre la statuaire publique réfractaire à l’avant-garde. Ainsi Camille Mauclair, en 1919, appelle-t-il au déboulonnage du Victor Hugo de Barrias érigé en 1902. Aragon devait en pleurer la fonte par « les Fritz ». Mais est-il plus « glorieux » d’avoir « abattu » en 2020 le Victor Schoelcher de Cayenne au prétexte que le racialisme de l’abolitionniste nous paraît contradictoire ? Ne sommes-nous pas assez grands pour faire la part des choses et accepter, à l’occasion, leur dualité ? Déboulonner ne fait pas avancer le débat et le savoir, ça les crispe et finalement les vicie. Ma position (voir le catalogue du Modèle noir), à ce sujet, diffère de celle de l’auteur. Nul plus que Barrias, si fameux de son vivant, si invisibilisé désormais, avait besoin de son livre informé et réparateur ! SG / Camille Orensanz, Louis-Ernest Barrias. Entre académisme et naturalisme, Mare § Martin, 33€.
THÉÂTRE

Vient de paraître aux éditions SAMSA, 12 euros !
Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat,
David ou Terreur, j’écris ton nom
Homme d’argent et de pouvoir, David fut de toutes les révolutions, même les plus radicales ! Puisque le monde est une scène, voici le peintre de Marat sur le théâtre de son action, entre Caravage et Bonaparte, Paris et Bruxelles.



