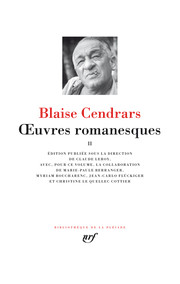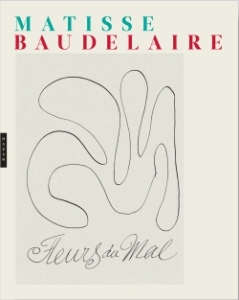On n’osait plus y croire, tant il avait été annoncé par ses prédécesseurs… Mais Xavier Salmon l’a fait. Le patron du département des arts graphiques du Louvre est parvenu au bout du catalogue des pastels de la grande maison, la plus belle collection au monde, largement supérieure à celles de Dresde et de Londres. Depuis la décision que prit Louis XVIII de faire ramener à Paris les trésors de Versailles afin d’enrichir la collection du Louvre, transfert qui faisait prévaloir la qualité esthétique sur la dimension politique sans l’annuler, le musée est détenteur d’un trésor que Salmon ne s’est pas contenté d’étudier à la faveur d’une campagne de restaurations exemplaires et d’une série de découvertes dont son indispensable catalogue regorge. L’exposition qui vient d’ouvrir en a sélectionné la fleur, 120 feuilles ou tableaux, puisque le pastel, si léger, moelleux ou même vaporeux soit-il, a toujours été considéré comme relevant de la peinture. Sa vogue débute au plus fort du règne de Louis XIV, dont Le Brun a fixé les traits encore jeunes, en 1667, en usant de la technique à la mode. Une mode qui inquiète les portraitistes fidèles à l’huile. Car le pastel n’a pas que la vitesse pour lui, il possède un éclat suave qui résiste, semble-t-il, au temps. L’épiderme, l’humide de l’œil et le brillant des lèvres, comme le transparent des couleurs, y sont donc promis à une fraîcheur éternelle… D’un autre côté, il suffit d’un accident pour ruiner la magie de l’effet. Le grand format, enfin, suppose des montages de feuilles auxquels peu se plient. Le pastel, sauf exception, invite donc à la psychologie, à l’intime, au mondain plus qu’au guindé. Le XVIIe siècle, Nanteuil ou Pierre Simon, le pratique sagement. Le médium attend son heure, elle arrive sous la Régence et s’illustre d’abord sous les doigts de Rosalba Carriera. La Vénitienne, amie des grâces sans modération, est la chérie du milieu Crozat qui l’impose à l’Académie royale. C’est une petite révolution. Non que la compagnie tienne le beau sexe à distance! Mais l’Académie l’accueille sans exiger la présentation d’aucun morceau de sa main si séduisante…
On n’osait plus y croire, tant il avait été annoncé par ses prédécesseurs… Mais Xavier Salmon l’a fait. Le patron du département des arts graphiques du Louvre est parvenu au bout du catalogue des pastels de la grande maison, la plus belle collection au monde, largement supérieure à celles de Dresde et de Londres. Depuis la décision que prit Louis XVIII de faire ramener à Paris les trésors de Versailles afin d’enrichir la collection du Louvre, transfert qui faisait prévaloir la qualité esthétique sur la dimension politique sans l’annuler, le musée est détenteur d’un trésor que Salmon ne s’est pas contenté d’étudier à la faveur d’une campagne de restaurations exemplaires et d’une série de découvertes dont son indispensable catalogue regorge. L’exposition qui vient d’ouvrir en a sélectionné la fleur, 120 feuilles ou tableaux, puisque le pastel, si léger, moelleux ou même vaporeux soit-il, a toujours été considéré comme relevant de la peinture. Sa vogue débute au plus fort du règne de Louis XIV, dont Le Brun a fixé les traits encore jeunes, en 1667, en usant de la technique à la mode. Une mode qui inquiète les portraitistes fidèles à l’huile. Car le pastel n’a pas que la vitesse pour lui, il possède un éclat suave qui résiste, semble-t-il, au temps. L’épiderme, l’humide de l’œil et le brillant des lèvres, comme le transparent des couleurs, y sont donc promis à une fraîcheur éternelle… D’un autre côté, il suffit d’un accident pour ruiner la magie de l’effet. Le grand format, enfin, suppose des montages de feuilles auxquels peu se plient. Le pastel, sauf exception, invite donc à la psychologie, à l’intime, au mondain plus qu’au guindé. Le XVIIe siècle, Nanteuil ou Pierre Simon, le pratique sagement. Le médium attend son heure, elle arrive sous la Régence et s’illustre d’abord sous les doigts de Rosalba Carriera. La Vénitienne, amie des grâces sans modération, est la chérie du milieu Crozat qui l’impose à l’Académie royale. C’est une petite révolution. Non que la compagnie tienne le beau sexe à distance! Mais l’Académie l’accueille sans exiger la présentation d’aucun morceau de sa main si séduisante…
 Les plus grands pastellistes français du XVIIIe siècle auront fort à faire pour égaler son prestige. Ils sont tous ici présents ces maîtres du médium, qui allait les propulser au zénith de la société et du Salon, sis alors au Louvre, un espace où s’invente une sociabilité qui aurait pu nous épargner la guerre civile à venir. Salmon en retrouve l’atmosphère et l’accrochage serré. La vieille noblesse, le clergé, la nouvelle France, femmes et hommes, enfants souvent, animaux parfois, s’installent paisiblement dans ce qui est le moment le plus fort du parcours, sous les bienveillantes besicles du grand Chardin. La rivalité des artistes y est ramenée à ce qui fut une saine émulation, comme celle qui entraînait Quentin de La Tour et Perronneau vers le meilleur d’eux-mêmes. J’ai dit ici, au sujet de ce dernier, mon regret de voir le portrait d’Olivier Journu quitter la France pour le Met en juin 2002… Le Louvre est richement doté, dira-t-on, en chefs-d’œuvre de cet homme assez nomade, aussi habile à saisir une coquette qu’un jeune seigneur plein de soi. Mais est-ce une consolation efficace ? La Tour, lui, élargit son domaine. Et l’exposition frappe trois coups à cet égard : une restauration magique, celle du non moins magique Portrait de la marquise de Pompadour (couverture) et son effort crypté, via la nature morte des livres et de la gravure visibles à droite, de concilier le cœur et l’esprit, la cour et la ville, Louis XV et les philosophes qui commencent à s’éloigner ; une réattribution, celle de cette charmante religieuse qui, pour n’être pas l’une des filles du Bien Aimé, n’en est pas moins royale ; une acquisition insigne enfin, celle du portrait espiègle de Marie-Louise Gabrielle de la Fontaine Solare de la Boissière dont Edmond de Goncourt et René Gimpel étaient fous. À ces bonnes fortunes, celle-ci sourit encore, du sourire des femmes de tête qui s’acceptent telles qu’elles sont. Car le pastel n’a nul besoin de flatterie pour exister, c’est la réponse de la France aux douceurs trop sucrées de Rosalba, ce sera la réponse de Labille-Guiard, de Vigée Le Brun et de Prud’hon, les trois noms qui referment un parcours soutenu, auquel il ne manque qu’un pastel, mais ils sont rares, de Jean-Bernard Restout…
Les plus grands pastellistes français du XVIIIe siècle auront fort à faire pour égaler son prestige. Ils sont tous ici présents ces maîtres du médium, qui allait les propulser au zénith de la société et du Salon, sis alors au Louvre, un espace où s’invente une sociabilité qui aurait pu nous épargner la guerre civile à venir. Salmon en retrouve l’atmosphère et l’accrochage serré. La vieille noblesse, le clergé, la nouvelle France, femmes et hommes, enfants souvent, animaux parfois, s’installent paisiblement dans ce qui est le moment le plus fort du parcours, sous les bienveillantes besicles du grand Chardin. La rivalité des artistes y est ramenée à ce qui fut une saine émulation, comme celle qui entraînait Quentin de La Tour et Perronneau vers le meilleur d’eux-mêmes. J’ai dit ici, au sujet de ce dernier, mon regret de voir le portrait d’Olivier Journu quitter la France pour le Met en juin 2002… Le Louvre est richement doté, dira-t-on, en chefs-d’œuvre de cet homme assez nomade, aussi habile à saisir une coquette qu’un jeune seigneur plein de soi. Mais est-ce une consolation efficace ? La Tour, lui, élargit son domaine. Et l’exposition frappe trois coups à cet égard : une restauration magique, celle du non moins magique Portrait de la marquise de Pompadour (couverture) et son effort crypté, via la nature morte des livres et de la gravure visibles à droite, de concilier le cœur et l’esprit, la cour et la ville, Louis XV et les philosophes qui commencent à s’éloigner ; une réattribution, celle de cette charmante religieuse qui, pour n’être pas l’une des filles du Bien Aimé, n’en est pas moins royale ; une acquisition insigne enfin, celle du portrait espiègle de Marie-Louise Gabrielle de la Fontaine Solare de la Boissière dont Edmond de Goncourt et René Gimpel étaient fous. À ces bonnes fortunes, celle-ci sourit encore, du sourire des femmes de tête qui s’acceptent telles qu’elles sont. Car le pastel n’a nul besoin de flatterie pour exister, c’est la réponse de la France aux douceurs trop sucrées de Rosalba, ce sera la réponse de Labille-Guiard, de Vigée Le Brun et de Prud’hon, les trois noms qui referment un parcours soutenu, auquel il ne manque qu’un pastel, mais ils sont rares, de Jean-Bernard Restout…
 On savait ce Restout-là d’allure belle et farouche, de caractère instable et de conduite indomptable. On disait qu’il avait abattu l’Académie royale de peinture, en 1793, par vengeance personnelle. L’artiste, pour les historiens trop rapides, comptait moins que son destin d’ingrat rejeton et d’héritier soupe-au-lait. La thèse m’a toujours paru mince… Fils du grand Restout, apparenté aux Hallé et aux Jouvenet par le jeu des alliances normandes, Jean-Bernard était né coiffé, le 22 février 1732. Avant de le pousser vers le Prix de Rome, la famille le confie à Maurice Quentin de La Tour – le portraitiste de ses parents – dont l’adolescent retient, miracle, plus que le métier. Il est peu de portraitistes qui aient montré sous Louis XV autant de vérité et de mordant que Restout, le « franc-tireur » (Jean-Pierre Cuzin). Mais là ne pouvait s’arrêter la fièvre conquérante d’un jeune homme qui passa par les mains de Boucher et n’oublia pas de regarder, autre maître en nus licencieux, Carle Van Loo. Le livre très complet que lui consacre Nicole Wilk-Brocard, pesons nos mots, nous permet enfin de comprendre, et la grandeur insoupçonnée du peintre, et les raisons de ses menées révolutionnaires, dès l’été 1789, avec peut-être même plus de sincérité que David lui-même. Ce qui fascine précisément chez Restout, c’est qu’il eût pu se tracer une tout autre route dans le siècle. On a déjà compris laquelle. À l’évidence, Jean-Bernard a bénéficié de la protection de papa. En 1758, il se voit accorder le Grand Prix avec un rien de bienveillance de la part de ses juges. Les pauvres, ils ne comprenaient pas que, ce faisant, ils contribueraient à lui donner un jour l’envie de réformer la Compagnie de fond en comble… Alors qu’il se prépare à rejoindre Rome, on le voit traduire en peinture le théâtre moderne le plus noir, celui de Baculard d’Arnaud, signe annonciateur de ses relations difficiles avec l’Académie romaine qu’abrite le palais Mancini. C’est alors le bon Natoire qui a la rude tâche d’imposer aux jeunes pensionnaires, enfin libres des concours, le règlement, les exercices requis et les devoirs religieux. En 1977, Pierre Rosenberg a montré, correspondance administrative à l’appui, qu’il n’y parvint pas. L’indiscipline règne plutôt, et Restout, janséniste de tête plus que de corps, n’est pas le dernier à «se licencier», selon la belle formule du directeur débordé.
On savait ce Restout-là d’allure belle et farouche, de caractère instable et de conduite indomptable. On disait qu’il avait abattu l’Académie royale de peinture, en 1793, par vengeance personnelle. L’artiste, pour les historiens trop rapides, comptait moins que son destin d’ingrat rejeton et d’héritier soupe-au-lait. La thèse m’a toujours paru mince… Fils du grand Restout, apparenté aux Hallé et aux Jouvenet par le jeu des alliances normandes, Jean-Bernard était né coiffé, le 22 février 1732. Avant de le pousser vers le Prix de Rome, la famille le confie à Maurice Quentin de La Tour – le portraitiste de ses parents – dont l’adolescent retient, miracle, plus que le métier. Il est peu de portraitistes qui aient montré sous Louis XV autant de vérité et de mordant que Restout, le « franc-tireur » (Jean-Pierre Cuzin). Mais là ne pouvait s’arrêter la fièvre conquérante d’un jeune homme qui passa par les mains de Boucher et n’oublia pas de regarder, autre maître en nus licencieux, Carle Van Loo. Le livre très complet que lui consacre Nicole Wilk-Brocard, pesons nos mots, nous permet enfin de comprendre, et la grandeur insoupçonnée du peintre, et les raisons de ses menées révolutionnaires, dès l’été 1789, avec peut-être même plus de sincérité que David lui-même. Ce qui fascine précisément chez Restout, c’est qu’il eût pu se tracer une tout autre route dans le siècle. On a déjà compris laquelle. À l’évidence, Jean-Bernard a bénéficié de la protection de papa. En 1758, il se voit accorder le Grand Prix avec un rien de bienveillance de la part de ses juges. Les pauvres, ils ne comprenaient pas que, ce faisant, ils contribueraient à lui donner un jour l’envie de réformer la Compagnie de fond en comble… Alors qu’il se prépare à rejoindre Rome, on le voit traduire en peinture le théâtre moderne le plus noir, celui de Baculard d’Arnaud, signe annonciateur de ses relations difficiles avec l’Académie romaine qu’abrite le palais Mancini. C’est alors le bon Natoire qui a la rude tâche d’imposer aux jeunes pensionnaires, enfin libres des concours, le règlement, les exercices requis et les devoirs religieux. En 1977, Pierre Rosenberg a montré, correspondance administrative à l’appui, qu’il n’y parvint pas. L’indiscipline règne plutôt, et Restout, janséniste de tête plus que de corps, n’est pas le dernier à «se licencier», selon la belle formule du directeur débordé.
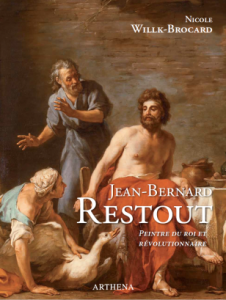 On ne met pas en cage de tels fauves. Restout se fiche des morceaux d’anatomie et, en matière de copies, va naturellement aux bolonais les plus virils et à Valentin, le plus génial des caravagesques français… Les meilleurs tableaux de Restout ont quitté la France, à commencer par son premier chef-d’œuvre, Les Plaisirs d’Anacréon qui donne l’envie de pousser quelque Ode amoureuse à ses côtés. Étonnamment, les spécialistes du XVIIIe siècle, sauf erreur, n’ont pas vu que la toile, gravée et fort célèbre en son temps, fut sans doute l’une des sources de La Mort de Socrate de David, page aussi stoïcienne que son modèle l’était peu. Cet Anacréon en belle humeur n’eut pas l’heur de plaire à Diderot, lors du Salon de 1767, de même que Diogène demandant l’aumône aux statues donne l’impression au critique difficile d’être en présence d’un charretier insuffisamment noble d’aspect. Mais le pire, en fait d’incompréhension, restait à venir et il viendrait une fois de plus de ses pairs. Agréé et reçu sur présentation du beau Philémon et Baucis de Tours, Restout se voit refuser un tableau au Salon de 1769, dont on aimerait qu’il se confondît avec le Satyre et Nymphe Resnick, comme le suggère Nicole Wilk-Brocard. Si l’on ajoute quelques portraits d’une rare puissance, l’immense Présentation de Notre-Seigneur au Temple, tableau hélas introuvable, et la préromantique Descente de saint Louis de 1774, le catalogue peint de Restout est presque déjà parvenu à son terme. L’homme, lui, est loin d’avoir encore désarmé.
On ne met pas en cage de tels fauves. Restout se fiche des morceaux d’anatomie et, en matière de copies, va naturellement aux bolonais les plus virils et à Valentin, le plus génial des caravagesques français… Les meilleurs tableaux de Restout ont quitté la France, à commencer par son premier chef-d’œuvre, Les Plaisirs d’Anacréon qui donne l’envie de pousser quelque Ode amoureuse à ses côtés. Étonnamment, les spécialistes du XVIIIe siècle, sauf erreur, n’ont pas vu que la toile, gravée et fort célèbre en son temps, fut sans doute l’une des sources de La Mort de Socrate de David, page aussi stoïcienne que son modèle l’était peu. Cet Anacréon en belle humeur n’eut pas l’heur de plaire à Diderot, lors du Salon de 1767, de même que Diogène demandant l’aumône aux statues donne l’impression au critique difficile d’être en présence d’un charretier insuffisamment noble d’aspect. Mais le pire, en fait d’incompréhension, restait à venir et il viendrait une fois de plus de ses pairs. Agréé et reçu sur présentation du beau Philémon et Baucis de Tours, Restout se voit refuser un tableau au Salon de 1769, dont on aimerait qu’il se confondît avec le Satyre et Nymphe Resnick, comme le suggère Nicole Wilk-Brocard. Si l’on ajoute quelques portraits d’une rare puissance, l’immense Présentation de Notre-Seigneur au Temple, tableau hélas introuvable, et la préromantique Descente de saint Louis de 1774, le catalogue peint de Restout est presque déjà parvenu à son terme. L’homme, lui, est loin d’avoir encore désarmé.
 Deux gravures témoignent alors de l’horreur que lui a inspirée le dernier gouvernement de Louis XV et l’autoritarisme du vieux roi à l’égard des parlements. C’est le plus mauvais cadeau que le vieux monarque faisait à son petit-fils, le tout jeune Louis XVI. En 1775, sans perdre de temps, Restout réclamait la suppression du jury académique du Salon. Au contraire, tout allait se durcir dans les années à venir, marquées par la sédition des uns et le raidissement des autres. Bref, une situation typiquement française qui déboucherait, après l’été 1789, sur une guerre ouverte entre le clan davidien et ses adversaires, de Vien à Vincent. Nicole Wilk-Brocard ramasse en deux chapitres denses l’imbroglio révolutionnaire qui jette l’enthousiaste Restout dans les intrigues, puis les prisons des amis de Robespierre et du délicieux Fabre d’Eglantine. Il n’y a pas de fumée sans feu, dit-on. Restout, bondissant des Jacobins au Garde-Meuble en trois ans, montre nul scrupule à évincer qui le gène ou entrave la marche de la Nation. Notons que l’homme que la Terreur jette en prison fin 1793 a autant le sens des opportunités que le respect du patrimoine menacé, religieux comme laïc. Avant de mourir, à 64 ans dans les bras d’une amie chère, il se paya le luxe de jeter, le 14 mai 1793, à ses rouges ennemis : « J’ai vécu libre quand nous étions esclaves ; âpre la conquête de la liberté, pourquoi faut-il que je sois privé de la mienne ? » Disons le avec Pierre Rosenberg, qui préface ce formidable livre : Restout a largement mérité son prénom. Stéphane Guégan
Deux gravures témoignent alors de l’horreur que lui a inspirée le dernier gouvernement de Louis XV et l’autoritarisme du vieux roi à l’égard des parlements. C’est le plus mauvais cadeau que le vieux monarque faisait à son petit-fils, le tout jeune Louis XVI. En 1775, sans perdre de temps, Restout réclamait la suppression du jury académique du Salon. Au contraire, tout allait se durcir dans les années à venir, marquées par la sédition des uns et le raidissement des autres. Bref, une situation typiquement française qui déboucherait, après l’été 1789, sur une guerre ouverte entre le clan davidien et ses adversaires, de Vien à Vincent. Nicole Wilk-Brocard ramasse en deux chapitres denses l’imbroglio révolutionnaire qui jette l’enthousiaste Restout dans les intrigues, puis les prisons des amis de Robespierre et du délicieux Fabre d’Eglantine. Il n’y a pas de fumée sans feu, dit-on. Restout, bondissant des Jacobins au Garde-Meuble en trois ans, montre nul scrupule à évincer qui le gène ou entrave la marche de la Nation. Notons que l’homme que la Terreur jette en prison fin 1793 a autant le sens des opportunités que le respect du patrimoine menacé, religieux comme laïc. Avant de mourir, à 64 ans dans les bras d’une amie chère, il se paya le luxe de jeter, le 14 mai 1793, à ses rouges ennemis : « J’ai vécu libre quand nous étions esclaves ; âpre la conquête de la liberté, pourquoi faut-il que je sois privé de la mienne ? » Disons le avec Pierre Rosenberg, qui préface ce formidable livre : Restout a largement mérité son prénom. Stéphane Guégan
*En société. Pastels du Louvre des 17 et 18e siècles, Musée du Louvre, jusqu’au 10 septembre. Xavier Salmon, Pastels du musée du Louvre XVIIe-XVIIIe siècles, Louvre éditions / Hazan, 59€.
*Nicole Wilk-Brocard, Jean-Bernard Restout. Peintre du roi et révolutionnaire, préface de Pierre Rosenberg, de l’Académie française, ARTHENA, 86€.
Un parfum de XVIIIe siècle…
 Comme les vrais bonheurs vont par deux, la réédition récente de Madame du Deffand et son monde de Benedetta Craveri (Flammarion, 2017, 25€), précédé d’une préface de Marc Fumaroli sur les souplesses de la conversation à la française (si préférables aux tribuns du nouveau dogmatisme), n’avait fait qu’annoncer le retour en librairie de l’épistolière. Surgie à point nommé pour connaître le crépuscule de Louis XIV et les sauteries en tout genre de la Régence, la marquise ne saurait se contenter du libertinage pour oublier le malheur d’être née et bien née. Le pire, ajouterait-elle en fanatique de Montaigne et Pascal, c’est que « vivre sans aimer la vie ne fait pas désirer sa fin ». Le vide et l’ennui, ses terreurs, l’ont conduite à parachever en société, ou la plume à la main, ce qu’elle avait appris à Sceaux, auprès de la duchesse du Maine. C’est le versant plus solaire, plus Saint-Simon et Sévigné, ses idoles, de cette femme douée, disait Sainte-Beuve, de la plus belle langue du XVIIIe siècle. Avec la circonspection qui la préserve des cuistres sombres ou des futurs coupeurs de têtes, l’amie de Voltaire jette des ponts prudents entre Versailles et ces écrivains sulfureux, souvent pensionnés, et déjà sûrs de leurs paroles corrosives. Le très beau passage sur la maladie de la Pompadour, en 1764, dit bien sur quelle crête un rien dangereuse se tiennent ces femmes qui firent aussi l’histoire. Peu de peinture dans les lettres de Madame du Deffand (la Tour de Babel, page 411, ne désigne pas le pastelliste, contrairement à ce que dit l’index), peu d’images hors les siennes et son art du portrait. Nul style n’est plus énergique, déniaisé que le sien. Sainte-Beuve avait l’oreille. SG // Madame du Deffand, Lettres (1742-1780), préface de Chantal Thomas, Le Temps retrouvé, Mercure de France, 14,50€
Comme les vrais bonheurs vont par deux, la réédition récente de Madame du Deffand et son monde de Benedetta Craveri (Flammarion, 2017, 25€), précédé d’une préface de Marc Fumaroli sur les souplesses de la conversation à la française (si préférables aux tribuns du nouveau dogmatisme), n’avait fait qu’annoncer le retour en librairie de l’épistolière. Surgie à point nommé pour connaître le crépuscule de Louis XIV et les sauteries en tout genre de la Régence, la marquise ne saurait se contenter du libertinage pour oublier le malheur d’être née et bien née. Le pire, ajouterait-elle en fanatique de Montaigne et Pascal, c’est que « vivre sans aimer la vie ne fait pas désirer sa fin ». Le vide et l’ennui, ses terreurs, l’ont conduite à parachever en société, ou la plume à la main, ce qu’elle avait appris à Sceaux, auprès de la duchesse du Maine. C’est le versant plus solaire, plus Saint-Simon et Sévigné, ses idoles, de cette femme douée, disait Sainte-Beuve, de la plus belle langue du XVIIIe siècle. Avec la circonspection qui la préserve des cuistres sombres ou des futurs coupeurs de têtes, l’amie de Voltaire jette des ponts prudents entre Versailles et ces écrivains sulfureux, souvent pensionnés, et déjà sûrs de leurs paroles corrosives. Le très beau passage sur la maladie de la Pompadour, en 1764, dit bien sur quelle crête un rien dangereuse se tiennent ces femmes qui firent aussi l’histoire. Peu de peinture dans les lettres de Madame du Deffand (la Tour de Babel, page 411, ne désigne pas le pastelliste, contrairement à ce que dit l’index), peu d’images hors les siennes et son art du portrait. Nul style n’est plus énergique, déniaisé que le sien. Sainte-Beuve avait l’oreille. SG // Madame du Deffand, Lettres (1742-1780), préface de Chantal Thomas, Le Temps retrouvé, Mercure de France, 14,50€
 Au capital symbolique cher à Bourdieu, toujours prompt à lâcher la proie pour l’ombre, je préfère le capital érotique propre au génie des arts. Du rapt à l’extase, de la prise à la sublimation, Ravissement (Citadelles & Mazenod, 59€) explore les modes visuels de l’étreinte sexuée entre la Renaissance et l’art d’aujourd’hui, en-deçà et au-delà du domaine de spécialité de Jérôme Delaplanche. Auteur d’un excellent Noël-Nicolas Coypel (ARTHENA, 2004), il s’attarde peu ici sur l’âge des Lumières, ne parle pas du saphisme chez Boucher comme masque de l’hétérosexualité ou délégation vers d’autres formes d’homosexualité, mais il s’expose, plus audacieux, aux foudres de tous ceux et celles qui, nouveaux croisés de la peinture neutre, ont des envies de bûcher à la vue du moindre nu de femme… Pensez combien les scènes de prédation brutale, voire heureuse, les mettent en fureur ! La chasse au phallocentrisme ne connaît plus de bornes, jusqu’à caricaturer et démonétiser l’analyse sereine du pouvoir masculin. Citant Françoise Frontisi, avec laquelle il a signé quelques livres, Delaplanche note que les féministes qui posent ou forcent l’équivalence entre réalité et fiction en arrivent à condamner la quasi-totalité de la production artistique. Ils et elles oublient que la violence coïtale, pulsions essentielles d’après Freud, appartient au « mystère de nos sexualités » et réconcilie le réel et les images autour du même besoin d’envelopper de fiction l’acte lui-même. Quelque chose de l’ordre du sacrificiel, diraient Masson et Bataille auxquels Delaplanche donne droit de cité à plusieurs reprises, s’agrège au désir et au jeu amoureux. Il se pourrait bien que nos rabat-joie de service n’aient pas accès à ces plaisirs-là. Ravissement vogue en meilleure compagnie, puisque Titien, Bernin, Rubens et Fragonard en sont les invités d’honneur. On peut dire que l’étreinte agressive devient métaphore de la peinture comme théâtre passionnel, et que la matière picturale elle-même s’y substitue à la chair selon le mot vénitien de De Kooning, un peu écorché dans le livre : « Flesh was the reason why oil painting was invented ». SG
Au capital symbolique cher à Bourdieu, toujours prompt à lâcher la proie pour l’ombre, je préfère le capital érotique propre au génie des arts. Du rapt à l’extase, de la prise à la sublimation, Ravissement (Citadelles & Mazenod, 59€) explore les modes visuels de l’étreinte sexuée entre la Renaissance et l’art d’aujourd’hui, en-deçà et au-delà du domaine de spécialité de Jérôme Delaplanche. Auteur d’un excellent Noël-Nicolas Coypel (ARTHENA, 2004), il s’attarde peu ici sur l’âge des Lumières, ne parle pas du saphisme chez Boucher comme masque de l’hétérosexualité ou délégation vers d’autres formes d’homosexualité, mais il s’expose, plus audacieux, aux foudres de tous ceux et celles qui, nouveaux croisés de la peinture neutre, ont des envies de bûcher à la vue du moindre nu de femme… Pensez combien les scènes de prédation brutale, voire heureuse, les mettent en fureur ! La chasse au phallocentrisme ne connaît plus de bornes, jusqu’à caricaturer et démonétiser l’analyse sereine du pouvoir masculin. Citant Françoise Frontisi, avec laquelle il a signé quelques livres, Delaplanche note que les féministes qui posent ou forcent l’équivalence entre réalité et fiction en arrivent à condamner la quasi-totalité de la production artistique. Ils et elles oublient que la violence coïtale, pulsions essentielles d’après Freud, appartient au « mystère de nos sexualités » et réconcilie le réel et les images autour du même besoin d’envelopper de fiction l’acte lui-même. Quelque chose de l’ordre du sacrificiel, diraient Masson et Bataille auxquels Delaplanche donne droit de cité à plusieurs reprises, s’agrège au désir et au jeu amoureux. Il se pourrait bien que nos rabat-joie de service n’aient pas accès à ces plaisirs-là. Ravissement vogue en meilleure compagnie, puisque Titien, Bernin, Rubens et Fragonard en sont les invités d’honneur. On peut dire que l’étreinte agressive devient métaphore de la peinture comme théâtre passionnel, et que la matière picturale elle-même s’y substitue à la chair selon le mot vénitien de De Kooning, un peu écorché dans le livre : « Flesh was the reason why oil painting was invented ». SG
 Ceux qui ont eu la chance de visiter un musée avec Julian Schnabel, d’approcher quelques tableaux avec lui at least, connaissent son avidité, sa justesse de regard. En quelques mots, ce qui l’a touché est dit, défini, fixé, on n’y revient pas… Goya, Delacroix, Manet, Lautrec, Van Gogh, Picasso, ses phares les plus volontiers avoués, ne l’empêchent de voir ailleurs, très loin parfois des coquetteries ou des tabous de l’art d’aujourd’hui si propret. Schnabel est disponible à toute rencontre, toute collision ou collusion entre le monde extérieur et son œuvre de peintre, qu’il construit, conjointement au cinéma, depuis quarante ans. Il y a, du reste, un zest de filmique dans la série qu’expose la Pace Gallery, à Londres, jusqu’au 22 juin. Cela provient d‘abord du matériau de départ, une série de douze gravures en couleurs, chacune représentant un mois de l’année, que l’on doit à William Hamilton (1751-1801) et qui respirent une merveilleuse et trompeuse candeur. Scènes de ferme et de labour, invites amoureuses en tout genre, jusqu’à la planche pré-balthusienne de L’Hiver, où le baiser et la ferveur qu’échangent deux jeunes gens s’accomplit près du feu d’une cheminée ardente. Sur ce fil narratif, Schnabel suspend d’étranges coulées de peinture noire, pas nécessairement du dripping, bien que Norman Rosenthal ait raison de rapprocher de Pollock, dans le somptueux catalogue, cette écriture arachnéenne. L’ancien homme fort de la Royal Academy parle de «pastorale subvertie» à propos de ce contre-discours. Notons que ces tracés d’un noir profond ne manquent pas d’humour et qu’ils agissent comme le révélateur de la fausse innocence d’Hamilton et des rêveries goyesques de Schnabel. « The re-use of a joke », selon son mot, me paraît la formule idoine. SG // Julian Schnabel. The re-use of 2017 by 2018. The re-use of Christmas, birthdays. The re-use of a joke. The re-use of air and water, Pace, 6 Burlington Gardens, London, W1S 3ET, jusqu’au 22 juin, Catalogue, 60$.
Ceux qui ont eu la chance de visiter un musée avec Julian Schnabel, d’approcher quelques tableaux avec lui at least, connaissent son avidité, sa justesse de regard. En quelques mots, ce qui l’a touché est dit, défini, fixé, on n’y revient pas… Goya, Delacroix, Manet, Lautrec, Van Gogh, Picasso, ses phares les plus volontiers avoués, ne l’empêchent de voir ailleurs, très loin parfois des coquetteries ou des tabous de l’art d’aujourd’hui si propret. Schnabel est disponible à toute rencontre, toute collision ou collusion entre le monde extérieur et son œuvre de peintre, qu’il construit, conjointement au cinéma, depuis quarante ans. Il y a, du reste, un zest de filmique dans la série qu’expose la Pace Gallery, à Londres, jusqu’au 22 juin. Cela provient d‘abord du matériau de départ, une série de douze gravures en couleurs, chacune représentant un mois de l’année, que l’on doit à William Hamilton (1751-1801) et qui respirent une merveilleuse et trompeuse candeur. Scènes de ferme et de labour, invites amoureuses en tout genre, jusqu’à la planche pré-balthusienne de L’Hiver, où le baiser et la ferveur qu’échangent deux jeunes gens s’accomplit près du feu d’une cheminée ardente. Sur ce fil narratif, Schnabel suspend d’étranges coulées de peinture noire, pas nécessairement du dripping, bien que Norman Rosenthal ait raison de rapprocher de Pollock, dans le somptueux catalogue, cette écriture arachnéenne. L’ancien homme fort de la Royal Academy parle de «pastorale subvertie» à propos de ce contre-discours. Notons que ces tracés d’un noir profond ne manquent pas d’humour et qu’ils agissent comme le révélateur de la fausse innocence d’Hamilton et des rêveries goyesques de Schnabel. « The re-use of a joke », selon son mot, me paraît la formule idoine. SG // Julian Schnabel. The re-use of 2017 by 2018. The re-use of Christmas, birthdays. The re-use of a joke. The re-use of air and water, Pace, 6 Burlington Gardens, London, W1S 3ET, jusqu’au 22 juin, Catalogue, 60$.