 Je ne peux plus penser au grandiose Fra Angelico sans penser au tout jeune Manet s’enfermant au couvent de San Marco pour dessiner et s’évaluer. La même résolution dans l’évidence les rapproche, la même vérité dans le détachement. Ce sont aussi deux artistes à qui le sang ne fait pas peur. Timothy Verdon, adepte convaincu et convaincant de la «lectio divina», est frappé par cette expression brutale de la permanence eucharistique qu’il glose comme personne. Fra Angelico fait saigner la peinture en multipliant les images du calvaire rédempteur. Peinture et coulure, dirait Guillaume Cassegrain, s’appellent l’une l’autre, à l’instar de la lumière et de l’espace, ces autres vecteurs d’une théologie indissociable de son actualisation sensible. La perspective, invention des hommes, n’est guère moins merveilleuse que «l’altérité du monde céleste», étrangère aux mathématiques. Car Fra Angelico fut peintre, et peintre moderne, avant d’entrer chez les dominicains, au service desquels il montra une fidélité incomparable. Il y avait de l’entrepreneur dans cet homme aussi ouvert au luminisme de Lorenzo Monaco qu’à la virilité de Masaccio. Devenu Fra Giovanni en 1428, il ne renonce en rien à la «carrière» et aux nouveautés du temps, style, technique et iconographie. En s’attardant sur la machinerie du théâtre sacré et la verve dramatique de la prédication dominicaine, Timothy Verdon déniche ailleurs les effets d’une communauté d’intérêts et d’âmes. Il sait aussi sortir des images trop souvent reproduites. L’une des perles de sa superbe étude est la Madone à l’Enfant de Berne, don du peintre Adolf von Stürler, qui fut élève d’Ingres à l’époque de la reconquête primitiviste. Celle où naissait Manet.
Je ne peux plus penser au grandiose Fra Angelico sans penser au tout jeune Manet s’enfermant au couvent de San Marco pour dessiner et s’évaluer. La même résolution dans l’évidence les rapproche, la même vérité dans le détachement. Ce sont aussi deux artistes à qui le sang ne fait pas peur. Timothy Verdon, adepte convaincu et convaincant de la «lectio divina», est frappé par cette expression brutale de la permanence eucharistique qu’il glose comme personne. Fra Angelico fait saigner la peinture en multipliant les images du calvaire rédempteur. Peinture et coulure, dirait Guillaume Cassegrain, s’appellent l’une l’autre, à l’instar de la lumière et de l’espace, ces autres vecteurs d’une théologie indissociable de son actualisation sensible. La perspective, invention des hommes, n’est guère moins merveilleuse que «l’altérité du monde céleste», étrangère aux mathématiques. Car Fra Angelico fut peintre, et peintre moderne, avant d’entrer chez les dominicains, au service desquels il montra une fidélité incomparable. Il y avait de l’entrepreneur dans cet homme aussi ouvert au luminisme de Lorenzo Monaco qu’à la virilité de Masaccio. Devenu Fra Giovanni en 1428, il ne renonce en rien à la «carrière» et aux nouveautés du temps, style, technique et iconographie. En s’attardant sur la machinerie du théâtre sacré et la verve dramatique de la prédication dominicaine, Timothy Verdon déniche ailleurs les effets d’une communauté d’intérêts et d’âmes. Il sait aussi sortir des images trop souvent reproduites. L’une des perles de sa superbe étude est la Madone à l’Enfant de Berne, don du peintre Adolf von Stürler, qui fut élève d’Ingres à l’époque de la reconquête primitiviste. Celle où naissait Manet.
 Oserais-je dire qu’on publie trop sur Caravage et qu’il sert même le plus souvent aux gloses les plus étrangères à sa peinture et son être historique. Deux écueils, en effet, attendent celui qui s’y attelle, la trompeuse transparence du réalisme et, en sens contraire, l’excès interprétatif, grand péché du narcissisme contemporain. Giovanni Careri, conscient de ces dangers mais jouant cartes sur table, se saisit de L’Incrédulité de saint Thomas (Postdam) pour illustrer d’emblée une méthode et, disons-le, une éthique du regard. Le doute, ici, conduit à n’écarter l’analyse d’aucune piste (et Dieu sait si elles sont nombreuses !), il engage surtout la lecture (et le lecteur) à les examiner en toute rigueur. A l’instar de Thomas, le doigt dans la plaie du Christ par défiance des yeux, Careri y regarde plutôt deux fois qu’une avant de trancher le débat que chaque tableau désormais soulève quant à son bouquet très (trop) ouvert de significations. Au risque d’appauvrir un livre d’une richesse incontestable, et qui fait appel à toutes les approches possibles, on dira qu’il privilégie deux dimensions de cette peinture. Tableau de genre ou scène sacrée, selon un distinguo qu’il remet en question, Caravage n’ignore aucune des attentes inhérentes à leur iconographie et au substrat textuel de l’image savante, mais il cherche surtout à les associer à une expérience existentielle forte, selon des modes d’adresse qui varient avec le temps et le contexte de réception. Le second trait distinctif de cet art «révolutionnaire» (Roberto Longhi), révolutionnaire en ce qu’il semble dire le réel avant d’en fixer le sens et l’histoire avant d’en clore le récit, ce second trait est la «réflexion métapicturale» qui traverse l’œuvre et la conscience qui affleure partout des pouvoirs propres de la peinture à élaborer une pensée nouvelle de l’image et du monde. Cela nous vaut, sous la plume précise et incisive de Giovanni Careri, de très belles pages sur le toucher, les effets de miroir, le jeu érotique du regard partagé et la suspension du temps. Cette peinture fait de son action sur nous sa raison d’être.
Oserais-je dire qu’on publie trop sur Caravage et qu’il sert même le plus souvent aux gloses les plus étrangères à sa peinture et son être historique. Deux écueils, en effet, attendent celui qui s’y attelle, la trompeuse transparence du réalisme et, en sens contraire, l’excès interprétatif, grand péché du narcissisme contemporain. Giovanni Careri, conscient de ces dangers mais jouant cartes sur table, se saisit de L’Incrédulité de saint Thomas (Postdam) pour illustrer d’emblée une méthode et, disons-le, une éthique du regard. Le doute, ici, conduit à n’écarter l’analyse d’aucune piste (et Dieu sait si elles sont nombreuses !), il engage surtout la lecture (et le lecteur) à les examiner en toute rigueur. A l’instar de Thomas, le doigt dans la plaie du Christ par défiance des yeux, Careri y regarde plutôt deux fois qu’une avant de trancher le débat que chaque tableau désormais soulève quant à son bouquet très (trop) ouvert de significations. Au risque d’appauvrir un livre d’une richesse incontestable, et qui fait appel à toutes les approches possibles, on dira qu’il privilégie deux dimensions de cette peinture. Tableau de genre ou scène sacrée, selon un distinguo qu’il remet en question, Caravage n’ignore aucune des attentes inhérentes à leur iconographie et au substrat textuel de l’image savante, mais il cherche surtout à les associer à une expérience existentielle forte, selon des modes d’adresse qui varient avec le temps et le contexte de réception. Le second trait distinctif de cet art «révolutionnaire» (Roberto Longhi), révolutionnaire en ce qu’il semble dire le réel avant d’en fixer le sens et l’histoire avant d’en clore le récit, ce second trait est la «réflexion métapicturale» qui traverse l’œuvre et la conscience qui affleure partout des pouvoirs propres de la peinture à élaborer une pensée nouvelle de l’image et du monde. Cela nous vaut, sous la plume précise et incisive de Giovanni Careri, de très belles pages sur le toucher, les effets de miroir, le jeu érotique du regard partagé et la suspension du temps. Cette peinture fait de son action sur nous sa raison d’être.
 Yeux noisette et cheveux fournis, fine moustache et bouche gourmande, nez impérial et corps de danseur, le jeune Louis XIV fut une manière d’Apollon, comblant les femmes et honorant les arts avec l’ardeur qu’il mettrait au gouvernement de la France après 1661. Ainsi la symbolique solaire trouvait-elle en lui un sujet favorable à son propre accomplissement. Mais, au vrai, qui se cachait derrière les talons rouges du portrait de Rigaud, qui se dissimulait sous la sublime armure que les Vénitiens lui offrirent pour bouter les Turcs hors d’Europe ? Et comment saisir l’intimité d’un souverain qui prit conscience à vingt ans qu’il ne s’appartenait pas : « Je ne suis point à moi, je suis à l’univers », lui fait dire le génial Isaac de Benserade, en 1653. Il n’y entrait aucune courtisanerie. Louis, selon nos critères bourgeois, eut-il une « vie » ? Oui, répond Hélène Delalex au terme de l’enquête, fine et piquante, qui l’a conduite à interroger l’iconographie du roi, des langes à la fameuse cire d’Antoine Benoist, et à relire pour nous toutes sortes de témoignages écrits, à commencer par ceux de l’intéressé. Elle sait que la saine franchise de Saint-Simon imposait un ton particulier à son petit inventaire des qualités et des défauts du grand homme. D’emblée, le lecteur est pris par cette chronique des marges de l’histoire officielle, et souvent plus éclairante que l’autre. Comment résister, en effet, à la voix du passé quand elle nous parle si bien des passions d’un roi qui ne les sacrifia jamais à l’exercice du pouvoir, ni ne les laissa entraver les devoirs du trône ? Son faible pour la guitare, ses amours de jeunesse et de vieillesse, sa folie des oranges et des petits pois, autant de preuves, dirait Racine, que le monde avait trouvé son maître.
Yeux noisette et cheveux fournis, fine moustache et bouche gourmande, nez impérial et corps de danseur, le jeune Louis XIV fut une manière d’Apollon, comblant les femmes et honorant les arts avec l’ardeur qu’il mettrait au gouvernement de la France après 1661. Ainsi la symbolique solaire trouvait-elle en lui un sujet favorable à son propre accomplissement. Mais, au vrai, qui se cachait derrière les talons rouges du portrait de Rigaud, qui se dissimulait sous la sublime armure que les Vénitiens lui offrirent pour bouter les Turcs hors d’Europe ? Et comment saisir l’intimité d’un souverain qui prit conscience à vingt ans qu’il ne s’appartenait pas : « Je ne suis point à moi, je suis à l’univers », lui fait dire le génial Isaac de Benserade, en 1653. Il n’y entrait aucune courtisanerie. Louis, selon nos critères bourgeois, eut-il une « vie » ? Oui, répond Hélène Delalex au terme de l’enquête, fine et piquante, qui l’a conduite à interroger l’iconographie du roi, des langes à la fameuse cire d’Antoine Benoist, et à relire pour nous toutes sortes de témoignages écrits, à commencer par ceux de l’intéressé. Elle sait que la saine franchise de Saint-Simon imposait un ton particulier à son petit inventaire des qualités et des défauts du grand homme. D’emblée, le lecteur est pris par cette chronique des marges de l’histoire officielle, et souvent plus éclairante que l’autre. Comment résister, en effet, à la voix du passé quand elle nous parle si bien des passions d’un roi qui ne les sacrifia jamais à l’exercice du pouvoir, ni ne les laissa entraver les devoirs du trône ? Son faible pour la guitare, ses amours de jeunesse et de vieillesse, sa folie des oranges et des petits pois, autant de preuves, dirait Racine, que le monde avait trouvé son maître.
 Énorme fut la production fantastique du XIXe siècle, énorme et moins confinée qu’on ne le croit. En plein essor de la communication, de la presse et du livre illustrés, rien n’échappe désormais au grand nombre. Et le langage des avant-gardes, un temps controversé, rejoint de plus en plus vite le mainstream. L’exposition du Petit Palais et son catalogue ont su redonner aux images les plus étranges ou loufoques le mouvement qui fut le leur après 1820, quand se combinèrent la révolution lithographique et une certaine libéralisation de l’espace public. Si l’accès à tout un imagier ne cessera plus de s’étendre, malgré les effets de rareté dont jouèrent des artistes comme Bresdin et Redon, les œuvres qui véhiculent le merveilleux se diffusent selon de nombreux canaux, depuis les affiches de librairie jusqu’aux publications populaires, justement introduites par les commissaires. Ils aiment à suivre ainsi le destin et les métamorphoses de ces classiques de l’esprit gothique, le Sommeil de la raison de Goya ou le Cauchemar de Füssli, que l’estampe française adapte dans les années 1830. La vague fantastique, on le sait, atteint un sommet au lendemain de la Révolution de juillet et s’en nourrit, rires et larmes. Car, ainsi que le note Todorov en introduction, le surnaturel romantique est moins l’envers que le complément de son vœu de vérité.
Énorme fut la production fantastique du XIXe siècle, énorme et moins confinée qu’on ne le croit. En plein essor de la communication, de la presse et du livre illustrés, rien n’échappe désormais au grand nombre. Et le langage des avant-gardes, un temps controversé, rejoint de plus en plus vite le mainstream. L’exposition du Petit Palais et son catalogue ont su redonner aux images les plus étranges ou loufoques le mouvement qui fut le leur après 1820, quand se combinèrent la révolution lithographique et une certaine libéralisation de l’espace public. Si l’accès à tout un imagier ne cessera plus de s’étendre, malgré les effets de rareté dont jouèrent des artistes comme Bresdin et Redon, les œuvres qui véhiculent le merveilleux se diffusent selon de nombreux canaux, depuis les affiches de librairie jusqu’aux publications populaires, justement introduites par les commissaires. Ils aiment à suivre ainsi le destin et les métamorphoses de ces classiques de l’esprit gothique, le Sommeil de la raison de Goya ou le Cauchemar de Füssli, que l’estampe française adapte dans les années 1830. La vague fantastique, on le sait, atteint un sommet au lendemain de la Révolution de juillet et s’en nourrit, rires et larmes. Car, ainsi que le note Todorov en introduction, le surnaturel romantique est moins l’envers que le complément de son vœu de vérité.
 Un sacré graveur, Matisse le fut assurément, lui qui singeait vers 1900 les autoportraits de Rembrandt au travail sur le cuivre. Sa carrière, tardive comme on sait, ne faisait que s’ébaucher, mais elle affichait déjà d’immenses ambitions. L’estampe y occupa une place et y joua un rôle qu’on a préféré oublier. Elle n’a plus aujourd’hui le prestige du dessin, jet unique, ou du papier découpé, où s’abolit la frontière entre tracé et couleur. Pourtant Matisse a beaucoup gravé, avec l’aide ou non de sa fille Marguerite, avant de collaborer avec des ateliers réputés. Parmi les 829 pièces que recensait en 1983 le catalogue raisonné des Duthuit, le musée Matisse du Cateau-Cambrésis et son directeur Patrice Deparpe ont retenu près de 180 feuilles, tributaires des techniques et des encrages les plus divers, et nées d’une pensée évolutive de la réserve qui convenait si bien à la psyché mallarméenne du maître. Le dessin est rarement centré et la forme souvent ouverte. C’est que le vide où ils prennent vie n’est jamais un support inerte. Aragon, parlant du « ciel blanc de la feuille », en soulignait la présence insistante. A ce peintre si économe de ses moyens, il importe de conserver au visible la possibilité de sa disparition. Plus qu’à un simple exercice d’équilibriste, qui apprivoise la gravitation à tout moment, Matisse comparait ses estampes aux défis de l’acrobate. Eaux-fortes et lithographies bousculaient sa virtuosité par crainte de l’y enfermer. Les bois de Gauguin avaient hanté ses années fauves, de même que l’émulation de Dufy et Derain. A la veille de la guerre, le trait s’allège et virevolte. Durant les années niçoises, la litho lui rend cette maîtrise du réel qu’il croyait avoir perdue. Ses odalisques aux seins lourds, d’ethnies précises, débouchent parfois sur des paraphrases ingresques ou picassiennes de circonstance. Les linogravures de la fin des années 30, où visages et corps se détachent en blanc sur noir, font écho aux monotypes de 1916 tant il est vrai que rien ne se perd chez Matisse.
Un sacré graveur, Matisse le fut assurément, lui qui singeait vers 1900 les autoportraits de Rembrandt au travail sur le cuivre. Sa carrière, tardive comme on sait, ne faisait que s’ébaucher, mais elle affichait déjà d’immenses ambitions. L’estampe y occupa une place et y joua un rôle qu’on a préféré oublier. Elle n’a plus aujourd’hui le prestige du dessin, jet unique, ou du papier découpé, où s’abolit la frontière entre tracé et couleur. Pourtant Matisse a beaucoup gravé, avec l’aide ou non de sa fille Marguerite, avant de collaborer avec des ateliers réputés. Parmi les 829 pièces que recensait en 1983 le catalogue raisonné des Duthuit, le musée Matisse du Cateau-Cambrésis et son directeur Patrice Deparpe ont retenu près de 180 feuilles, tributaires des techniques et des encrages les plus divers, et nées d’une pensée évolutive de la réserve qui convenait si bien à la psyché mallarméenne du maître. Le dessin est rarement centré et la forme souvent ouverte. C’est que le vide où ils prennent vie n’est jamais un support inerte. Aragon, parlant du « ciel blanc de la feuille », en soulignait la présence insistante. A ce peintre si économe de ses moyens, il importe de conserver au visible la possibilité de sa disparition. Plus qu’à un simple exercice d’équilibriste, qui apprivoise la gravitation à tout moment, Matisse comparait ses estampes aux défis de l’acrobate. Eaux-fortes et lithographies bousculaient sa virtuosité par crainte de l’y enfermer. Les bois de Gauguin avaient hanté ses années fauves, de même que l’émulation de Dufy et Derain. A la veille de la guerre, le trait s’allège et virevolte. Durant les années niçoises, la litho lui rend cette maîtrise du réel qu’il croyait avoir perdue. Ses odalisques aux seins lourds, d’ethnies précises, débouchent parfois sur des paraphrases ingresques ou picassiennes de circonstance. Les linogravures de la fin des années 30, où visages et corps se détachent en blanc sur noir, font écho aux monotypes de 1916 tant il est vrai que rien ne se perd chez Matisse.
 X comme XX, évidemment, dès qu’on revient à Picasso ou qu’on aborde la réception critique de ses faits et gestes, comme nous y invite le musée de l’hôtel Salé pour ses trente ans. L’ouvrage qui paraît à cette occasion, un précieux éphéméride où l’on suit l’artiste à travers la presse qu’il aura très tôt suscitée et les documents personnels qu’il a religieusement conservés, répond à l’une des priorités de Laurent Le Bon. A peine était-il nommé que le nouveau directeur annonça vouloir rapprocher les collections des archives et ouvrir ce fonds plus largement aux chercheurs. La mesure est de bon sens. A très peu d’exceptions, Picasso a cessé d’être un domaine où les Français comptent et publient. Ce n’est pas le lieu d’en dresser les raisons, il est plus urgent d’organiser la reprise, comme on dit en économie. Elle ne se fera qu’en collaboration étroite avec le musée Picasso et en connaissance des travaux qui sont menés hors de nos frontières. Tout un réseau est à reconstruire, un défi à relever. Ce livre, étape nécessaire, résonne brillamment des plumes du passé, il faut désormais reprendre la parole.
X comme XX, évidemment, dès qu’on revient à Picasso ou qu’on aborde la réception critique de ses faits et gestes, comme nous y invite le musée de l’hôtel Salé pour ses trente ans. L’ouvrage qui paraît à cette occasion, un précieux éphéméride où l’on suit l’artiste à travers la presse qu’il aura très tôt suscitée et les documents personnels qu’il a religieusement conservés, répond à l’une des priorités de Laurent Le Bon. A peine était-il nommé que le nouveau directeur annonça vouloir rapprocher les collections des archives et ouvrir ce fonds plus largement aux chercheurs. La mesure est de bon sens. A très peu d’exceptions, Picasso a cessé d’être un domaine où les Français comptent et publient. Ce n’est pas le lieu d’en dresser les raisons, il est plus urgent d’organiser la reprise, comme on dit en économie. Elle ne se fera qu’en collaboration étroite avec le musée Picasso et en connaissance des travaux qui sont menés hors de nos frontières. Tout un réseau est à reconstruire, un défi à relever. Ce livre, étape nécessaire, résonne brillamment des plumes du passé, il faut désormais reprendre la parole.
 Ne faut-il pas toujours interroger Baudelaire pour saisir à sa naissance les poncifs, fussent-ils féconds, du XXe siècle ? Son éloge de Delacroix, en 1855, est dans toutes les mémoires. La souveraineté sans partage du peintre lui semblait résider dans sa faculté à pénétrer « jusqu’à l’âme par le canal des yeux. […] vu à une distance trop grande pour analyser ou même comprendre le sujet, un tableau de Delacroix a déjà produit sur l’âme une impression riche, heureuse ou mélancolique. On dirait que cette peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa pensée à distance. » Du symbolisme historique aux différents avatars du shamanisme contemporain (Beuys n’en est que l’un des noms), en passant évidemment par le surréalisme et l’automatisme psychique que Breton théorise dès 1924, une large fraction de notre modernité s’est donnée pour objectif d’instaurer « une nouvelle relation, immédiate, entre l’artiste et le spectateur. » C’est Pascal Rousseau qui parle, preuves en mains. L’attrait du magnétisme animal et du spiritisme, qui passionnèrent Balzac et Gautier, s’est exercé sur les générations suivantes avec un succès qu’on ne mesure plus et que ce livre documente avec un soin remarquable. Nul besoin, du reste, de croire à l’existence des esprits (Gautier et Breton n’y croient pas) pour s’intéresser aux mécanismes psychiques et inter-relationnels. Cosa Mentale ne conte pas l’histoire d’une restauration idéaliste, exposition et catalogue ravivent avec brio le cœur neuronal du XXe siècle et ses rêves de télépathie.
Ne faut-il pas toujours interroger Baudelaire pour saisir à sa naissance les poncifs, fussent-ils féconds, du XXe siècle ? Son éloge de Delacroix, en 1855, est dans toutes les mémoires. La souveraineté sans partage du peintre lui semblait résider dans sa faculté à pénétrer « jusqu’à l’âme par le canal des yeux. […] vu à une distance trop grande pour analyser ou même comprendre le sujet, un tableau de Delacroix a déjà produit sur l’âme une impression riche, heureuse ou mélancolique. On dirait que cette peinture, comme les sorciers et les magnétiseurs, projette sa pensée à distance. » Du symbolisme historique aux différents avatars du shamanisme contemporain (Beuys n’en est que l’un des noms), en passant évidemment par le surréalisme et l’automatisme psychique que Breton théorise dès 1924, une large fraction de notre modernité s’est donnée pour objectif d’instaurer « une nouvelle relation, immédiate, entre l’artiste et le spectateur. » C’est Pascal Rousseau qui parle, preuves en mains. L’attrait du magnétisme animal et du spiritisme, qui passionnèrent Balzac et Gautier, s’est exercé sur les générations suivantes avec un succès qu’on ne mesure plus et que ce livre documente avec un soin remarquable. Nul besoin, du reste, de croire à l’existence des esprits (Gautier et Breton n’y croient pas) pour s’intéresser aux mécanismes psychiques et inter-relationnels. Cosa Mentale ne conte pas l’histoire d’une restauration idéaliste, exposition et catalogue ravivent avec brio le cœur neuronal du XXe siècle et ses rêves de télépathie.
 O comme O’Keeffe, la grande oubliée, en France, des expositions… Coup double, donc, pour le musée de Grenoble puisque la « fée de Santa Fe » s’y voit rejointe par les photographes qui s’emparèrent de son regard et de son corps magnifique. Peintre et modèle, elle ne crut pas déchoir en assumant ce double rôle à égalité. La fusion semble son mode d’existence. Les hommes, la nature, le désert, elle les épousa avec une sorte de tranquille assurance et ses vues de New York détournent à leur profit un inévitable élan phallique. Le photographe et marchand Stieglitz, au départ, profite sans modération de cette jeune pousse du Wisconsin. Entre 1916 et 1937, il fait plus de 350 photographies d’elle. A l’inverse, et à ses côtés, elle étend une utile connaissance du milieu dans le New York de Duchamp. Il semble que la fréquentation du créateur de Fountain, dont la symbolique sexuée n’a pu lui échapper, n’ait pas éteint un goût précoce pour Picasso. Revendiquée à grands cris par les féministes après 1970, Georgia avait facilement suivi le cursus des garçons. Ses débuts, sous l’œil de Stieglitz, son mentor et futur mari, datent de 1917. Les médiums ne se cherchent pas querelle alors. O’Keeffe s’intéresse à Strand, Sheeler ou Weston hors de tout mimétisme, elle procède aussi par gros plans, et pousse ses compositions au bord de l’abstraction pour mieux s’en écarter et faire exploser l’Eros du monde. Cette synesthésie va se nourrir de Kandinsky et de culture amérindienne après que Georgia eut découvert le Nouveau-Mexique. Greenberg, en lui reprochant de ramener la peinture à un culte trop « privé », voyait involontairement juste. Ses erreurs sont d’or.
O comme O’Keeffe, la grande oubliée, en France, des expositions… Coup double, donc, pour le musée de Grenoble puisque la « fée de Santa Fe » s’y voit rejointe par les photographes qui s’emparèrent de son regard et de son corps magnifique. Peintre et modèle, elle ne crut pas déchoir en assumant ce double rôle à égalité. La fusion semble son mode d’existence. Les hommes, la nature, le désert, elle les épousa avec une sorte de tranquille assurance et ses vues de New York détournent à leur profit un inévitable élan phallique. Le photographe et marchand Stieglitz, au départ, profite sans modération de cette jeune pousse du Wisconsin. Entre 1916 et 1937, il fait plus de 350 photographies d’elle. A l’inverse, et à ses côtés, elle étend une utile connaissance du milieu dans le New York de Duchamp. Il semble que la fréquentation du créateur de Fountain, dont la symbolique sexuée n’a pu lui échapper, n’ait pas éteint un goût précoce pour Picasso. Revendiquée à grands cris par les féministes après 1970, Georgia avait facilement suivi le cursus des garçons. Ses débuts, sous l’œil de Stieglitz, son mentor et futur mari, datent de 1917. Les médiums ne se cherchent pas querelle alors. O’Keeffe s’intéresse à Strand, Sheeler ou Weston hors de tout mimétisme, elle procède aussi par gros plans, et pousse ses compositions au bord de l’abstraction pour mieux s’en écarter et faire exploser l’Eros du monde. Cette synesthésie va se nourrir de Kandinsky et de culture amérindienne après que Georgia eut découvert le Nouveau-Mexique. Greenberg, en lui reprochant de ramener la peinture à un culte trop « privé », voyait involontairement juste. Ses erreurs sont d’or.
 Et Andy, père du Pop, passa au disco. C’est, en cet hiver 1978-1979, un choix qu’il partage avec maintes stars vieillissantes, souvent ses amis, de la scène rock. Le punk l’a déjà rectifiée… Qu’importe, Iggy, Bowie et Lou Reed se refont une beauté et une jeunesse à Berlin, au son des boîtes à rythme et du beat sombre des clubs pas très clairs. Celui qu’affectionnait Warhol à New York, le Studio 54, plus flamboyant, convenait mieux à notre quinqua richissime que le succès des somptueux Mao de 1973 acculait à un nouveau coup de force. Ce sera Shadows, 102 panneaux presque identiques (tout est dans le presque) qu’il montre presque ensemble (tout est dans le presque) dans la galerie de Heiner Friedrich, au cœur de Soho, en janvier 1979. Une immense frise d’ombres y capture l’espace et le coupe du monde des gris. La couleur, à l’intérieur, explose, des rouges, des oranges et des turquoises sur lesquels l’impression sérigraphique alterne un motif unique, répété en positif et en négatif une centaine de fois, de façon à tourner le cauchemar du même en rêve édénique. Ce théâtre d’ombres, écrit Victor Stoichita, est moins superficiel qu’il n’en a l’air et que Warhol n’affecta de le dire : « Quelqu’un m’a demandé si je pensais qu’ils [les panneaux] étaient de l’art et j’ai dit non. Vous voyez, il y avait de la musique disco durant la fête du vernissage. Je suppose que cela en fait un décor disco. » Stoichita agite d’autres fantômes au-dessus de la guirlande festive, surtout celle de De Chirico, que Warhol a croisé peu avant la mort du vieux maître. Signifierait-elle, cette mort, celle de la peinture elle-même ? Shadows désigne, par défaut, une lumière, un geste, une culture à protéger des nouveaux iconoclastes. La postmodernité a commencé. Autant qu’une exposition atypique, Warhol Unlimited est un de ces catalogues qu’on n’a pas fini d’exploiter.
Et Andy, père du Pop, passa au disco. C’est, en cet hiver 1978-1979, un choix qu’il partage avec maintes stars vieillissantes, souvent ses amis, de la scène rock. Le punk l’a déjà rectifiée… Qu’importe, Iggy, Bowie et Lou Reed se refont une beauté et une jeunesse à Berlin, au son des boîtes à rythme et du beat sombre des clubs pas très clairs. Celui qu’affectionnait Warhol à New York, le Studio 54, plus flamboyant, convenait mieux à notre quinqua richissime que le succès des somptueux Mao de 1973 acculait à un nouveau coup de force. Ce sera Shadows, 102 panneaux presque identiques (tout est dans le presque) qu’il montre presque ensemble (tout est dans le presque) dans la galerie de Heiner Friedrich, au cœur de Soho, en janvier 1979. Une immense frise d’ombres y capture l’espace et le coupe du monde des gris. La couleur, à l’intérieur, explose, des rouges, des oranges et des turquoises sur lesquels l’impression sérigraphique alterne un motif unique, répété en positif et en négatif une centaine de fois, de façon à tourner le cauchemar du même en rêve édénique. Ce théâtre d’ombres, écrit Victor Stoichita, est moins superficiel qu’il n’en a l’air et que Warhol n’affecta de le dire : « Quelqu’un m’a demandé si je pensais qu’ils [les panneaux] étaient de l’art et j’ai dit non. Vous voyez, il y avait de la musique disco durant la fête du vernissage. Je suppose que cela en fait un décor disco. » Stoichita agite d’autres fantômes au-dessus de la guirlande festive, surtout celle de De Chirico, que Warhol a croisé peu avant la mort du vieux maître. Signifierait-elle, cette mort, celle de la peinture elle-même ? Shadows désigne, par défaut, une lumière, un geste, une culture à protéger des nouveaux iconoclastes. La postmodernité a commencé. Autant qu’une exposition atypique, Warhol Unlimited est un de ces catalogues qu’on n’a pas fini d’exploiter.
 Le 13 novembre dernier, nous avons compris ce que signifiait la «nuit parisienne» pour les ennemis de l’Occident «hédoniste». Un bain de sang contre un bain de jouvence… Car Paris, at night, vous soulage de vos années de trop. Dancing ou simple déambulation, ça bouge. Les gens, disait Eustache, y sont plus beaux, la ville plus romanesque. Et Michel Déon, en 1958: «La nuit est vouée aux rencontres brèves, au plaisir, aux dialogues fous, montagne accouchant d’une souris quand le jour se lève.» Mais chacun a sa recette pour prolonger «l’ivresse», un mot qu’affectionne Antoine de Baecque et qui guide son exploration très entraînante des nocturnes parisiens. Aussi féru d’histoire que de cinéma et de littérature, le biographe de Truffaut et Godard n’étudie pas seulement son sujet à la lumière des salles obscures, par films interposés… Tableaux et photographies lui parlent aussi des temps évanouis. Boulevards, bars, cafés, restaurants et boîtes en tout genre sont décrits, sous Louis XIV ou sous Giscard, comme si Guitry lui avait refilé son don d’ubiquité. Notre grand marcheur topographie les espaces du plaisir et leur géographie mouvante, Montmartre, Montparnasse, le Palace de l’ami Pacadis et aujourd’hui le quartier Oberkampf, celui des cafés sonores, celui des bars à vins gagnés sur la fringomnaie de la capitale, celui du Bataclan… Nos nuits, oui, sont bien plus belles que vos jours. Stéphane Guégan
Le 13 novembre dernier, nous avons compris ce que signifiait la «nuit parisienne» pour les ennemis de l’Occident «hédoniste». Un bain de sang contre un bain de jouvence… Car Paris, at night, vous soulage de vos années de trop. Dancing ou simple déambulation, ça bouge. Les gens, disait Eustache, y sont plus beaux, la ville plus romanesque. Et Michel Déon, en 1958: «La nuit est vouée aux rencontres brèves, au plaisir, aux dialogues fous, montagne accouchant d’une souris quand le jour se lève.» Mais chacun a sa recette pour prolonger «l’ivresse», un mot qu’affectionne Antoine de Baecque et qui guide son exploration très entraînante des nocturnes parisiens. Aussi féru d’histoire que de cinéma et de littérature, le biographe de Truffaut et Godard n’étudie pas seulement son sujet à la lumière des salles obscures, par films interposés… Tableaux et photographies lui parlent aussi des temps évanouis. Boulevards, bars, cafés, restaurants et boîtes en tout genre sont décrits, sous Louis XIV ou sous Giscard, comme si Guitry lui avait refilé son don d’ubiquité. Notre grand marcheur topographie les espaces du plaisir et leur géographie mouvante, Montmartre, Montparnasse, le Palace de l’ami Pacadis et aujourd’hui le quartier Oberkampf, celui des cafés sonores, celui des bars à vins gagnés sur la fringomnaie de la capitale, celui du Bataclan… Nos nuits, oui, sont bien plus belles que vos jours. Stéphane Guégan
 *Timothy Verdon, Fra Angelico, Actes Sud, 140€
*Timothy Verdon, Fra Angelico, Actes Sud, 140€
*Giovanni Careri, Caravage. La peinture en ses miroirs, Citadelles et Mazenod, 189€
*Hélène Delalex, Louis XIV intime, Gallimard, 29€
Valérie Sueur-Hermel, Gaëlle Rio, Fantastique ! L’estampe visionnaire. De Goya à Redon, Editions Bibliothèque Nationale de France, 39€.
*Patrice Deparpe (dir.), Matisse et la gravure, l’autre instrument, Silvana, 35€. L’exposition du Musée Matisse (Le Cateau-Cambrésis) reste visible jusqu’au 6 mars 2016.
*Laurent Le Bon (dir.), ¡ Picasso !, Editions de la RMN, 45€
*Pascal Rousseau, Cosa mentale. Art et télépathie au XXe siècle, Gallimard, 49€. L’exposition du Centre Pompidou Metz reste visible jusqu’au 28 mars 2016.
*Guy Tosatto et Sophie Bernard (dir.), Georgia O’Keeffe et ses amis photographes, Somogy, 28€. L’exposition du Musée de Grenoble reste visible jusqu’au 7 février 2016.
*Sébastien Gokalp et Hervé Vanel (dir.), Warhol Unlimited, Paris-Musées, 44,90€. L’exposition du Musée d’art moderne de la Ville de Paris reste visible jusqu’au 7 février 2016.
*Antoine de Baecque, Les Nuits parisiennes XVIIIe-XXIe siècle, Le Seuil, 39€
 Vous rentrez de Rome le cœur gros mais l’âme retendue, reconnaissante envers ces empereurs et ces papes qui en firent un musée à ciel ouvert, un musée de l’esprit… Vous voilà regonflé par deux millénaires de beauté toujours active. Car vous avez su tenir à bonne distance la noria touristique, si prévisible dans son nomadisme et ses stations… Et tout vous tombe des mains, bien sûr, les romans à bons sentiments, les essais contrits, les philosophes officiels du repentir occidental, les journaux à retape, les expositions en trompe-l’œil, le vide sidéral, en somme, de la vie culturelle parisienne. Aux grands maux, les grands remèdes, vous vous saisissez du dernier Sollers et, miracle, la confiance revient. La musique des mots retrouve sa cadence et sa flamme, les idées leur flux naturel. Il y a une vérité de l’oreille, comme il y a une évidence du regard. Récompense immédiate, les dieux sourient à ceux qui les aiment et les respectent. Il faudra se demander un jour pourquoi le terrorisme actuel, qui croit pouvoir arrimer Saint-Just et Robespierre à sa haine du libéralisme et sa détestation des infidèles, ne sait plus écrire comme ces admirables stylistes et modèles trompés de l’iconoclasme anti-chrétien, et antipaïen, des temps actuels. Toutes les révolutions ne se valent pas, contrairement à ce que pensent ces jeunes Français et Françaises dépris de leur pays et de leur culture native par cécité, simple frustration ou lucre hypocrite.
Vous rentrez de Rome le cœur gros mais l’âme retendue, reconnaissante envers ces empereurs et ces papes qui en firent un musée à ciel ouvert, un musée de l’esprit… Vous voilà regonflé par deux millénaires de beauté toujours active. Car vous avez su tenir à bonne distance la noria touristique, si prévisible dans son nomadisme et ses stations… Et tout vous tombe des mains, bien sûr, les romans à bons sentiments, les essais contrits, les philosophes officiels du repentir occidental, les journaux à retape, les expositions en trompe-l’œil, le vide sidéral, en somme, de la vie culturelle parisienne. Aux grands maux, les grands remèdes, vous vous saisissez du dernier Sollers et, miracle, la confiance revient. La musique des mots retrouve sa cadence et sa flamme, les idées leur flux naturel. Il y a une vérité de l’oreille, comme il y a une évidence du regard. Récompense immédiate, les dieux sourient à ceux qui les aiment et les respectent. Il faudra se demander un jour pourquoi le terrorisme actuel, qui croit pouvoir arrimer Saint-Just et Robespierre à sa haine du libéralisme et sa détestation des infidèles, ne sait plus écrire comme ces admirables stylistes et modèles trompés de l’iconoclasme anti-chrétien, et antipaïen, des temps actuels. Toutes les révolutions ne se valent pas, contrairement à ce que pensent ces jeunes Français et Françaises dépris de leur pays et de leur culture native par cécité, simple frustration ou lucre hypocrite. Que l’histoire ne se répète pas, Sollers le sait bien, lui qui mit éphémèrement un col Mao au dictionnaire, comme Hugo l’avait coiffé d’un bonnet phrygien. Plus il avance en âge, mieux il écrit et s’observe, admet ses faux pas et confirme ses vraies passions, Homère, la Bible, la poésie chinoise, Dante, Baltasar Gracián, Bach, Watteau, Mozart, Chateaubriand, Lautréamont, Céline, Bataille… On dira que Mouvement, parce qu’il met en branle cette armée d’ombres et converse avec Hegel (notre photo) et le premier Marx, hors du pacte et de l’ennui des récits balisés, n’est pas un roman, on dira que sa couverture ment qui s’en réclame. Ce qu’on ne dira pas, à moins de le lire, c’est la ciselure de sa prose, son humour dévastateur, son art romanesque de passer l’actualité au crible d’une lucidité décapante, son nez désormais aguerri aux pièges de la bienpensance de gauche et, au fond, son girondisme de grand Bordelais. Il ne vous a peut-être pas échappé qu’il rejoint plutôt Lamartine sur 1789 que l’historiographie montagnarde, ivre de ses violences rétrospectives. Né peu avant la guerre, Sollers se souvient que le premier acte des nazis, à Bordeaux, et donc en zone occupée, fut de détruire le monument dressé à la mémoire de Vergniaud et de ses compagnons… Guerre des symboles… On n’en est pas sorti… Drapée dans la tunique du bien, et l’oubli du péché originel, l’intolérance contemporaine, pareil au narco-système dont elle est souvent parente, a seulement changé de visage mais frappe toujours par ces « innovations » que Montaigne notait, inquiet, au temps des guerres de religion. Parce que « les nihilistes ne peuvent pas penser le néant, ils y courent», avertit Sollers, lanceur d’alertes, mais en bon et beau français.
Que l’histoire ne se répète pas, Sollers le sait bien, lui qui mit éphémèrement un col Mao au dictionnaire, comme Hugo l’avait coiffé d’un bonnet phrygien. Plus il avance en âge, mieux il écrit et s’observe, admet ses faux pas et confirme ses vraies passions, Homère, la Bible, la poésie chinoise, Dante, Baltasar Gracián, Bach, Watteau, Mozart, Chateaubriand, Lautréamont, Céline, Bataille… On dira que Mouvement, parce qu’il met en branle cette armée d’ombres et converse avec Hegel (notre photo) et le premier Marx, hors du pacte et de l’ennui des récits balisés, n’est pas un roman, on dira que sa couverture ment qui s’en réclame. Ce qu’on ne dira pas, à moins de le lire, c’est la ciselure de sa prose, son humour dévastateur, son art romanesque de passer l’actualité au crible d’une lucidité décapante, son nez désormais aguerri aux pièges de la bienpensance de gauche et, au fond, son girondisme de grand Bordelais. Il ne vous a peut-être pas échappé qu’il rejoint plutôt Lamartine sur 1789 que l’historiographie montagnarde, ivre de ses violences rétrospectives. Né peu avant la guerre, Sollers se souvient que le premier acte des nazis, à Bordeaux, et donc en zone occupée, fut de détruire le monument dressé à la mémoire de Vergniaud et de ses compagnons… Guerre des symboles… On n’en est pas sorti… Drapée dans la tunique du bien, et l’oubli du péché originel, l’intolérance contemporaine, pareil au narco-système dont elle est souvent parente, a seulement changé de visage mais frappe toujours par ces « innovations » que Montaigne notait, inquiet, au temps des guerres de religion. Parce que « les nihilistes ne peuvent pas penser le néant, ils y courent», avertit Sollers, lanceur d’alertes, mais en bon et beau français. Un autre Bordelais propre à vous remettre d’aplomb, c’est Marquet (1875-1947), que la méchante vulgate aime à classer parmi les seconds couteaux du fauvisme. Colossale erreur dont la belle exposition de Sophie Krebs, sans faire de vagues, prend nettement la mesure. Seul Matisse, dans cette histoire pourtant collective, aurait eu du génie, seul il aurait porté la leçon de Gustave Moreau, leur maître à l’école des Beaux-Arts, vers la rupture qui ferait des Fauves les accoucheurs d’une peinture reconduite à l’essentiel. Bref, nous nous étions habitués à traiter le grand Marquet en apostat d’une virulence qu’il n’avait pas eu le cran de pratiquer longtemps. De fait, la synthèse subtile, l’appel direct au spectateur et le rapport intime au réel, comme le note Claudine Grammont, le définissent mieux que la pyrotechnie exclusive, celle que nous attachons, par sécheresse d’analyse, au groupe. Le fugace, l’émiettement ne captive pas Marquet. Nulle série, comme chez Monet, mais la chose sentie, savoureusement. Du fauvisme, à sa manière, il fut donc le Manet, comme le suggérait Claude Roger-Marx en mars 1939, et comme le confirment son sens de la composition solide, du dessin chinois ou japonais, des surfaces dépouillées et douces à l’œil. Le bavardage n’est pas français, ni le barbouillage. Et Dieu sait si ces peintres se sont voulus français !
Un autre Bordelais propre à vous remettre d’aplomb, c’est Marquet (1875-1947), que la méchante vulgate aime à classer parmi les seconds couteaux du fauvisme. Colossale erreur dont la belle exposition de Sophie Krebs, sans faire de vagues, prend nettement la mesure. Seul Matisse, dans cette histoire pourtant collective, aurait eu du génie, seul il aurait porté la leçon de Gustave Moreau, leur maître à l’école des Beaux-Arts, vers la rupture qui ferait des Fauves les accoucheurs d’une peinture reconduite à l’essentiel. Bref, nous nous étions habitués à traiter le grand Marquet en apostat d’une virulence qu’il n’avait pas eu le cran de pratiquer longtemps. De fait, la synthèse subtile, l’appel direct au spectateur et le rapport intime au réel, comme le note Claudine Grammont, le définissent mieux que la pyrotechnie exclusive, celle que nous attachons, par sécheresse d’analyse, au groupe. Le fugace, l’émiettement ne captive pas Marquet. Nulle série, comme chez Monet, mais la chose sentie, savoureusement. Du fauvisme, à sa manière, il fut donc le Manet, comme le suggérait Claude Roger-Marx en mars 1939, et comme le confirment son sens de la composition solide, du dessin chinois ou japonais, des surfaces dépouillées et douces à l’œil. Le bavardage n’est pas français, ni le barbouillage. Et Dieu sait si ces peintres se sont voulus français ! En l’absence de l’implacable Portait de Rouveyre (MNAM, 1904), le groupe des nus féminins établit cette filiation décisive dès le premier moment du parcours, l’un des plus forts. A vouloir concentrer en Picasso l’Eros moderne, l’histoire de l’art, avec ou sans l’appui du puritanisme moderniste, a chassé de nos mémoires la part la plus sexuée des nouveaux fauves. Marquet, Camoin et Matisse, face au modèle, se sont pourtant vite dégagés des joliesses fin-de-siècle et des pudeurs nabies. Ils font sauter, ces supposés dynamiteurs, l’interdit qui frappe la toison pubienne et les autres signes d’une vérité reconquise. Quelle merveille de verdeur que le Nu au divan de 1914 (notre photo) ! Et combien nous aurions aimé le voir dans la lumière de La Femme blonde (MNAM, 1919), pour lequel on donnerait tout Vallotton… On se consolera avec l’album lubrique et saphique de 1920, diffusé sous le manteau et sous un titre, L’Académie des dames. Vingt attitudes par Albert Marquet, qui renvoyait au Modi de Giulio Romano. Le paysage et la marine gorgés de lumière pourront prendre bientôt le dessus, Marquet continuera à déshabiller son motif avec délicatesse. Qu’il scrute les berges de la Seine ou les bords de la Méditerranée, à Saint-Tropez, Naples ou depuis les hauteurs d’Alger, la volonté de pénétrer des beautés de la nature, et non quelque paresse, dicte le retour à certains motifs, élus autant que plébiscités par une clientèle et des marchands toujours plus avides. L’exposition aurait pu le rappeler, Marquet connut le succès commercial dès l’entre-deux-guerres, lequel fut loin de se démentir sous l’Occupation, qu’il vécut en Afrique du Nord. Cet épisode mal connu (voir nos Arts en péril, Hazan, 2015) n’aurait pas manqué de retenir le visiteur s’il avait été isolé de la séquence algérienne. Le 3 juillet 1943, L’Écho d’Alger reproduisait une photographie montrant De Gaulle et Camoin, côte à côte, quelques mois après le débarquement des forces alliées en Afrique du Nord. Peintre d’histoire, Marquet ? Eh oui. Stéphane Guégan
En l’absence de l’implacable Portait de Rouveyre (MNAM, 1904), le groupe des nus féminins établit cette filiation décisive dès le premier moment du parcours, l’un des plus forts. A vouloir concentrer en Picasso l’Eros moderne, l’histoire de l’art, avec ou sans l’appui du puritanisme moderniste, a chassé de nos mémoires la part la plus sexuée des nouveaux fauves. Marquet, Camoin et Matisse, face au modèle, se sont pourtant vite dégagés des joliesses fin-de-siècle et des pudeurs nabies. Ils font sauter, ces supposés dynamiteurs, l’interdit qui frappe la toison pubienne et les autres signes d’une vérité reconquise. Quelle merveille de verdeur que le Nu au divan de 1914 (notre photo) ! Et combien nous aurions aimé le voir dans la lumière de La Femme blonde (MNAM, 1919), pour lequel on donnerait tout Vallotton… On se consolera avec l’album lubrique et saphique de 1920, diffusé sous le manteau et sous un titre, L’Académie des dames. Vingt attitudes par Albert Marquet, qui renvoyait au Modi de Giulio Romano. Le paysage et la marine gorgés de lumière pourront prendre bientôt le dessus, Marquet continuera à déshabiller son motif avec délicatesse. Qu’il scrute les berges de la Seine ou les bords de la Méditerranée, à Saint-Tropez, Naples ou depuis les hauteurs d’Alger, la volonté de pénétrer des beautés de la nature, et non quelque paresse, dicte le retour à certains motifs, élus autant que plébiscités par une clientèle et des marchands toujours plus avides. L’exposition aurait pu le rappeler, Marquet connut le succès commercial dès l’entre-deux-guerres, lequel fut loin de se démentir sous l’Occupation, qu’il vécut en Afrique du Nord. Cet épisode mal connu (voir nos Arts en péril, Hazan, 2015) n’aurait pas manqué de retenir le visiteur s’il avait été isolé de la séquence algérienne. Le 3 juillet 1943, L’Écho d’Alger reproduisait une photographie montrant De Gaulle et Camoin, côte à côte, quelques mois après le débarquement des forces alliées en Afrique du Nord. Peintre d’histoire, Marquet ? Eh oui. Stéphane Guégan
 *Philippe Sollers, Mouvement, Gallimard, 19€. Puisque nous en sommes à signaler des lectures roboratives, on recommandera le nouveau roman de Philippe Bordas dont Chant furieux a révélé la verve célinienne et le lyrisme acide. Il avait su mettre de la passion dans une histoire de crampons, Cœur-Volant (Gallimard, 20,50€) observe la furie des corps dans une histoire de cœur. Amants, heureux amants, disait Valery Larbaud. On pense à leur incandescence en lisant Bordas, et aux virées du Paysan de Paris. La frontière entre prose et poésie s’annule, fusion charnelle et effusion sentimentale ne font plus qu’une. On ne se libère pas de l’amour par le sexe, ni du chant par l’ironie. L’aigre-doux est aussi le domaine de Marie Nimier, qui n’a pas son pareil pour alterner la violence du réel et le cocasse de sa fantaisie, passer du cru au feutré, sans jamais trahir complètement l’âme de ses personnages. Ils sont trois, plongés dans un huis clos plus humide et torride que la pièce de Sartre. Je ne sais pourquoi La Plage (Gallimard, 14€), dont le temps revécu est l’autre protagoniste, me fait penser à ce mot de Heidegger ou de Hölderlin, c’est tout comme, cité par Sollers : « Il n’y a de secret que là où règne la tendresse. » Marie Nimier a le courage et la pudeur de ses sentiments, cela devient rare. SG
*Philippe Sollers, Mouvement, Gallimard, 19€. Puisque nous en sommes à signaler des lectures roboratives, on recommandera le nouveau roman de Philippe Bordas dont Chant furieux a révélé la verve célinienne et le lyrisme acide. Il avait su mettre de la passion dans une histoire de crampons, Cœur-Volant (Gallimard, 20,50€) observe la furie des corps dans une histoire de cœur. Amants, heureux amants, disait Valery Larbaud. On pense à leur incandescence en lisant Bordas, et aux virées du Paysan de Paris. La frontière entre prose et poésie s’annule, fusion charnelle et effusion sentimentale ne font plus qu’une. On ne se libère pas de l’amour par le sexe, ni du chant par l’ironie. L’aigre-doux est aussi le domaine de Marie Nimier, qui n’a pas son pareil pour alterner la violence du réel et le cocasse de sa fantaisie, passer du cru au feutré, sans jamais trahir complètement l’âme de ses personnages. Ils sont trois, plongés dans un huis clos plus humide et torride que la pièce de Sartre. Je ne sais pourquoi La Plage (Gallimard, 14€), dont le temps revécu est l’autre protagoniste, me fait penser à ce mot de Heidegger ou de Hölderlin, c’est tout comme, cité par Sollers : « Il n’y a de secret que là où règne la tendresse. » Marie Nimier a le courage et la pudeur de ses sentiments, cela devient rare. SG *** Vient de paraître : Ingres, Lettres 1841-1867. De l’Âge d’or à Homère déifié, édition établie, présentée et annotée par Daniel Ternois. Préface de Stéphane Guégan, 2 tomes, Honoré Champion éditeur, 230€. Indispensable, évidemment.
*** Vient de paraître : Ingres, Lettres 1841-1867. De l’Âge d’or à Homère déifié, édition établie, présentée et annotée par Daniel Ternois. Préface de Stéphane Guégan, 2 tomes, Honoré Champion éditeur, 230€. Indispensable, évidemment.


















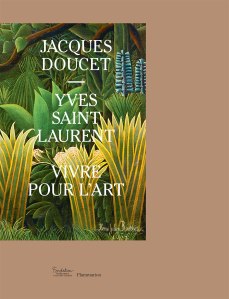







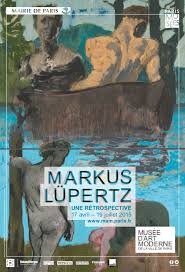




 Des bruts, Chaissac et Dubuffet? Des naïfs, des sauvages… Et puis quoi encore? Évidemment, ça arrange l’histoire de l’art de nous le faire croire et d’héroïser leur contre-culture, pour parler l’idiome de la secte. Eux n’ont jamais opposé une vérité à l’autre. Leur démarche, mois uniforme que commune, aura plutôt consisté à élargir le domaine de l’art à d’autres pratiques, d’autres savoirs, en les tirant d’autres territoires de la création. S’ils en privilégient les marges en apparence, c’est pour mieux en libérer le cœur et les acteurs. L’art des enfants, l’art des simples ou l’art des fous, dont les surréalistes s’étaient déjà réclamés, les poussent plus loin dans l’exploration d’une poésie débridée, déridée, hautement loufoque, où n’auraient plus cours les derniers blocages intellectuels, moraux et presque sociaux de leurs aînés. Le freudisme de salon avait fait son temps, une cocasserie moins convenable, moins soucieuse des formes, à tous égards, ne demandait qu’à faire contrepoids à la sinistrose de l’après-guerre, compassionnelle ou existentialiste. Toute révolution culturelle s’opère à l’intérieur de ses anciennes limites: Chaissac et Dubuffet ne sont pas des autodidactes, des innocents sortis de nulle part et n’aspirant qu’à rester d’anonymes inventeurs. La brutalité ne saurait être qu’une pose, l’inculte une provocation, le rejet du milieu une stratégie provisoire… Et quand Dubuffet, le plus Parisien, le plus versé dans les usages avant-gardistes, lance «l’art brut» en novembre 1947, dans les sous-sols de la galerie René Drouin, Chaissac grogne un peu: «Et vinci. le titien Michel ange et compagnie ne pourrait-on pas appelér ça l’art barbare?»
Des bruts, Chaissac et Dubuffet? Des naïfs, des sauvages… Et puis quoi encore? Évidemment, ça arrange l’histoire de l’art de nous le faire croire et d’héroïser leur contre-culture, pour parler l’idiome de la secte. Eux n’ont jamais opposé une vérité à l’autre. Leur démarche, mois uniforme que commune, aura plutôt consisté à élargir le domaine de l’art à d’autres pratiques, d’autres savoirs, en les tirant d’autres territoires de la création. S’ils en privilégient les marges en apparence, c’est pour mieux en libérer le cœur et les acteurs. L’art des enfants, l’art des simples ou l’art des fous, dont les surréalistes s’étaient déjà réclamés, les poussent plus loin dans l’exploration d’une poésie débridée, déridée, hautement loufoque, où n’auraient plus cours les derniers blocages intellectuels, moraux et presque sociaux de leurs aînés. Le freudisme de salon avait fait son temps, une cocasserie moins convenable, moins soucieuse des formes, à tous égards, ne demandait qu’à faire contrepoids à la sinistrose de l’après-guerre, compassionnelle ou existentialiste. Toute révolution culturelle s’opère à l’intérieur de ses anciennes limites: Chaissac et Dubuffet ne sont pas des autodidactes, des innocents sortis de nulle part et n’aspirant qu’à rester d’anonymes inventeurs. La brutalité ne saurait être qu’une pose, l’inculte une provocation, le rejet du milieu une stratégie provisoire… Et quand Dubuffet, le plus Parisien, le plus versé dans les usages avant-gardistes, lance «l’art brut» en novembre 1947, dans les sous-sols de la galerie René Drouin, Chaissac grogne un peu: «Et vinci. le titien Michel ange et compagnie ne pourrait-on pas appelér ça l’art barbare?» On respecte ici son écriture et sa ponctuation volontiers fautives, espiègles, conformément aux choix éditoriaux de Dominique Brunet et Josette-Yolande Rasle. Ils viennent de rassembler, en deux volumes aussi indispensables l’un que l’autre, la correspondance que Chaissac échangea avec Dubuffet et
On respecte ici son écriture et sa ponctuation volontiers fautives, espiègles, conformément aux choix éditoriaux de Dominique Brunet et Josette-Yolande Rasle. Ils viennent de rassembler, en deux volumes aussi indispensables l’un que l’autre, la correspondance que Chaissac échangea avec Dubuffet et  C’est fin 1943 que Paulhan, œil alerte, commence à s’intéresser à Chaissac et Dubuffet. C’est lui encore qui les pousse à s’écrire et s’épauler. C’est lui enfin qui intègre les deux complices à ses entreprises propres à partir de 1946, la collection Métamorphoses, les Cahiers de la Pléiade, ouverts à
C’est fin 1943 que Paulhan, œil alerte, commence à s’intéresser à Chaissac et Dubuffet. C’est lui encore qui les pousse à s’écrire et s’épauler. C’est lui enfin qui intègre les deux complices à ses entreprises propres à partir de 1946, la collection Métamorphoses, les Cahiers de la Pléiade, ouverts à  Les anniversaires en ce début d’année nous bousculent. Après Le Sacre et ses tempi affolés, Alcools et son ivresse indémodable. Stravinsky, Apollinaire, 1913… Il ne manque que la réouverture du
Les anniversaires en ce début d’année nous bousculent. Après Le Sacre et ses tempi affolés, Alcools et son ivresse indémodable. Stravinsky, Apollinaire, 1913… Il ne manque que la réouverture du  Le livre de Campa, énorme et léger, érudit et vif, maîtrise une information confondante sans y noyer son lecteur. Nombreux et périlleux étaient pourtant les obstacles à surmonter. La Belle époque ne bute-t-elle pas sur la méconnaissance, de plus en en plus répandue, de notre histoire politique? La poésie, elle, n’attire guère les foules, encore moins celle d’une période que l’on présente habituellement comme intermédiaire entre le symbolisme et le surréalisme. Et que dire du milieu pictural, si ouvert et cosmopolite, dont Apollinaire fut l’un des acteurs et des témoins essentiels ! Comment aborder enfin le nationalisme particulier de ce «Russe», né en Italie de père inconnu, et fier de défendre l’art français avant de se jeter dans la guerre de 14 par anti-germanisme ? Or la biographie de Campa ne se laisse jamais déborder par l’ampleur qu’elle s’assigne et la qualité d’écriture qu’elle s’impose. On ne saurait oublier la difficulté majeure de l’entreprise, Apollinaire lui-même et sa méfiance instinctive, nietzschéenne, des catégories auxquelles la librairie française obéissait servilement. Ce n’était pas son moindre charme aux yeux de Picasso. Pour avoir refusé la pensée unique et la tyrannie de l’éphémère, ces dieux du XXe siècle, l’écrivain et le critique d’art restent donc difficiles à saisir. Nos codes s’affolent à sa lecture. Il faut pourtant l’accepter en bloc. On aimerait tant qu’il ait prêché le modernisme sans retenue, au mépris de ce que l’art du jour mettait justement en péril, dans une adhésion totale à chacune des nouveautés dont se réclamaient ses contemporains. Entre 1898 et 1918, de la mort de Mallarmé à la sienne, il fut pourtant tout autre chose que le chantre abusé des avant-gardes européennes.
Le livre de Campa, énorme et léger, érudit et vif, maîtrise une information confondante sans y noyer son lecteur. Nombreux et périlleux étaient pourtant les obstacles à surmonter. La Belle époque ne bute-t-elle pas sur la méconnaissance, de plus en en plus répandue, de notre histoire politique? La poésie, elle, n’attire guère les foules, encore moins celle d’une période que l’on présente habituellement comme intermédiaire entre le symbolisme et le surréalisme. Et que dire du milieu pictural, si ouvert et cosmopolite, dont Apollinaire fut l’un des acteurs et des témoins essentiels ! Comment aborder enfin le nationalisme particulier de ce «Russe», né en Italie de père inconnu, et fier de défendre l’art français avant de se jeter dans la guerre de 14 par anti-germanisme ? Or la biographie de Campa ne se laisse jamais déborder par l’ampleur qu’elle s’assigne et la qualité d’écriture qu’elle s’impose. On ne saurait oublier la difficulté majeure de l’entreprise, Apollinaire lui-même et sa méfiance instinctive, nietzschéenne, des catégories auxquelles la librairie française obéissait servilement. Ce n’était pas son moindre charme aux yeux de Picasso. Pour avoir refusé la pensée unique et la tyrannie de l’éphémère, ces dieux du XXe siècle, l’écrivain et le critique d’art restent donc difficiles à saisir. Nos codes s’affolent à sa lecture. Il faut pourtant l’accepter en bloc. On aimerait tant qu’il ait prêché le modernisme sans retenue, au mépris de ce que l’art du jour mettait justement en péril, dans une adhésion totale à chacune des nouveautés dont se réclamaient ses contemporains. Entre 1898 et 1918, de la mort de Mallarmé à la sienne, il fut pourtant tout autre chose que le chantre abusé des avant-gardes européennes. Fils d’une aventurière, une de ces Polonaises en perpétuel exil qui vivaient de leur charme et de leur intelligence sur la Riviera, Wilhelm de Kostrowitzky a fait de brillantes études avant de convertir son goût des livres en puissance littéraire. D’un lycée à l’autre, au gré des finances aléatoires de sa jolie maman, il s’acoquine à quelques adolescents grandis aussi vite que lui. Certains devaient croiser ses pas plus tard, et se faire un nom à Paris. Sur le moment, on partage déjà tout, les livres interdits,
Fils d’une aventurière, une de ces Polonaises en perpétuel exil qui vivaient de leur charme et de leur intelligence sur la Riviera, Wilhelm de Kostrowitzky a fait de brillantes études avant de convertir son goût des livres en puissance littéraire. D’un lycée à l’autre, au gré des finances aléatoires de sa jolie maman, il s’acoquine à quelques adolescents grandis aussi vite que lui. Certains devaient croiser ses pas plus tard, et se faire un nom à Paris. Sur le moment, on partage déjà tout, les livres interdits,
 Mais le piège des Italiens ne se refermera pas sur Apollinaire, qui reconnaît les vertus roboratives du futurisme. Ainsi son enthousiasme pour Delaunay et la peinture simultanée doit-il s’évaluer à l’aune des tensions du milieu de l’art parisien, gagné par la surchauffe patriotique de l’avant-guerre. En mars 1913, lors du Salon des Indépendants,
Mais le piège des Italiens ne se refermera pas sur Apollinaire, qui reconnaît les vertus roboratives du futurisme. Ainsi son enthousiasme pour Delaunay et la peinture simultanée doit-il s’évaluer à l’aune des tensions du milieu de l’art parisien, gagné par la surchauffe patriotique de l’avant-guerre. En mars 1913, lors du Salon des Indépendants,  De cette guerre, tellement moderne par son alliance de haute technologie et de bas instincts, de mélancolie et d’énergie, de peur et de surpassement de soi, Apollinaire va traduire les tristesses et les beautés. Il en fut l’Ovide et l’Homère. Aux poèmes de l’absence et de l’attente répond l’éclat paradoxal, explosif, de certains calligrammes, qui ont tant fait pour rejeter leur auteur parmi les suppôts d’un «patriotisme niais» ou d’une virilité risible. Il faut croire que notre génération, celle de Laurence Campa, n’a plus de telles préventions à l’égard du poète en uniforme ! Lequel, comme Campa le montre aussi, n’oublie pas le front des arts jusqu’en 1918 (il meurt un jour avant l’armistice !). Ajournés pour cause de conflit, Les Trois Don Juan paraissent en 1915. Là où Apollinaire voyait ou affectait de voir un expédient alimentaire, le lecteur d’aujourd’hui découvre avec bonheur une des plus heureuses divagations, drôles et érotiques à la fois, sur ce grand d’Espagne, obsédé de femmes et repoussant la mort et l’impossible à travers elles. Cette fantaisie admirable, qui absorbe Molière comme Byron sans le moindre scrupule, respire, au plus fort du conflit, l’immoralisme des Onze mille verges… Après son retour du front, le trépané va accumuler les aventures les plus audacieuses, signer des préfaces, seconder les galeries qui se lancent ou se réveillent. Adulé par la nouvelle génération, du Nord/Sud de Reverdy à
De cette guerre, tellement moderne par son alliance de haute technologie et de bas instincts, de mélancolie et d’énergie, de peur et de surpassement de soi, Apollinaire va traduire les tristesses et les beautés. Il en fut l’Ovide et l’Homère. Aux poèmes de l’absence et de l’attente répond l’éclat paradoxal, explosif, de certains calligrammes, qui ont tant fait pour rejeter leur auteur parmi les suppôts d’un «patriotisme niais» ou d’une virilité risible. Il faut croire que notre génération, celle de Laurence Campa, n’a plus de telles préventions à l’égard du poète en uniforme ! Lequel, comme Campa le montre aussi, n’oublie pas le front des arts jusqu’en 1918 (il meurt un jour avant l’armistice !). Ajournés pour cause de conflit, Les Trois Don Juan paraissent en 1915. Là où Apollinaire voyait ou affectait de voir un expédient alimentaire, le lecteur d’aujourd’hui découvre avec bonheur une des plus heureuses divagations, drôles et érotiques à la fois, sur ce grand d’Espagne, obsédé de femmes et repoussant la mort et l’impossible à travers elles. Cette fantaisie admirable, qui absorbe Molière comme Byron sans le moindre scrupule, respire, au plus fort du conflit, l’immoralisme des Onze mille verges… Après son retour du front, le trépané va accumuler les aventures les plus audacieuses, signer des préfaces, seconder les galeries qui se lancent ou se réveillent. Adulé par la nouvelle génération, du Nord/Sud de Reverdy à  C’est un bien joli cadeau de Noël que nous font les éditions Claire Paulhan, si actives dans l’exhumation des journaux intimes et des inédits de la mémoire littéraire, à partir desquels petit à petit il devient possible de faire revivre autrement l’activité créatrice des années d’
C’est un bien joli cadeau de Noël que nous font les éditions Claire Paulhan, si actives dans l’exhumation des journaux intimes et des inédits de la mémoire littéraire, à partir desquels petit à petit il devient possible de faire revivre autrement l’activité créatrice des années d’ Préférerait-on qu’il eût réagi favorablement à l’antisémitisme d’État, à l’étoile jaune, aux excès de la discrimination et aux ultras de la collaboration et de l’Europe allemande, Chateaubriant,
Préférerait-on qu’il eût réagi favorablement à l’antisémitisme d’État, à l’étoile jaune, aux excès de la discrimination et aux ultras de la collaboration et de l’Europe allemande, Chateaubriant, 
 Centrée sur le peintre, cette biographie cursive, lucide mais un peu contrainte, nous prive notamment d’un vrai bilan des années américaines. Or elles furent fastes à bien des titres, au-delà de l’esthétique très ouverte, espace et couleur, des deux ballets mentionnés plus haut. Cette double expérience scénique, en un sens, ramenait Chagall au merveilleux de son cher Bakst et lui donnait l’occasion d’en dépasser l’esthétique. Quand la pente dionysiaque s’ouvrait sous ses pieds et ses pinceaux, il ne se faisait jamais prier… Il faut savoir gré, du reste, à Jackie Wullschläger de ne pas sentimentaliser au sujet des amours du peintre, « l’inconsolable » amant de Bella, et des relations qu’il entretint avec les femmes en général. Voilà qui fait du bien et voilà qui éclaire les dérives du prétendu mystique. Les peintres américains, à l’évidence, ne retinrent que le meilleur de l’artiste. Il fut bien un de ceux qui les poussèrent à sortir de leur coquille formaliste autant que Picasso,
Centrée sur le peintre, cette biographie cursive, lucide mais un peu contrainte, nous prive notamment d’un vrai bilan des années américaines. Or elles furent fastes à bien des titres, au-delà de l’esthétique très ouverte, espace et couleur, des deux ballets mentionnés plus haut. Cette double expérience scénique, en un sens, ramenait Chagall au merveilleux de son cher Bakst et lui donnait l’occasion d’en dépasser l’esthétique. Quand la pente dionysiaque s’ouvrait sous ses pieds et ses pinceaux, il ne se faisait jamais prier… Il faut savoir gré, du reste, à Jackie Wullschläger de ne pas sentimentaliser au sujet des amours du peintre, « l’inconsolable » amant de Bella, et des relations qu’il entretint avec les femmes en général. Voilà qui fait du bien et voilà qui éclaire les dérives du prétendu mystique. Les peintres américains, à l’évidence, ne retinrent que le meilleur de l’artiste. Il fut bien un de ceux qui les poussèrent à sortir de leur coquille formaliste autant que Picasso, 
