
Pour qu’il y ait une petite sœur, il faut un grand frère… Mais la taille et l’âge sont indifférents à l’enfance qui réinvente sans rien dire l’autorité. Celle de Mika, tendre, audacieuse, cocasse, Alice en fit la grâce de ses jeunes années. De 13 mois l’aînée, elle s’est fondue dans cette relation inversée, qui confortait sa décision de ne pas grandir, vieillir. Frère et sœur ont aimé ce lien, si fort qu’il refusait de s’expliquer, ils ont aimé leur vie gémellaire, sous la vigilance aléatoire de leurs comédiens de parents. Comme sorti d’un film de Jean Cocteau, Mika n’a pas seulement jeté un filet protecteur autour d’Alice et son visage d’ange, tracé un espace de rêve et d’insolence, il l’a tenue sous l’emprise de désirs de plus en plus menacés, l’adolescence venue, par l’inceste qui les travaillait. Un soir, l’alcool et le jeu libérant les fantasmes, tout aurait pu basculer. Tout aurait dû faire place au drame le plus sordide, comme dans les mauvais romans qui pullulent depuis que l’intimisme glauque, mais cadré, fait recette. Là où d’autres se seraient complus à symboliser la violence masculine, le malaise des petits secrets bourgeois et l’horreur des blessures inguérissables, Marie Nimier retisse le canevas plus subtil des relations familiales et des sentiments qui les soudent. Elle élargit vite à d’autres personnages le soin de nous éclairer sur Alice, devenue une jeune femme, auteure du livre qu’elle a entrepris d’écrire sur ce frère dont elle ne saurait faire son deuil. Ce livre la conduit à occuper un appartement que son propriétaire en voyage lui confie, à charge de veiller sur des plantes carnivores et un chat tigré, Virgile, aussi insaisissable que la poésie. Ce lieu inconnu devient aussitôt le lieu de l’inconnu, la chance d’une vie que la solitude avait dressée contre elle-même. Si l’on y retrouve l’extrême finesse de touche de Marie Nimier, sa psychologie oblique, son humour des raccourcis, Petite sœur n’oublie pas, autres traits de fabrique savoureux, la truculence, la justesse érotique et cet art consommé de faire progresser le récit comme s’il ignorait jusqu’où Virgile aime à disparaître. SG / Marie Nimier, Petite sœur, Gallimard, 19€.

A consulter Claude Leroy, auquel rien de la vie de Cendrars n’a échappé, 1938 fut une année presque blanche. Silence des sources. Hiver des cœurs ? Un an plus tôt, les amours de Blaise n’allaient pas fort. Raymone Duchâteau, auprès de qui il espérait, à 51 ans, un second souffle, lui préféra son ami Bénouville, que la guerre allait rendre célèbre… Point de roman sur le feu, et pas d’argent en poche. Ce serait le moment de décamper ou de découcher. Pierre Pucheu l’a compris, l’étonnant Pucheu, promis lui à s’activer à Vichy, puis à tomber, malgré sa rupture avec Laval et Pétain, sous les balles communistes en Algérie… Cendrars lui doit d’avoir été présentée à Elisabeth Prévost, autrement plus jeune et riche, en février 1938. Ont-ils, là-bas, dans les Ardennes où elle l’entraîne ? Bu, lu, écrit ensemble, certainement. Mais le reste ? Un nuage d’incertitudes flotte au-dessus de la forêt impénétrable (Guderian, en mai 1940, prouva le contraire). François Sureau, qui a servi dans les Ardennes, à la fin des années 1970, n’a pas épuisé les prestiges de la sylve obscure, il se glisse, le temps d’une plongée temporelle et éminemment littéraire, parmi quelques fantômes au salut amical. Avoir porté l’uniforme ne lui semble pas un crime, impardonnable aux gens de lettres. La preuve par Apollinaire, la preuve par Cendrars, deux étrangers devenus français et lyriques, au feu, en 1914. Un an dans la forêt, sur les traces de « Bee and bee » (Beth et Blaise), tricote les époques et les émotions : cela finit par durer plus de douze mois, tant il est vrai que l’écrivain est maître du temps et que les flirts plus ou moins consommés, à cette altitude et à cette époque, réchauffent les cœurs en hiver. SG / François Sureau, de l’Académie française, Un an dans la forêt, Gallimard, 12,50 €. Claude Leroy a mis en poche deux recueils de textes parmi les moins connus de Cendrars. Voyages, cinéma, peintres modernes, vertus et malheurs du monde accéléré, détestation du renfermé et de l’art en vase clos, deux manières de manifeste : Aujourd’hui (Folio Essais, Gallimard, 8,40€) sort en 1948, Trop, c’est trop (Folio, Gallimard, 8,40€) en 1957. L’après-guerre a dû compter avec le bourlingueur d’un autre temps et d’une autre géographie.

La Russie où Cendrars a reconnu, vif adolescent et mauvais élève, une seconde patrie, moins suisse que poétique, la Russie n’a pas attendu les ballets de Bakst et Diaghilev pour faire des ravages loin de ses frontières. Bien avant même la création du Transsibérien, l’Europe d’Orient s’est frottée à sa sœur d’Occident et mêlée notamment au Tout-Paris, cette internationale moins regardante que celle qui ourdissait 1917. Deux milieux auront favorisé le transfert Est-Ouest à la Belle-Epoque, la littérature et la galanterie, entendons le roman peu farouche et les mœurs peu corsetées. Quant à croiser les lettres et le leste, le chic et le stupre, on peut faire confiance à Jean Lorrain (1855-1906), il n’eut pas son pareil : écrire, décida-t-il très tôt, était un vice parmi d’autres, voire une prostitution plus savoureuse que les autres. Si le génie lui manque, il a du style, et il a appris des mentors qu’il s’est donnés, Baudelaire et Poe, ou qui lui accordèrent, tels Barbey d’Aurevilly ou Edmond de Goncourt, plus qu’un talent de polygraphe sans morale. Une plume intempérante et payée à tant la ligne ou plutôt à tant l’indiscrétion salée… Les clefs de lecture, à ce petit jeu, doivent être, selon le danger encouru, d’une transparence flatteuse ou d’une pointe blessante. Paru en 1886, Très russe, son deuxième roman, aussi peu discret et retenu que son titre, lui vaut un duel avec Guy de Maupassant, évité à la dernière minute. Ils appartenaient tous deux à l’école normande et situaient Flaubert au-dessus de tout. Très russe cite en ouverture La Tentation de saint Antoine dont les décadents, qu’ils soient de Fécamp ou pas, firent un bréviaire vénéneux : « Avance tes lèvres. Mes baisers ont le goût d’un fruit qui se fondrait dans ton cœur. » Celle qui incarne cette promesse de bonheurs illimités fut une précoce experte de la chose. Russe de naissance, Madame Livitinof change de maris et d’amants dès que sa fantaisie, qui n’est pas exclusivement vénale, l’exige. Autour d’elle, on ramasse avec gratitude les miettes de l’amour dont elle ne cède que l’illusion. Il y a bien parfois une âme tendre assez candide, quelque poète symboliste comme cet Allain Mauriat, pour croire à la comédie des sentiments : les hommes sont si puérils ! Voilà un livre qui comblera les féministes et les amateurs de bel esprit, un livre drôle et tordu, français et russe. SG / Jean Lorrain, Très russe, roman suivi de son adaptation théâtrale par Oscar Méténier, édition établie, présentée et annotée par Noëlle Benhamou, Honoré Champion, 48 €. L’éditrice montre bien ce que la pièce tirée du roman, plus sanglante et piquante que son précédent, doit à l’intertexte moliéresque, et notamment au Misanthrope. Ah ! Célimène qui ne peut « empêcher les gens de [la] trouver aimable » !

Il est vertueux d’écrire ou de peindre pour le grand nombre, légitime de faire entrer le peuple dans les romans et les tableaux susceptibles d’être compris de lui. Mais l’histoire nous apprend que les hommes et les femmes qui s’y employèrent, au cours des 250 dernières années, ont le plus souvent sacrifié ces louables intentions au pire des catéchismes et des académismes, le contraire même de la liberté, de la complexité humaine et morale, de l’imprévisibilité, qui devraient présider à toute écriture du réel. La critique de la culture dite bourgeoise, l’examen de ce ou de ceux qu’elle exclurait de son champ, n’est pas d’hier. Et Dominique Fernandez fait justement précéder sa défense et illustration du « roman soviétique » d’un utile rappel des débats qui mirent en émoi un Lamartine en 1840, un Gide ou un Henri Poulaille (grand amateur de Maupassant et de Cendrars) au cours des années 1920-1930. Le Céline du Voyage, qui doit beaucoup à Charles-Louis Philippe, Barbusse et Carco, a été touché par les partisans d’un roman populaire : parler d’en-bas, personnages fort en gueule, situations noires. Mais il s’est bien gardé de prétendre créer une littérature saine à l’usage d’une société dont il importait d’abattre, d’un même mouvement, le classes et les ferments d’immoralité. Une littérature faite de l’acier, de l’hygiène collective, de la tempérance sexuelle que la construction de l’avenir rendait impératifs. Grand connaisseur du roman russe, s’en faisant l’avocat dès 1955, au temps de la renaissance de la NRF sous la conduite de Jean Paulhan, Fernandez n’a jamais confondu littérature révolutionnaire et corsetage stalinien. Certes, la propagande la plus détestable, entre des mains géniales, est capable de nous rappeler que l’esthétique est irréductible à ses conditionnements les plus prescriptifs. On préfère toutefois les vraies découvertes que ce livre décomplexé nous oblige à faire parmi la production pré-jdanovienne. Dans l’élan de la rupture bolchevique, de la pire des guerres civiles, ou de la résistance à la Wehrmacht, il s’est écrit de vrais romans, incarnés, de respiration large, loin du nombrilisme ou du wokisme qui encombrent nos librairies bienpensantes. Blanche, comme le premier Kessel, ou rouge, comme les cavaliers d’Isaac Babel, la littérature russe post-Tolstoï, et même post-Gorki, peut sortir de sa longue satellisation. SG / Dominique Fernandez, de l’Académie française, Le roman soviétique, un continent à découvrir, Grasset, 26€.

Parvenu à l’âge de les relire, Théophile Gautier fit le triste constat que ses belles éditions romantiques s’étaient envolées plus vite que ses cheveux : victime de petits larcins, de prêts amnésiques, la bibliothèque de sa jeunesse pileuse avait notamment perdu les plus rares Renduel de 1830, Hugo, les frénétiques… Il en eût été plus attristé si la bibliophilie des créateurs ressemblait à la thésaurisation obsessionnelle des traqueurs d’incunables. Au contraire, elle reflète, comme une véronique, leur vie de bosses, de déboires et de combines. Fut-il existence plus secouée que celle de Georges Bataille (1897-1962) qui, clerc renoncé, chartiste atypique, vécut pourtant au milieu des livres, à défaut de jamais vivre de sa plume, même au temps de Critique (née en 1946) ? Parce qu’il eut à en vendre une partie, parce qu’elle eut à se déchirer au gré d’un destin sentimental complexe, la bibliothèque de Bataille s’est lentement soustraite à l’ordre du connaissable. En outre, lorsqu’il se défaisait d’un livre avec envoi, l’auteur du Bleu du ciel en déchirait la page qui l’eût trahi, reste de culpabilité catholique et de dévotion aux mots. L’ensemble compta donc plus que les 1283 références consultables sur le site des excellentes éditions du Sandre. Une petite moitié d’entre eux ont fait l’objet de la présente publication, très illustrée, très informée, qui rend accessibles, entre autres, les fameuses dédicaces manuscrites, bon témoignage des vraies fidélités (Michel Leiris, André Masson, Maurice Blanchot…) et des fausses réconciliations (Breton, Eluard, Tzara…). L’anthropologie et la sociologie sont évidemment d’une présence écrasante, conforme à l’idée quasi tauromachique que Bataille se faisait de la culture, définie par l’impératif du sacrifice et la nécessité du rachat. Du reste, la tragique figure de Colette Peignot, entre un Pilniak et le Staline (1935) de Boris Souvarine, nous adresse un énième signe de détresse. Bataille n’avait ni l’envie, ni les moyens, de faire relier ses livres. Certains le furent malgré tout, signe d’élection, tel L’Âge d’homme de Leiris ou le Manet de Tabarant. Les logiques d’argent se brisaient sur l’essentiel, car les livres touchent au sacré. SG / La Bibliothèque de Georges Bataille, Librairie Vignes § librairie du Sandre, 20€.

« A la belle étoile » : Herman Melville n’était pas loin d’estimer que le génie français se résumait à cette formule riche de poésie, d’aventure et d’humour. Le titre que François Gibault a donné à son récit, pour en être proche, promet une harmonie différente avec les éléments, et une manière de fatalité heureuse, si l’on accepte que le bonheur dans un monde sans transcendance, ni restauration écologique possible, peut prendre des formes inattendues. C’est la force du conte d’éveiller chez le lecteur pareil optimisme, c’est surtout la force du conte de Gibault, formé à bonne école, Céline, Marcel Schwob et, pour la note douce-amère, Marcel Aymé. On suit le vagabondage de Sigmund et Gisella, errance mêlée d’aphorismes et de surprises, comme s’il nous était donné à lire quelque version post-atomique de Daphnis et Chloé. Le paysage, certes, s’est singulièrement assombri depuis Longus, mais son exploration très grecque des caprices de l’amour, maladie sans âge, reste exemplaire. La pastorale, mythe infini, n’est-elle pas une sagesse plus qu’une paresse ? Croire à sa « bonne étoile », suggère Gibault en souriant à lui-même, c’est accorder foi aux incertitudes du réel, c’est se rendre disponible aux accidents de la route, pas ceux de la banale automobile, ceux du grand véhicule. Pouvait-on imaginer que l’encre si parisienne de Libera me contenait cette aptitude au merveilleux cosmique, qui ramène à Gide et Giono par le chemin de l’enfance ? La preuve. SG / François Gibault, La Bonne Étoile, récit, Gallimard, 14€. On s’intéressera, au printemps 2023, à la nouvelle édition, revue et augmentée, du Céline de Gibault (Bouquins, 32€), première biographie moderne jamais consacrée à l’écrivain sulfureux. La lecture de Londres (Gallimard, 24€, édité par Régis Tettamanzi), plus fou et fort que Guerre, ne devrait pas lui concilier les nouvelles ligues de vertu. L’actualité célinienne, la refonte notamment des volumes de La Pléiade en raison des manuscrits retrouvés, sera alors plus propice à un bilan.

Puisque Shakespeare l’a dit et que nous sommes faits de l’étoffe des songes, autant rêver les yeux ouverts, marcher tout éveillé dans son rêve, disait Hugo, considérer, dirait Sylvain Tesson, que l’aventure est le nom que nous donnons au besoin de se hisser au-dessus des fourmis, des écrans, des masques, des grèves rituelles, des bâfreries de réveillon… À dates fixes, quatre années durant, notre traceur de cime s’est attelé à la même expédition, rejoindre Trieste par les hauteurs alpines en quittant Menton, skis et paquetage de survie au dos : « Je porte tout ce que je possède », conseillait Cicéron, qui aurait méritait d’être chrétien. Le blanc, là-haut, appelle l’immersion dangereuse, l’exclusion volontaire, la conversion à on ne sait quel absolu. Les peintres et les poètes l’ont mieux dit que les simples ascètes, en raison de leur sens du concret, de leur abandon magnétique à la frousse, au vide et à ce qui semble, dans l’effort absurde, vouloir le combler. « La montagne était notre église. » Tenté par le recentrement métaphysique et les dialogues qu’inspirent l’ivresse des sommets ou les rencontres de hasard, animales ou humaines, ce Journal de bord, aux antipodes de la chronique sportive, possède des accents picturaux qui ne trompent pas : « Sous la neige, le monde se retire. Restent quelques coups de pinceaux chinois. » Le skieur de Cuno Amiet, visible à Orsay et filant ici sur la bande du livre, en fut assurément l’un des déclencheurs. « Je voulais devenir ce personnage : une présence sans valeur dans un monde sans contours. Le voyage deviendrait un déplacement dépourvu de finalité, suspendu dans le monochrome. Ce serait l’action pure, parfaitement réduite à son seul accomplissement. » Le romantisme cher à Tesson, lecteur de Pascal et Byron, n’est pas sans rejoindre Baudelaire, le Gautier le plus goethéen ou le Gide des Caves du Vatican. Rien n’est préférable au sentiment d’être démodé à l’heure de l’hyper-présentisme et, selon le mot de Jarry, du décervelage servile. Du reste, les refuges de montagne, à lire Blanc, sont aussi les derniers refuges de la pensée occidentale, de vrais cabinets de lecture, saint Augustin, Proust, Cendrars y traînent à côté des allumettes. Un livre qui donne envie de grimper ne saurait avoir manqué son but, celui-ci pince, de plus, comme la glace salvatrice, et vous enveloppe de ses silences. SG / Sylvain Tesson, Blanc, Gallimard, 20€.





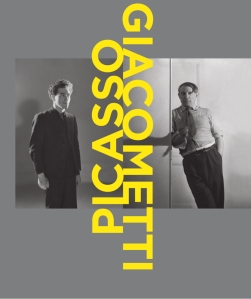



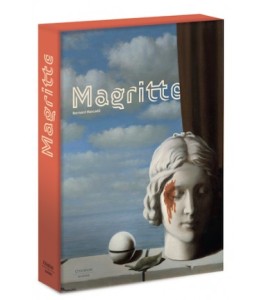



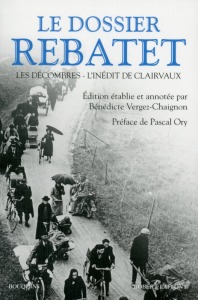
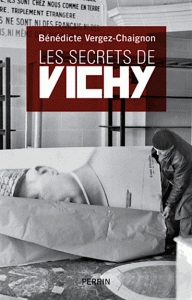


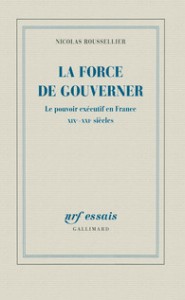

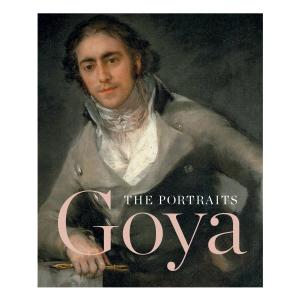
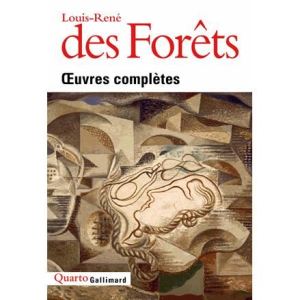








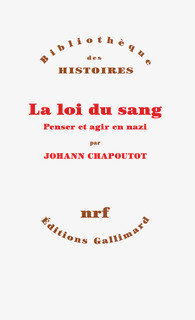
 Directes à souhait, ces «nouvelles mises au point» sont remarquables à plusieurs titres, bien qu’elles portent maintenant sur des «révélations» connues des spécialistes : preuve est ainsi faite de la composante subversive, moitié politique, moitié morale, des Mouches et de Huis Clos, un rapport des Renseignements généraux du 14 janvier 1943 corroborant le témoignage de Sartre et celui d’autres membres du Comité national des écrivains, un des foyers de la résistance intellectuelle; confirmation est donnée au fait que
Directes à souhait, ces «nouvelles mises au point» sont remarquables à plusieurs titres, bien qu’elles portent maintenant sur des «révélations» connues des spécialistes : preuve est ainsi faite de la composante subversive, moitié politique, moitié morale, des Mouches et de Huis Clos, un rapport des Renseignements généraux du 14 janvier 1943 corroborant le témoignage de Sartre et celui d’autres membres du Comité national des écrivains, un des foyers de la résistance intellectuelle; confirmation est donnée au fait que  À l’évidence, l’un de nos prix littéraires devrait être réservé à l’écrivain le plus infréquentable du moment. Revenu avec trois livres sur le devant de la scène,
À l’évidence, l’un de nos prix littéraires devrait être réservé à l’écrivain le plus infréquentable du moment. Revenu avec trois livres sur le devant de la scène,  Ce dernier se nomme Bugeaud et sonne perpétuellement la charge contre les bassesses de l’époque. N’y avait-il pas lieu d’intenter un procès au nostalgique des colonies perdues? Il est vrai que le livre ne donne pas prise à ce genre d’attaque. Bugeaud, c’est Millet se moquant un peu de lui-même ou du rôle qu’on aime à lui faire jouer. Amusant dédoublement, il apporte au roman une cocasserie inattendue, comme si on passait de Blanchot et ses vides angoissés à Queneau et ses satires littéraires. Plutôt que dévoiler la fin, ce qui serait un vrai crime pour le coup, disons qu’elle rejoint l’esprit de L’Être-Bœuf, véritable cri d’amour adressé à la viande bovine, à son Limousin natal et aux plaisirs qu’on dit de bouche. Les textes brefs que publie
Ce dernier se nomme Bugeaud et sonne perpétuellement la charge contre les bassesses de l’époque. N’y avait-il pas lieu d’intenter un procès au nostalgique des colonies perdues? Il est vrai que le livre ne donne pas prise à ce genre d’attaque. Bugeaud, c’est Millet se moquant un peu de lui-même ou du rôle qu’on aime à lui faire jouer. Amusant dédoublement, il apporte au roman une cocasserie inattendue, comme si on passait de Blanchot et ses vides angoissés à Queneau et ses satires littéraires. Plutôt que dévoiler la fin, ce qui serait un vrai crime pour le coup, disons qu’elle rejoint l’esprit de L’Être-Bœuf, véritable cri d’amour adressé à la viande bovine, à son Limousin natal et aux plaisirs qu’on dit de bouche. Les textes brefs que publie  Mélomane averti, Millet aura aussi associé son nom, en 2013, au bicentenaire de la naissance de Wagner, en préfaçant ses Écrits sur la musique, principalement ceux que l’autre Richard consacra au dieu Beethoven et à l’explication ou à la promotion de son propre génie. Ils sont loin de former l’ensemble des essais et articles de Wagner, graphomane par nécessité matérielle et vocation poétique. Millet était donc en droit de le présenter comme le plus «écrivain» des grands musiciens allemands. Le plus écrivain et le plus aimé de ses confrères de la plume, notamment en France. Seul Chopin l’égale dans l’estime et l’admiration de Nerval, Gautier et
Mélomane averti, Millet aura aussi associé son nom, en 2013, au bicentenaire de la naissance de Wagner, en préfaçant ses Écrits sur la musique, principalement ceux que l’autre Richard consacra au dieu Beethoven et à l’explication ou à la promotion de son propre génie. Ils sont loin de former l’ensemble des essais et articles de Wagner, graphomane par nécessité matérielle et vocation poétique. Millet était donc en droit de le présenter comme le plus «écrivain» des grands musiciens allemands. Le plus écrivain et le plus aimé de ses confrères de la plume, notamment en France. Seul Chopin l’égale dans l’estime et l’admiration de Nerval, Gautier et  Ses lettres mettent surtout en évidence sa volonté de puissance et de reconnaissance, qui trouvèrent en Liszt plus qu’une oreille attentive, un agent d’autant plus efficace qu’il s’estimait moins capable de partitions «sublimes». Après avoir conquis le pianiste virtuose et le tombeur byronien des flamboyantes années 1830, Wagner abuse de «la nature essentiellement aimable et aimante» de cet homme à peine plus âgé que lui, mais lié, vers 1848, à toute
Ses lettres mettent surtout en évidence sa volonté de puissance et de reconnaissance, qui trouvèrent en Liszt plus qu’une oreille attentive, un agent d’autant plus efficace qu’il s’estimait moins capable de partitions «sublimes». Après avoir conquis le pianiste virtuose et le tombeur byronien des flamboyantes années 1830, Wagner abuse de «la nature essentiellement aimable et aimante» de cet homme à peine plus âgé que lui, mais lié, vers 1848, à toute  Pour quelqu’un qui s’est tant reproché son impuissance à écrire et sa paresse incurable, Thadée Klossowski de Rola tient plutôt bien sa plume. Elégance, constance, aucune suffisance, autant de vertus dont il eût été criminel de priver le public. Ce journal retrouvé des années 1965-1977, avec des trous et des entailles qui s’expliquent au fil des pages, fuit la complaisance et les trémolos de l’écriture intime. Le stylo de Thadée Klossowski ne bave pas. On ne joue pas les Musset quand on est si bien né. Sa douleur à rester sec sur la page blanche sonne juste, de même que son émerveillement à peine contrit devant ceux qui ont triomphé du livre impossible. Larbaud,
Pour quelqu’un qui s’est tant reproché son impuissance à écrire et sa paresse incurable, Thadée Klossowski de Rola tient plutôt bien sa plume. Elégance, constance, aucune suffisance, autant de vertus dont il eût été criminel de priver le public. Ce journal retrouvé des années 1965-1977, avec des trous et des entailles qui s’expliquent au fil des pages, fuit la complaisance et les trémolos de l’écriture intime. Le stylo de Thadée Klossowski ne bave pas. On ne joue pas les Musset quand on est si bien né. Sa douleur à rester sec sur la page blanche sonne juste, de même que son émerveillement à peine contrit devant ceux qui ont triomphé du livre impossible. Larbaud,