
Le livre que Colette dit préférer parmi les siens, en 1941, n’est pas celui auquel le public l’identifie à présent, elle, ses écolières peu sages, ses amies plus âgées, ses chats, ses fleurs, ses odeurs, son Palais-Royal, sa Bourgogne, son accent du terroir (1). Lire ou relire Le Pur et l’Impur, c’est interroger, en premier lieu, cette préférence. Puis, une fois celle-ci comprise, se demander ce qui a pu pousser Colette à le rééditer et le remanier sous l’Occupation, quand sa suractivité ou la simple prudence l’en dispensaient (2). Le brûlot de 1932, opaque et scabreux, reçu comme tel par la presse alors, s’exposait davantage à froisser la censure et les bonnes âmes, dix ans plus tard, d’autant plus que Colette l’avait enrichi à contre-courant d’une certaine moraline d’époque. Il faut croire que son « meilleur livre » contenait, sous la botte ou non, des vérités bonnes à dire sur les hommes et les femmes, le désir entre individus de sexes différents ou identiques, l’amour et la jalousie. Programme proustien, s’il en était. On sait que Colette, dès les Claudine, observe l’éveil des libidos et leur part d’ombre, fréquente ensuite certaines des plus éminentes représentantes de la Lesbos 1900 et s’en fait même aimer parfois… N’oublions pas, du reste, que le saphisme ne l’a pas attendue pour pénétrer les lettres françaises. Les romans de Victor Joze, dont Seurat et Lautrec secondèrent la popularité, et ceux de Catulle Mendès, que Colette a bien connu à l’époque de son mariage avec Willy, avaient déjà poussé le thème de l’inversion aux limites du tolérable… Jean Lorrain, que mentionne Le Pur et l’Impur, avait osé les pires audaces en la matière. De toutes les marges à la fois, l’auteur de Monsieur de Phocas était bien cet « homme à qui l’abîme n’a jamais suffi ». Rien toutefois n’aurait incité Colette à embrasser cette matière inflammable autant que la lecture de Sodome et Gomorrhe et l’envie de corriger Proust au sujet du lesbianisme. Le génie n’excusait pas tout… Au début des années 1930, Ces plaisirs…, titre provisoirement préféré au Pur et l’Impur, libèrent un parfum de Belle Époque, dont le mythe est en constitution. Colette et Paul Morand, aux avant-postes, le lestent aussitôt d’équivoque. Faisait-il si bon vivre dans la France d’avant 14 ? Y aimait-on à sa guise ? La volupté courait-elle les rues ? En apparence, l’auteur du Blé en herbe (1923) continue à moissonner là où son sensualisme sait rencontrer des lecteurs, du côté des plaisirs « qu’on nomme à la légère physiques ». N’oublions pas non plus que le « nouveau roman » des années 20, Drieu en tête, s’était fait un devoir de son intempérance sexuelle et de son audace à tout en dire. Consciente de cela au seuil des années 30, Colette joue, en outre, avec ses propres textes, et sa notoriété déjà solide, afin de déjouer les attentes. Dès la version de 1932, le livre refuse les pièges de la nostalgie heureuse et du libertinage diapré. André Thérive, qui devait collaborer à La N.R.F. de Drieu, salue la hardiesse de la romancière et la gravité avec laquelle elle dissèque le licencieux en moraliste classique (3).

Les remaniements de 1941, comme Jacques Dupont le montre dans sa présentation de La Pléiade, donnent tous plus de relief et de mordant à « l’évocation du Lesbos aristocratique » (4). L’insolite cueille le lecteur sans tarder…. Après lui avoir promis de « verser au trésor de la connaissance des sens une contribution personnelle », la romancière douche son auditoire en précisant qu’elle parlera « tristement » du plaisir. On était prêt à décoller vers des horizons heureux, à revivre une époque révolue, à rompre tous les tabous, Colette, d’un adverbe, nous plaque à terre, au niveau des illusions où pataugent nos intimes secrets, nos interminables regrets, et nos inlassables frustrations. Le récit débute dans une de ces maisons d’opium chères à son ami Cocteau. Colette s’y met en scène aussitôt. Nez à nez avec un confrère surpris, elle s’en débarrasse. Oui, lui avoue-t-elle, ce sont bien des repérages en vue d’un livre, amusante mise en abyme… Colette ne consomme pas, elle écoute « par devoir professionnel » en humant les effluves d’Orient. Et, précise le récit, il n’est aucun Américain « frété d’alcool », aucun « danseur nu » pour l’en détourner. Mais soudain une voix de femme s’élève du silence, qu’une autre voix, masculine, fait taire brutalement. Elle, c’est Charlotte, une chasseuse mûre, « un Renoir 1875 » (Colette). Lui est beaucoup plus jeune, schéma usuel, vite grippé. Car la violence du jeune amant a pour origine l’insatisfaction charnelle où il laisse après chaque étreinte sa maîtresse. Celle-ci tente de le lui cacher, « tendre imposture » : elle l’aime, mais son corps trahit dans ses transes trop mécaniques ce que son cœur dissimule par charité. La lectrice de La Rochefoucauld qu’est Colette ne met pas longtemps à suspecter derrière la dérive de ce couple mal soudé l’éventail des aveuglements de la passion amoureuse et des exigences de l’amour-propre. Si Colette « ne distingue pas entre le bien et le mal et se préoccupe peu de l’édification de son prochain », notait Apollinaire, elle fait de la sincérité une vertu cardinale et du don réciproque la clef des vraies ententes, fussent-elles courtes. Se connaître, rejoindre l’autre dans le plaisir, tout est là […].
Stéphane Guégan
Lire la suite dans la livraison de février 2023 de la Revue des deux Mondes, qui contient un riche dossier sur l’éminente écrivaine et son féminisme éclairé.
(1)Comment ramener l’œuvre immense de Colette, déjà à l’étroit entre les quatre volumes de La Pléiade, à un seul, qui en fût l’écume, la crème, le must, eût dit Morand depuis le Savoy ? Antoine Compagnon, grand connaisseur et défenseur de l’écrivaine, s’est prêté au difficile exercice du choix, et le sien est bon : les onze titres de ce « tirage spécial », en effet, sont reliés par leurs thèmes et la progressive affirmation d’un style que Benjamin Crémieux, dans La N.R.F. de décembre 1920, eut la prescience de dire féminin, parce que plus abandonné et moins artificiel que les voix masculines (la plupart d’entre elles, précisons) quant aux « sujets » de Colette… On y trouvera, outre Le Pur et l’Impur, Claudine à l’école, qui fit scandale, Mitsou, qui fit pleurer Proust, Le Blé en herbe, qui en initia plus d’un et d’une, La fin de Chéri, plus géniale que Chéri aussi retenu, et qui convertit Gide à son auteure. Si sa vie fut « scandale sur scandale », résumait l’ami Cocteau, sa carrière littéraire fut succès sur succès. Colette a su inventer une langue de la sensation, et placer la mémoire des sens au rang des souvenirs conscients, à l’instar de la chimie proustienne, mais sans le labyrinthisme de Marcel, trop complexe pour toucher le grand public. Willy, volontiers caricaturé et stigmatisé aujourd’hui, et dont on oublie l’esprit et la plume incomparables, accoucha sa jeune épouse (littérairement) autant qu’il la spolia. Il l’aura poussée, au préalable, vers le terrain de sa future excellence, comme le dit Compagnon, l’enfance, les bêtes, la et/ou les sexualités, l’autofiction, sans tournicoter. En lisant Chéri, Gide eut l’impression de voir Olympia pour la première fois, et fit part immédiatement à Colette du double effet de son livre décapant, « nudité » et « dévêtissement » : ils n’étaient pas que de style… A cet égard, on peut regretter que Colette, qui connut tant de peintres, n’ait pas confié à Pierre Bonnard l’illustration de ses œuvres les plus affranchies. Le Bonnard de Parallèlement, où rôdent Sappho, Verlaine et Rimbaud, mais aussi le Bonnard de Marthe nue et de Dingo, ce formidable roman de Mirbeau où les animaux ont déjà voix au chapitre et en remontrent aux hommes, amours, liberté et sagesse. SG / Colette, Le Blé en herbe et autres écrits, préface d’Antoine Compagnon, La Pléiade, Gallimard, tirage spécial, 65€.

(2)Voir Bénédicte Vergez-Chaignon, Colette en guerre 1939-1945, Flammarion, 2022, qui constitue l’enquête enfin documentée, équilibrée, sur un des moments les moins, ou les plus mal, glosés de la biographie de l’auteure. Classée par La Pensée libre, dès 1941, parmi « les écrivains français en chemise brune », puis désignée par les clandestines Lettres françaises comme se montrant trop docile envers certains organes de presse, Colette se garde, en réalité, de toute adhésion au programme de « la nouvelle Europe » ou de la Révolution nationale. On ne saurait lui reprocher de chanter la terre et les animaux sous la Botte, elle l’a toujours fait, en accord avec la fronde anti-technicienne des années 1930, que Vichy reprend à son compte. Les contributions de Colette au Petit Parisien et à La Gerbe ne concèdent rien à la ligne politique de ces publications acquises à la Collaboration. Orné d’un portrait de l’écrivaine par Cocteau (voir ill. 2, supra), Le Pur et l’Impur, en 1941, parait sous les couleurs d’Aux Armes de France, avatar aryanisé de Calmann-Lévy, à qui elle confie aussi Mes Cahiers, livre innocent de toute compromission, et qu’elle adresse à Drieu avec un envoi amical (ils étaient proches depuis la fin des années 1920). C’est que la vie des arts sous l’Occupation ne ressemble pas à sa caricature anachronique et angélique. Colette continue alors à fréquenter ses égaux de la République des lettres, quels qu’ils soient. Toutefois, son attitude, durant la guerre, est surdéterminée par la judéité de son mari, Maurice Goudeket, qui est raflé dès décembre 1941, et qu’elle fait libérer en février 1942. Son fringant troisième époux dira, après la Libération, que Colette activa ses relations les mieux placées, de Dunoyer de Segonzac et Sacha Guitry à Suzanne Abetz, l’épouse française d’Otto, levier plus efficace. SG

(3)Figure très intéressante, et très oubliée, des lettres françaises, André Thérive (1891-1967) avait tous les talents : auteur d’un livre sensible sur Huysmans (1924), romancier prolixe, il remplaça avantageusement Paul Souday – que Suarès qualifiait de Trissouday et donc de Trissotin – à la rubrique littéraire du Temps, entre 1929 et 1942. Son journalisme, qu’il faudra réunir, permettrait de relier les générations quant à l’analyse des mœurs de l’entre-deux-guerres et donc de la vraie littérature. On n’est pas surpris de le voir prendre la défense, le 18 juin 1933, du magnifique (et peu puritain) Drôle de Voyage de Drieu dont il pressent que l’audace réside aussi dans le contournement des voiles et cachoteries du roman chic. Il parle, dans Le Temps donc, d’un « récit stendhalien, plein de dandysme et de sincérité, de convention et d’acuité, de faveur et de violence. » Pour avoir participé au second « voyage » de Weimar et œuvré au sein de la Commission de contrôle du papier d’édition, de même que Brice Parain, Paul Morand, Ramon Fernandez ou Marguerite Duras (ne l’oublions pas), Thérive fut épuré, ce qui mit Chardonne et Michel Déon hors d’eux. Sur la réception de Drôle de voyage, voir Drieu la Rochelle, Drôle de voyage et autres romans, édition établie par Stéphane Guégan, Julien Hervier et Frédéric Saenen, Bouquins, 2023. SG
(4) Voir aussi la contribution de Jacques Dupont (« Colette moraliste ») aux actes du colloque Notre Colette, PUR, 2004, p. 79-91. Ce colloque était placé sous l’autorité de Julia Kristeva qui tient Le Pur et l’impur pour un des livres majeurs de Colette, livre balzacien par sa peinture des excès de la passion amoureuse, livre prémonitoire sur la bisexualité et sur un féminisme qui ne nierait pas le sexe biologique.
La N.R.F. encore et toujours

La lumière et la flamme, soit l’intelligence et le feu… Gabriel Bounoure n’avait besoin que de deux mots pour définir l’admiration de toute sa vie, André Suarès. Comment le génial écrivain, juif marseillais (1868-1948), et son cadet de 18 ans, rejeton d’Issoire, sont-ils parvenus à si bien et si vite se comprendre ? Bounoure, l’une des plumes vibrantes de La N.R.F., mérite amplement les efforts actuels à le remettre en selle. Ce sont les poètes, et pas les plus mauvais du XXe siècle, qui l’eussent confirmé, eux qui, de Claudel à Jouve, ne plaçaient rien au-dessus de ses recensions. Aucun pourtant ne pouvait mieux l’exprimer que Suarès, objet privilégié de la verve analytique de Bounoure, vite devenu son confident, et avec lequel il échangea une correspondance digne du premier rang de nos bibliothèques. « Il n’est pas facile de parler de vous », écrivait Paulhan à Suarès, en avril 1933. Bounoure sut parler de et avec Suarès… Si Paulhan n’ignorait rien de son caractère de cochon, il chérissait surtout le tranchant pascalien de son style et la richesse de pensée, volontiers philosophique, de son interlocuteur, souvent débarqué de La N.R.F. (alors qu’il en avait été un des piliers de départ). Non content de repêcher Suarès, Paulhan lança Bounoure. La Bretagne, en 1913, avait facilité le rapprochement des deux ardents ; cette année-là, professeur à Quimper, Bounoure publie son premier article sur Suarès, le Suarès des beautés et rudesses bretonnes, chez qui paganisme et catholicisme, raison et cœur se voulaient, se faisaient indistincts. Leur commune éthique de la noblesse intérieure et de la vie totale explose, avec leur attachement au drapeau, dès l’année suivante. Jeune officier, alors que Suarès est trop âgé pour être mobilisé, Bounoure va faire une guerre exceptionnelle de courage, d’empathie envers les gamins foudroyés sous ses ordres et son regard (c’est son côté Genevoix), de lucidité envers un certain bellicisme et, à l’inverse, un antipatriotisme ragaillardi par le carnage (c’est son côté Drieu, époque Interrogation). La poésie résumait tout à leurs yeux, et d’abord le pouvoir d’enchantement, de révélation, des mots, à condition d’en distraire l’idéalisme, la rhétorique, qui les corrompaient, surtout en temps de guerre. « Contre la Bête », les chrétiens Baudelaire et Péguy, chers aux deux épistoliers, voire Michelet, leur semblaient plus fréquentables que les séides de Déroulède ou de Nietzsche. L’art déniaisé devait être d’affirmation, non de négation, d’élévation, non de déconstruction. Cela s’appelle aussi « l’accroissement de soi » par l’exercice du courage et de la beauté. Cela revient à soigner le désarroi, l’obscénité des temps modernes en matière de barbarie, par la défense opiniâtre des « vraies valeurs ». Le Suarès de Bounoure personnifie la protestation de l’esprit, comme on le verra à la fin des années 1930, devant l’évidence du retour de la Bête outre-Rhin. De surcroît, la véhémence du Marseillais était servie par la langue la plus dépouillée qui soit, une sorte d’atticisme solaire. La mort ne put mettre fin à cette amitié unique. Bounoure, disparu en 1969, vingt-et-un ans après son mentor, ne l’a jamais trahi quand tant d’autres s’étaient empressés d’oublier le mauvais coucheur. SG /André Suarès – Gabriel Bounoure, Correspondance 1913-1948, Édition d’Edouard Chalamet-Denis, Gallimard, Les cahiers de la N.R.F, 23€.
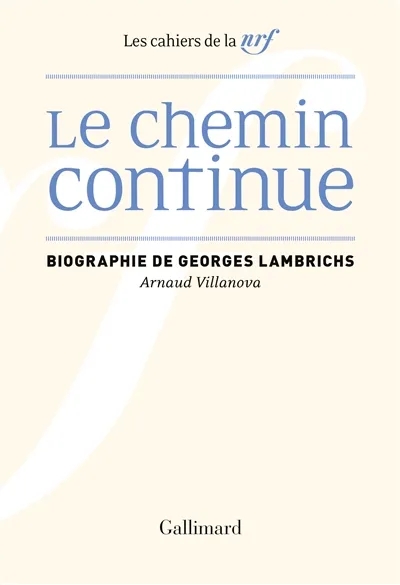
Né en Belgique, peu avant la fin de la guerre de 14-18, mais naturalisé français en 1959 avec l’appui décisif de Paulhan, Georges Lambrichs appartient de plein droit à notre histoire littéraire. Son nom est désormais synonyme du triomphal « nouveau roman », bombe glacée, mais peu alcoolisée, des années 50-60, et d’une revue notoire, Les Cahiers du chemin (1967-1977), qui facilita le transfert de certains des ténors des éditions de Minuit vers Gallimard et La N.R.F.. Lambrichs devait la diriger après la mort de Marcel Arland, lequel avait succédé à Paulhan en 1968. Mais, dès cette date, au fond, le vieux Gaston avait compris qu’il lui fallait du sang neuf, un intellectuel trempé, mais qui sut ménager en douceur le tournant esthétique et la supposée fin de l’humanisme incarné par sa maison. Or, Lambrichs, en plus d’avoir été l’éditeur de Le Clézio ou de Butor, – un des premiers à avoir gagné la blanche -, s’était aguerri du côté de Critique et de Georges Bataille… Il devait remettre les clefs de La N.R.F. à son ami Jacques Réda en 1987. Une vraie tranche d’histoire à entrées multiples, c’est ce que, d’un ton alerte plein de connivence, nous propose Arnaud Villanova, en plus d’annexes, qui font regretter un peu plus l’absence d’index et quelques couacs (Les Illusions perdues pour Illusions perdues, le passage expédié sur La N.R.F. de Drieu et le prétendu retrait de Paulhan). Mais l’essentiel, fort intéressant, notamment quant aux tiraillements entre maisons d’édition, est ailleurs. SG // Arnaud Villanova, Le Chemin continue : biographie de Georges Lambrichs, Gallimard, Les cahiers de la N.R.F, 21,50€.
